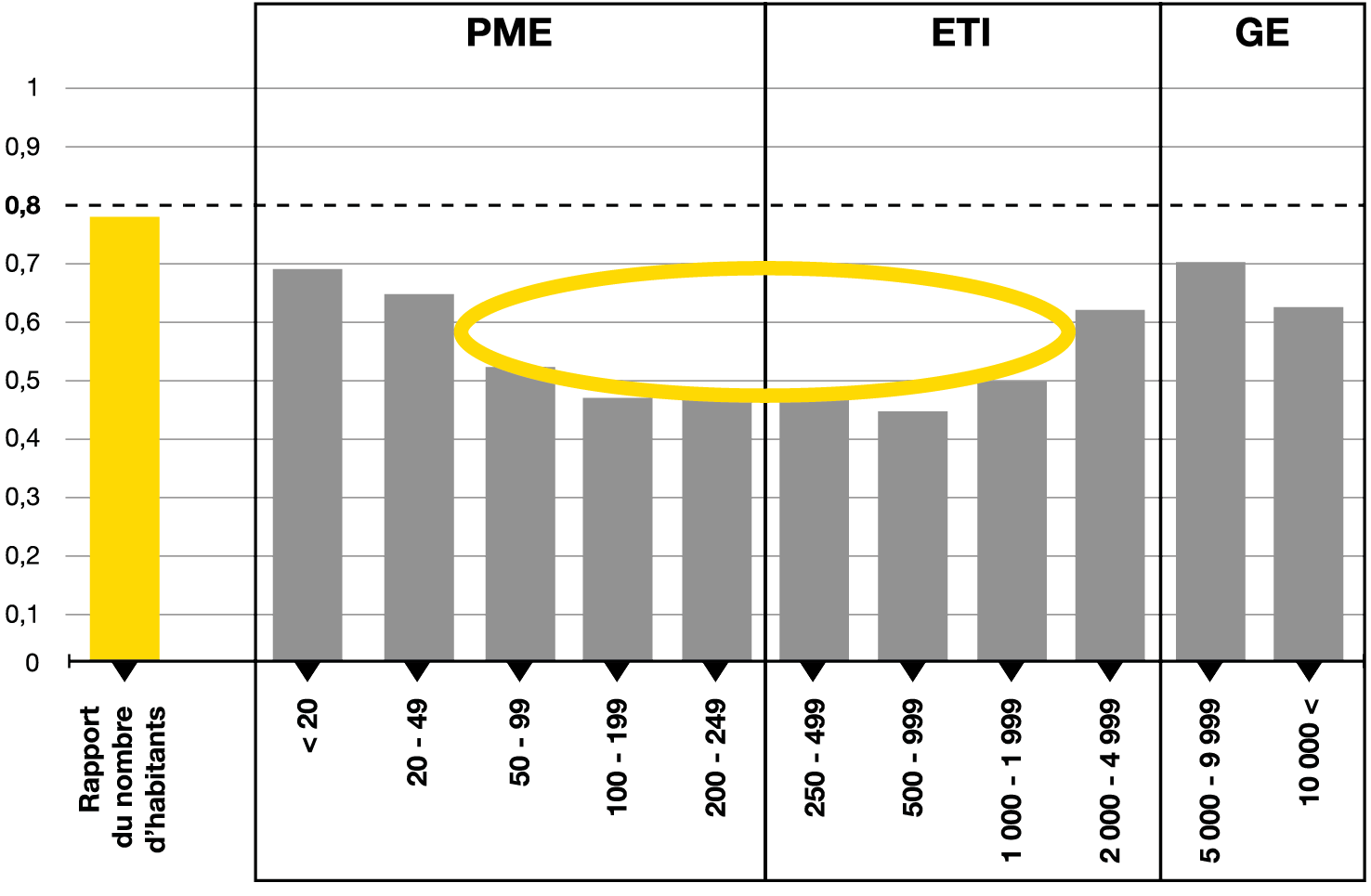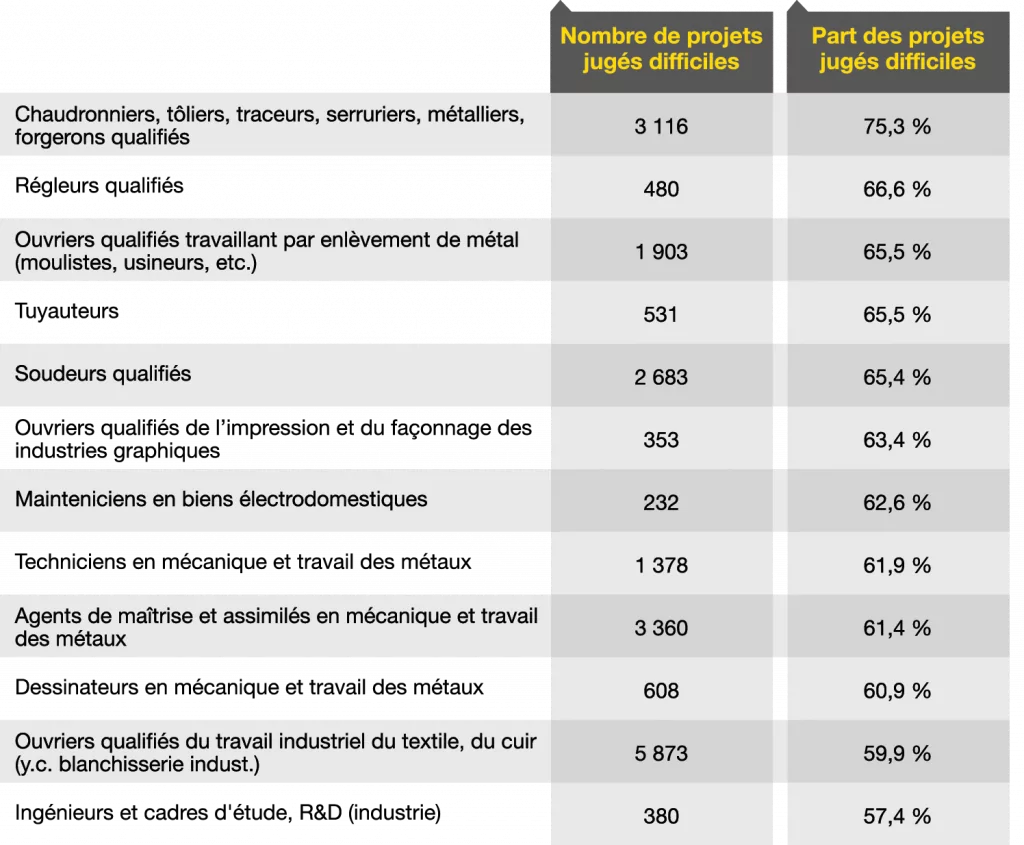Paroles d’ETI : les entreprises de taille intermédiaire à la conquête de la croissance

Kandinsky Vassily (1866-1944), Kleine Welten IV. © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian
Préface
Un constat aujourd’hui s’impose : l’appareil industriel français pourrait exporter et innover davantage s’il comportait un plus grand nombre d’entreprises de taille intermédiaire, ces fameuses ETI. La France compte de beaux grands groupes, véritables locomotives pour notre économie. Notre pays fait aussi preuve d’un grand dynamisme entrepreneurial, comme en atteste la vitalité des créations d’entreprise et le grand nombre de PME. Mais, dans l’ensemble, les PME françaises ont toujours du mal à grandir et à devenir des ETI.
Ce sont pourtant ces entreprises qui font la force du tissu industriel allemand : agiles, innovantes, exportatrices et proches de leurs clients dans le monde entier. Elles ne font pas souvent la « Une » pour de grands contrats, mais sont profondément insérées dans le jeu de la mondialisation. Moins nombreuses en France, les ETI emploient un quart des salariés du privé mais représentent un tiers des exportations, contre près du double pour les grandes entreprises.
Mais comment faciliter la croissance des PME pour qu’elles parviennent au stade d’ETI ? Comment favoriser ensuite leur développement pour régénérer le tissu industriel ? Les témoignages de dirigeants collectés dans cet ouvrage montrent qu’il n’y a pas de recette miracle ou de solution unique, mais que chacun invente, choisit ou adapte au contexte spécifique de son activité des pratiques pour innover, attirer les talents, développer les compétences de ses collaborateurs, partir à la conquête des marché mondiaux, trouver les ressources financières nécessaires à ses ambitions.
Ce livre évoque le rôle du dirigeant, sa capacité à développer une vision de long terme, à s’adapter à de nouvelles situations, à faire face aux échecs, à attirer de bons collaborateurs et à les mobiliser, à promouvoir un dialogue social apaisé. Les chefs d’entreprise insistent aussi sur l’importance des partenariats avec leurs clients, leurs sous-traitants ou les acteurs du territoire pour asseoir leur croissance. Ces coopérations permettent, par exemple, d’avoir une longueur d’avance en matière d’innovation, de maintenir une vision d’ensemble sur une chaîne de valeur ou encore de s’ancrer durablement dans le territoire et de bénéficier de ses multiples réseaux.
Ce « jeu collectif » a été initié très tôt en Allemagne mais fait encore trop souvent défaut en France. Cependant, grâce à une meilleure prise de conscience des enjeux, la situation semble s’y améliorer. Le débat sur les priorités d’une politique industrielle sort enfin d’une opposition stérile entre grands groupes, ETI et PME. L’idée que les écosystèmes prospères reposent sur un tissu d’acteurs complémentaires fait son chemin. Les politiques de filière trouvent dans cette complémentarité leur vraie justification. Les donneurs d’ordre prennent conscience de leur rôle dans le développement des capacités de leurs sous-traitants avec lesquels ils engagent des partenariats plus équilibrés et plus durables, notamment dans des roadmaps technologiques sectorielles et des co-développements de produits futurs. De même, les ETI découvrent la richesse des coopérations possibles avec les établissements publics d’enseignement et de recherche.
En faisant mieux connaître la réalité des ETI, la manière dont leurs dirigeants surmontent les obstacles à leur croissance, ce livre a l’ambition de contribuer à ce mouvement nécessaire au redressement de notre économie et tout particulièrement de notre industrie.
Denis Ranque
Co-Président de la Fabrique de l’industrie
Introduction
Une guerre de religion stérile oppose dans notre pays ceux qui considèrent que la croissance viendra avant tout de la création de nouvelles entreprises et ceux qui préconisent de miser sur les grands groupes qui seuls disposeraient des capacités d’intégration et de distribution sur un marché mondial.
Au centre, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont les grandes oubliées du débat. Longtemps ignorées par les statistiques, noyées entre les PME et les grands groupes, les entreprises de taille intermédiaire ont été reconnues officiellement par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Depuis, elles ont rejoint le champ lexical des politiques, des acteurs économiques, des spécialistes de l’entreprise, mais elles restent peu connues du grand public. Souvent citées en exemple, elles seraient le modèle à suivre pour sortir la France de sa mauvaise passe. Ces entreprises possèdent en effet la taille critique qui leur permet d’innover, de créer des emplois, de mettre en œuvre un dialogue social original, d’exporter et d’être les leaders de demain. Leur faible nombre, notamment par rapport à l’Allemagne, témoigne, pour de nombreux observateurs, des difficultés structurelles de la France à faire croître et développer ses entreprises performantes.
Plusieurs think tanks et instituts1 ont proposé différents remèdes pour pallier le déficit d’ETI en France. La Fabrique de l’industrie a souhaité participer à ce débat, en donnant la parole aux dirigeants d’ETI et de « grosses PMI », à l’occasion de séminaires visant à montrer les ressorts micro-économiques de leur croissance.
Cet ouvrage est le fruit de ce travail. Il rassemble une trentaine de témoignages de dirigeants qui livrent leurs réponses à plusieurs interrogations : comment croître, se développer à l’international, innover, financer sa croissance, attirer et gérer les talents, développer un climat social favorable ? Sur quels atouts spécifiques s’appuyer ? Quels sont les obstacles à surmonter ?
L’observation de cet échantillon est une mine d’informations pour des entreprises en recherche de « bonnes pratiques ». Il permet par ailleurs de sensibiliser les pouvoirs publics à leurs problématiques.
Pourquoi étudier les ETI ?
Les ETI occupent une place centrale dans l’économie française : elles emploient plus de 3,4 millions de salariés (soit près du quart des effectifs salariés du privé en France, 15 millions) et représentent 33 % des exportations. La taille de ces entreprises leur confère des atouts importants dans la compétition mondiale. Plus structurées que les PME, capables de mobiliser des moyens importants au service de leur stratégie de développement, elles ont souvent une réactivité et une flexibilité supérieures à celles des grands groupes.
On les assimile parfois, avec une certaine approximation, aux entreprises du Mittelstand2 qui jouent un rôle très important dans le tissu industriel de notre voisin allemand. Ce sont parfois aussi des « champions cachés »3, leaders mondiaux sur une niche assez précise, qui préfèrent rester incontournables dans leur métier plutôt que de se disperser. Le stade d’ETI peut aussi constituer une étape dans le développement d’une future grande entreprise.
Dans tous les cas, les ETI participent à la solidité et au renouvellement de notre industrie. Or cette population d’entreprises est statistiquement faiblement représentée en France (voir graphique 1).
Graphique 1 – Rapport du nombre d’entreprises entre la France et l’Allemagne par taille d’effectifs
UN DÉFICIT TRÈS NET. Le rapport entre la population française et la population allemande ressort à 0,78 environ. De son côté, le rapport numérique entre les entreprises françaises et allemandes distinguées par classes d’effectif croissant fait apparaître un net décrochage de la France par rapport à l’Allemagne pour les entreprises entre 50 et 2 000 salariés. Sur cet intervalle, le nombre des entreprises françaises ne représente que 58 % de celui des entreprises allemandes. Il y a donc bien, si l’on tient compte du différentiel de population, un « déficit » d’entreprises moyennes en France par rapport à l’Allemagne.
Source : INSEE, Destatis, 2008. Calculs KOHLER Consulting & Coaching.
Comment étudier les ETI ?
Plutôt que de compiler les études existantes, il nous a semblé intéressant d’inviter les dirigeants d’ETI et de PMI de 150 à 250 salariés qui aspirent à devenir des ETI, à partager leur expérience. Avec l’appui de leurs associations (METI4 et FBN France), des organismes publics destinés à les aider (la Caisse des Dépôts, le Fonds stratégique d’investissement, Oséo), réunis désormais au sein de Bpifrance, et du Collège des Bernardins, nous avons organisé entre décembre 2012 et juin 2013, un cycle de séminaires qui leur était dédié.
Ces séminaires ont mis en avant la capacité de ces entreprises à rebondir et à trouver des solutions alternatives pour faire face aux défis qui leur sont imposés. Les six séances, animées par Thibaut de Jaegher, directeur des rédactions de L’Usine nouvelle, ont ainsi porté sur différentes thématiques, autour de plusieurs orateurs intervenant conjointement : internationalisation, innovation, qualité des relations sociales, compétences clés, financement et coopérations interentreprises. Toutes les séances ont fait l’objet de comptes-rendus disponibles depuis 2013 sur le site de La Fabrique de l’industrie (www.la-fabrique.fr).
EN SAVOIR PLUS – Qui sont les ETI ?
Les ETI ont été définies par la Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Auparavant, elles n’avaient d’existence ni juridique ni statistique en tant que catégorie. Les ETI occupent moins de 5 000 personnes et réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 Md€ ; le total de leur bilan est inférieur à 2 milliards d’euros et ce ne sont pas des PME5.
En 2011 (dernières données disponibles), l’Insee recensait 4 794 ETI, dont 1 248 sous contrôle de capitaux étrangers. Les ETI forment un ensemble disparate, allant de la grosse PME à la « petite grande entreprise ».
Bpifrance les caractérise ainsi :
– Des entreprises patrimoniales. Selon la DGCIS, près des 2https://www.la-fabrique.fr/wp-content/uploads/pdf-images/11107/3 des ETI nationales sont patrimoniales. On entend par « patrimonial » que le capital y est détenu de façon significative par une ou plusieurs personnes physiques. 40 % sont familiales, c’est-à-dire qu’il existe en plus un lien de parenté entre les actionnaires. La sur-représentation des entreprises patrimoniales parmi les ETI conduit parfois à confondre abusivement les deux catégories.
– Des entreprises à dominante industrielle. Selon l’Insee, en 2011, 33 % des salariés des ETI travaillaient dans l’industrie manufacturière (contre 19 % pour l’ensemble des entreprises)
– 2/3 des ETI ont moins de 500 salariés et de nombreuses ETI comptent moins de 250 salariés en France (leurs effectifs à l’étranger leur permettent de dépasser ce seuil). Par leur taille, les ETI sont souvent plus proches des PME que des grandes entreprises ; en revanche, leur performance globale (taux d’investissement, taux de marge et de rentabilité d’exploitation, taux d’exportation, taux de R&D) les rapproche des grandes entreprises.
– Parmi les ETI très internationalisées, 6 sur 10 appartiennent au secteur de l’industrie.
D’autres témoignages ont été recueillis lors d’un autre séminaire intitulé « Aventures industrielles ». Ce dernier s’inscrit dans la méthode propre à l’École de Paris du management. Cette institution originale a été fondée en 1993 par Michel Berry. Chercheurs et praticiens y dialoguent à partir de l’intervention d’un orateur, selon des modalités assurant l’ouverture des débats et la qualité orale et écrite des travaux. Parmi les nombreux séminaires thématiques proposés par l’École de Paris, le séminaire « Aventures industrielles », créé en 2013 et soutenu par l’UIMM ainsi que par La Fabrique de l’industrie, met en exergue les réussites de PME et d’entreprises de taille intermédiaire, afin d’explorer les ressorts des succès qu’on observe dans tous les secteurs, même ceux en déclin. Chaque séminaire fait également l’objet d’un compte rendu disponible sur le site www.ecole.org6.
Précisions méthodologiques et apports
L’échantillon est principalement constitué par des ETI au sens de la loi française (voir encadré ci-dessus), appartenant au secteur industriel. La majorité de ces ETI sont patrimoniales, mais toutes ne le sont pas. Nous y avons adjoint quelques PMI qui aspirent à devenir des ETI ou sont proches du seuil. Quelques-unes seulement de ces entreprises présentent les caractéristiques des « champions cachés » (voir la liste des entreprises auditionnées et le passeport des entreprises en annexe).
Par ailleurs, les analyses se focalisent sur les ressorts micro-économiques du succès. En cela, elles se distinguent des approches quantitatives ou macro-économiques. Nous avons choisi de proposer un découpage thématique autour des moteurs et freins à la croissance. Le choix des thématiques relève de notre seule responsabilité.
Précisons également que les dirigeants d’entreprises sont intervenus sur un thème particulier. Dans le cadre de La Fabrique de l’industrie, il leur a été assigné un sujet constituant le cadre de leur intervention. On ne peut donc guère leur reprocher de ne pas avoir abordé des questions qui ne leur ont pas été posées. À l’École de Paris, l’exercice est plus ouvert mais il n’en reste pas moins que le nom même du séminaire « Aventures industrielles » et le contexte de l’intervention conduisent à privilégier un story telling de nature positive. Même si les questions des participants les poussent parfois dans leurs retranchements ou les amènent à entrer dans les détails, les dirigeants restent maîtres de la façon dont ils exposent l’histoire de leur entreprise. C’est pourquoi, nous proposons occasionnellement des encadrés afin d’apporter des éclairages complémentaires à certaines affirmations, en vue de les contextualiser.
Enfin, l’observation de cet échantillon met en exergue une grande variété de solutions aux problèmes rencontrés, adaptées au contexte de l’activité, à l’histoire de l’entreprise et à la personnalité des dirigeants. Ce qui est bon pour telle entreprise et dans telles circonstances peut se révéler contre-productif dans d’autres configurations. Rien de plus dangereux, dans ce domaine, que des approches trop normatives. En revanche, il peut exister des sources d’inspiration et de comparaison. C’est pourquoi, nous avons souligné dans notre synthèse la diversité des situations et des approches autant que les convergences apparentes. Si certaines généralisations sont possibles, elles doivent rester équilibrées par le rappel de la singularité de chaque firme.
Liste des entreprises auditionnées
Affival – Claude Lenoir
Aventics SAS – Étienne Piot
Bernard Controls – Étienne Bernard
Clextral – Georges Jobard
Daher – Didier Kayat
Darégal – Luc Darbonne
ERMO – Jean-Yves Pichereau
Eurotab – Olivier Desmarescaux
GYS – Bruno Bouygues
Groupe Hervé – Emmanuel Hervé
HRA Pharma – André Ulmann
IGE+XAO – Alain Di Crescenzo
Mecachrome – Philippe Blandin
Multiplast – Dominique Dubois
Moret Industries – Jérôme Duprez
Poclain Hydraulics – Laurent Bataille
Poujoulat – Frédéric Coirier
Rossignol Technology – Bertrand de Taisne
Sacred – Didier Fégly
Sisley – Philippe d’Ornano
SMSM – Éva Escandon
SNF – Pascal Rémy
Somfy – Jean-Philippe Demaël
Thuasne – Élisabeth Ducottet Et Christel Bories, Directeur général délégué d’Ipsen.
Stéphan Guinchard, co-auteur des Champions cachés du XXIe siècle, associé chez Ixens, conseil en développement d’entreprises.
Paul Rivier, ex-PDG de Tefal et Calor (groupe Seb).
- 1 – Voir bibliographie, p. 173.
- 2 – Qui sont souvent, mais pas toujours, des ETI, Voir aussi Kohler D. et Weisz J-D., Pour un nouveau regard sur le Mittelstand, La Documentation française, 2012.
- 3 – Selon la définition forgée par le consultant allemand Hermann Simon. Hermann Simon, Hidden Champions, Harvard Business School Press, 1996. Traduction en langue française : Les Champions cachés de la performance, Dunod, 1998. On discutera abondamment de cette catégorie d’entreprises au chapitre 1.
- 4 – METI, mouvement des entreprises de taille intermédiaire est, depuis le 11 mai 2015, le nouveau nom d’ASMEP-ETI.
- 5 – Une PME occupe moins de 250 personnes et réalise un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou un total de bilan n’excédant pas 43 M€.
- 6 – Nous avons utilisé dans le présent ouvrage les comptes-rendus de ce séminaire parus jusqu’au 31 décembre 2014.
Le choix de la croissance
À RETENIR
Le choix de la croissance est souvent lié à l’ambition des dirigeants d’ETI pour leur organisation.
La stratégie se construit « en marchant ».
Les ETI, du fait de leur taille initiale, se développent fréquemment à partir d’une stratégie de niche qu’elles déploient à l’échelle mondiale.
Si la niche devient trop étroite ou si les conditions de marché se modifient, elles recourent à différentes formes de diversification par connexité de clientèles ou de technologies. L’intégration verticale peut également représenter une forme de diversification qui permet un meilleur contrôle de la chaîne de valeur et réduit leur vulnérabilité.
Par souci d’indépendance, de contrôle de la qualité et de proximité avec leurs clients, les ETI sont parfois réticentes à externaliser.
La croissance externe est un facteur d’accélération de développement en matière d’internationalisation ou d’innovation.
Les rachats d’entreprise résultent souvent d’opportunités successives qui contribuent à construire le « grand dessein » de l’entreprise.
Comme le dit avec humour le consultant en management du changement Olivier Bas : « Toutes les stratégies se ressemblent et peuvent se résumer ainsi : “Réaliser une croissance rentable sur des marchés mondialisés et pour cela, créer de la valeur par l’innovation et la qualité des produits et des services, sources de satisfaction des clients”. »7 La plupart des ETI sont des PME qui ont fait le choix de la croissance.
Ce choix n’a rien d’évident. Beaucoup de PME prospères choisissent de limiter leurs ambitions, parfois parce que leur dirigeant sent qu’il n’a pas les compétences requises pour changer d’échelle ou rechigne à partager le pouvoir, parfois parce qu’il ne trouve pas les moyens financiers d’une croissance rapide dans des conditions satisfaisantes, parfois par peur des tracas qui pèsent sur les entreprises d’une certaine taille8. Cette attitude restrictive a été nommée « le syndrome de Peter Pan »9.
Un moteur : l’ambition du dirigeant
En rupture avec ce comportement, « l’un des points communs entre les champions cachés français et allemands est la très forte ambition de leurs dirigeants », confirme Stéphan Guinchard, co-auteur avec Hermann Simon d’un ouvrage récent sur « les champions cachés »10. Cette ambition se traduit par des objectifs élevés dans tous les domaines, et particulièrement en termes de croissance. Loin de décourager les salariés, ce genre d’objectif a souvent pour effet de les galvaniser. Car l’ambition du dirigeant n’est souvent pas que personnelle ; elle est aussi, et peut-être avant tout, collective. Elle est associée à une création de valeur pour l’entreprise, la communauté, et souvent le pays tout entier.
Pourtant, c’est justement cette ambition qui peut contribuer à l’image ambiguë des patrons d’ETI. Celle-ci est meilleure que celle des dirigeants de grands groupes mais moins bonne que celle des dirigeants de TPE/PME11. Selon Stéphan Guinchard, ceci est d’autant plus paradoxal que ce sont souvent ces entreprises qui créent le plus de valeur. Un patron de PME peut avoir un côté « sympathique » et susciter le respect, mais le patron d’une ETI qui réalise 300, 700 millions ou 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, aura une image plus mitigée, similaire à celle des patrons du CAC40.
Emmanuel Hervé, président du Groupe Hervé, nuance cette analyse. Il déclare : « Je suis convaincu que la réussite est reconnue en France. Il existe simplement une vingtaine de cas surmédiatisés qui donnent une image déplorable et caricaturale du “patron” qui, par exemple, délocalise l’outil de travail le week-end dans un autre pays. On dénonce souvent le corporatisme de certains acteurs économiques, mais on peut aussi regretter le corporatisme du patronat, qui l’empêche de mettre en cause sans réserve ce genre de comportement totalement marginal. Les salariés des ETI ont une bonne image de leurs managers qu’ils connaissent et reconnaissent. Cette démarche d’adhésion est indispensable à la croissance des ETI car elle permet d’impliquer et de faire participer les équipes au développement de leur entreprise. »
Pour les patrons des entreprises à forte croissance, l’ambition est donc une vertu cardinale.
Faire le choix de la croissance mobilise des ressources importantes. Celle-ci ne peut s’opérer dans toutes les directions à la fois et suppose des options stratégiques préalables ou implicites. Derek Abell, doyen d’Harvard dans les années 1960 et auteur pionnier en stratégie, distingue trois dimensions pour décrire l’activité d’une entreprise : la clientèle visée (qui ?) ; ce qu’elle propose, la fonctionnalité apportée (quoi ?) ; la technologie ou les modalités d’offre de produit ou de service (comment ?). La mondialisation nécessite d’ajouter aux trois dimensions d’Abell, une quatrième, géographique : le territoire sur lequel l’entreprise veut être présente (où ?)12.
Les ETI ne dérogent pas aux principes d’Abell mais leur cheminement stratégique présente fréquemment une singularité : il se fait à partir de l’occupation d’une niche avec un nombre limité de concurrents et de fortes barrières à l’entrée13. Stéphan Guinchard affirme : « Le point commun à de nombreux champions cachés est le choix stratégique de se concentrer sur un marché “étroit”, un marché de niche. La société allemande Flexi est leader mondial des laisses pour chiens. Son patron déclarait en 2009 : “Nous ne faisons qu’une seule chose, mais nous la faisons mieux que tous les autres. »
Dans De la performance à l’excellence14, Jim Collins compare les sociétés hérisson et les sociétés renard. Les sociétés renard s’épuisent et se dispersent, tel le renard qui se pique le museau en cherchant à dévorer le hérisson et qui finit par renoncer. Le hérisson, lui, se met en boule et attend. « Les sociétés qui réussissent sont presque toujours des sociétés hérisson. Ce qu’elles font, elles le font mieux que les autres », renchérit Bertrand de Taisne qui a repris la société Rossignol Technology.
Cependant, il serait erroné de généraliser à outrance. Toutes les ETI ne sont pas des champions cachés, ni tous leurs dirigeants des conquérants de l’impossible, et leurs choix stratégiques de développement sont plus variés qu’on ne le croit souvent.
Les niches ou la spécialisation
Croître par spécialisation est la stratégie adoptée par la majorité des ETI de notre échantillon, car elles ne disposent pas, à l’origine, d’une taille et de moyens suffisants pour se diversifier. Être sur une niche présente l’intérêt de s’assurer d’une rentabilité potentiellement élevée du fait du faible nombre de concurrents. Le choix de se concentrer sur un segment très précis est, par ailleurs, compensé par le fait de s’adresser d’emblée au marché mondial. Dès le début des années 1990, le groupe Moret Industries s’est installé à Singapour et en Chine. Pour une PME de quelques dizaines ou centaines de salariés, cela n’a rien d’évident de « se projeter » pour aller créer des filiales à l’étranger. Selon Stéphan Guinchard, cette démarche repose sur une hypothèse fondamentale : « Au sein d’une même industrie, les clients ont les mêmes besoins, quel que soit leur pays d’origine, et il vaut mieux servir tous les plombiers de divers pays plutôt qu’essayer de servir tous les artisans de son pays d’origine (…). Cette stratégie permet à ces entreprises de s’affranchir de la concurrence en devenant les leaders de leur marché, ce qui les protège grâce à d’importantes barrières à l’entrée et leur confère aussi une marge de manœuvre pour faire évoluer ce marché grâce à l’innovation. »
Darégal est l’exemple type d’une stratégie de niche réussie avec de fortes barrières à l’entrée qui réduisent le nombre de concurrents. Cette ETI possède 70 % du marché mondial des herbes aromatiques surgelées, séchées, déshydratées, lyophilisées, en pâte, en huile ou en arôme. L’entreprise sert trois grands marchés : l’industrie (70 %) avec des clients comme Unilever, Nestlé, McCormick, Bongrain ou Bel ; la restauration (18 %) avec McDonald’s ou encore Subway ; la grande distribution (12 %) avec Picard ou Carrefour. « En quarante ans, j’ai vu passer beaucoup de concurrents, raconte Luc Darbonne, le fondateur. J’ai remarqué que tous ceux qui produisaient à la fois des herbes aromatiques et des légumes finissaient par faire faillite. C’est ce qui m’a conduit à me spécialiser dans les herbes aromatiques et, plus précisément, dans les produits feuillus. »
Le métier de Poclain Hydraulics est la transmission hydrostatique de puissance, qui consiste à remplacer tout ce qui se trouve entre un moteur thermique et des roues par des systèmes hydrauliques. « Nous disposons d’une technologie unique sur un marché de niche en forte croissance : notre chiffre d’affaires a progressé en moyenne de 10 % par an depuis vingt-cinq ans. Notre argument principal est la différenciation par la technologie. Nous avons fait le choix de la stratégie Océan bleu15, c’est-à-dire d’une niche où nous avons très peu de concurrents », explique Laurent Bataille, son PDG. Mais le segment de marché est loin d’être étroit : « Le marché potentiel est colossal : il comprend par exemple les machines agricoles et forestières, les pelles hydrauliques, les camions et véhicules routiers ou utilitaires. »
Typique aussi d’une stratégie Océan bleu, l’aventure de Royal Canin. En 1997, quand cette entreprise décide de passer de l’alimentation pour animaux de compagnie à la nutrition-santé animale, en distribuant uniquement via les prescripteurs que sont les vétérinaires, les éleveurs et les animaleries, elle déplace les frontières de son activité, définit un nouveau territoire stratégique et peut, dès lors, se permettre d’offrir les produits les plus chers du marché. La spécialisation sur une niche présente toutefois quelques inconvénients. Elle rend les entreprises plus vulnérables lorsque leur marché est menacé par l’arrivée d’un nouveau concurrent ou d’un nouveau produit, l’apparition de nouvelles technologies, l’évolution de la réglementation ou encore le changement du comportement des consommateurs.
C’est ce positionnement sur des segments de marché très ciblés qui fait des ETI, des « belles inconnues » du grand public ou encore des « champions cachés ». On peut, en effet, relever la singularité des marchés sur lesquels les ETI de notre échantillon sont positionnées : les tiges de freins (Rossignol Technology), les bouchons de bouteilles (ERMO), l’extrusion bi-vis (Clextral), le fil fourré (Affival), etc.
La diversification : sortir de sa niche
Si la niche initiale devient trop étroite, l’entreprise se développera alors par connexité : soit en visant des clientèles connexes, soit en apportant de nouvelles fonctionnalités à la même clientèle. Ainsi Tefal a su, à partir d’une innovation (un procédé de fixation d’une couche anti-adhésive de Teflon sur du métal), développer d’abord des poêles à frire, se diversifier vers d’autres produits impliquant des couches anti-adhésives (appareil à raclette, pierrade), puis développer des technologies complémentaires pour répondre à d’autres besoins de ses clients : bouilloire électrique, pèse-personne électronique, chauffe-biberon, etc.
C’est aussi le cas, par exemple, de la société Clextral dans le domaine des machines pour l’extrusion bi-vis. « Notre marché se compose d’une juxtaposition d’une vingtaine de niches applicatives, chacune avec des clients et des concurrents différents, analyse Georges Jobard, le PDG. Les marchés sont souvent de très petite taille, avec un nombre de compétiteurs réduit (de un à trois), sauf pour la plasturgie, domaine dans lequel nous sommes confrontés à une trentaine de concurrents. Nous détenons 30 % du marché mondial pour la cuisson-extrusion dans l’industrie agroalimentaire, 70 % du marché des lignes de production de semoule de couscous, 70 % du marché de la fabrication de pâte à papier fiduciaire. » Il existe ainsi une proximité entre le métier de base − dans le cas de Clextral, l’extrusion pour la plasturgie − et les nouvelles activités vers lesquelles l’entreprise se tourne − l’extrusion pour l’agro-alimentaire et la pâte à papier fiduciaire, l’expérience dans l’agro-alimentaire ayant conduit à la production d’équipements pour la fabrication de la semoule. « Le fait de travailler pour plusieurs types d’industries est un atout pour nous. Il nous est arrivé d’utiliser une compétence développée dans le plastique pour une application dans l’agroalimentaire. Nous sommes les seuls à avoir développé une expertise aussi transversale. »
Certaines ETI font le choix de sortir de leur domaine d’activité d’origine et d’élargir leur portefeuille d’activités. Cette décision peut être prise parce que l’entreprise a atteint une certaine rentabilité ; elle souhaite alors exploiter son surplus de ressources. Mais plus souvent, c’est parce que son métier d’origine n’offre plus (ou moins) de perspectives de développement. Stéphan Guinchard cite le cas de la société Favi16, anciennement dirigée par Jean-François Zobrist, activité de fonderie sous pression d’alliages cuivreux, et leader dans la fabrication de fourches de boîtes de vitesses manuelles. « Constatant la tendance de long terme favorable aux boîtes automatiques, il a su élargir son business vers d’autres opportunités. Ainsi, en s’appuyant sur les propriétés antibactériennes du cuivre, il a identifié un nouveau marché, la fabrication de poignées de portes pour les hôpitaux. »
Jean-Yves Pichereau, fondateur du groupe ERMO, fabricant de moules, a, lui aussi, su changer radicalement de voie. Lorsqu’il a constaté, dans les années 2000, que la fabrication de la téléphonie et de l’électroménager s’était déplacée en Asie, il s’est lancé avec succès dans la fabrication de moules à haute cadence pour les bouchons de bouteilles.
L’entreprise familiale Daher n’a, quant à elle, cessé de réinventer son métier. Elle est ainsi passée du métier d’armateur à celui de logisticien, puis à celui de prestataire de services industriels, et finalement à une fonction d’équipementier intégrateur de solutions industrie et services. Daher a pu mesurer les risques de n’être qu’un prestataire de services, lorsqu’elle a été mise en difficulté par des retours de cycles dans certains secteurs d’activité. En développant sa propre activité industrielle tout en poursuivant ses prestations de service, elle s’est libérée d’une dépendance et a réduit sa vulnérabilité. « L’équilibre entre industrie et services dans notre chiffre d’affaires est atteint depuis huit ans déjà », souligne Didier Kayat, le DG.
Enfin, une autre forme de diversification est l’intégration verticale qui nécessite de développer (ou d’assimiler) des compétences différentes. Il ne s’agit pas de tout faire bien entendu, mais de capter le maximum de valeur sur une chaîne (voir ci-après l’encadré Moret Industries).
EN SAVOIR PLUS – La clairvoyance de Moret Industries
Jérôme Duprez a combiné fusion, rachat d’entreprise et croissance organique pour développer son activité première, les pompes pour la sucrerie, avant de procéder à d’autres rachats afin d’assurer une intégration verticale : « La pression de la concurrence se faisant de plus en plus forte, avec des sociétés de dix à cinquante fois plus grosses que la nôtre, nous avons décidé en 2000 de fusionner à 50/50 avec une société belge, Ensival, qui possédait une compétence technique reconnue. De notre côté, nous bénéficiions d’une puissance commerciale plus importante que la sienne. Malheureusement, nous avons rencontré quelques déboires avec les propriétaires de cette entreprise, qui n’avaient pas vraiment de vision industrielle. Ceci nous a conduits, en 2004, à racheter l’ensemble de l’entreprise. Le chiffre d’affaires de l’activité pompes est passé de 20 millions d’euros en 1999 à 58 millions d’euros en 2000, au moment de la fusion, puis à 90 millions en 2006. Nous avons alors lancé un plan de croissance organique qui nous a permis d’atteindre un chiffre d’affaires de 170 millions d’euros en 2012. En 1986, nous avons racheté la société Maguin, qui fabrique divers équipements pour la sucrerie. Enfin, nous avons récemment acquis une activité d’ingénierie, De Smet Engineers & Contractors ». Aujourd’hui, l’entreprise associe trois métiers (pompes, équipements et ingénierie), ce qui présente un double avantage : « D’une part, nous sommes désormais capables de proposer des usines clé en main en sucrerie, distillerie et amidonnerie, en fournissant à la fois les procédés, le système, les équipements et les pièces détachées. D’autre part, le fait de maîtriser toute la chaîne nous permet de recevoir des commandes décalées dans le temps, ce qui contribue à pérenniser l’entreprise. Par exemple, si l’activité ingénierie signe un contrat aujourd’hui, l’activité pompes recevra le bon de commande correspondant dans deux ans. En 2011-2012, la branche équipements a été en difficulté et c’est l’activité pompes qui a permis de sécuriser les rentrées du groupe. »
L’externalisation
Les ETI recourent assez peu à l’externalisation. Cela peut s’expliquer par leur souci d’indépendance marquée, par la volonté d’apporter et de capter en permanence le plus de valeur possible, et de contrôler l’ensemble de la chaîne pour assurer un haut niveau de qualité. Cependant, certaines y ont tout de même recours.
Darégal possédait initialement ses propres terres pour cultiver les herbes aromatiques, ce qui était assez compliqué à gérer. Luc Darbonne a décidé d’externaliser les cultures, en les confiant à des fermiers. Les agriculteurs s’occupent de la plantation, de l’apport d’engrais, du désherbage et de l’irrigation ; Darégal se charge de la récolte et de la transformation. Mais en fournissant à ceux-ci les plants, les graines et même des semoirs spécialement conçus pour les herbes aromatiques, et en conservant la propriété des végétaux, Darégal garde un fort contrôle sur cet approvisionnement stratégique.
HRA Pharma, pour sa part, est bâtie sur un modèle d’externalisation. « Notre modèle organisationnel repose sur l’externalisation d’un certain nombre de tâches. Nous nous réservons les activités que nous considérons comme notre savoir-faire de base : la stratégie de R&D ; les aspects réglementaires spécifiques à l’industrie pharmaceutique (constitution des dossiers d’enregistrement, transmission aux agences du médicament, obtention des autorisations de mise sur le marché) ; le business développement, c’est-à-dire la capacité à trouver des partenaires pour distribuer nos produits. Les autres activités sont sous-traitées. Pour la recherche de base, nous travaillons notamment avec l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et le NIH (National Institutes of Health) qui nous aident à identifier des projets susceptibles de faire l’objet d’un développement. En ce qui concerne le développement pharmaceutique, nous sommes donneurs d’ordres pour des sociétés qui se chargent de développer des formulations galéniques. »
Mais HRA Pharma met aussi le doigt sur les limites et difficultés de l’externalisation : « La fabrication est également totalement sous-traitée, ce qui nous a valu quelques déconvenues. Nous étions dépendants de fabricants qui n’étaient pas forcément les plus performants en termes de qualité et qui nous ont parfois maltraités en raison de notre petite taille. Nous avons rapidement compris qu’il était indispensable de nous professionnaliser et nous avons recruté un ancien directeur d’usine pour contrôler de près la fabrication. De plus, nous avons rapatrié une partie de la production en Europe. Dans les débuts, nous fabriquions essentiellement en Asie du Sud-Est, mais les problèmes de qualité étaient difficiles à gérer et en définitive, les économies réalisées n’étaient pas significatives. Actuellement, nous fabriquons en France, en Espagne et en Italie, dans des usines qui ont appartenu à d’anciens grands groupes pharmaceutiques et ont une véritable culture de la qualité. Seule la matière première de l’un de nos produits est fabriquée à Taïwan. »
Des modes de développement diversifiés : croissance interne, externe, alliances
Croître de façon organique prend plus de temps que d’acheter des actifs existants. Cette lenteur peut se révéler problématique dans des secteurs en croissance où il est important d’acquérir rapidement des positions fortes. Aussi certaines ETI acceptent-elles le risque de la croissance externe. Les raisons de leur appétence pour cette stratégie sont variées : acquérir de nouvelles compétences ou des technologies qu’il serait long et difficile de développer en interne, accéder à de nouveaux marchés, s’internationaliser rapidement ou se diversifier.
Mais la croissance externe peut poser des problèmes d’intégration des entreprises rachetées et engendrer des déconvenues coûteuses. L’arbitrage entre croissance externe et interne reste donc toujours posé. Pascal Rémy, PDG de SNF, déclare, par exemple : « sur un marché qui connaît un tel développement (les polymères hydrosolubles), la croissance interne est de loin ce qu’il y a de plus efficace et profitable. La croissance externe sert souvent à compenser une croissance interne insuffisante, et nous n’y avons jamais eu recours. » Alain di Crescenzo de IGE+XAO (logiciels de conception assistée par ordinateur – CAO pour les systèmes électriques) nuance : « Nous avons créé nous-mêmes toutes nos filiales étrangères, à l’exception de deux sociétés que nous avons achetées au Danemark et aux Pays-Bas. La croissance externe est plus rapide que l’organique, mais elle peut s’avérer un miroir aux alouettes et provoquer un certain endormissement. Le mieux est d’associer croissance interne et externe. »
La plupart des ETI recourent donc à des rachats d’entreprise, à des fusions ou à des alliances. Ce qui les caractérise est de fonctionner par opportunité, au gré des relations qu’elles développent et des partenariats réussis qu’elles décident d’approfondir. C’est grâce au rachat d’une société lyonnaise « qui était leader mondial dans son domaine, mais avait du mal à survivre seule » que Clextral s’est lancé hors de l’extrusion bi-vis, dans la construction d’équipements industriels pour la fabrication de la semoule pour couscous, dont elle détient aujourd’hui 70 % du marché mondial.
C’est également grâce à la croissance externe qu’ERMO s’est développé. « Nous avons réalisé deux opérations de croissance externe, d’abord en 1987 avec le rachat d’une entreprise en difficulté à Alençon, puis, en 2004, avec l’acquisition de Moulindustrie, une société située à Vire. Cette entreprise est à l’origine de la technologie des moules bi-matières, qui permettent de produire des bouchons de deux couleurs, par exemple pour des flacons de shampoing. Le rachat a été une réussite à la fois pour le propriétaire, pour nous et pour nos clients. L’entreprise n’avait que deux clients, tous deux français, était débordée de travail et n’avait pas de capacité d’investissement. Nous avions du capital et nous disposions d’un service commercial très dynamique : nous avons pu vendre le savoir-faire de cette société un peu partout dans le monde », raconte Jean-Yves Pichereau, son fondateur.
Il ne faut cependant pas sous-estimer les difficultés d’intégration des acquisitions ou de fonctionnement des alliances : elles mettent en contact des activités différentes ayant chacune leurs contraintes de fonctionnement et de développement ; les synergies peuvent être moindres qu’espérées, alors que les différences organisationnelles ou culturelles s’avéreront plus profondes que cela n’avait été imaginé.
***
Quels que soient le cadre stratégique envisagé et la préférence pour tel ou tel mode de développement, les ressorts principaux de la croissance des ETI sont l’internationalisation et l’innovation que nous examinerons aux chapitres suivants.
- 7 – Bas O., L’envie, une stratégie, Dunod, 2015.
- 8 – Les entreprises de taille intermédiaire ne bénéficient pas des seuils d’exemption et des mesures de simplifications dont jouissent les PME.
- 9 – Voir Bertrand B., Bodenez P., Hans E., « Le patron de PME ou le syndrome de Peter Pan », La Gazette de la société et des techniques, n°55, janvier 2010.
- 10 – Simon H., Guinchard S., Les champions cachés du XXIe siècle. Stratégies à succès, Économica, 2012. Préface d’Yvon Gattaz. L’ouvrage est lauréat du prix Zerilli-Marimo 2013, prix d’économie de l’Académie des sciences morales et politiques, ainsi que du Prix de la Fondation ManpowerGroup pour l’emploi-Élèves HEC.
- 11 – Voir Muzet D., « Les mots de la compétitivité », Institut Médiascopie, in Sociétal 2014, Institut de l’entreprise/Eyrolles, 2014. « Sur le podium, de la première marche à la plus haute, on trouve ainsi successivement les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, les TPE et les PME. »
- 12 – Voir Weil T., Stratégie d’entreprises, Presses des Mines, 2008.
- 13 – Reste à savoir comment on identifie, construit et protège une niche. Sur ce point, les témoignages recueillis ont manqué d’approfondissement. Selon le cabinet spécialisé dans les marchés de niche BM&S, « une niche ne se cherche pas, elle se trouve ».
- 14 – Pearson-Village mondial, 2009. Traduction française de Good to Great, Random House Business, 2001.
- 15 – Chan Kim W., Mauborgne R., Stratégie Océan bleu. Comment créer de nouveaux espaces stratégiques, Pearson-Village mondial, 2008.
- 16 – Op. cit.
Le grand bond en avant : s’internationaliser
À RETENIR
Les ETI sont massivement ouvertes à l’international qu’elles considèrent comme un relais de croissance privilégié pour faire face à la concurrence et à la saturation du marché intérieur.
Leur déploiement à l’international ne se limite pas à l’exportation. Il passe souvent par l’implantation, le rachat ou la création de filiales à l’étranger.
Le succès de la démarche d’internationalisation repose sur la capacité de ces entreprises à adopter des stratégies différenciées en fonction des marchés et de leurs spécificités culturelles.
Le déploiement à l’international ne s’improvise pas. Cette décision est le fruit d’une analyse mûrement réfléchie. Elle s’inscrit dans une démarche de long terme.
Malgré quelques exceptions, les dirigeants d’ETI interrogés ne jugent pas que le dispositif public d’appui à l’internationalisation soit bien adapté à leurs spécificités.
Les ETI sont profondément insérées dans le jeu de la mondialisation et la conçoivent comme un vecteur majeur de leur développement stratégique. Selon la direction générale du Trésor, près des trois quarts d’entre elles sont exportatrices et réalisent un tiers de leur chiffre d’affaires à l’export. Un tiers des ETI détient au moins une filiale à l’étranger.
Plusieurs raisons les conduisent à s’internationaliser. La plus évidente est la saturation progressive du marché domestique. Comme le rappelle Christel Bories, ex-vice-présidente de La Fabrique de l’industrie et aujourd’hui directeur général délégué du laboratoire Ipsen, ces entreprises se caractérisent par « la prise de conscience que le marché pertinent ne peut être le marché français. Dans beaucoup de métiers industriels, il apparaît clairement qu’on ne peut pas survivre en se contentant du marché intérieur. »
L’internationalisation permet également de répartir les risques de marché sur plusieurs zones géographiques, afin de les équilibrer. Subsidiairement, des implantations industrielles à l’international permettent de produire à des coûts inférieurs, soit pour assurer des économies d’échelle sur de grandes séries, soit pour pénétrer le marché local et assurer les nécessaires adaptations des produits, soit encore pour accompagner les grands donneurs d’ordre.
Les mobiles autant que les modalités de l’internationalisation peuvent différer sensiblement selon les zones géographiques, les secteurs d’activité ou les créneaux de marché à prendre.
Comment les ETI parviennent-elles à se développer à l’étranger ? Quelles sont leurs principales motivations ? Sur quels types de ressources et de compétences internes et externes peuvent-elles s’appuyer ? Quel regard portent-elles sur les dispositifs d’accompagnement publics à l’étranger ?
EN SAVOIR PLUS – ETI et internationalisation
Présence à l’exportation
Les ETI représentent 1 % du nombre total d’exportateurs (365 000) mais réalisent un tiers du chiffre d’affaires total des exportations françaises (200 Md€ sur 607 Md€). Les ETI exportent 33 % de leur CA, ce qui les positionne entre les grandes entreprises (52 % du CA à l’export, soit 313 Md€) et les PME (16 %, soit 94 Md€).
Implantation à l’étranger
Un tiers des ETI françaises détient une filiale à l’étranger. Les ETI françaises détiennent 11 867 filiales à l’étranger contre 19 852 pour les grandes entreprises et 3 715 pour les PME. Ces filiales réalisent un chiffre d’affaires consolidé de 169 Md€ contre 991 Md€ pour les grands groupes et 12 Md€ pour les PME. Elles emploient près de 800 000 personnes (4,1 millions pour les grands groupes et 100 000 pour les PME).
Contrôle par des groupes étrangers
Le quart des ETI françaises (soit 1 283 entreprises) est contrôlé par un groupe étranger contre 32 % pour les grandes entreprises et 0,2 % des PME. Ces ETI sous contrôle étranger emploient 966 000 personnes (29 % de l’effectif total des ETI et 6,5 % de l’effectif salarié total en France).
Source : DG Trésor – Pôle commerce extérieur, « L’internationalisation des Pme et ETI françaises : principaux chiffres », décembre 2014
L’internationalisation des ETI en quelques exemples
Chez Clextral, qui fabrique des équipements pour l’extrusion bi-vis, la part du chiffre d’affaires réalisée à l’export est passée de moins de 50 % en 1990 à 84 % en 2010. En 2012, la part de l’export hors zone euro atteignait 73 %. L’entreprise, basée à Firminy en Rhône-Alpes, réalise des ventes dans 88 pays avec 10 bureaux et filiales implantés sur les cinq continents. Sur 280 salariés, 60 travaillent dans ces bureaux à l’étranger et permettent, notamment, d’assurer le service après-vente des machines.
Chez Bernard Controls, spécialiste des servomoteurs pour l’industrie du pétrole, de la chimie et le nucléaire, la proportion du chiffre d’affaires à l’export n’était en 1981 que de 20 à 30 % ; en 2008, elle était de l’ordre de 60 à 65 % ; aujourd’hui, le taux est de 75 à 80 %. « Nous avons désormais deux usines de production et neuf filiales, dont une en Chine, une en Corée et une à Singapour. En Chine, nous employons une centaine de personnes (dont 50 % de commerciaux et 50 % de personnels dédiés à la production). Cette implantation nous a donné la possibilité de produire pour les États-Unis, et nous a permis en même temps de créer 20 % d’emplois supplémentaires en France à Gonesse », explique Étienne Bernard, son PDG.
Idem pour Rossignol Technology qui produit des tiges de freinage pour les équipementiers de l’industrie automobile : « Aujourd’hui, nous sommes leader mondial sur ce composant stratégique avec 40 % de parts de marché ; entre 120 000 et 150 000 tiges fabriquées par jour ; 97 % de notre chiffre d’affaires à l’exportation », décrit son PDG, Bertrand de Taisne.
Des stratégies d’internationalisation différenciées
L’internationalisation coûte cher et peut être dangereuse. Elle nécessite du temps et une stratégie patiente. Tous les pays ne peuvent pas être abordés de la même manière, ni en même temps.
Pour Affival, il aura fallu plus de trente ans pour construire cette internationalisation auprès des aciéristes. L’entreprise a commencé à produire du fil fourré (procédé utilisé pour le traitement de l’acier liquide et de la fonte) en 1981, sur le site de Solesmes dans le Nord de la France. En 1985, l’entreprise implante une usine aux États-Unis, et détient aujourd’hui à peu près la moitié du marché américain. En 1987, l’entreprise crée une filiale au Japon, nécessaire pour pouvoir vendre dans ce pays. La production vient de France et trois personnes s’occupent, sur place, de la commercialisation. En 1998, l’entreprise ouvre une usine en Corée du Sud pour couvrir le marché coréen et le Sud-Est asiatique. Suit une phase de pause dans l’internationalisation. En 2007, Affival s’implante en Chine ; en 2008, au Mexique ; et enfin en Russie, à Kolomna (près de Moscou). Affival est aujourd’hui le leader mondial sur le marché du fil fourré et des équipements d’injection, et commercialise ses produits dans le monde entier.
IDEES CLES – Ne pas se laisser « happer » par le marché
« Une des erreurs à éviter en matière d’internationalisation est de se laisser “happer” par le marché et de se lancer dans des implantations que l’on ne parvient pas à rentabiliser. Quand on veut s’installer dans un pays, il faut établir un plan d’action précis et y consacrer les ressources nécessaires, en hommes et en capitaux. C’est ce que nous avons fait en Chine, avec l’aide d’Oséo. En revanche, après avoir calculé ce que nous coûterait, en temps et en argent, le fait d’attaquer le marché russe, nous y avons renoncé. » Etienne Bernard, PDG de Bernard Controls
En outre, les modalités de l’internationalisation − exportation, licences, joint-ventures, rachat d’entreprises, création de filiales ex nihilo − varient selon les configurations locales et les opportunités, sans pour autant suivre un chemin de progression balisé.
Jérôme Duprez de Moret Industries décrit la différence de ses approches, selon les pays : « Au Brésil, nous vendons des pompes pour la chimie phosphorique et le pétrole. En matière d’ingénierie, il est très difficile de s’implanter là-bas avec des méthodes européennes. C’est ce qui nous a conduits à racheter une entreprise locale de 35 personnes spécialisée dans l’ingénierie de la fabrication de sucre et d’alcool. En Russie, les commissions versées lors de l’obtention des commandes peuvent atteindre 30 % du prix. Nous avons décidé de nous contenter d’implantations commerciales. En Inde, nous sommes leaders sur un certain nombre de produits, que nous importons depuis l’Europe. Nous avons tenté de nous installer localement, mais nous nous sommes heurtés à un problème de qualité lié à la problématique des castes. Les produits livrés par notre sous-traitant présentaient des défauts. Notre dirigeant indien était remarquablement intelligent et comprenait tout ce que je lui expliquais, mais les consignes ne parvenaient jamais jusqu’à l’ouvrier de base qui devait apporter les modifications au produit. Nous rencontrions également des difficultés d’ordre logistique : en Inde, dès qu’on quitte l’autoroute, les voies de communication sont en terre battue. Tout cela nous a conduits à choisir de nous développer plutôt en Chine. »
Luc Darbonne, fondateur de Darégal, raconte lui aussi les différentes étapes de son internationalisation : « En 1985, j’ai décidé de développer les herbes aromatiques surgelées aux États-Unis. J’ai donc cherché à m’associer avec deux sociétés américaines qui produisaient de la ciboulette lyophilisée, mais elles n’ont pas donné suite. J’ai embauché le directeur commercial de l’une d’entre elles, qui était une filiale de McCormick, et nous nous sommes lancés seuls, en 1987. L’affaire s’est bien développée et quelques années plus tard, nous détenions 70 % du marché. En 1991, la filiale de McCormick nous a proposé une joint-venture à 50-50. Nous avons accepté et ce partenariat continue à fonctionner encore aujourd’hui. Pour l’Argentine, je me suis fait aider par des Chiliens qui nous achetaient des plants d’asperges et possédaient une filiale en Argentine. Pour la Chine, je connaissais une entreprise familiale taïwanaise à laquelle j’achetais de l’ail et des champignons lyophilisés pour les vendre aux États-Unis. Cette société est maintenant implantée en Chine et toutes les personnes qui contrôlent nos produits en Chine en sont membres. »
Cinq grandes motivations pour se développer à l’international
L’une des caractéristiques des ETI est qu’elles n’hésitent pas à passer de l’exportation classique à la création de filiales commerciales ou de production, en dépit des investissements supérieurs à engager. Quelles en sont les principales raisons ?
Trouver de nouveaux relais de croissance
Pour Stéphan Guinchard, « les champions cachés se caractérisent souvent par la proportion importante de leur chiffre d’affaires réalisée hors des frontières de leur pays et, pour les entreprises communautaires, en dehors de l’Europe. Cette stratégie d’internationalisation permet d’être présent sur des marchés de taille significative en dépit de la focalisation sur des marchés étroits : ainsi, 40 % des champions cachés sont sur des marchés de taille supérieure à un milliard d’euros, et 20 % sur des marchés supérieurs à trois milliards d’euros. »
L’accession à de nouveaux marchés et à de nouveaux clients est ainsi l’un des principaux moteurs du développement des ETI et PMI de notre échantillon. Bruno Bouygues, PDG de GYS, fabricant de postes à soudure et de chargeurs de batteries pour la réparation automobile, déclare ainsi : « Il y a dix ans, la guerre des prix était moins intense qu’aujourd’hui et GYS pouvait maintenir ses marges en se concentrant uniquement sur son marché intérieur de 60 millions de personnes. Aujourd’hui, pour garder une équation économique tenable, il n’est plus possible de ne se concentrer que sur la France, nous avons absolument besoin d’un marché domestique plus grand, d’au moins 200 millions de personnes, d’où l’idée chez GYS de décider que France, Allemagne et Angleterre seraient désormais notre marché domestique et que nous aurions nos équipes sur place dans les trois pays. »
De même, Jérôme Duprez, PDG de Moret Industries, qui fabrique des pompes industrielles, raconte que « plutôt que de perdre beaucoup de temps et d’argent à essayer de développer l’entreprise en Europe, où elle était confrontée à de nombreux concurrents, mon père a décidé de viser tout de suite la grande exportation. Après avoir ouvert un bureau commercial à Singapour en 1992, notre entreprise a été, en 1996, l’une des premières PME françaises à s’installer en Chine. Aujourd’hui, notre filiale de Shanghai compte 250 salariés. Nous sommes en train de créer une deuxième usine et de doubler les effectifs. »
Tirer parti des coûts compétitifs
L’internationalisation permet de bénéficier d’avantages concurrentiels en termes de coûts, qui peuvent être significatifs. On pense bien entendu au différentiel de coûts salariaux, mais d’autres paramètres (élimination de barrières douanières, de risques de change, zones franches, avantages fiscaux et subventions) peuvent aussi entrer en ligne de compte.
Somfy, leader de l’automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment, est essentiellement un assembleur et 95 % de ses coûts directs proviennent des achats. « Certains de nos produits font aujourd’hui face à une pression sur les prix et une concurrence des Chinois. Pour ces produits, notre décision a été de les fabriquer dans des pays à bas coûts, à commencer par notre usine tunisienne qui représente aujourd’hui plus de 50 % de la production de la marque Somfy, précise Jean-Philippe Demaël, le directeur général. Cette production en pays à bas coûts nous permet de réaliser des marges sur les produits d’entrée de gamme et à très grands volumes. Ce sont ces marges qui permettent de financer nos efforts importants en R&D, de lancer de nouveaux produits, industrialisés dans nos usines françaises, et de consacrer des efforts suffisants à nos dépenses de marketing, notamment de publicité TV. C’est donc un cercle vertueux entre innovation et fabrication haut de gamme en France et fabrication sur les produits plus concurrencés en pays low cost. »
« Le fait de nous installer sur place nous a permis de profiter de certains autres avantages compétitifs, explique Georges Jobard. Par exemple, lorsque Clextral vend des machines au Brésil depuis l’Europe, nos clients sont assujettis à des taxes d’environ 30 %. Nous nous sommes implantés au Chili, où nous faisons assembler nos machines, et en vertu d’accords bilatéraux passés entre le Chili et le Brésil, nos clients ont moins de taxes à régler lorsque nous vendons des machines au Brésil avec de la valeur ajoutée au Chili. Par ailleurs, en Algérie, il y a encore deux ans, il fallait une lettre de crédit pour payer une facture de 1 000 euros. Cela ne posait pas de problème pour acheter une ligne de fabrication de 1,5 million d’euros, mais devenait très fastidieux lorsqu’il s’agissait de commander des pièces de rechange. Grâce à notre filiale locale, nous pouvons les facturer en dinars. »
Pour Rossignol Technology, en raison des droits de douane, du taux de change, des coûts de transport et de la nécessité d’un stock plus important pour compenser les délais, la même pièce automobile, vendue au même prix, coûte à son client équipementier entre 25 % et 30 % plus cher si elle vient d’Europe que si elle est produite dans le pays d’assemblage. De plus, comme l’explique le PDG, Bertrand de Taisne, de nombreux pays imposent un pourcentage de fabrication locale en échange de subventions. « L’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) impose 15 % de droits de douane aux produits fabriqués au Mexique pénétrant le territoire américain, si ceux-ci n’ont pas 60 % de contenu local. (…) Si nous voulons développer notre chiffre d’affaires avec les équipementiers installés au Mexique, nous n’avons d’autre choix que d’implanter une usine au Mexique. »
IDEES CLES – « Jouer collectif » pour conquérir de nouveaux marchés
Bertrand de Taisne, PDG de Rossignol Technology raconte que pour s’installer au Mexique, il n’a pas eu d’autre choix que de faire venir des décolleteurs français. « Il faut dix ans pour former un bon professionnel (…). Le savoir-faire du décolletage est unique en France. »
Il a donc convaincu cinq décolleteurs de la vallée de l’Arve (sur 310 contactés !) de l’accompagner dans son implantation au Mexique. La tâche n’a pas été aisée car comme le précise le dirigeant, « culturellement, tous les décolleteurs de la vallée de l’Arve se méfient terriblement les uns des autres. » Comment les a-t-il convaincus ? Deux arguments ont joué « la faible croissance en Europe et le potentiel du marché de l’Amérique du Nord. Il est impensable de développer des ventes sur l’ALÉNA si on ne travaille pas localement. » Cette action collective se traduira par le partage de la métrologie, la maintenance, la logistique et des approvisionnements afin de baisser les coûts fixes d’implantation.
Sortir de l’impasse du milieu de gamme
L’implantation à l’international représente également un laboratoire d’expérimentations pour une entreprise, lui permettant de simplifier ou au contraire de perfectionner les produits en fonction des exigences du marché local.
Bruno Bouygues en a fait l’expérience chez GYS. « Dès que nous nous sommes lancés dans la guerre technologique pour le matériel de réparation automobile, nous avons rapidement constaté que dans notre métier, les innovations venaient majoritairement d’Allemagne. Il fallait donc nous installer là-bas pour comprendre ce qui était en train de se jouer. Nous avons mis sept ans à constituer nos équipes allemandes. Elles vont désormais nous faire bénéficier de leur savoir-faire dans les trois composantes du métier : chargeurs, soudure, carrosserie. Les produits que nous avons spécifiés en Allemagne sont majoritairement du très haut de gamme destiné aux clients allemands. Récemment, un prospect indonésien nous a expliqué qu’il ne s’intéressait qu’aux premiers prix et au très haut de gamme : ce qui était entre les deux ne l’intéressait pas. »
Cette polarisation a de quoi inquiéter les entreprises françaises, car il est, d’une part, difficile de fabriquer en France des premiers prix et, d’autre part, les clients français ne demandent pas forcément du très haut de gamme, de sorte que les entreprises industrielles ont naturellement tendance à se concentrer au milieu du gué. L’internationalisation constitue l’opportunité de sortir de cette impasse, qu’il s’agisse d’aller vers le bas de gamme ou le haut de gamme.
« Après nous être implantés en Allemagne pour mieux apprendre à spécifier le haut de gamme, nous nous sommes implantés en Angleterre pour mieux comprendre les produits industriels premiers prix, très demandés dans ce pays. Grâce à ces deux filiales commerciales et techniques, nous avons pu construire un meilleur catalogue – plus large – et plus en phase avec la demande dans de nombreux autres pays », conclut Bruno Bouygues.
IDEES CLES – Créer des marques différentes en fonction de la gamme du produit
Affival, producteur de fil fourré pour la sidérurgie et la fonderie, a adopté cette approche : « En 2007, nous avons fait une acquisition en Chine, pour bénéficier de la croissance de la production d’acier dans ce pays. Pour être compétitifs vis-à-vis des entreprises chinoises dans leur pays, nous sommes obligés de nous battre avec les mêmes armes qu’elles. Nous utilisons donc des équipements chinois améliorés et nous produisons du fil fourré de qualité supérieure à la moyenne chinoise mais inférieure à celui produit en France, sous la marque Tianjin Hong Long, essentiellement dédiée au marché chinois. En 2008, nous avons suivi le même raisonnement pour le Mexique, avec Affimex, où là aussi le marché n’était pas encore prêt à l’utilisation et l’achat de produits plus sophistiqués. Cette stratégie vise essentiellement à entrer sur des marchés avec des produits correspondant à la demande, en attendant de rejoindre les standards d’Affival, en lien avec l’évolution des pratiques des pays concernés ».
Claude Lenoir, président d’Affival.
Contrôler la distribution pour assurer une proximité avec le client
Les ETI s’intéressent tout particulièrement au contrôle de leur distribution, afin de construire une proximité avec le client qui contribue par la suite à leur développement (compréhension fine des besoins des clients, voire des clients des clients ; adaptation ou co-développement des produits). Or l’exportation traditionnelle via des agents ou des sociétés de commercialisation permet difficilement ce contrôle fin. Il en va d’ailleurs souvent de même avec les licences.
« Notre développement sur le marché international n’aurait pas été possible sans la création de nombreux bureaux et filiales à l’étranger, explique Georges Jobard, le PDG de Clextral. Les clients qui nous achètent une machine ou une ligne de production s’engagent avec nous pour vingt ou trente ans. Nous avons besoin de créer une proximité, et même une intimité, avec eux si nous voulons qu’ils nous fassent confiance et acceptent de prendre le risque de travailler avec nous. Être proches d’eux géographiquement nous permet de leur fournir rapidement matériels et pièces de rechange, et aussi de leur apporter des services : fiabiliser un process, former des opérateurs, upgrader une machine quand les matières premières évoluent ou que l’entreprise décide de modifier ses produits, etc. Notre proximité et l’offre de services très attractive que nous proposons nous permettent de faire payer nos produits plus chers que nos concurrents».
Étienne Bernard, PDG de Bernard Controls, témoigne dans le même sens : « Il est souvent indispensable de monter une filiale locale, sans quoi on est à la merci des agents que l’on emploie dans le pays. En Corée, par exemple, nous avons constaté que les agents qui nous servaient d’intermédiaire se réservaient la marge. Nous vendions beaucoup mais ne gagnions pas beaucoup d’argent. Nous avons donc monté une filiale, qui est une structure coréenne, mais c’est nous qui avons pris en main notre propre développement. Nous continuons à faire appel à des intermédiaires, mais comme désormais nous connaissons nos clients, le coût de ces intermédiaires a beaucoup baissé. Malheureusement, on ne peut pas créer des filiales partout, il faut donc arrêter une stratégie claire et s’y tenir ».
Accompagner les grands donneurs d’ordre dans leur stratégie multidomestique
Selon leur position dans la chaîne de valeur, les entreprises sous-traitantes n’ont pas vraiment d’autre choix que d’accompagner leurs grands donneurs d’ordre dans leur développement international. C’est souvent à cette occasion que les opportunités de l’international s’ouvrent, comme le raconte Étienne Bernard dans les servomoteurs pour les centrales nucléaires : « Ma société n’a pu s’installer en Chine que parce qu’elle a été emmenée par EDF et Framatome. Au moment de la construction des premières centrales chinoises, l’État chinois a exigé que nous nous installions là-bas. Nous l’avons fait et cela nous a permis par la suite de prendre des parts de marché sur de nombreuses autres opérations. À ce stade, nous n’avions plus besoin du soutien d’EDF ni de Framatome. »
Dans le domaine des produits pour la réparation automobile, Bruno Bouygues, PDG de GYS, raconte : « Nos premières machines ont eu un peu de succès et nous avons eu la chance de les faire progressivement homologuer par de nombreux constructeurs automobiles européens. Du fait de leurs alliances internationales (par exemple Renault et Nissan), nous avons commencé à recevoir des commandes du monde entier : c’est un bon exemple de la façon dont un groupe français peut “tirer” une PME à l’international. »
Pour Rossignol Technology, la nécessité de suivre le donneur d’ordre répond à des questions de réactivité : « Si nos clients − des équipementiers automobiles − attendent de nous une présence locale, c’est tout d’abord pour disposer des pièces en temps réel. Il n’y a pas une semaine sans que nos clients nous demandent de leur envoyer en catastrophe des caisses de nos produits parce qu’ils sont en rupture de stock. C’est évidemment moins cher si nous sommes à deux heures de camionnette de leur usine ».
L’entreprise globale et son pilotage
Passer de PME locale à ETI globale n’est pas une mince affaire. Les différences culturelles et organisationnelles ont un impact non négligeable lors de n’importe quel rachat d’entreprise, mais elles sont encore accentuées dans le contexte international. Elles nécessitent souvent de refondre l’organisation existante en matière de systèmes de pilotage, d’information et de communication, tout en respectant l’autonomie des filiales afin de ne pas « casser » les dynamiques existantes et permettre les adaptations locales. Un exercice d’équilibrisme toujours instable entre « penser globalement et agir localement ».
EN SAVOIR PLUS – Les difficiles relations entre grands comptes et fournisseurs
Dans le domaine industriel, les ETI sont souvent des fournisseurs de la grande industrie. Elles regrettent que les grands donneurs d’ordre ne soient pas plus sensibles à la bonne santé de leurs fournisseurs et sous-traitants, voire leur imposent des conditions susceptibles de les faire péricliter.
Comme l’indique Stéphan Guinchard, bon connaisseur de l’Allemagne, « il faut renforcer la solidarité entre les grands comptes et leurs fournisseurs. La direction des achats de Volkswagen a probablement des attentes aussi exigeantes vis-à-vis de ses fournisseurs que celles de Renault ou de PSA, mais elle se montre plus attentive à leur pérennité, et par ailleurs, elle sait faire jouer la préférence nationale. En France, il n’est pas rare de voir de grands comptes payer leurs fournisseurs avec un retard significatif, au risque de mettre ces derniers en grande difficulté. »
Selon Georges Jobard, « depuis une quinzaine d’années, surtout en France, les relations entre les fournisseurs et les clients sont rendues très difficiles en raison des barrières instaurées par les acheteurs et les juristes. » Ce que confirme Étienne Bernard : « il faudrait promouvoir un dialogue d’ingénieurs à ingénieurs entre petites et grandes entreprises, car le plus souvent, les PME n’ont pas d’autre interlocuteur dans les grands groupes que les responsables des achats. »
Notons la création, depuis avril 2010, de la Médiation inter-entreprises. Ce dispositif gouvernemental aide les entreprises à surmonter des difficultés contractuelles ou relationnelles entre clients et fournisseurs (gratuit et totalement confidentiel).
Entre centralisation excessive et laisser-faire local, la prudence et la patience s’imposent. Dans le cadre des acquisitions externes réalisées par Somfy, Jean-Philippe Demaël décrit les avantages et les inconvénients des trois méthodes qu’il a expérimentées. « La première constituait une forme d’Anschluss. Après le rachat d’une société, les différents services de Somfy prenaient en main la production, le développement, le commercial, etc. Cette méthode a conduit à des échecs massifs, avec une forte destruction de valeur. Nous avons alors adopté la méthode inverse, qui consistait à ne rien toucher et à laisser l’entreprise fonctionner de manière autonome, avec simplement une légère gouvernance via le conseil d’administration. Cette solution donnait de meilleurs résultats, car elle ne détruisait pas de valeur. En revanche, elle conduisait à une redoutable complexité de gestion pour le groupe et à des phénomènes de concurrence entre sociétés. Aujourd’hui, nous essayons de revenir au centre du balancier : les nouvelles sociétés gardent leur autonomie de gestion mais nous mettons en place des mécanismes de coordination sur le plan commercial, d’échanges sur le plan technologique, ou encore d’harmonisation des systèmes d’information. C’est malgré tout un domaine dans lequel nous n’avons pas de certitudes. »
Approche plutôt centralisée chez IGE+XAO. « Je suis en contact direct avec tous les patrons de filiales et j’ai mis en place une organisation corporate performante, avec des responsables transversaux pour le marketing, les produits, la gestion des ventes, la communication, la finance, le contrôle de gestion, qui sont également proches de moi. Toutes les filiales ont exactement la même organisation et elles doivent appliquer un cahier des charges très serré, avec notamment un reporting quasiment en temps réel sur les ventes, les actions commerciales et les travaux de développement informatique », indique Alain di Crescenzo, son PDG.
Les hommes et l’international
Les défis liés à l’internationalisation nécessitent pour les entreprises de recruter, former, intégrer et motiver de nouvelles catégories de salariés.
Au stade initial, beaucoup d’entreprises recourent au volontariat international en entreprise (VIE) ou aux séjours Erasmus en alternance. Clextral y a, par exemple, eu recours : « Pour le lancement de notre pilote en Australie, nous avons commencé par recourir à un VIE, en tirant parti de la très grande motivation des jeunes français à aller découvrir le monde. Pour nous, c’est un outil très précieux. »
Mais ce sont surtout les postes de commerciaux qui focalisent toute l’attention. Chez Clextral, la place accordée aux vendeurs et agents export de l’entreprise est très importante. « Sur nos 280 salariés, 28 font de la vente. Nous leur demandons de savoir parler non seulement anglais mais si possible une autre langue, car pour avoir une relation vraiment proche avec le client, l’anglais ne suffit pas. Aujourd’hui, nous sommes capables de mener des discussions dans 17 langues différentes. De même, à une époque où nous étions très présents en Iran, nous nous appuyions sur un agent iranien qui avait été formé aux États-Unis, possédait un bon niveau scientifique, comprenait bien notre technologie et a été en mesure de nous faire rencontrer les différents investisseurs locaux qui pouvaient être intéressés par nos machines », décrit Georges Jobard.
IDEES CLES – Éloge de la lenteur
« Personnellement, je préfère que l’intégration se fasse plutôt trop lentement que trop vite. Dans le premier cas, on peut toujours accélérer. Mais quand on s’aperçoit que l’on a procédé trop rapidement, les dégâts sont souvent déjà irréversibles. »
Jean-Philippe Demäel, DG de Somfy.
IDEE CLES – Se doter d’outils pour partager les informations depuis n’importe quel point du monde
Poclain Hydraulics s’est doté d’une base de connaissances partagée et a mis en place des systèmes mondiaux de type ERP (Enterprise Resource Planning), PLM (Product Lifecycle Management) et CRM (Customer Relationship Management). « Le but est de pouvoir nous connecter et partager les informations depuis n’importe quel point du monde. Pour une ETI, il s’agit de gros investissements mais cela nous permet de faire coopérer en continu les équipes de développement qui sont réparties entre la France, la Slovénie, l’Italie et la Slovaquie. »
Laurent Bataille, PDG de Poclain Hydraulics
Expat ou local ?
Le choix des managers de filiales pour l’international est l’un des défis les plus complexes à relever pour les ETI. Le lien avec la maison-mère, la connaissance des technologies « maison » mais aussi la capacité à faire remonter à la maison-mère la culture du pays, les besoins et spécificités locales, représentent un équilibre subtil qui se construit entre le manager et l’entreprise dans la durée. Alors « expat » ou local, le patron de filiale ?
Pour Alain di Crescenzo, « autant on peut recourir à l’expatriation pour des pays proches comme l’Italie ou l’Espagne, autant c’est difficile à envisager en Asie, car dans notre métier seul un Chinois peut réussir à vendre quelque chose à d’autres Chinois. Tout le problème est alors de recruter des personnes fiables et performantes ».
Pour chacune de ses implantations, Clextral a recruté une personne qui avait déjà une connaissance approfondie du pays, souhaitait y vivre, parlait sa langue, partageait sa culture et parfois même sa religion. « Nous devons avoir totalement confiance en lui, non seulement pour représenter l’entreprise et maintenir son niveau de qualité et de service, mais aussi parce qu’il est chargé de nous rapporter de l’information stratégique sur le marché local afin de détecter les opportunités et les menaces. Nos managers de filiales sont nos meilleurs “capteurs”, à condition qu’ils soient totalement intégrés à l’entreprise. Notre filiale américaine est dirigée par quelqu’un qui travaille depuis vingt ans pour Clextral et qui a choisi de terminer sa carrière dans ce pays. Notre bureau chinois est dirigé par une personne qui a été pendant dix ans notre agent à Hong Kong. Nous l’avons sélectionné parce qu’il était complètement “clextralisé”. Notre bureau russe est piloté par quelqu’un dont la grand-mère est russe et qui est entré chez Clextral en nous expliquant que son but était de travailler un jour en Russie. »
Enfin chez Poclain Hydraulics, on aimerait recruter des patrons locaux, mais en pratique beaucoup de leurs dirigeants sont des expatriés. Les métiers sont très techniques et les patrons doivent être très expérimentés. Ils sont souvent sélectionnés parmi les cadres les plus anciens et les plus aguerris du groupe.
Intégrer des équipes multiculturelles
Pour intégrer et animer des équipes multiculturelles, il faut imaginer de nouvelles pratiques de management.
Chez Poclain Hydraulics, on fait beaucoup voyager les cadres pour assurer une meilleure transversalité. « Nous envoyons par exemple des Tchèques un peu partout dans le monde et nous avons actuellement une quinzaine d’Indiens en France ». On organise aussi des événements transversaux. « L’an dernier, par exemple, nous avons réuni tous les directeurs d’usine du monde entier. (…) L’événement préféré de nos collaborateurs est le repas multiculturel, une sorte de concours de cuisine où chacun apporte des spécialités de son pays. C’est important de créer des moments de rencontre sur un registre positif, surtout lorsque les relations entre pays sont tendues, comme cela l’a été à certaines époques entre la France et les États-Unis ou entre la France et la Chine. »
IDEES CLES – Ouvrir les formations en alternance aux salariés des filiales étrangères
« Mon rêve serait de pratiquer des formations en alternance internationales : recruter par exemple des jeunes Tchèques qui travailleraient dans nos usines françaises et suivraient en alternance des cours dans un centre de formation de la métallurgie. Au bout de deux ou trois ans, ils connaîtraient à la fois le métier, l’entreprise et la culture française. Même s’ils quittaient l’entreprise au bout de quelques années, il est probable qu’ils resteraient des prescripteurs de produits français. J’essaie de vendre cette idée à Ubifrance. »
Laurent Bataille, PDG de Poclain Hydraulics
L’implication du dirigeant
Le rôle du dirigeant et de la maison-mère est déterminant dans le processus d’internationalisation. Bernard Bouygues de GYS en témoigne : « Aujourd’hui, la direction générale consacre plus de la moitié de son temps à l’international. C’est important et indispensable car nous restons une PME et avant de pouvoir vendre un produit technique et souvent cher à l’international, il faut créer des liens de confiance entre client et fournisseur. »
La culture internationale du dirigeant, son expérience personnelle de la vie à l’étranger, particulièrement dans les pays émergents, sont aujourd’hui des qualités recherchées, susceptibles de faire la différence dans la compétition mondiale. Jean-Philippe Demaël, par exemple, avait été pendant trois ans CEO d’ArcelorMittal au Brésil, avant de prendre la direction générale de Somfy en Haute-Savoie.
IDEES CLES – Quand le PDG s’imprègne des codes culturels du pays d’accueil
Bertrand de Taisne a passé une bonne partie de sa vie à l’étranger, avant de décider de racheter Rossignol Technology. « Si la société avait été très bonne à l’international, je ne l’aurais pas achetée car je n’aurais eu que peu de valeur ajoutée. Je me consacre essentiellement au business développement et à la finance. Mon métier, c’est, par exemple, de contacter les équipementiers japonais lorsqu’il me semble que leur stratégie nous est favorable. »
Cette entreprise offre un bel exemple d’adaptation aux codes de communication des clients. Le dirigeant raconte : « Pour préparer ma visite au Japon, j’avais embauché un ingénieur japonais neuf mois avant. Notre analyse du marché avait permis de découvrir que les équipementiers de ce pays travaillent essentiellement avec des fournisseurs nippons, y compris pour leur production américaine ou mexicaine, et subissent eux aussi des surcoûts importants de ce fait. Notre présentation, en japonais, les a convaincus. Leurs services achats du Mexique et des États-Unis nous ont aujourd’hui ouvert les portes et sont très intéressés par notre projet d’usine mexicaine ! »
Les appuis institutionnels à l’internationalisation
Les organismes institutionnels d’accompagnement à l’international sont perçus assez diversement par les entreprises de notre échantillon. Toutes constatent un certain retard de maturité des institutions par rapport aux enjeux et exigences de la globalisation, et un niveau d’efficacité très variable d’un pays à l’autre, reposant davantage sur les qualités et le répondant individuels que sur la puissance de l’organisation.
La qualité variable de l’accompagnement à l’export
Les opinions divergent concernant le personnel diplomatique et les postes d’expansion économique (PEE)17 rattachés à Ubifrance.
Georges Jobard rapporte deux expériences antagonistes. En Ouzbékistan, Clextral a pu bénéficier de l’aide de l’ambassadeur de France et du poste d’expansion économique (PEE). « L’Ouzbékistan ne produit pas de pâte à papier mais, en revanche, regorge de déchets de coton. Nous avons développé un procédé, dérivé de celui de la pâte à papier fiduciaire, qui permet de fabriquer, à partir de déchets de coton, du papier destiné à l’impression et à l’écriture. Très peu d’entreprises s’aventurent dans ce pays et les projets y sont rares : l’ambassadeur et le poste d’expansion se sont passionnés pour notre affaire et nous ont beaucoup aidés. Avec l’aide de l’ambassadeur, nous avons pu convaincre les Ouzbeks qu’il serait vraiment intéressant d’investir dans cette technologie. » À l’inverse, l’expérience a été très négative en Chine : « Lorsque je suis allé rencontrer le responsable du PEE de Shanghai, j’ai eu l’impression de le déranger, et quand je lui ai indiqué le chiffre d’affaires de ma société, qui à l’époque s’élevait à 30 M€, il m’a ri au nez. Il m’a expliqué que son avenir était de travailler dans un grand groupe, et qu’il n’avait pas l’intention de perdre son temps avec une société comme la nôtre. »
Étienne Bernard, pour sa part, se juge satisfait : « En Corée, par exemple, un de mes collaborateurs s’est adressé à Ubifrance et, moyennant un millier d’euros, a obtenu une étude très bien faite sur la concurrence locale. En Russie, nous avons également été très bien reçus. J’entends même dire, dans le cadre de mes fonctions au Medef, que désormais les collaborateurs d’Ubifrance ne s’intéressent plus qu’aux PME ».
Luc Darbonne de Darégal exprime, quant à lui, le plus grand scepticisme à l’égard des services mis à disposition par les pouvoirs publics : « Je ne me suis jamais beaucoup servi de ces outils. L’essentiel, quand on s’installe dans un nouveau pays, est de pouvoir s’appuyer sur un interlocuteur honnête et sérieux, susceptible de vous faire profiter de ses réseaux et de vous aider à comprendre l’univers dans lequel vous allez travailler. Autour des services mis en œuvre par l’État, par exemple les postes d’expansion, gravitent des acteurs locaux qui ne demandent qu’à vous offrir leurs services mais qui ne sont généralement ni honnêtes, ni sérieux. Il vaut mieux chercher les bons interlocuteurs soi-même ».
Bruno Bouygues de GYS s’étonne, pour sa part, de la faible participation des PME industrielles françaises aux salons internationaux. « Nous y croisons très souvent 50 ou 60 entreprises allemandes contre moins de 10 entreprises françaises. Nous avons donc soit un problème dans notre offre de produits industriels pour l’international, soit un manque d’ambition et de culture de l’international, soit les moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics allemands sont plus importants que ceux mis en œuvre par la France. » Probablement les trois à la fois !
Le difficile financement de l’internationalisation
Il existe une vraie difficulté à financer l’internationalisation. Si toutes les entreprises reconnaissent en chœur l’aide qui leur a été apportée par Oséo et CDC-Entreprises, elles constatent qu’un palier est atteint, dès lors que les besoins de financement atteignent 5 à 10 M€, des montants que l’on atteint vite quand on souhaite se développer dans les pays émergents. « Une de nos difficultés est de répondre aux besoins de financement de nos clients, pour des affaires qui peuvent se monter à plusieurs millions d’euros. À l’heure actuelle, nous perdons environ une affaire sur deux, simplement parce que nos concurrents, qui sont des entreprises américaines ou allemandes, ont des solutions de financement à proposer à leurs clients, alors que nous ne pouvons leur offrir que la qualité des produits, du service, la notoriété, mais pas de financement », témoigne un intervenant. Et un autre de rebondir : « Le problème est qu’Oséo et CDC Entreprises ont du mal à suivre lorsqu’une PMI approche du niveau d’une ETI. » Plusieurs dirigeants évoquent le besoin d’un « Oséo-ETI-International », une idée désormais reprise par Bpifrance.
Cette nécessité se fait d’autant plus sentir que, d’une part, la Coface a réduit ses encours et limité le nombre des pays sur lesquels elle intervient et que, d’autre part, les banques françaises régionales, qui sont souvent les partenaires naturels et historiques des PMI, sont très réticentes à financer la croissance à l’étranger. « Je rencontre un problème culturel auprès des banquiers régionaux avec lesquels je travaille. L’un d’entre eux m’a dit un jour “Vous savez, la Chine, c’est bien loin de Romorantin”. Un autre, “L’Asie, on n’y comprend rien”. L’agence régionale d’une grande banque française m’a expliqué qu’il serait souhaitable de faire traduire mes documents de l’anglais au français », raconte un intervenant. En désespoir de cause, reste alors le recours aux banques étrangères.
EN SAVOIR PLUS – L’accompagnement de Bpifrance à l’international
Prêt export
Le prêt export s’adresse aux entreprises souhaitant se développer à l’international. Avec un financement par Bpifrance de 30 000 à 5 M€ sur 7 ans, sans demande de garantie, le bénéficiaire ne commence à rembourser qu’à partir de la 3e année.
Crédit export
Bpifrance peut consentir un crédit export pour les PME ou ETI françaises vendant des biens d’équipement et des prestations de service à des clients étrangers. Sous forme de rachat de crédit fournisseur et de crédit acheteur, les prêts peuvent aller de 1 à 25 M€ pour Bpifrance prêteur seul, et jusqu’à 75 M€ de participation Bpifrance dans le cas d’un cofinancement. Ces prêts s’étendent sur des périodes de 3 à 12 ans et exigent une couverture COFACE DGP à hauteur de 95 %, complétée le cas échéant de garanties ou sûretés.
Garantie de projet à l’international (GPI)
Bpifrance peut garantir les fonds propres d’une entreprise souhaitant créer une filiale à l’étranger hors de l’Union Européenne. Le bénéficiaire de la garantie, la société mère, jouit d’une couverture du risque économique de la filiale, et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à 7 ans.
Avance + Export
Lorsqu’une entreprise française facture des clients à l’étranger en euros, Bpifrance peut mobiliser ses créances étrangères comme avance de trésorerie dans l’attente du règlement par l’entreprise étrangère. Requérant une autorisation de crédit confirmée, le produit Avance + Export octroie jusqu’à 100 % du portefeuille de créances cédées.
Partenariats
Bpifrance a noué des partenariats à l’export avec plusieurs entités, parmi lesquels CCI France/CCI International, l’initiative du Ministère du Commerce Extérieur « France International », le groupe HSBC, les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF), les Opérateurs Spécialisés du Commerce International (OSCI) et le groupe Société Générale. Les partenariats s’opèrent également avec des entités institutionnelles, telles que l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII), la Banque européenne d’investissement (BEI), l’Enterprise Europe Network mais aussi avec la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB).
Accompagnement à l’international
Le travail d’accompagnement Bpifrance bénéficie aux entreprises souhaitant exporter. Le module « Accompagnement export » de l’Accélérateur PME a par exemple mission de soutenir les petites et moyennes entreprises souhaitant conquérir des marchés au-delà de nos frontières. Cet accompagnement prend notamment la forme de mise en relation avec des partenaires internationaux, d’un audit export et d’informations sur les marchés visés (prospection, etc.) La partie Université de Bpifrance propose en outre une formation « Internationale » sous forme de séminaire en partenariat avec HEC.
L’implication du politique
À la différence des grands groupes, les PMI/ETI sont faiblement associées aux voyages politiques officiels de nos présidents VRP. « Je me rends régulièrement en Indonésie et j’ai notamment noté que Mme Merkel y avait récemment emmené de nombreux chefs d’entreprise du Mittelstand industriel », remarque Bruno Bouygues de GYS qui est intéressé par cette région.
Toujours par comparaison avec l’Allemagne, d’autres instances, notamment régionales, pourraient jouer le même rôle. « Dans le Land de Rhénanie de Nord Westphalie, j’ai eu l’occasion de rencontrer trois personnes − niveau chef d’entreprise et parlant chacune trois ou quatre langues différentes – qui voyagent énormément pour attirer des entrepreneurs industriels dans leur région et qui, inversement, conseillent les entreprises locales sur les thèmes de l’international. »
Philippe d’Ornano, président de Sisley, la marque de cosmétiques de luxe, raconte à ce propos une anecdote destinée à interpeller les pouvoirs publics : « J’ai reçu la visite, à Paris, du maire du district de Shanghai, où est implantée l’une de nos plus grosses filiales. Il venait me proposer ses services et son aide pour le cas où nous voudrions développer nos affaires là-bas… Certains pays semblent avoir compris que l’industrie et, plus généralement, les entreprises représentent une dimension vraiment stratégique et veillent à leur offrir un écosystème favorable. Par exemple, la Chine a décidé de créer une sorte de Cosmetic Valley (pôle de compétitivité français dédié à l’industrie cosmétique) à côté de Nanjing. Pour cela, elle a supprimé tout impôt dans la zone en question pendant une durée de sept ans et elle démarche les sous-traitants pour les inciter à s’installer là-bas. Elle va ainsi créer un terreau dans lequel pourront émerger ou se développer des marques chinoises, ce qui sera d’autant plus facile que ce pays adore les cosmétiques et en consomme beaucoup. Si cette stratégie aboutit, la France, qui jusqu’ici était le pays où il fallait lancer de nouvelles marques, même pour une firme étrangère, risque de se voir détrôner. » À quand Anne Hidalgo en Chine ?!
FACTEURS DE SUCCES – Pour l’internationalisation
Établir un plan d’action précis pour s’internationaliser et évaluer notamment le coût de chaque implantation en termes de ressources humaines, de capitaux et de temps à allouer.
Être « sur place » afin de maîtriser le coût des intermédiaires.
Assurer une proximité géographique avec le client afin de lui proposer une offre globale (i.e incluant des services) permettant de vendre le produit plus cher que celui des concurrents.
Être patient, construire des relations durables et savoir saisir des opportunités de rachat ou d’alliance, différenciées selon les pays.
« Jouer collectif » pour conquérir de nouveaux marchés.
Décliner des gammes de produits en fonction des exigences du marché local.
Créer des marques différentes en fonction de la gamme du produit.
Se doter d’outils pour partager des informations et faire coopérer en continu les équipes depuis n’importe quel point du monde.
Sur les marchés lointains, s’entourer de managers, intégrés à la fois à l’entreprise et à la culture du pays d’accueil.
- 17 – Ancien nom des Missions économiques.
La différenciation par l’innovation
À RETENIR
Les ETI investissent en R&D un pourcentage de leur chiffre d’affaires supérieur à la moyenne nationale.
L’innovation peut conduire à une transformation complète du business model de l’entreprise.
L’innovation est utilisée par les ETI comme facteur de différenciation « par le haut » favorisant la montée en gamme.
Protéger l’innovation est une priorité mais les brevets n’en sont qu’une des modalités.
La R&D s’inscrit prioritairement dans une logique applicative. Elle est tirée par la demande et est souvent menée avec les clients qui vont même parfois jusqu’à la financer.
L’accès à la recherche fondamentale se fait par appui sur l’écosystème national ou international, et se construit parfois en réseau. Les collaborations des industriels avec la recherche publique restent complexes.
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est plébiscité et les chefs d’entreprise attendent des pouvoirs publics qu’ils garantissent la stabilité de ce dispositif.
Selon une étude menée sur un panel de mille sociétés européennes par l’Institut der Wirtschaftsprüfer (institut des commissaires aux comptes allemands), les entreprises dépensent en moyenne 3 % de leur chiffre d’affaires en R&D. En France, les chiffres 2012 du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche indiquent que l’intensité en R&D (ratio DIRDE totale/chiffre d’affaires total) est de 3 % pour les PME/ETI contre 2,7 % pour la moyenne nationale. Le cabinet Booz Allen Hamilton, qui publie chaque année une liste des mille sociétés les plus innovantes du monde, a constaté que celles-ci dépensaient 3,6 % de leur chiffre d’affaires en R&D. Pour certaines entreprises de notre échantillon, il n’est pas rare que les dépenses atteignent 6 % du chiffre d’affaires, voire 10 % et parfois plus.
Les ETI se distinguent ainsi par une activité importante en matière de R&D et, plus largement, d’innovation. Elles doivent concevoir une organisation pour la produire et lui allouer des moyens proportionnés ; c’est d’ailleurs sur ce dernier point qu’elles se différencient des grands groupes.
Comme ces entreprises sont industrielles, avec une culture technique marquée, elles ont une tendance nette à se concentrer sur des innovations à fondement technologique, pouvant ensuite connaître des prolongements en matière d’innovation process et d’innovation de service.
L’innovation ne se réduit, en effet, pas à la R&D. Alain Di Crescenzo, PDG de IGE+XAO, entreprise spécialisée dans les logiciels de CAO, note, toutefois, un « retard français » en matière d’innovation non technologique (service, marketing, design) : « En France, nous avons tendance à assimiler innovation et technologie. Pourtant, savoir établir une liste de prix pertinente, inventer un packaging attractif, imaginer un nouveau modèle de ventes, développer un marketing performant, tout cela constitue aussi de l’innovation. »
Quels sont les objectifs assignés à l’innovation ? Les ETI peuvent-elles tirer parti de l’innovation au point de réinventer leur modèle d’affaires ? Quel regard posent-elles sur les dispositifs d’innovation, qu’ils soient partenariaux ou non (pôles de compétitivité, CIR, etc.) ?
La place centrale de l’innovation
Bpifrance18 cite une enquête d’OpinionWay pour KPMG selon laquelle l’innovation est un levier essentiel de développement pour 90 % des ETI. Pour près de trois ETI sur quatre, ce sont les produits ou services qui font l’objet des efforts d’innovation. Mais l’innovation se retrouve à tous les niveaux, que ce soit les process, le marketing, la stratégie commerciale ou encore la politique sociale. Par exemple, près de la moitié (48 %) des ETI déclare avoir innové dans le management et les ressources humaines sur les trois dernières années19. Pour développer leurs innovations, 70 % des ETI s’appuient notamment sur une politique de partenariats active avec les écoles et les universités, les réseaux d’entreprises ou encore avec leurs clients et leurs fournisseurs.
D’après Bpifrance20, en 2012, les ETI ont mobilisé plus de 40 % de la dépense intérieure de recherche-développement des entreprises (DIRDE) et près de 34 % du crédit d’impôt recherche.
Objectifs de l’innovation et moyens dédiés
Pour Luc Darbonne chez Darégal, leader mondial des herbes aromatiques culinaires, il faut innover sans cesse si l’on veut mener la course en tête ; 3 % de son chiffre d’affaires est dépensé en R&D. « Nous investissons énormément dans la recherche agronomique, que ce soit pour l’amélioration variétale, les façons culturales, ou encore la résistance aux maladies. Nous faisons également de la R&D sur les process de déshydratation, de lyophilisation, de surgélation, de stabilisation, de concentration. Contrairement à nos concurrents, qui généralement se spécialisent dans l’une de ces techniques, nous les maîtrisons toutes, qu’elles mobilisent le chaud ou le froid. Cela nous permet de répondre à n’importe quelle demande des industriels de l’agro-alimentaire. »
EN SAVOIR PLUS – De l’innovation à la différenciation par le haut
L’innovation est l’une des composantes fondamentales d’une stratégie de différenciation. Elle peut être appliquée aux produits, aux process mais aussi aux services, à l’organisation ou à l’image de marque. Innovation et différenciation finissent d’ailleurs souvent par se confondre dans le vocabulaire courant. Quand elle est difficilement imitable, la différenciation devient source d’un avantage concurrentiel. C’est pourquoi les entreprises se préoccupent de protéger leurs atouts, par exemple par des brevets dans le domaine technologique.
L’intérêt d’une différenciation dite « par le haut » est qu’elle accroît la valeur perçue du produit ou du service, les clients étant prêts à payer un prix plus élevé, ce qui permet à l’entreprise de dégager de plus fortes marges et, souvent, d’investir pour maintenir son avance. Ce fameux cercle vertueux de la « montée en gamme », souvent reconnu à l’industrie allemande, fait couler beaucoup d’encre.
L’innovation, notamment sur les procédés de fabrication, de commercialisation et de distribution, peut aussi permettre d’importantes réductions de coûts (comme chez Ikea). La montée en gamme n’est donc qu’une des modalités de la « montée en capacité » due à l’innovation.
L’innovation dresse également des barrières à l’entrée face à de nouveaux compétiteurs. Il arrive même qu’elle réussisse à modifier les règles du jeu concurrentiel et à créer de toutes pièces de nouveaux marchés, des « niches » plus ou moins durables, sur lesquelles les ETI construisent souvent leur développement.
La société Eurotab réalise un chiffre d’affaires de 43 M€, en fabriquant des tablettes de poudre comprimée à partir de produits très variés : aliments, détergents, traitement pour l’eau des piscines, minéraux, etc. Elle investit chaque année environ 7 % de son chiffre d’affaires dans la R&D. Elle emploie 30 chercheurs pour plus de 200 salariés, soit 15 % de son effectif. « Notre premier métier consiste à inventer de nouveaux produits. Nos chercheurs travaillent sur des innovations incrémentales mais surtout sur des innovations de rupture, afin d’apporter une valeur ajoutée par rapport aux formats traditionnels. Eurotab a, par exemple, inventé la tablette Javel dans les années quatre-vingt, puis a mis au point les tablettes pour lave-vaisselle dans les années quatre-vingt-dix. Nous avons également développé des tablettes de café pour Sara Lee, et nous commençons à nous intéresser au domaine des minéraux industriels, pour lesquels la forme compactée peut représenter une valeur ajoutée supplémentaire significative », décrit son PDG, Olivier Desmarescaux.
Somfy est le leader mondial de l’automatisation des ouvertures et fermetures dans le tertiaire et le résidentiel, avec quatre grands domaines d’activité : stores et volets, stores d’intérieur, accès et sécurité, domotique. Selon Jean-Philippe Demaël, le DG : « La première force de notre entreprise est notre capacité d’innovation. Nous investissons environ 10 % du chiffre d’affaires de la marque Somfy en R&D, et le centre de recherche de Cluses compte 500 cadres et techniciens. Dans notre centre de R&D, l’innovation est tellement riche qu’il faut régulièrement opérer des tris dans le portefeuille pour recentrer les chercheurs sur les projets ayant le plus de chances de trouver leur marché. »
La société SNF fabrique des polymères hydrosolubles pour le traitement de l’eau et l’extraction des hydrocarbures. Elle investit annuellement 10 % de son CA en R&D. « Nos 250 chercheurs ont pour consigne de ne rien inventer et de chercher plutôt à copier vite et bien. Nous partons du principe que dans notre domaine, la quasi-totalité des sujets a déjà fait l’objet de recherches. Nous avons donc instauré une règle très stricte selon laquelle nos équipes n’ont pas le droit de lancer une nouvelle recherche tant qu’elles n’ont pas établi la synthèse de la bibliographie et des brevets existants », explique Pascal Rémy, PDG de SNF.
Pour André Ulmann, dès la création du laboratoire pharmaceutique HRA Pharma, la R&D est au cœur du projet stratégique de l’entreprise : « Notre idée était de découvrir, développer, homologuer et commercialiser des médicaments ou des dispositifs médicaux répondant à une demande médicale non satisfaite. Ces produits devaient être innovants et à forte valeur ajoutée, ce qui nécessitait de nous doter de moyens de R&D : nous n’avions aucune envie de fabriquer des génériques ou des me too. Notre intention était de cibler des domaines négligés par les grands laboratoires pharmaceutiques, pour lesquels on ne voyait guère émerger de nouveaux produits. Nous étions particulièrement intéressés par le thème de la santé de la femme, et plus précisément de la reproduction, tout en restant ouverts à d’autres opportunités. » Chaque année, depuis l’origine, les dépenses de R&D ont représenté entre 15 et 20 % des revenus. « Pour la deuxième génération de la pilule du lendemain, par exemple, nous avons investi au total environ 20 M€. » “ En France, nous avons tendance à assimiler innovation et technologie. Pourtant, savoir établir une liste de prix pertinente, inventer un packaging attractif, imaginer un nouveau modèle de ventes, développer un marketing performant, tout cela constitue aussi de l’innovation.
EN SAVOIR PLUS – Le champ d’investigation de la R&D chez Somfy
« Un tiers des chercheurs travaille sur les moteurs et donc sur l’électromécanique. Leur principal défi actuel est de rendre les moteurs totalement silencieux, en sachant qu’ils sont composés de 150 pièces et que leur fonctionnement peut entraîner des phénomènes de vibrations et de résonances.
Un deuxième tiers de ces techniciens se consacre à l’électronique et notamment aux logiciels embarqués, qui permettent de très nombreuses innovations. Par exemple, les moteurs de volets roulants sont maintenant capables de détecter une tentative d’intrusion, en faisant la différence avec un coup de vent qui aurait fait vibrer le volet.
Le troisième tiers se consacre à la modélisation de systèmes de domotique et de pilotage de la maison à distance grâce au cloud computing. Il ne s’agit plus de manœuvrer un équipement avec une télécommande, mais d’organiser les interactions entre dix, quinze ou vingt produits différents (alarme, capteur de vent, capteur solaire…), en définissant des règles de priorité lorsque les uns et les autres donnent des ordres contradictoires. »
Jean-Philippe Demaël, DG
EN SAVOIR PLUS – France-Allemagne : innovation de rupture versus innovation incrémentale
Selon les analyses de Stéphan Guinchard développées dans Les Champions cachés du XXIe siècle21, « La France apparaît souvent comme bien classée en matière d’innovation, mais elle privilégie les innovations de rupture, alors que les Allemands donnent une plus grande place à l’innovation incrémentale. Guy Maugis, le patron de Bosch France, souligne que dans notre pays, nous aimons bien partir d’une feuille blanche pour envoyer des fusées dans l’espace ou faire rouler des trains à 500 kilomètres à l’heure, mais que nous sommes nettement moins motivés par l’idée de travailler sur la huitième génération de rails communs d’injection et de faire passer la tolérance des buses d’injection de 10 à 8 microns. Or, ce sont souvent les innovations incrémentales qui permettent aux champions cachés de conquérir de nouveaux marchés ». Ainsi en témoigne le patron de l’entreprise d’origine allemande Sennheiser, l’un des leaders mondiaux des casques audio : « Ce sont des évolutions, plus que des révolutions, qui ont renforcé notre entreprise. Même la plupart des innovations de rupture ont été le résultat d’une politique de développement par petits pas. » Une affirmation qui n’est pas démentie par l’étude de notre panel d’entreprises françaises.
Un autre aspect de l’innovation est qu’il n’est pas nécessaire d’être dans un secteur d’activité à fort contenu technologique pour mettre l’innovation au cœur de sa stratégie. Stéphan Guinchard donne l’exemple de la société allemande Flexi qui fabrique des laisses pour les chiens. Celle-ci fait appel à la R&D pour décliner et améliorer les différentes parties du produit (la poignée, l’enrouleur, la matière de la laisse qui doit être souple et résistante, etc.).
Un investissement stratégique, piloté au plus haut niveau
L’importance stratégique de l’innovation conduit bien souvent à ce que celle-ci soit pilotée au plus haut niveau de l’entreprise. Pascal Rémy, DG de SNF (fabrication de polymères hydrosolubles), s’investit personnellement dans le sujet. « Je passe beaucoup de temps avec les universitaires et scientifiques qui travaillent dans notre champ d’activité pour comprendre quelles pistes ils sont en train d’explorer. Je discute également avec les équipes de R&D de nos clients : je consacre pratiquement une journée par semaine à des réunions avec eux. Enfin, je participe aux réunions internes de suivi de la R&D. » Depuis l’origine du laboratoire HRA Pharma, André Ulmann est chargé d’apporter et de sélectionner les nouveaux projets : « Je passe énormément de temps à lire, à rencontrer des gens, à aller dans des congrès, à interroger mon réseau. Trouver de nouvelles idées demande du temps et de la réflexion. Il faut parvenir à évaluer le potentiel d’un brevet n’ayant pas été développé par l’entreprise auquel il appartient. C’est d’autant plus difficile que la concurrence est féroce. Pour que l’entreprise continue à prospérer, nous devons sélectionner un nouveau projet chaque année, ce qui n’a rien d’évident. »
Quant à Olivier Desmarescaux, PDG d’Eurotab, il assiste à toutes les revues de projets stratégiques, au cours desquelles sont prises les décisions de les poursuivre ou de les arrêter, et il assiste également à la revue trimestrielle du portefeuille de brevets. « Je supervise les négociations de joint research agreement avec nos clients. C’est une fonction quasiment opérationnelle mais cruciale pour s’assurer notamment que la ligne rouge n’est pas franchie en matière de propriété intellectuelle. »
De l’organisation de la R&D à l’entretien d’une « culture de l’innovation »
R&D centralisée ou décentralisée, place des scientifiques dans l’organisation… il n’existe pas de règle évidente en la matière. Chaque entreprise a créé son propre modèle. Chez Moret Industries par exemple, la R&D se fait au niveau de chacune des branches. Il s’agit de R&D appliquée et les centres de recherche sont situés dans les usines. La branche « pompes » comprend une vingtaine d’ingénieurs qui sont répartis entre la France, la Belgique et la Chine. Inversement, chez SNF, l’essentiel de la R&D continue à se faire en France, même si des centres ont également été créés aux États-Unis et en Chine.
Plusieurs entreprises vantent l’efficacité des petites équipes. Ainsi, chez SNF, les chercheurs travaillent en équipes de cinq à dix personnes : « La création de valeur dépend du nombre d’interactions entre les membres d’un groupe, mais lorsque les interactions sont trop nombreuses, le système devient inefficace. C’est pourquoi, lorsqu’un thème de recherche prend de l’importance, nous le divisons en sous-thèmes afin de conserver de petites équipes. Quand nous avons commencé à travailler sur les hydrocarbures, par exemple, la même équipe traitait tous les sujets. Aujourd’hui, cinq équipes de six personnes se partagent la tâche », indique Pascal Rémy. André Ulmann chez HRA Pharma marque la même préférence : « En matière de R&D, il est clair que l’on a intérêt à fonctionner en petites unités. »
À plus long terme, le développement de plateformes de R&D tend à modifier la composition des effectifs de l’entreprise. Georges Jobard raconte cette transformation chez Clextral : « À l’époque, nous employions essentiellement des mécaniciens, des électriciens et quelques automaticiens. Nous avons recruté des ingénieurs en agroalimentaire pour qu’ils parlent le même langage que nos clients et soient capables de comprendre ce qui se passait à l’intérieur des machines. De même, lorsque nous nous sommes lancés dans l’activité de pâte à papier, nous avons embauché un ingénieur de l’École française de papeterie. »
SNF ne recrute pratiquement que des profils techniques. « Les commerciaux sont tous des techniciens et même pour la finance, nous faisons appel à des ingénieurs ayant un double cursus ou ayant travaillé dans le conseil, car nous estimons qu’ils comprennent mieux les enjeux. D’une façon générale, nous avons constaté que les personnes n’ayant pas un profil technique s’intègrent mal dans cette entreprise. »
Graduellement, on voit donc que le choix des profils induit une réflexion sur une culture d’entreprise qui soit plus propice à l’innovation. Chez Eurotab, on déclare franchement ne recruter que des personnes qui adhèrent à une culture de l’innovation, « faute de quoi elles ne resteront pas dans l’entreprise ». En bonne logique, il faut également que la direction fasse en sorte de cultiver cet état d’esprit. « Chaque chercheur peut obtenir quelques jours par trimestre pour travailler sur ses propres sujets, de façon à présenter des propositions qui en sont pratiquement au stade de la preuve de concept. C’est ce que nous appelons le teasing : le chercheur dispose de quelques jours et de quelques moyens pour analyser la liberté d’exploitation et la faisabilité technique de son idée. Si cette étape est franchie avec succès, on peut entrer dans la phase d’avant-projet. »
Chez SNF, tous les chercheurs doivent passer au moins une semaine par mois chez les clients ou sur le terrain, de façon à observer par eux-mêmes quels résultats donnent les produits qu’ils sont censés mettre au point. « Nous n’aimons pas qu’ils restent trop longtemps dans leurs laboratoires, précise Pascal Rémy. Ils assistent aux essais des produits qu’ils ont conçus, et surtout ils discutent avec les clients pour essayer de comprendre quels sont leurs sujets de préoccupation. Dès qu’ils ont identifié un problème particulier chez un client, ils se mettent à chercher une solution : c’est le principe même de la chimie de spécialité. Dès la semaine suivante, ils doivent faire une proposition au client, sans quoi celui-ci risque d’avoir oublié le problème qu’il avait soulevé et d’être passé à autre chose. Il faut parvenir à le convaincre que la solution proposée va vraiment améliorer ses résultats. Si nos chercheurs restaient dans leurs laboratoires, ils risqueraient de se scléroser ou de mettre au point des molécules ne correspondant à aucun besoin particulier. »
Les clients, acteurs de l’innovation
Une des caractéristiques des PMI/ETI innovantes réside dans l’implication des clients dans le processus d’innovation. Ces derniers sont souvent intimement associés au développement ou à la mise au point d’une innovation, afin de ne pas gaspiller les ressources et de répondre immédiatement aux besoins du marché. Tous les secteurs d’activité sont concernés.
Du co-développement…
Chez SNF, l’entreprise des polymères hydrosolubles, les nouveaux produits ne sont développés qu’en vue d’une application particulière pour un client22. Luc Darbonne procède de même chez Darégal (herbes aromatiques culinaires) : « Nos centres de R&D collaborent par exemple avec ceux des fromagers pour mettre au point des préparations spécifiques. Nous croisons même notre R&D agronomique avec la R&D de nos clients pour élaborer ensemble les produits qu’ils souhaitent. Par exemple, Barilla produit depuis plusieurs années un pesto spécifique qui ne soit pas “thermisé”, de façon à conserver tout son arôme, et qui reste néanmoins vert, grâce à la variété de basilic que nous avons mise au point pour cet industriel. Nous allons très loin dans la recherche pour satisfaire les besoins de nos clients. »
EN SAVOIR PLUS – Clextral et le co-développement autour de la pâte à papier fiduciaire
« Dès 1976, Creusot-Loire avait coopéré avec le Centre technique du papier (CTP) pour tenter de fabriquer de la pâte à papier grâce à la technologie bi-vis. Le responsable de l’équipe du CTP est venu de Grenoble avec un sac de copeaux. Il l’a versé dans une machine qui servait à fabriquer des cornflakes et a obtenu quelque chose qui ressemblait à de la pâte à papier. Nous avons alors créé un pilote en partenariat avec plusieurs papetiers et mis au point un procédé beaucoup plus économe en eau et en énergie que le procédé traditionnel.
L’application de loin la plus intéressante, celle de la pâte à papier fiduciaire, a été mise au point avec la Banque de France. À l’issue d’un co-développement qui a duré trois ans, nous avons déposé un brevet tripartite entre Clextral, le Centre technique du papier et la Banque de France. Celle-ci a inauguré son installation en janvier 1991 et nous avons signé avec elle un accord de commercialisation : pendant plusieurs années, elle a ouvert ses portes à nos prospects et chaque fois que cela nous permettait de conclure une vente, nous lui versions des royalties. Grâce au brevet et à cette coopération exemplaire avec ce premier client, nous avons réussi à prendre pratiquement les trois quarts du marché mondial de la fabrication de pâte à papier fiduciaire. »
Georges Jobard, PDG de Clextral
Chez Clextral, le co-développement avec les clients a joué un rôle moteur dans le développement de l’entreprise. Pour convaincre les clients que l’extrusion bi-vis pouvait s’appliquer à d’autres marchés que la plasturgie, l’entreprise a monté un centre de recherche avec des machines pilotes. Georges Jobard raconte : « Dès nos premiers pas dans l’agroalimentaire, nous nous sommes dotés d’une machine pilote qui nous a permis d’attirer les industriels du secteur. Ils venaient à Firminy avec leur matière première et leurs ingénieurs pour travailler avec les nôtres. En 1985, nous avons créé un centre de recherche plus important, avec des machines pilotes mais aussi des accessoires qui permettaient d’en faire des petites lignes de production, de façon à sécuriser les clients sur la faisabilité de leurs produits, voire à produire en petite quantité pour tester les nouveaux marchés. Assez vite, nous avons dû construire un deuxième centre de recherche sur le même modèle aux États-Unis, pour que les grands comptes américains puissent disposer des mêmes outils. Nous avons toujours tenu à travailler en co-développement avec nos clients. Lorsqu’il nous arrive de faire quelques essais par nous-mêmes, nous leur soumettons aussitôt les échantillons pour voir leur réaction : ce sont eux qui connaissent le marché et qui auront envie ou pas de prendre le risque de se lancer dans un nouveau procédé ou un nouveau produit. »
… Au co-financement
Certaines entreprises poussent le co-développement encore plus loin, en faisant co-financer le processus d’innovation par le client sans pour autant lui en céder la propriété intellectuelle. C’est le cas chez Eurotab, par exemple, dont bon nombre de projets sont co-financés, partiellement, par les clients. « C’est indispensable pour nous assurer de leur motivation et du fait qu’ils vont consacrer suffisamment d’équipes et de budget au projet. » Parmi ces projets, 60 % des innovations sont tirées par la demande des clients et 40 % sont totalement autofinancées et poussées par Eurotab. « Mais en définitive, toutes nos innovations menées à bien sont de type “pull”, car les produits que nous imaginons ne peuvent être mis sur le marché que par un client donneur d’ordres », indique Olivier Desmarescaux.
Cela se passe également ainsi chez IGE+XAO. « Il nous arrive de mener de petites recherches sans partenaires, mais nous ne lançons jamais un programme de R&D significatif sans mobiliser un, deux, voire trois de nos clients ou prospects. Le fait que notre recherche intéresse un client ou un prospect est une bonne façon de nous assurer qu’elle crée de la valeur. L’initiative peut venir d’eux comme de nous. Leur intérêt se traduit par un co-financement du projet de R&D ou par un préachat des futures licences », explique Alain Di Crescenzo.
La protection de la propriété intellectuelle
Protéger l’innovation est une priorité. La présence de plus en plus importante des entreprises innovantes en Asie, et plus particulièrement en Chine, a rendu cette question encore plus prégnante. La plupart des chefs d’entreprises converge pour affirmer que la protection par les brevets n’est pas, loin s’en faut, une barrière à l’entrée suffisante. Comme le rappelle Olivier Desmarescaux (Eurotab), « Nestlé avait protégé son Nespresso par 1 800 brevets et a réussi à repousser ses concurrents pendant une quinzaine d’années, jusqu’au jour où Sara Lee et un fabricant de marques distributeurs ont réussi à les contourner. » D’autres formes de protection, comme, par exemple, imposer un rythme d’innovations soutenu ou personnaliser les produits, sont parfois plus efficaces.
Poclain Hydraulics a une politique de brevets bien structurée. « Nous avons une culture d’ingénieur et, par le passé, nous ne déposions que des brevets vraiment innovants. Aujourd’hui, nous commençons à raisonner en termes stratégiques et nous déposons aussi des brevets d’amélioration dans le but d’être les premiers à accéder au marché. Deux personnes s’occupent de cette question à temps plein. » Les produits de l’entreprise sont copiés en Chine, où la protection juridique ne sert pas à grand-chose. Laurent Bataille juge que la vraie protection réside dans la capacité de l’entreprise à innover en permanence et par la barrière à l’entrée représentée par les technologies elles-mêmes. « Nous travaillons par exemple à des pressions de 400 à 450 bars. Seule une dizaine de sociétés dans le monde sont capables de gérer ce niveau de pression. Les imitations de nos produits n’ont pas la même qualité ni surtout la même durée de vie que les nôtres. » Les relations suivies et de long terme avec les clients sont également un facteur de protection : « Entre le moment où émerge une idée nouvelle et le moment où le produit correspondant est mis sur le marché, il se passe à peu près dix ans. Nous travaillons sur la longue durée, à la fois en termes de R&D et dans nos relations avec nos clients. Si un nouveau venu vient leur présenter un produit concurrent, ils ne seront pas très enclins à lui faire confiance tout de suite. »
SNF a déposé au départ un certain nombre de brevets de fabrication de monomères par voie biologique, c’est-à-dire à partir de bactéries. Cette technologie a servi de base à tous les polymères produits. « Aujourd’hui, ce brevet est tombé dans le domaine public, mais nous continuons à développer des bactéries pour améliorer le procédé et chaque nouvelle génération de bactéries fait l’objet d’un brevet. […] Nous constatons que nous régénérons environ 10 % de notre portefeuille de produits tous les ans, mais c’est plus un état de fait qu’une cible. » Ces brevets sont destinés à protéger l’entreprise de ses concurrents mais aussi de ses clients. « C’est surtout avec des pétroliers et de grandes sociétés de service telles que Halliburton ou Schlumberger que nous pouvons rencontrer des difficultés en matière de propriété intellectuelle. Ces entreprises jouent le rôle d’intermédiaires entre les fournisseurs de technologies et les compagnies pétrolières, et à ce titre elles sont nos clientes, mais elles cherchent aussi à devenir des fournisseurs de technologies et, dans ce but, déposent des brevets à tour de bras. » SNF a aussi connu quelques déconvenues en Chine : « Un chercheur chinois que nous employions en France est parti avec un certain nombre de nos procédés. Nous sommes en procès contre lui depuis huit ans. En Chine, nos chercheurs récupèrent surtout de l’information sur les brevets chinois, plus qu’ils n’en produisent eux-mêmes. Les autorités chinoises tiennent à faire quelques exemples spectaculaires en matière de protection de la propriété intellectuelle, mais dans la vie de tous les jours, c’est la loi de la jungle. Cela dit, nous en tirons plutôt profit, car les Chinois publient beaucoup. »
Souvent la politique de brevets a d’autres fonctions que la seule protection. « Pour Eurotab, explique Olivier Desmarescaux, les brevets constituent aussi un levier de négociation avec nos clients : ils ne peuvent pas prétendre profiter de notre contribution et de notre valeur ajoutée tout en nous privant de notre propriété intellectuelle. C’est pourquoi nous déposons des brevets non seulement sur nos produits mais sur nos procédés et même, parfois, sur nos équipements industriels. Une fois l’affaire conclue, nos brevets protègent également notre client contre des concurrents éventuels. »
Enfin, dans certains secteurs d’activités, il n’y a pas de brevets, ou ceux-ci ne confèrent pas une protection suffisamment efficace. Pour Alain Di Crescenzo d’IGE+XAO, « La meilleure façon de nous protéger, c’est d’aller plus vite que nos concurrents. Cela dit, nous prenons quand même quelques précautions comme le fait d’éviter les standards du marché pour la protection de l’accès à nos logiciels car ce sont les premiers piratés. C’est ce qui nous a conduits à développer notre propre système de protection, basé sur des algorithmes bancaires. En revanche, toutes nos marques sont protégées. »
IDEES CLES – Conserver la propriété intellectuelle : une priorité absolue
Chez Somfy, « même lorsque nous concluons des partenariats avec de grandes entreprises, comme Gaz de France ou Philips, nous ne cédons jamais notre technologie. Nous préférons renoncer à une affaire plutôt qu’abandonner notre propriété intellectuelle, gage de notre succès et de notre pérennité à long terme. »
Chez IGE+XAO, « quand nous développons une innovation avec un client, il bénéficie de conditions avantageuses (prix et/ou services), mais c’est nous qui conservons la propriété intellectuelle. C’est ce qui nous permet de réutiliser l’innovation dans nos produits. Cette clause est quasiment une condition sine qua non pour la mise en place d’un partenariat. »
Même discours chez Eurotab, « nous conservons la propriété intellectuelle, même lorsque nous avons affaire à un groupe très puissant comme un lessivier ou une multinationale de l’agroalimentaire, et alors même que nous avons absolument besoin de notre client pour établir le cahier des charges, le valider, réaliser des expertises fonctionnelles, etc. En contrepartie, nous leur offrons l’exclusivité du brevet, ce qui ne nous pose pas de problème dans la mesure où nos partenaires sont souvent des leaders mondiaux. Tout ce que nous inventons reste notre propriété, et si notre partenaire n’accepte pas ces conditions, nous ne faisons pas affaire. Nous devons trouver un équilibre délicat entre la nécessité de rester propriétaires de nos inventions et celle de travailler dans une grande intimité et “à livre ouvert” avec notre client. Les négociations sont souvent longues, mais en général, elles aboutissent. »
La transformation du business model par l’innovation
Changer de métier
Une innovation réussie peut conduire l’entreprise beaucoup plus loin que la simple mise sur le marché de nouveaux produits. L’innovation produit s’accompagne fréquemment d’innovations process, puis du développement de services d’accompagnement. Par réactions en chaîne, cela peut l’amener à une transformation substantielle de son business model, de son « terrain de jeu » et de son organisation. C’est alors toute l’entreprise qui se trouve réinventée.
Lorsque Luc Darbonne rejoint, en 1974, l’entreprise familiale qui produit des plants d’asperges et des herbes aromatiques, il décide de passer d’agriculteur à industriel et se lance dans la surgélation des herbes aromatiques. « La première année, je n’en ai vendu que 300 kg. Le premier client que j’ai livré, avec un camion de location, était Armand Decelle, qui venait d’ouvrir son premier magasin Picard à Fontainebleau. Le choix du surgelé a coïncidé avec la vague nouvelle des plats préparés, des sandwiches et des sauces à emporter : j’apportais aux industriels la solution dont ils avaient besoin. » Luc Darbonne met au point une technique de production de flocons de feuilles surgelés saupoudrables. « J’ai déposé un brevet sur cette technique et c’est sur ce brevet qu’a reposé tout le développement ultérieur de l’entreprise. » En quarante ans, le chiffre d’affaires des herbes aromatiques est passé de 1 à 118 millions d’euros.
À l’époque où Clextral n’était encore qu’une unité de Creusot-Loire, elle vendait des lignes de plasturgie à Rhône-Poulenc et elle le faisait sur cahier des charges. Elle restait donc un équipementier : seul le client maîtrisait le process. C’est le fait de se lancer dans l’agroalimentaire qui a permis à Clextral de devenir une entreprise innovante. « Nos premiers clients en agroalimentaire ne connaissaient pas l’extrusion bi-vis, rapporte Georges Jobard, ce qui nous a laissé le temps de développer notre compétence process et nous a permis de les entraîner dans notre propre dynamique d’innovation. » (voir encadré ci-contre).
EN SAVOIR PLUS – Comment la Cracotte a ouvert à Clextral le marché des industries agroalimentaires
En 1971, le Centre technique de l’union des céréaliers (CTU) organise une mission aux États-Unis pour étudier la façon dont sont valorisés les produits issus du maïs. Il découvre un procédé mis au point par une société familiale, Wenger : une machine mono-vis cuit les grains de maïs sous pression, comme dans une cocotte-minute ; au moment où le maïs sort de la machine, il s’expand instantanément et devient croustillant.
Le CTU cherche alors des constructeurs français de mono-vis pour concevoir avec eux des produits innovants à partir de céréales. N’en ayant pas trouvé, il se rabat sur l’extrusion bi-vis de Creusot-Loire. Cette société a été suffisamment iconoclaste pour accepter de mettre de la farine dans une machine destinée à fabriquer du plastique, et le résultat a été un pain plat qui a connu un énorme succès. Commercialisé en France sous le nom de Cracotte, il s’est répandu dans le monde entier sous divers noms et avec des recettes variées. Le co-développement a été assuré avec la société Diepal, ultérieurement rachetée par BSN.
Dès ce moment, Clextral est identifiée par l’industrie agroalimentaire comme possédant une technologie permettant de créer des produits innovants dans des conditions de fabrication très intéressantes, c’est-à-dire en continu et en utilisant très peu d’eau.
Changer d’organisation
La montée en gamme induite par l’innovation et la transformation du business model peuvent s’accompagner de la modernisation de l’outil de production, d’investissements lourds dans des systèmes d’information intégrés et dans des processus qualité avec les certifications ISO. Le franchissement de ces étapes permet à l’entreprise de s’établir (ou de se maintenir) comme leader de sa niche et de conserver la confiance de ses clients.
Un des cas les plus emblématiques de ce type de mutation est celui de la société ERMO. En 1979, Jean-Yves Pichereau crée, à l’âge de vingt-six ans, ERMO (Études réalisation moules et outillages), spécialisée dans la conception et la fabrication de moules d’injection destinés à la production de pièces en matière plastique. Pendant vingt ans, il produit des moules pour l’automobile, l’électroménager, la bureautique, la télévision et la téléphonie. « À partir des années 2000, toutes ces industries se sont délocalisées en Asie et la fabrication de téléphones mobiles s’est effondrée. » Jean-Yves Pichereau décide alors de réinventer son entreprise, en la positionnant sur un nouveau marché, celui de la production de bouchons en grand volume et à haute cadence, par exemple pour la fabrication de bouchons de bouteilles d’eau minérale. Chaque moule comprend jusqu’à 128 empreintes, ce qui permet de produire 128 bouchons en moins de trois secondes. Le marché à haute cadence est beaucoup plus exigeant que celui des moules destinés à l’industrie automobile, pour lesquels il n’y a qu’une empreinte par moule et où les pièces peuvent être ajustées. Passer d’un marché à l’autre s’est avéré difficile. « Cela nous a pris cinq ans, raconte Jean-Yves Pichereau. Nous avons dû investir énormément pour démontrer notre volonté de monter en gamme. » ERMO est l’un des premiers moulistes à introduire des machines à commande numérique, des postes de conception tridimensionnelle CATIA, des robots, des certifications ISO‚ à maîtriser de nouvelles techniques et à apporter des services en amont et en aval. L’entreprise connaît depuis une croissance à deux chiffres (49 % en 2011).
Chez Multiplast, lorsqu’il s’est agi de passer de la construction de voiliers à l’aéronautique, il a fallu remplir un certain nombre de conditions : « La première consistait à instaurer un contrôle de qualité. La responsable qualité de mon entreprise aéronautique de Nantes a accepté d’être mutée à Vannes. Comme elle connaissait bien l’aéronautique, elle a mis en place chez Multiplast un système de management de la qualité correspondant aux attentes d’Airbus. Nous en sommes actuellement à la phase de certification ISO. Nous avons également dû nous adapter aux normes industrielles en matière de HSE (hygiène, sécurité, environnement). J’ai fait peindre les sols de l’atelier avec de la peinture antipoussière, de façon à ce que les industriels visitant l’entreprise retrouvent l’environnement qui leur est familier. »
Le système public de soutien à l’innovation : pôles de compétitivité, recherche publique, CIR
Le soutien public à l’innovation fait l’objet d’appréciations contrastées par les PMI/ETI. Les pôles de compétitivité reçoivent une appréciation globalement positive. La recherche publique est encore jugée difficile d’accès. Le CIR est plébiscité par ceux qui en bénéficient.
Apprivoiser les pôles de compétitivité
Parce qu’elles disposent souvent de moins de moyens de R&D que les grands groupes, les PMI/ETI sont supposées travailler davantage en réseau et mutualiser leurs moyens, soit pour avoir accès à la recherche fondamentale des grands groupes et des laboratoires publics, soit pour créer leurs propres structures de recherche. Si les pôles de compétitivité ont beaucoup contribué à ouvrir les réseaux et à favoriser les coopérations, il n’en demeure pas moins que les réflexes individualistes perdurent. Les PMI jugent les pôles difficiles d’accès et il y a sur ce point une différence d’appréciation assez nette entre PMI et ETI.
Clextral, la « multinationale de poche » de l’extrusion bi-vis, qui se situe à la lisière entre PMI et ETI, est membre de quatre pôles de compétitivité. Selon Georges Jobard, son PDG, il n’y a pas encore de retombées en termes de chiffre d’affaires, à l’exception de la vente de quelques machines de laboratoire. « En revanche, les pôles nous ont permis de faire labelliser des projets de R&D et d’obtenir des subventions du FUI (Fonds unique interministériel). Nous travaillons par exemple avec Limagrain et l’Institut national de la recherche agronomique sur la sélection de céréales qui permettraient de produire des cornflakes avec beaucoup moins d’eau, tout en ayant une croustillance et un goût supérieurs. » Le pôle est aussi perçu comme ayant des vertus de décloisonnement. « J’apprécie beaucoup, explique Georges Jobard, de pouvoir se parler entre ingénieurs d’entreprises différentes, sans que les acheteurs et les juristes s’interposent et nuisent à la coopération. »
Didier Fégly, PDG de Sacred, et président fondateur du pôle de compétitivité Elastopôle dans l’industrie du caoutchouc et des polymères, souligne les aspects positifs de la création des pôles dans la construction de nouvelles coopérations : « Avant la création d’Élastopôle, nous avions peu de contacts avec les universités. Aujourd’hui nous travaillons davantage avec celles d’Orléans, de Tours, de Clermont-Ferrand, de Nantes. J’ai également découvert de nouvelles entreprises, car la majorité des 110 membres actuels du pôle ne participent pas aux réunions syndicales qui se tiennent à Paris. Dans l’industrie du caoutchouc, comme ailleurs, la tendance est à rester chacun de son côté. Aujourd’hui, le pôle fédère une cinquantaine de projets, dont chacun réunit au moins une dizaine d’entreprises ou de centres de recherche. »
Néanmoins, comme le souligne Georges Jobard, les pôles demeurent peu accessibles pour les PMI. « La principale barrière à l’entrée des pôles de compétitivité pour une PMI est de ne pas être suffisamment familiarisée avec la culture et le comportement des grands groupes. Il est parfois très difficile, pour un patron de PMI, de comprendre le langage d’un grand groupe ou celui d’un universitaire. […] Il faudrait que les gens passent plus souvent d’un univers à l’autre. »
Chez Eurotab, Olivier Desmarescaux déclare : « Nous nous sentons assez peu concernés par les pôles de compétitivité. Faire financer un projet de R&D par le FUI en partenariat avec un pôle est trop complexe pour une entreprise comme la nôtre, et ce serait de toute façon assez artificiel. Nous préférons suivre notre propre stratégie plutôt que nous imposer de répondre à certaines conditions pour pouvoir participer aux programmes des pôles. »
IDEES CLES – Créer son propre laboratoire de recherche collaboratif en l’absence de pôle dédié à son activité
Le groupe Poujoulat, le leader européen de la fabrication des conduits de cheminée, a créé, en l’absence de pôle dédié, son propre laboratoire de recherche, le CERIC (Centre Essais Recherches des Industries de la Cheminée). Frédéric Coirier, son président, explique cette initiative : « Avec l’appui de l’Ademe (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) et de l’ANR (Agence nationale de la recherche), nous lançons des programmes de recherche thématiques auxquels nous associons d’autres fabricants ainsi que des centres de recherche universitaires. Ce dispositif nous permet d’entretenir des relations avec l’ensemble de notre profession et de compenser un peu l’absence de pôle de compétitivité dans notre domaine. Par ailleurs, grâce à notre site de Saint-Étienne, nous avons la possibilité de travailler en partenariat avec l’École supérieure du design et avec la Cité du design. »
Les liens complexes entre recherche publique et industrie
Le sujet est assez clivant : certains industriels constatent une amélioration des possibilités de collaboration avec la recherche publique, d’autres jugent toujours le système trop lourd, surtout s’ils le comparent aux pratiques de certaines universités étrangères.
Chez Thuasne, Elizabeth Ducottet juge les relations excellentes. « Nos produits doivent obligatoirement être testés et expérimentés en collaboration avec le corps médical, ce qui nous conduit à travailler en partenariat étroit avec les CHU (centre hospitalier universitaire). Nous accueillons en permanence des doctorants en contrat Cifre, qui mènent leurs recherches à la fois à l’université et dans l’entreprise. On peut parler d’une véritable osmose entre l’activité scientifique et l’activité économique. »
Chez Eurotab, Olivier Desmarescaux considère que les partenariats avec des laboratoires publics sont complexes à organiser pour une PME. Mais, ayant besoin de fonder ses produits sur des certitudes scientifiques, l’entreprise a pu établir plusieurs contrats de coopération, notamment pour avoir accès à du matériel d’analyse et à des prestations d’expertise.
Certains déplorent la difficulté de proposer un projet à des chercheurs ou ne serait-ce qu’une orientation de recherche. Par comparaison, les relations avec les universités étrangères paraissent plus adaptées aux besoins des ETI. Elizabeth Ducottet en témoigne : « Les conditions de partenariat avec les centres de recherche publics sont toujours délicates : la confidentialité est difficile à obtenir, l’achat des brevets est impossible. Je reviens d’un voyage à Boston et il m’a suffi de passer une demi-journée dans une université américaine pour entrer en contact avec un chercheur dont le travail correspondait très précisément à ce dont j’avais besoin. Ce chercheur va s’occuper du projet qui nous intéresse en étant encadré par un professeur, qui est lui-même entrepreneur et a déjà fondé sa société. Il est dommage que nous ne puissions pas obtenir les mêmes prestations dans des laboratoires situés dans notre région, qui mènent des travaux remarquables dans les nanotechnologies et le textile. »
Pascal Rémy chez SNF se montre encore plus mordant : « Lorsqu’il nous arrive de travailler avec les quelques universitaires qui continuent à s’intéresser aux hydrocarbures, ils cherchent généralement à placer chez nous des doctorants ou des post-docs. C’est légitime, mais financer un doctorant pendant trois ans avant d’obtenir le moindre résultat est beaucoup trop long. Aux États-Unis, les universitaires mettent leurs propres compétences à la disposition des entreprises. Nous leur soumettons un problème et ils réalisent en quelques mois des études que nous rémunérons et qui leur permettent de financer les doctorats et post-docs mobilisés sur ces recherches. Faute de dispositif satisfaisant en France, nous signons de très nombreux contrats avec des universités américaines. Ils prennent parfois la forme de groupes de travail associant universitaires et industriels sur un sujet donné, chacun apportant sa contribution financière et scientifique et bénéficiant en retour du partage des informations. En général, ces groupes réunissent un budget de 10 à 20 M$. Dans notre domaine, c’est souvent le département américain de l’énergie qui apporte une subvention initiale, à laquelle s’ajoutent les financements apportés par les universités. Les industriels contribuent généralement à hauteur de 500 000$ $. »
Vive le CIR !
Succès incontestable et incontesté pour le crédit d’impôt recherche. Les entreprises qui en bénéficient le plébiscitent, celles qui n’en bénéficient pas s’en plaignent. Toutes en appellent à la continuité de ce dispositif essentiel pour la R&D, moyennant des règles stables et cohérentes. De la sécurité juridique en somme.
Dominique Dubois, président de Multiplast qui fabrique des voiliers de compétition, précise que sa société est bénéficiaire grâce au crédit d’impôt recherche (CIR) et au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). « C’est un peu triste car, si les charges étaient moins élevées, notre bilan serait tout à fait correct et ressemblerait à ceux de nos concurrents étrangers. Avec le CIR et le CICE, nous sommes comme un homme sur un escabeau avec la corde au cou, à redouter le moment où quelqu’un décidera d’enlever l’escabeau… »
EN SAVOIR PLUS – Le CIR en chiffres
Depuis sa réforme de 2008, le crédit d’impôt recherche est devenu le premier dispositif de financement public de R&D. En 2012, quelque 20 400 entreprises (+ 6 % par rapport à 2011) ont déclaré 18,4 milliards d’euros de dépenses. La créance du CIR s’élève à 5,2 milliards d’euros. Près de 15 300 entreprises en ont bénéficié, dont près de 89 % de PME (MENESR 2013). Le taux de financement via le crédit d’impôt recherche est d’autant plus élevé que l’entreprise est petite (près de 32 % pour les entreprises de moins de 10 salariés) même si le montant du crédit d’impôt augmente avec l’effort de R&D et donc, assez logiquement en moyenne, avec la taille du bénéficiaire. Rappelons qu’il est affecté d’un taux réduit au-delà de 100 M€ de dépenses déclarées et assorti d’un taux majoré pour les nouveaux entrants, principalement issus des entreprises de moins de 250 salariés. Signalons enfin que les PME indépendantes tendent à externaliser davantage que les autres entreprises leurs travaux de R&D auprès des laboratoires publics, les dépenses correspondantes bénéficiant d’un crédit d’impôt majoré.
Source : TiVA, OCDE
Source : Bpifrance, PME 2014, Rapport sur l’évolution des PME, La Documentation française, mars 2015.
Pour Guillaume Bataille, directeur général délégué de Poclain Hydraulics : « Le CIR nous permet de localiser en France la R&D, ce qui tire les usines locales. L’alternative, ce serait d’ouvrir un bureau d’études en Slovaquie. Grâce au CIR, nous pouvons même embaucher en avance de phase et être capable de mener une politique de plus long terme. »
Jean-Yves Pichereau chez ERMO, lui, n’a pas obtenu le CIR : « Pendant la crise, au lieu de mettre tous les salariés au chômage, j’ai demandé à certains d’entre eux de faire de la R&D. C’est de cette façon qu’ils ont inventé un système d’assemblage des pièces à l’intérieur des moules. J’ai adressé au ministère une demande de CIR à propos de cette innovation, ce qui m’a aussitôt valu un contrôle fiscal. La personne chargée du dossier a demandé l’avis du ministère de l’Économie et des Finances, et ce dernier a estimé qu’il s’agissait bien de recherche. Elle a ensuite demandé les noms et qualités des salariés qui avaient travaillé sur le dossier et, constatant qu’il n’y avait pas d’ingénieur parmi eux, elle a refusé l’attribution du CIR. J’ai pourtant des salariés qui, après 35 ans de métier, sont vraiment brillants et capables d’inventer des choses auxquelles jamais un ingénieur n’aurait pensé. Et par ailleurs, cette innovation nous a valu des commandes pour 6 millions d’euros… » Rappelons-nous des médecins de Molière : « Un malade ne doit point vouloir guérir que la Faculté n’y consente. »
D’autres ont appris à se débrouiller seuls. « En ce qui concerne la R&D et plus précisément sur des prestations de service, nous n’avons pratiquement droit à aucune aide publique, déclare Emmanuel Hervé, président du groupe Hervé. Que ce soit en matière sociale ou fiscale, une ETI est mise sur le même plan qu’un grand groupe. Nous partons du principe que nous devons nous débrouiller tous seuls (sans attendre des aides), et comme l’innovation coûte cher, nous passons systématiquement par des partenariats. »
Pour conclure, écoutons le satisfecit nuancé donné par Didier Fégly (Sacred) au système public d’aide à l’innovation : « Sans le pôle de compétitivité, nous n’aurions jamais pu lancer les projets actuels labellisés et acceptés, qui représentent plus de 170 M€ de R&D mutualisée et mobilisent en moyenne une dizaine d’acteurs par consortium. Entre ces premiers résultats et ceux que nous pouvons espérer atteindre, il nous reste une belle marge de progression. Mais il faut aussi que chacun prenne sa part de responsabilité : on critique beaucoup l’État, trop à mon avis, mais de nombreuses entreprises restent trop isolées par individualisme et par crainte du partage. C’est aussi contre ces pesanteurs-là que nous devons nous battre. »
Innovation
Maîtriser l’innovation sur toute la chaîne de process afin de mieux répondre aux demandes des clients.
Savoir repérer, intégrer ou adapter les innovations des autres.
Cibler des segments de marché négligés afin de capter une nouvelle demande.
Conserver la propriété intellectuelle, au besoin en offrant des compensations aux clients (exclusivité, tarifs avantageux sur le nouveau produit).
Imposer un rythme d’innovations soutenu ou personnaliser les produits.
Déposer des brevets sur les produits, leur amélioration, les procédés et parfois même les équipements industriels.
À défaut de protéger le produit, protéger ses marques.
Impliquer la direction dans le pilotage de l’innovation que ce soit en interne, par le suivi des équipes de R&D, ou en externe par le réseautage.
Privilégier le travail en petite équipe de chercheurs sans les isoler du reste de l’entreprise.
Recruter des candidats qui adhèrent à la culture d’innovation de l’entreprise. Offrir aux chercheurs des « temps libres » afin de stimuler l’émergence de nouvelles idées.
Promouvoir les rencontres et les échanges entre clients et chercheurs pour s’assurer notamment de la déclinaison opérationnelle, commerciale du projet. facteurs de succès
- 18 – Bpifrance, Rapport sur l’évolution des PME 2014, La Documentation française, mars 2015.
- 19 – OpinionWay pour KPMG, mars 2011.
- 20 – Bpifrance, PME 2013, Rapport sur l’évolution des PME, La Documentation française, février 2014.
- 21 – Op. cit.
- 22 – Quelques marchés de niche comme la cosmétique ou l’agriculture, où les clients sont très « dilués », font cependant exception.
Financement, gouvernance et succession : l’obsession du contrôle
À RETENIR
La stabilité de l’actionnariat est systématiquement évoquée comme un atout de développement par toutes les entreprises qui en bénéficient. Elle conditionne la vision de long terme.
Ceci explique que les ETI familiales privilégient souvent l’autofinancement et se méfient des investisseurs extérieurs qui changent l’horizon temporel de l’entreprise.
Lorsqu’elles font entrer des investisseurs extérieurs, leur principale préoccupation est de garder le contrôle.
Les investisseurs extérieurs peuvent cependant « professionnaliser » la gestion de l’entreprise.
Les réglementations boursières sont encore peu adaptées à la taille des ETI.
Dans les entreprises familiales, des règles claires de gouvernance doivent permettre de distinguer stratégie patrimoniale et stratégie opérationnelle.
La succession du dirigeant doit être anticipée et préparée afin de prévenir les risques de conflit entre générations.
Le coût de la transmission s’est nettement amélioré mais demeure supérieur à la moyenne européenne.
Les stratégies de croissance des ETI impliquent une mobilisation importante de capitaux. Le crédit bancaire n’y suffit généralement pas, d’autant que les conditions d’accès se sont récemment durcies. Les ETI sont alors partagées entre leur volonté de se développer et la crainte de perdre leur indépendance. Peuvent-elles alimenter leur croissance par des apports en capital, tout en conservant leur gouvernance et leur projet ? Parmi les différentes sources, autofinancement, emprunts bancaires, investissements privés, introduction en Bourse, ou encore actionnariat salarié, quelles sont celles qu’elles privilégient ? On note que le changement de structure actionnariale induit par les différents choix est apprécié diversement selon l’histoire et la configuration de l’entreprise.
Le choix de l’autofinancement
Plus que les autres, les entreprises familiales bâties sur plusieurs générations sont très attachées à leur indépendance. Pour cette raison, elles se méfient souvent des investisseurs extérieurs, soupçonnés de privilégier le court terme sur le temps long du développement. L’entreprise privilégie alors l’autofinancement et le recours à l’emprunt bancaire, ce qui peut se justifier si sa santé financière est bonne.
Ce choix est parfaitement illustré par Philippe d’Ornano, président de Sisley : « Notre famille travaille dans les cosmétiques depuis trois générations. Mon père a co-créé la marque Lancôme avec un associé et la lui a revendue assez rapidement pour créer avec ses deux fils l’entreprise Orlane, juste après la guerre. En 1975, après avoir vendu à un groupe américain, il a créé avec ma mère une nouvelle entreprise de cosmétiques, Sisley, qui compte actuellement 4 000 salariés. J’ai rejoint cette société dix ans plus tard, et ma sœur en a fait de même quelques années après. Nous sommes donc deux générations à être actionnaires de l’entreprise. » Selon Philippe d’Ornano, une entreprise familiale ne fait appel à un investisseur extérieur que si elle a un projet précis de développement et qu’elle ne dispose pas d’autofinancement suffisant pour le mener à bien. Dans les autres cas, il vaut mieux privilégier l’autofinancement, qui lui donne de la liberté et du temps pour construire sa marque. « La force d’une entreprise familiale, insiste-t-il, est de pouvoir développer une vision de long terme dans la construction de sa marque. Les investisseurs extérieurs n’ont pas du tout le même horizon de temps et peuvent exercer une pression pour infléchir la stratégie de l’entreprise. »
Comment faire alors pour financer des investissements lourds et dont la rentabilité ne se conçoit qu’à moyen et long terme, comme l’ouverture de filiales à l’étranger ou l’extension et la modernisation de l’outil de production ? Pour financer un investissement de l’ordre de 150 millions d’euros, à la fois dans un laboratoire de recherche, des usines de fabrication et la logistique, Sisley a fait appel à l’emprunt, « ce qui a été relativement facile dans la mesure où l’entreprise n’avait jamais emprunté, sauf au tout début. L’ensemble de l’investissement a été couvert par cet emprunt, qui aujourd’hui est en bonne partie remboursé », précise Philippe d’Ornano. Mais le recours à l’emprunt dépend évidemment de la bonne santé financière de l’entreprise. Philippe d’Ornano, également coprésident de METI23, reconnaît que l’« on ne prête qu’aux riches » et constate que « la situation est de plus en plus difficile pour les entreprises françaises qui sollicitent des prêts, même lorsqu’elles sont en bonne santé. » Il faut donc rester pragmatique en fonction des projets et des situations : « Nous ne nous interdirons pas de faire appel à des financements extérieurs, s’il se présente un jour une opportunité ou un besoin particulier. »
Les investisseurs extérieurs
Pour ne pas renoncer à des investissements, les PMI/ETI peuvent au contraire choisir d’ouvrir leur capital, sans pour autant baisser la garde quant à leur indépendance. À quels types d’investisseurs s’adressent-elles ? Quels sont leurs points de vigilance ?
Les fonds d’investissement
Chez Darégal, le leader mondial des herbes aromatiques, deux fonds d’investissement sont entrés au capital en 1992, à hauteur de 24 %. Selon Luc Darbonne, le fondateur, « leur rôle a été très positif. Ils ont facilité la compréhension, par certains membres de la famille, de la nécessité d’assurer la profitabilité de l’entreprise en améliorant ses rendements. Ils nous ont également aidés à réaliser des investissements importants, notamment la construction d’une chambre froide d’un montant de 10 M€. Nous avons réalisé cet investissement en Espagne, ce qui nous a permis de bénéficier de subventions européennes représentant 30 % du montant. Au bout de vingt ans, ces deux fonds ont souhaité, légitimement, récupérer leur investissement. L’opération a été très bénéfique pour eux et nous l’avons financée par l’emprunt, en profitant des taux actuels extrêmement bas ». Comme le précise André Ulmann (HRA Pharma), l’avantage d’un fonds d’investissement ne se limite pas à l’apport d’argent frais : « En faisant entrer un fonds d’investissement dans notre capital, nous avions aussi pour objectif de bénéficier de son réseau. De fait, nous sommes désormais beaucoup plus visibles et nous avons accès à bien plus d’opportunités qu’auparavant. Un emprunt bancaire ne nous aurait pas offert les mêmes avantages. »
EN SAVOIR PLUS – Daher, bénéficiaire des premiers investissements du FSI
Lorsque Daher, une entreprise de services logistiques avec quelques activités de fabrication, décide de devenir un industriel à part entière, elle se trouve confrontée à un défi de financement. En 2008, au début de la crise financière, elle décide de racheter sur ses fonds propres une filiale d’EADS et, compte tenu de son appartenance à une filière stratégique, elle en informe le ministère de l’Économie et des Finances. Elle explique alors que si elle n’a pas de difficultés particulières pour financer le rachat, elle ne pourra pas investir dans l’immédiat dans le développement de l’entreprise, faute de crédits bancaires. Au même moment, le ministère recherche des entreprises « modèles » pour réaliser les premiers investissements du FSI (Fonds stratégique d’investissement) dont la création est imminente. Cette entreprise modèle, ce sera Daher. En quinze jours, l’affaire est bouclée et trois semaines plus tard, le président Sarkozy annonce la création du FSI depuis l’une des usines Daher, à Montrichard. « Grâce aux 80 millions d’euros apportés par le FSI, nous avons pu lancer un plan d’investissement de 280 millions d’euros sur cinq ans et, en pleine crise financière, nous avons notamment créé une usine de thermoplastique de nouvelle génération à Nantes et une usine logistique dédiée à Eurocopter à Marignane », s’étonne encore Didier Kayat, le DG.
Garder le contrôle
Limiter la part d’ouverture du capital n’est pas forcément suffisant pour conserver le contrôle de la société « Lorsque les actionnaires décident d’ouvrir le capital de leur entreprise, ils prennent un risque. Le nouvel investisseur entre au capital sur la base d’un business plan et des engagements pris par la direction. Si ceux-ci ne sont pas tenus, les clauses de dilution risquent de conduire à la perte du contrôle », indique André Ulmann.Comment alors contrôler ce risque ?
La première règle consiste à choisir un fonds d’investissement adapté à son projet et à ses besoins. « Nous avons cherché une banque d’investissement qui réponde à trois critères : accepter la valorisation que nous proposions, être capable de nous défendre et avoir un réseau qui nous permette d’accéder à des projets intéressants, raconte André Ulmann. Une quinzaine de candidats investisseurs se sont présentés. (…). Nous avons opté pour celui dont nous pensions qu’il nous laisserait le plus grand contrôle en matière de gouvernance, et qui par ailleurs avait la plus grande envergure financière et le meilleur réseau international. »
D’autres mesures peuvent aussi être prises pour limiter le risque : s’engager sur des chiffres réalistes et tenir ses engagements, mettre en place un dispositif définissant précisément les prérogatives de chacun (pacte d’actionnaires, voir encadré) et, surtout, bien évaluer les montants dont on a besoin. Souvent, les banques recommandent aux entreprises de demander l’apport de fonds le plus élevé possible, au prétexte qu’une ouverture de capital est un processus long et difficile. « Je crois au contraire qu’il faut limiter l’ouverture du capital au strict nécessaire, de façon à conserver aussi longtemps que possible le contrôle de l’entreprise », précise André Ulmann.
EN SAVOIR PLUS – Le pacte d’actionnaires
Le pacte d’actionnaire est un document juridique et technique indispensable pour régir les relations entre les différents actionnaires et, notamment, prévenir des litiges futurs. Contrairement au pacte d’associés qui est destiné aux SARL, il concerne les sociétés anonymes.
Le pacte d’actionnaires est un contrat, il ne peut donc contenir des clauses ne respectant pas le droit des sociétés et allant à l’encontre des statuts. Il est confidentiel : il n’est connu que des seuls signataires. Cependant, les sociétés cotées doivent communiquer les clauses concernant les conditions d’acquisition et de cession des actions à l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Un pacte d’actionnaires peut contenir de nombreuses clauses. Elles sont réparties en trois grandes catégories :
– les clauses concernant le capital social : elles permettent aux signataires de gérer la composition du capital ;
– les clauses concernant l’exercice du droit de vote : par exemple quelles décisions devront être prises à l’unanimité ;
– les clauses relatives à l’organisation et à la gestion de la société : procédure en cas de conflit, limitation du pouvoir, accès à l’information, etc.
Les actionnaires étrangers
Affival (producteur de fil fourré), ancienne filiale de Vallourec, a été cédé en 2004 à un actionnaire allemand devenu le groupe SKW Métallurgie, coté à la Bourse de Francfort. Claude Lenoir, son président, apprécie la qualité et le support de ses actionnaires allemands, tout en restant prudent pour l’avenir. « La vision à plus ou moins long terme nous permet d’investir entre 750 000 euros et 1 million d’euros par an en France, notamment dans la R&D, ce qui est remarquable pour un petit groupe français. Pour l’instant, c’est cette tendance qui domine tout en ayant des exigences de résultats, ce qui est normal. Mais il est possible que les choses évoluent avec la crise, la réduction de la rentabilité des entreprises, la nécessité de produire à proximité des clients. »
Aventics France est une ancienne filiale du groupe Bosch, spécialisée dans les composants et systèmes pneumatiques, située à Bonneville en Haute-Savoie. En 2014, Bosch l’a revendue à un fonds d’investissement germano-scandinave et le siège du nouveau groupe Aventics se situe à Hanovre. Comme l’explique Étienne Piot, président pour la France, qui a suivi la destinée de l’entreprise après la cession par Bosch : « L’objectif du nouvel actionnaire est parfaitement aligné avec le nôtre : il s’agit de développer l’activité pour la valoriser au mieux au moment de la sortie. L’horizon est de cinq à sept ans. À l’issue de cette période, nous devrons envisager soit la revente, soit l’introduction en Bourse. »
Un actionnaire majoritaire familial de référence
Une autre solution peut consister à trouver un actionnaire majoritaire de référence qui partage les valeurs de l’entreprise et ses ambitions de développement. En 1984, Somfy a été rachetée par le groupe Damart, qui cherchait à se diversifier. Au fil du temps, Somfy s’est beaucoup plus développée que Damart, avec un taux de croissance moyen d’environ 15 % par an. En 2002 a eu lieu un spin off boursier. La famille est restée actionnaire de Somfy à 70 %. Une petite partie du capital est détenue par des investisseurs et le reste est coté en Bourse. « Nous venons de fêter les trente ans de l’acquisition de Somfy par Damart, raconte Jean-Philippe Demaël, son DG. Notre actionnaire considère l’entreprise comme faisant durablement partie du patrimoine de sa famille, pour cette génération et pour les suivantes, ce qui apporte une grande sérénité aux salariés. »
C’est également le cas de Clextral qui, après avoir expérimenté diverses formes actionnariales, a été achetée en 2007 par Legris Industries, un groupe familial diversifié qui partage la vision managériale des dirigeants.
Entrer en Bourse
Le cas d’ERMO illustre bien les ambivalences de la cotation en Bourse pour une ETI. Jean-Yves Pichereau, qui a fondé cette entreprise de moules à injection, raconte : « En 1998, tout le monde s’introduisait en Bourse. J’ai cédé 10 % des actions et j’ai augmenté le capital de 5 %. La valorisation de l’entreprise a été très élevée, puis elle est retombée très vite. Lors de l’introduction, les actions se vendaient 10 euros. Aujourd’hui, alors que l’entreprise est quatre fois plus importante, le cours est à 8 euros seulement. Cela dit, les actionnaires ne se plaignent pas, car ils perçoivent des dividendes élevés chaque année. L’entrée en Bourse n’était pas vraiment indispensable mais elle nous a beaucoup appris. Les analystes nous ont poussés à accroître notre efficacité et nous n’aurions sans doute pas connu la même croissance sans cette opération. Il y a quelques années, je me suis dit que cela n’avait plus beaucoup de sens et j’ai envisagé de sortir. C’est alors qu’est arrivée la crise de 2009. Je n’ai pas eu envie de consacrer 2 millions d’euros à récupérer 17 % des actions alors qu’avec 83 % du capital, je vis très bien et que personne ne vient m’embêter. »
Alain di Crescenzo, PDG d’IGE+XAO, se félicite pour sa part de l’introduction en Bourse. « Depuis notre entrée en Bourse, la valeur de notre action a été multipliée par 7 et rien qu’au cours des deux dernières années, elle a progressé de 105 %. Chaque année, nous versons des dividendes à nos actionnaires. La Bourse, c’est l’indépendance ! À condition, bien sûr, d’apporter aux investisseurs les résultats qu’ils sont en droit d’attendre. » Mais il faut être disposé à en assumer les contreparties, dont la communication qui est quelques fois un peu lourde pour une entreprise, ou encore la perte du contrôle. « C’est la règle du jeu. Lorsque nous sommes entrés en Bourse, notre chiffre d’affaires était de 10 millions d’euros et nous enregistrions des pertes. Cette opération nous a permis de lever 5 millions d’euros et de financer notre développement international et nos produits. », conclut Alain di Crescenzo.
EN SAVOIR PLUS – Avantages et inconvénients d’une entrée en Bourse
Pour une entreprise familiale, l’introduction en Bourse présente des avantages indéniables, comme l’exigence accrue portée par un nouveau regard extérieur à l’entreprise, mais elle s’accompagne aussi de plusieurs inconvénients. D’abord, l’entrée au capital d’investisseurs extérieurs modifie l’horizon de temps de l’entreprise. Ensuite, les réglementations boursières sont encore peu adaptées aux ETI et encore moins aux PME. La cotation boursière représente un coût substantiel, de l’ordre de 600 000 à 700 000€ € par an, et alourdit la pression fiscale, notamment au moment de la transmission. Elle oblige également à livrer de grandes quantités d’informations sur l’entreprise et sur son modèle économique. C’est particulièrement risqué pour une ETI, dont les concurrents peuvent être des groupes plus puissants aux comptes parfois moins lisibles (multimarques, basés à l’étranger…). Enfin, il est difficile, pour une ETI ou une PME, de sortir de la Bourse une fois qu’elle y est entrée. Il suffit, qu’un spéculateur s’y oppose, comme beaucoup d’ETI en ont fait la désagréable expérience.
Actionnariat familial et gouvernance
Si l’arrivée de tiers investisseurs peut venir perturber le management d’une entreprise, doit-on en déduire que la vie ne serait qu’un long fleuve tranquille pour celles dont le capital reste familial ? Loin de là ! Comme l’écrivit la comtesse Diane de Beausacq, « La famille est un ensemble de gens qui se défendent en bloc et s’attaquent en particulier. » Aux dires de plusieurs membres d’entreprises familiales, ceci n’est pas une caricature. Les embûches sont multiples et une solide gouvernance s’impose.
Distinguer stratégie patrimoniale et stratégie entrepreneuriale
La gestion d’une entreprise familiale peut rapidement devenir très compliquée si chaque cousin a son mot à dire sur les décisions opérationnelles. Lorsque Patrick Daher a pris la présidence du groupe Daher, il y a une vingtaine d’années, il a établi des règles très claires de façon à ce que chacun fasse bien la différence entre son rôle patrimonial et son éventuel rôle opérationnel. Les actionnaires familiaux sont rassemblés au sein d’une holding patrimoniale qui définit la stratégie patrimoniale et établit des pactes d’actionnaires d’une durée de dix ans. Cette holding patrimoniale est actionnaire à 80 % de Compagnie Daher, la holding opérationnelle qui gère les activités du groupe, emploie 8 300 salariés et réalise un milliard d’euros de chiffre d’affaires. Cette gouvernance permet aux actionnaires familiaux de parler d’une seule voix au sein de la Compagnie. C’est grâce à ce dispositif que l’entreprise a pu prendre une décision en deux jours lorsque le ministère lui a proposé de bénéficier du premier investissement du FSI. Les deux holdings sont obligatoirement présidées par deux personnes distinctes. « Quand Patrick Daher a instauré cette gouvernance, il y a une vingtaine d’années, rapporte Didier Kayat, le DG, elle pouvait paraître disproportionnée pour une PME qui ne comptait que quelques dizaines d’actionnaires. Aujourd’hui, la famille comprend 500 membres dont plus de 300 sont actionnaires. Cette gouvernance très structurée est une innovation qui sera certainement précieuse pour la pérennité de l’entreprise. »
Stratégie patrimoniale et stratégie entrepreneuriale sont deux sujets différents : c’est lorsqu’on les confond que l’on s’expose à des conflits familiaux et que l’on met l’entreprise en danger.
IDEES CLES – Favoriser la cohésion entre les actionnaires familiaux
Patrick Daher, président du groupe Daher, a créé une association de loi 1901 baptisée « Générations Daher ». Elle compte une soixantaine de bénévoles qui organisent des activités d’animation et de solidarité, destinées à maintenir les liens entre actionnaires familiaux. Ces rassemblements conjuguent le plaisir des retrouvailles (week-end sportif, dîners…) avec des exposés sur les activités de l’entreprise.
Pactes de gouvernance
Nombreuses sont les entreprises familiales qui adoptent des pactes de gouvernance – à distinguer des pactes de conservation des titres, dits « pactes Dutreil » – afin de fixer les règles du jeu et prévenir les conflits d’intérêts.
Le groupe catalan Puig, qui possède les marques Paco Rabane et Nina Ricci, a fait appel à un professeur de Harvard pour établir une sorte de « constitution d’entreprise » entre la cinquantaine d’actionnaires familiaux. Ce texte définit des points très précis, comme le fait de savoir qui peut faire un stage dans l’entreprise, qui peut y travailler, etc. Si l’on ne prévoit pas ce genre de règle, on s’expose à des conflits d’intérêts permanents. Ce sont ces risques dits de « népotisme » qui sont mis en avant lorsque l’on caricature les entreprises familiales.
Sogemarco-Daher a établi une sorte de charte qui définit les droits et les devoirs des actionnaires candidats à l’embauche. Ils doivent d’abord être validés au sein de la famille avant de se présenter au dispositif de recrutement de l’entreprise et il est entendu que dans le cas où ils ne donneraient pas satisfaction, ils peuvent perdre leur emploi.
Chez Moret Industries également, chaque actionnaire familial, une fois parvenu à l’âge de 18 ans, signe un pacte qui prévoit notamment à quelles conditions les actionnaires familiaux peuvent devenir salariés de l’entreprise. Ceux-ci doivent avoir acquis au préalable cinq ans d’expérience en dehors du groupe, être recrutés par un cabinet de recrutement comme tous les autres salariés et être agréés par deux cadres salariés non-actionnaires de l’entreprise.
Succession et transmission
La pérennité d’une entreprise familiale se joue particulièrement au moment de la succession du dirigeant. Trois écueils principaux peuvent être identifiés.
Conflit entre générations
Le premier est celui où le dirigeant s’accroche à son poste et refuse d’envisager sa succession. S’ils travaillent déjà dans l’entreprise, les héritiers piaffent, la situation se tend, les conflits à la tête de l’entreprise se multiplient, engendrant souvent de mauvaises décisions et un climat irrespirable.
Éva Escandon, PDG du groupe SMSM qui réalise des ouvrages chaudronnés et des ensembles mécano-soudés complexes, témoigne de la difficulté de ce moment critique : « L’association entre mon père et moi-même fonctionnait très bien et faisait synergie car nous étions complémentaires. Dès 1995, nous avions complètement redressé l’entreprise. Jusqu’en 2003, nos relations sont restées bonnes. Mais quand le moment est arrivé pour lui de songer à prendre sa retraite, il a commencé à s’accrocher à l’entreprise et à vouloir reprendre en main des fonctions qu’il m’avait déléguées. Au lieu de faire synergie, nos forces respectives ont commencé à s’annuler. Cette situation de conflit me poussait à m’engager d’autant plus dans des activités extérieures à l’entreprise, ce qui aggravait les choses. À certaines périodes, notamment pendant les campagnes pour les élections consulaires, je consacrais plus de 50 % de mon temps à ces activités annexes. Du coup, plus les années passaient, plus mon père exprimait des doutes sur ma capacité à reprendre l’entreprise, alors que je la codirigeais avec lui depuis vingt ans. Si je ne m’étais pas battue avec acharnement pour lui succéder, nous aurions certainement vendu l’entreprise. »
IDEES CLES – Créer un « conseil de transition » pour gérer une transmission difficile entre deux générations
Luc Darbonne, fondateur de Darégal, reconnaît avoir été confronté à cette situation : « Mon deuxième fils a toujours exprimé le souhait de prendre ma suite. Je l’ai envoyé se former aux États-Unis, en le chargeant de monter une filiale pour vendre des surgelés en grande distribution. À son retour, il y a rapidement eu des tensions entre nous car, après avoir été autonome pendant quatre ans et demi, il lui était très difficile de devoir rendre des comptes à son père, à la fois en tant que président du groupe et président de la société. Nous avons créé un conseil de transition avec des membres du conseil d’administration mais également des experts extérieurs. L’objectif était de réussir à prendre de la distance par rapport à ce qui peut relever de l’irrationnel dans les relations père-fils. J’avais vécu une transition très difficile avec mon père, qui ne voulait pas céder sa place. Je ne souhaitais pas que cela se reproduise. Le conseil de transition nous a aidés à apaiser les relations et, au bout d’un an, nos rapports sont redevenus excellents. »
IDEES CLES – Identifier très en amont le ou les candidats à la succession
Jérôme Duprez chez Moret Industries a pris le parti de préparer sa succession très en amont afin d’identifier les candidats les plus pertinents à la reprise de son entreprise : « J’ai choisi d’annoncer longtemps à l’avance la date de mon départ à la retraite, prévu pour 2021. J’ai par ailleurs pris plusieurs mesures pour essayer d’intéresser dès maintenant la génération des 15-30 ans au devenir de l’entreprise et trouver mon successeur. Chaque année, j’associe à l’assemblée générale des actionnaires une réunion de famille. Les jeunes actionnaires ont par ailleurs droit à trois mois de travail rémunéré n’importe où dans le groupe ; leur seule obligation est de rédiger un rapport qu’ils présentent aux autres membres de la même génération à l’occasion de l’assemblée générale. Je fais partie de la cinquième génération de l’entreprise. La sixième compte 47 personnes. J’estime qu’il reste à l’heure actuelle 21 candidats potentiels, y compris des jeunes de 15 ans qui n’ont pas encore fait de choix d’orientation dans leurs études. Mais si je ne trouve pas, la perspective de faire appel temporairement à une personne extérieure est tout à fait envisagée. »
Absence de candidats à la succession
Le deuxième cas problématique est celui où il n’y a pas de candidat familial pour reprendre la direction de l’entreprise. Dans cette hypothèse, il faut envisager soit le recrutement d’un manager extérieur, soit la revente. C’est cette dernière option qu’a choisie Jean-Yves Pichereau, le mouliste de la Mayenne : « J’arrive à l’âge de la retraite : cela fait 34 ans que je travaille et il est temps que j’arrête. Ma fille aînée est notre responsable de la qualité depuis une dizaine d’années. Mais ce ne serait pas un cadeau que de lui laisser la présidence du groupe. Les gens d’atelier ont généralement de fortes personnalités et il est difficile de ne pas se laisser déborder lorsqu’on n’est pas “né” dans ce métier. J’ai donc signé un mandat de vente et nous avons déjà trouvé six candidats au rachat. »
Coût fiscal de la transmission
Troisième écueil : il arrive que le coût fiscal de la transmission soit tel que les héritiers choisissent de vendre l’entreprise. Ce dernier point est jugé critique par beaucoup de dirigeants. Entre le début des années quatre-vingt et la fin des années quatre-vingt-dix, les propriétaires devaient s’acquitter au moment de la transmission d’une taxe représentant 40 % de la valeur de ces sociétés. De très nombreuses entreprises ont été vendues à cette époque, en particulier à des sociétés étrangères qui ont conservé les marques, licencié les salariés et, parfois, liquidé l’outil industriel. Depuis l’introduction, à la fin des années quatre-vingt-dix des Pactes d’engagement de conservation de titres, dits « pactes Dutreil », la transmission des entreprises familiales s’est trouvée facilitée24. Selon certains observateurs, ces deux décennies douloureuses expliquent, pour partie du moins, qu’il y ait trois fois moins d’ETI en France qu’en Allemagne aujourd’hui.
« C’est une perte terrible dont l’économie française peine encore à se remettre, affirme Philippe d’Ornano, co-président de METI. C’est un peu comme lorsqu’on abat une forêt d’un coup : pour la reconstituer, il faut énormément de temps et d’énergie. »
EN SAVOIR PLUS – Le capitalisme d’héritiers : un débat toujours ouvert
Dans un ouvrage récent25, deux chercheurs, Gariel et Lherbier, indiquent que certains politiques se méfient toujours autant des entreprises patrimoniales. Ils citent, par exemple, un ancien ministre du Travail pour qui « il faudrait distinguer les vrais entrepreneurs qui ont pris énormément de risques, de ceux qui ont hérité de papa-maman. » De même qu’une ancienne ministre de la Culture, alors députée de l’opposition, pour laquelle « le pacte Dutreil est l’une des niches fiscales les plus scandaleuses : elle favorise le capitalisme de rentier, d’héritier, marque de fabrique du capitalisme français ».
Avec les pactes Dutreil, les héritiers prennent l’engagement de conserver les titres pendant six ans et, à cette condition, bénéficient d’un abattement de 75 % sur les 40 % de taxes, ce qui ramène le coût de la transmission à environ 6 ou 7 % de la valeur de l’entreprise. « Cela reste l’un des taux les plus élevés d’Europe, mais il rend toutefois la transmission envisageable, conclut Philippe d’Ornano. Les politiques ne sont pas toujours à même de percevoir les résultats des mesures qu’ils prennent. Il se trouve que j’ai eu l’occasion de revoir Renaud Dutreil après quelques années. Je lui ai expliqué que non seulement la loi qui porte son nom avait conduit mon père à nous transmettre l’entreprise plutôt qu’à la vendre à un groupe étranger, mais qu’elle l’avait également décidé à passer à la deuxième phase du développement et, pour cela, à investir 150 M€ en France et à multiplier son chiffre d’affaires par quatre sur la période 2000-2012. »
FACTEURS DE SUCCES – Financement, gouvernance, transmission
Faire appel à un investisseur extérieur si l’entreprise a un projet précis et ne dispose pas d’autofinancement, mais examiner soigneusement les différentes possibilités.
Faire entrer un fonds permet de bénéficier de son réseau et d’accéder à davantage d’opportunités.
Limiter l’apport de fonds au strict nécessaire afin de garder le contrôle de l’entreprise lors de l’ouverture du capital.
Bien évaluer les avantages et inconvénients d’une entrée en Bourse.
Se doter d’une gouvernance solide pour réussir à concilier la stratégie patrimoniale et la stratégie entrepreneuriale.
Créer un « conseil de transition » pour gérer une transmission difficile entre deux générations.
Identifier très en amont le ou les candidats à la succession.
- 23 – Ex ASMEP-ETI : syndicat des entreprises de taille intermédiaire.
- 24 – Voir aussi Gariel S. et Lherbier G., Développer les entreprises patrimoniales, un défi pour les héritiers et les managers, Eyrolles, 2014. Selon ces auteurs, cette niche fiscale aurait cependant des inconvénients : elle inciterait les dirigeants vieillissants à s’accrocher à leur poste pour des raisons fiscales.
- 25 – Op. cit. Le mythe des 200 familles a la vie dure.
Ressources humaines : osez les ETI
À RETENIR
Une grande majorité de PMI/ETI industrielles connaît des difficultés pour recruter des profils qualifiés, que ce soit en France ou à l’international.
En dépit du taux de chômage élevé que connaît notre pays, cette difficulté serait, pour beaucoup de dirigeants, associée à la mauvaise image de l’industrie, à l’inadaptation des formations aux besoins des entreprises, au manque d’attractivité de certains territoires et à la concurrence des grands groupes.
Les techniciens et ingénieurs sont mal préparés à devenir les managers dont les ETI ont besoin pour leur développement.
L’intéressement et l’actionnariat salarié sont très répandus dans les ETI qui ne peuvent pas toujours s’aligner sur la politique salariale des grands groupes.
Au-delà du revenu, la motivation des salariés est entretenue par la reconnaissance, le projet collectif et l’esprit PME.
La fidélité des salariés est un atout considérable pour les ETI. Cependant la structure démographique vieillissante de certaines entreprises pourrait devenir un obstacle aux nouveaux impératifs de mobilité.
La structure des ETI rend les questions relatives à leur gestion des ressources humaines particulièrement centrales. Leur dimension à taille humaine leur confère des avantages notables mais aussi des inconvénients par rapport aux autres catégories d’entreprise. À la différence des PME, elles disposent d’une structure d’activités et d’une organisation très développées. Elles peuvent proposer des formations internes efficaces et des perspectives de carrière que ne peuvent offrir les PME. Par rapport aux grands groupes, leur cadre organisationnel est particulièrement propice à la délégation des initiatives et des responsabilités. Mais cela leur impose de trouver des collaborateurs polyvalents, autonomes, capables d’aider le dirigeant dans ses choix stratégiques. Sur ce point précis, elles doivent faire face à la concurrence des grandes entreprises pour recruter et retenir des collaborateurs de haut niveau. D’autant que, très ancrées territorialement, elles sont dans certaines régions confrontées à une raréfaction de la main-d’œuvre qualifiée. Par ailleurs, à l’instar de nombreuses entreprises industrielles, elles font face à des difficultés de recrutement liées à l’image dégradée du secteur.
Quelles sont les difficultés de recrutement propres aux ETI ? Quelles démarches proactives mettent-elles en œuvre pour attirer et fidéliser des collaborateurs qualifiés ? Quels sont leurs atouts et handicaps par rapport aux grandes entreprises ?
Recruter
Les dirigeants de PMI/ETI sont quasiment unanimes sur le sujet. Ils ont beaucoup de mal à trouver les compétences dont ils ont besoin. Les difficultés de recrutement représentent un frein à leur développement. Cependant ces difficultés ne sont pas exactement les mêmes selon qu’il s’agisse des métiers traditionnels de l’industrie − dont certains sont qualifiés par Pôle Emploi de « métiers en tension » (voir tableau) − de métiers rares ou pointus, de techniciens, scientifiques et ingénieurs, ou encore de profils de managers. L’ampleur des difficultés varie également selon la localisation de l’entreprise ou encore le type d’activités.
Besoins et difficultés de recrutement
Pour Philippe Blandin, ancien secrétaire général de l’entreprise de mécanique Mecachrome, presque tous les profils sont concernés par des difficultés de recrutement. L’entreprise a beaucoup de mal à trouver des fraiseurs et surtout des tourneurs, en particulier sur des tours verticaux. Les chaudronniers sont également très rares. Difficile également de recruter des techniciens méthodes, destinés à assurer l’industrialisation des pièces et la programmation des machines, dont dépend une grande partie de la compétitivité. Il en va de même pour les ingénieurs et techniciens confirmés qui doivent concevoir et accompagner les nouveaux programmes.
Même son de cloche chez Georges Jobard, PDG de Clextral : « Nous rencontrons de grandes difficultés à recruter de jeunes ouvriers. En raison des dépôts de bilan liés à la crise de l’automobile, nous avons réussi à embaucher des ouvriers très bien formés, âgés d’une quarantaine d’années, mais il est très difficile, même en passant par l’apprentissage, de trouver des jeunes à la fois motivés et compétents. Or, sans ouvriers de qualité, notre pays aura du mal à relancer son industrie. »
Après avoir suivi une formation d’outilleur ajusteur fraiseur et avoir enseigné dans la voie professionnelle, Jean-Yves Pichereau a créé, à vingt-six ans, ERMO, une société spécialisée dans la fabrication de moules pour l’industrie. Sur ce sujet qu’il connaît bien, il témoigne que « le recrutement est toujours un problème pour nous. Quand les premières machines à commande numérique sont arrivées, personne n’en connaissait l’utilisation. Nous avons embauché des jeunes qui sortaient de l’école où j’avais enseigné, mais cela ne suffisait pas. Nous étions en période de forte croissance et nous ne trouvions pas suffisamment de personnel qualifié. Nous avons essayé d’en débaucher chez nos concurrents. La crise qui a frappé notre industrie à partir de 2000 a conduit de nombreuses sociétés à déposer leur bilan, ce qui nous a permis de recruter un certain nombre de personnes. »
Tableau 1 – Classement des quinze métiers industriels où le recrutement est jugé difficile
Source : Enquête BMO – Pôle emploi, 2014
Dans ce concert de lamentations, Olivier Desmarescaux, PDG d’Eurotab, dans la chimie de spécialité, fait entendre un autre point de vue : « Nous réussissons à trouver les compétences dont nous avons besoin, depuis les techniciens jusqu’aux docteurs. Nous avons un peu de mal à les attirer à Saint-Étienne, mais cela relève plutôt d’un problème d’attractivité du territoire que d’un problème de compétences. » Selon le PDG de la société IGE+XAO, spécialisée dans l’édition, la commercialisation et la maintenance de logiciels de CAO pour les circuits électriques, le secteur des logiciels pour l’industrie ne connaîtrait pas non plus de difficultés de ce point de vue.
Même si la tendance est très majoritaire, toutes les entreprises ne seraient donc pas égales face aux difficultés de recrutement.
Les raisons des difficultés à recruter et comment les surmonter
Mauvaise image générale de l’industrie, formations inexistantes ou inadaptées aux besoins des entreprises, manque d’attractivité de certains territoires, concurrence des grands groupes… sont les raisons les plus souvent invoquées par les chefs d’entreprise pour expliquer leurs difficultés à recruter. Mais le sujet est si stratégique que les patrons ne restent pas les bras croisés. Aux grands maux, les grands remèdes… chacun a mis en place des solutions pour y faire face.
Mauvaise image de l’industrie
Les chefs d’entreprise tombent majoritairement d’accord pour considérer que la mauvaise image de l’industrie ne leur facilite pas la tâche. L’image de l’industrie véhiculée par les médias et par l’Éducation nationale, leur paraît responsable du déficit de vocations dont ils paient le prix fort. « Nous souffrons de la mauvaise image de l’industrie. Les médias ne cessent d’évoquer les licenciements, les fermetures d’usines, les drames sociaux. Ils ne parlent presque jamais des innovations et des objets techniques superbes produits par l’industrie française, ni de ses succès commerciaux. Les organisations représentatives de l’industrie devraient travailler à améliorer cette image, comme cela a été fait, par exemple, pour le BTP », note Philippe Blandin de Mecachrome. Et Frédéric Coirier du groupe Poujoulat d’ajouter : « Les manuels scolaires continuent à ne montrer que des usines sales et des ouvriers exploités. Il serait souhaitable que les enseignants se fassent une idée plus juste du monde de l’entreprise. »
EN SAVOIR PLUS – Des synergies entre l’école et l’industrie encore insuffisantes
Selon l’édition 2014 du baromètre Ifop pour l’Institut Lilly, les enseignants indiquent mal connaître le secteur et les métiers industriels. Pourtant, les représentations qu’ils associent à l’industrie se révèlent plutôt conformes à la réalité.
Les enseignants connaissent mal le secteur de l’industrie mais leurs connaissances sur ses métiers ne sont pas négligeables.
61 % des enseignants ont le sentiment de ne pas être bien informés sur les métiers de l’industrie.
52 % des enseignants déclarent avoir visité une usine au cours des cinq dernières années.
Pour la plupart des enseignants, le problème de l’attractivité des métiers de l’industrie est d’abord un problème d’image.
50 % des enseignants qui émettent des réserves sur l’attractivité des métiers de l’industrie considèrent que le déficit d’image de l’industrie provient des messages diffusés par les médias.
Les enseignants sont conscients du manque d’adéquation entre les formations scolaires et universitaires et les métiers de l’industrie
81 % des enseignants conseilleraient à leurs étudiants de travailler dans l’industrie mais 78 % considèrent que les programmes et les enseignements ne permettent pas à leurs élèves de bien connaître les métiers de l’industrie.
Les enseignants se montrent plutôt réceptifs à des échanges plus poussés avec les entreprises industrielles.
55 % des enseignants interrogés pensent qu’inviter des représentants de l’industrie auprès des élèves serait une initiative intéressante et réalisable.
Pourtant, les représentations de l’industrie et, plus généralement, de l’entreprise tendent à bouger dans l’Éducation nationale, même si cette évolution n’est pas forcément encore perçue par les dirigeants. Selon une enquête réalisée par l’Ifop pour l’institut Lilly26 auprès de 601 personnes censées représenter les enseignants exerçant dans l’enseignement secondaire et supérieur, plus de 80 % des enseignants auraient une vision positive de l’industrie.
L’image de « métiers pour mauvais élèves » associée à l’usine reste, cependant, un préjugé tenace, quoiqu’en décalage complet avec les besoins réels. « Quand j’étais à l’école, un de mes camarades, qui avait de mauvaises notes, s’était vu infliger l’appréciation “Bon pour l’usine”. Mais dans nos entreprises, nous ne voulons pas de mauvais élèves ! Nous voulons des têtes bien faites et bien pleines. C’est en recrutant des gens doués, ayant envie de progresser, que nous serons compétitifs et pourrons fabriquer des produits qui donneront envie à nos clients de continuer à travailler avec nous. Actuellement, on a tellement dégradé l’image de l’industrie que les centres d’apprentissage ferment, faute de candidats », rapporte Philippe Blandin.
Cela frappe particulièrement ceux qui, du fait de leurs implantations, peuvent comparer la situation française à celle qui prévaut dans d’autres pays. « Nous avons une filiale en Suisse, une entreprise de 250 salariés, raconte Emmanuel Hervé, et nous observons là-bas une culture très différente de la nôtre. L’apprentissage n’y est pas vécu comme un échec. Pour toutes les fonctions de l’entreprise, que ce soit dans l’administration ou la production, il est considéré comme normal de commencer par être apprenti. » Et Philippe Blandin d’abonder : « Le président de Mecachrome, Julio de Sousa, a commencé sa carrière dans l’entreprise comme ajusteur. Dans certaines entreprises allemandes, on n’a aucun espoir de finir cadre dirigeant si on n’a pas commencé comme apprenti. Mais en France, on ne trouve pratiquement plus d’apprentis. »
IDEES CLES – Ouvrir les usines pour provoquer le « big Waouhhh ! »
Pour tous les chefs d’entreprise, il n’existe qu’une seule façon de surmonter les préjugés : ouvrir les usines pour les donner à voir27. Philippe Blandin raconte son expérience personnelle : « D’après les études que j’avais faites, j’aurais dû devenir banquier d’affaires. Sauf qu’un jour, tout à fait par hasard, je suis entré dans une usine et j’ai eu la même réaction que mon fils de sept ans quand je l’y ai emmené pour la première fois : “Waouhhh !”. Il me semble que si on faisait en sorte de provoquer ce “Waouhhh !” chez les jeunes, on réglerait une grande partie du problème. »
Pour provoquer ce « big Waouhhh », de nombreuses initiatives ont été prises par les industriels28. « Nous avons fait le choix d’ouvrir largement notre usine et nous avons construit des bâtiments spécifiques pour permettre l’accueil d’un grand nombre de personnes, rapporte Frédéric Coirier du groupe Poujoulat. Chaque semaine, l’entreprise est visitée par des élus, des clients, des écoliers. Au total, cela représente des milliers de visiteurs par an. » Éva Escandon est aussi très active dans ce domaine : « Dans le cadre de l’UIMM, nous avons participé à Dunkerque à l’opération “Bravo l’Industrie” et les chambres de commerce organisent des journées portes ouvertes pour les scolaires. Aussi bien les professeurs que les élèves sont époustouflés : ils ne s’attendent pas du tout à ce qu’ils découvrent dans les entreprises. Les actions spécifiques que nous avons menées en direction des filles – Les “Elles de l’industrie” − ont porté leurs fruits et je reçois de plus en plus souvent des candidatures de stages pour des filles, y compris en chaudronnerie. »
Mais ces efforts de longue haleine ne produisent pas forcément d’effets immédiats. « Malgré ces actions, nous avons toujours la même difficulté à embaucher. Actuellement, je cherche un chef d’atelier, des soudeurs, des tuyauteurs, et je n’en trouve pas. J’aurais également besoin de chargés d’affaires, et c’est encore plus difficile à recruter », conclut Éva Escandon.
EN SAVOIR PLUS – Apprentissage : un levier de compétitivité sous-estimé
Pour les industriels, l’apprentissage est un formidable outil pour assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. Le recours à l’alternance est très utile pour former des jeunes sur des métiers en tension (soudeurs, chaudronniers, charpentiers, électriciens…) du fait des départs à la retraite. Il permet notamment de les former à des savoir-faire pointus, directement en lien avec les besoins spécifiques de l’entreprise. Les industriels soulignent aussi le fait que l’apprentissage permet d’imprégner les jeunes de la culture de l’entreprise. En outre, si l’entreprise conserve l’apprenti à l’issue de son contrat, elle s’économise certains coûts liés au recrutement (prestations de cabinets, incertitude sur les compétences réelles des candidats extérieurs…).
Du côté des jeunes29, ce mode de formation leur permet d’acquérir des compétences très proches des besoins des entreprises, ce qui facilite leur insertion professionnelle. En février 2013, 65 % des apprentis étaient en emploi sept mois après la fin de leurs études et 58 % d’entre eux étaient en CDI. Compte tenu de ces résultats positifs sur l’emploi des jeunes, le développement de l’apprentissage constitue depuis de nombreuses années un enjeu prioritaire pour les pouvoirs publics. Pourtant, le dispositif semble aujourd’hui enrayé : les signatures de contrats d’apprentissage ont reculé de 8 % en 2013.
Formations initiales inexistantes ou inadaptées
Au-delà du manque d’attractivité des métiers industriels et du faible nombre de candidats motivés, il existe de nombreux cas où les formations initiales n’existent pas ou se révèlent inadaptées.
C’est le cas des maçons-peintres-cordistes recherchés par le groupe Poujoulat pour la maintenance de cheminées. La formation est si pointue qu’il n’y a pas une demande suffisante pour justifier des filières de formations ad hoc.
Plus fréquemment, la désindustrialisation des territoires a entraîné la disparition des formations. Chez Thuasne, par exemple, spécialistes des textiles pour le monde médical et sportif, les deux métiers principaux sont le tissage et le tricotage. Elizabeth Ducottet souligne que « l’Éducation nationale a purement et simplement fermé toutes les formations de tricoteurs à Saint-Étienne. Il existait pourtant quatre ou cinq entreprises de cette filière, présentes sur place, qui auraient pu justifier le maintien de ces formations, en les adaptant. Le métier de tricoteur, qui était essentiellement manuel, est en effet devenu un métier de mécanicien et d’électronicien. »
Enfin, pour Jean-Yves Pichereau, le mouliste, les formations existent mais elles sont inadaptées à la réalité du travail en entreprise : « Les CAP de tourneur, d’ajusteur ou d’usineur ne correspondent plus à aucune qualification. Quand les jeunes arrivent à l’usine, il faut pratiquement tout leur apprendre. Autre aberration : le rectorat a interdit l’utilisation de machines conventionnelles dans les écoles techniques, en raison du risque d’accident. Comment un jeune peut-il apprendre un métier s’il n’a pas accès aux machines ? »
Localisation et manque d’attractivité de certains territoires
Même quand les compétences sont disponibles, il peut être difficile d’embaucher en raison du manque d’attractivité de certains territoires. Comme le dit avec humour Frédéric Coirier, président du groupe Poujoulat, « on ne peut pas espérer qu’une usine soit implantée dans une station balnéaire ». L’industrie exigeant beaucoup de foncier, les entreprises industrielles sont généralement situées à l’écart des grandes villes.
IDEES CLES – Formations inexistantes ou inadaptées ? Une seule solution : former en interne
Chez Thuasne, faute de formation assurée par l’Éducation nationale, l’entreprise forme ses propres tricoteurs pendant deux ans. Même approche chez Mecachrome pour les métiers de la mécanique. « Nous sommes obligés de créer nos propres centres de formation dans chacune de nos usines. Nous proposons des formations initiales, de la formation continue et de la reconversion, qui sont accessibles après un test d’aptitude et rémunérées, et lorsque les personnes donnent satisfaction, nous les embauchons dans la foulée. »
Pour les métiers du caoutchouc, Sacred, en Eure-et-Loir, a pris le parti de créer dès 1990 son propre CAP interne de caoutchoutier. « Cette formation en trois niveaux, dispensée en interne par l’encadrement, repose sur la valorisation de l’expérience. Elle peut accueillir des jeunes gens n’ayant pas le niveau pour envisager un CAP traditionnel. À l’issue de la formation, ils reçoivent un diplôme d’entreprise qui peut être validé par l’Institut français du caoutchouc (IFOCA). L’IFOCA a ensuite intégré ce type de formation dans son catalogue. »
Cependant, la formation interne ne résout pas forcément tous les problèmes, comme en témoigne Philippe Blandin : « Malheureusement, un certain nombre de personnes font le choix de ne pas rester [dans l’entreprise]. Nous nous heurtons parfois aussi à des problèmes comportementaux : certains arrivent systématiquement un quart d’heure en retard, ou ne respectent pas les consignes. Or, nos métiers sont très exigeants sur le respect des normes. Les machines peuvent être dangereuses et nécessitent la stricte observation des règles de sécurité. »
Chez Mecachrome, l’éloignement des sites d’usinage par rapport aux grands centres urbains constitue un frein au recrutement : il faut au minimum posséder un véhicule et payer l’essence pour venir travailler. Pour certains, une distance de 35 km peut être rédhibitoire. Même si l’entreprise fournit des aides à la recherche du logement et prend en charge les frais de déménagement, voire les premiers mois de relocalisation, la question du logement reste épineuse pour toutes les catégories de salariés. Faute de trouver des candidats sur place, Mecachrome a même essayé d’en chercher dans des régions ayant un passé industriel ancien, comme la Lorraine ou le Nord. En dépit d’une campagne massive, une seule personne a accepté l’offre. « Dans certaines familles, le grand-père a perdu son emploi, le père n’a jamais travaillé, le fils est à la recherche de son premier emploi. Si le fils accepte de quitter sa région, il perd le réseau qui lui assure une solidarité économique. » Le capital social qu’apporte l’ancrage territorial de chacun ne doit pas être négligé parmi les freins à la mobilité territoriale et à la recherche d’emploi.
IDEES CLES – Miser sur l’attractivité territoriale relative
Certaines entreprises mettent en avant les qualités relatives de leur territoire. C’est le cas de Jean-Philippe Demaël, directeur général de Somfy, entreprise spécialisée dans les moteurs pour volets et stores : « Notre implantation en Haute-Savoie rebute parfois un peu des candidats parisiens ou lyonnais. C’est cependant une force pour l’entreprise car ceux qui viennent chez nous sont en partie attirés par le cadre naturel, ce qui contribue à façonner une culture d’entreprise assez forte. » “ On ne peut pas espérer qu’une usine soit implantée dans une station balnéaire.
IDEES CLES – Faire venir les candidats sur place « pour voir »
La plupart du temps, ce sont les cadres urbains qui rechignent le plus à quitter leur métropole de référence. L’astuce consiste à les faire venir sur place pour un premier rendez-vous. Souvent, c’est ainsi que leurs préjugés tombent. Ce que confirme Elizabeth Ducottet, PDG de Thuasne : « Saint-Étienne conserve une image de ville industrielle et “noire”. Le plus important est de réussir à faire venir les gens sur place pour un premier rendez-vous, afin qu’ils constatent que la ville est très différente de ce qu’ils imaginent. Nous invitons systématiquement le conjoint à participer à cette première rencontre, qui est décisive. » “ Même sur les métiers de base et pour des débutants, nous proposons plus que le Smic. En y ajoutant les primes et les heures supplémentaires, on aboutit à des rémunérations assez attractives.
Concurrence des grands groupes
Les ETI ne peuvent proposer ni les rémunérations des grands groupes, ni des plans de carrière par ascension pyramidale, leur organigramme étant souvent plus aplati que celui d’une grande entreprise. De ce fait, dit Éva Escandon, « les jeunes qui sortent des écoles d’ingénieurs n’ont pas forcément envie de travailler dans une PME. Ils se tournent plutôt vers de grandes entreprises qui leur offrent des perspectives plus alléchantes ». C’est ce qu’explique également Philippe Blandin (Mecachrome) : « À Toulouse, où sont implantées nos activités de tôlerie et chaudronnerie, on trouve des personnels formés, mais les ETI ont du mal à les recruter car elles sont en concurrence avec de grandes entreprises comme Airbus, qui peuvent offrir des salaires ou des avantages plus intéressants. Pourtant, même sur les métiers de base et pour des débutants, nous proposons plus que le Smic. En y ajoutant les primes et les heures supplémentaires, on aboutit à des rémunérations assez attractives. »
Ce phénomène de concurrence est encore aggravé, lorsque certaines ETI doivent recruter des ingénieurs à l’échelle mondiale et réussir à exister face à des entreprises mondialisées. Poclain Hydraulics, qui est présente dans 29 pays, doit recruter des ingénieurs au niveau mondial ; elle se retrouve alors en concurrence avec toutes les entreprises de la planète. Si l’on tient compte du fait que l’industrie attire peu, que les banques confisquent une bonne part des ingénieurs destinés à l’industrie et que la notoriété de l’entreprise est faible, on comprend aisément que l’entreprise ait des difficultés de recrutement. « J’ai huit postes ouverts en Allemagne qui attendent preneur », maugrée Guillaume Bataille, le directeur général délégué de Poclain.
IDEES CLES – Jouer la carte de la différence
Pour se différencier des grands groupes, les PMI/ETI vont mettre en valeur leur différence. « Ce qui fait rêver nos collaborateurs, c’est notre projet d’entreprise à taille humaine, “non corrosive”. Les profils les plus carriéristes préfèrent rejoindre des grands groupes. Il y a des personnes qui veulent travailler dans les entreprises de taille intermédiaire et celles qui préfèrent les grands groupes. Ce ne sont ni les mêmes carrières, ni les mêmes salaires, ni les mêmes contraintes », souligne Alain Di Crescenzo, PDG d’IGE+XAO. « Small can be beautiful », rappelle Éva Escandon : « Opter pour une petite entreprise offre de nombreux avantages. Le travail est beaucoup plus polyvalent, aussi bien en termes d’activité que de secteurs commerciaux. »
Recherche managers désespérément
Un des principaux enjeux du recrutement pour les PMI/ETI se situe aujourd’hui au niveau du management. Selon Jean-Philippe Demaël chez Somfy, la plupart des candidats s’avèrent très compétents pour la gestion des divers outils mais très démunis pour tout ce qui concerne la gestion des hommes, la motivation des équipes, ou encore la responsabilité sociale de l’entreprise. Ils sont incollables sur le plan technique mais il suffit parfois de cinq minutes pour comprendre qu’ils ne feront pas l’affaire sur le plan du savoir-être. « Je souhaiterais que les écoles d’ingénieurs fassent évoluer leurs formations dans ce sens. Un manager doit gérer des faits et des hommes. On forme les élèves à la gestion des faits, ce qui est le plus facile, car les faits sont froids. Mais on ne les forme guère à la gestion des hommes, qui est pourtant beaucoup plus complexe : les hommes éprouvent des émotions, expriment des aspirations, sont susceptibles de mouvements collectifs. »
Ces managers doivent s’adapter aux nouvelles organisations du travail qui fonctionnent sur un mode plus collaboratif et moins hiérarchique que par le passé.
Chez Mecachrome, le management intermédiaire joue un rôle clé dans l’organisation : si les chefs d’équipe ne réussissent pas à motiver ceux qui font tourner les machines, les délais ne seront pas tenus et les clients ne seront pas satisfaits. Or, les chefs d’équipe sont souvent promus pour leurs compétences techniques plutôt que pour leurs qualités managériales. « Une fois à leur nouveau poste, ce que nous attendons d’eux surtout, c’est qu’ils sachent s’adresser aux nouvelles recrues et les diriger ; pour les y aider, nous leur proposons des formations spécifiques au management et du coaching. »
IDEES CLES – Regrouper les équipes dans des petites unités gérées par un manager
Au sein du Groupe Hervé, les métiers et les compétences sont regroupés autour d’un manager qui est l’équivalent d’un patron de petite entreprise : il manage une équipe de dix à vingt personnes. Ces patrons de petites entreprises sont à leur tour managés par des responsables de moyennes entreprises, qui regroupent chacune entre 10 et 20 petites entreprises. Enfin, les responsables des moyennes entreprises sont managés par l’équivalent d’un patron d’ETI. Ce sont des animateurs qui doivent encourager les salariés dans leurs initiatives et assurer la coordination avec les autres petites entreprises pour pouvoir mieux répondre aux attentes des clients. Ils ont la responsabilité avec leur équipe de sélectionner (recruter et se séparer) les salariés, de choisir leur marché, de fixer leur budget, etc.
« Ce genre de profil est assez difficile à trouver, explique le président, c’est pourquoi nous privilégions l’évolution interne entre les trois niveaux hiérarchiques, en nous basant exclusivement sur la capacité managériale, et non sur la formation de base ou le bagage technique. Nous faisons, bien évidemment, également appel au recrutement externe. Dans les régions où nous sommes présents depuis vingt ou trente ans, le recrutement est relativement facile, grâce au bouche-à-oreille. C’est beaucoup plus délicat dans les régions où nous venons d’arriver. »
Politique de rémunération
Les PMI/ETI ne peuvent pas toujours rivaliser avec les grands groupes en matière de rémunération. En matière de politique salariale et de bonus, certaines entreprises évoquent transparence et clarté, quand d’autres, comme Moret Industries, indiquent n’avoir « aucune grille salariale ». Ainsi, Alain Di Crescenzo (IGE+IXAO) : « La politique de rémunération est la même pour tous. La progression du salaire fixe est indexée sur un multiple de l’inflation. La part variable peut aller de 10 à 40 %, en fonction des catégories de personnel et du niveau d’atteinte des objectifs. Il en va de même pour le comité de direction. Il y a trois ans, nous avons décidé de passer au treizième mois et de bloquer l’augmentation des salaires pendant trois ans ; cette règle s’est appliquée à tous. Les règles sont écrites et transparentes. Elles sont cruciales pour créer de la cohésion. »
Si le salaire demeure un facteur de motivation important, les ETI tentent d’attirer et de fidéliser par des formes complémentaires de revenus. Une immense majorité des ETI de notre panel a ainsi mis en place des accords d’intéressement, de participation ou d’actionnariat salarié. Ceux-ci permettent d’augmenter les revenus des salariés ; ils jouent aussi un rôle dans le dialogue social, en « déplaçant » les revendications directement salariales vers d’autres formes d’avantages sociaux.
Au sein de Poclain Hydraulics, l’intéressement a été mis en place à partir de 1987. Aujourd’hui, les salariés détiennent près de 8 % des parts de l’entreprise au travers d’un FCPE, ce qui représente une source de financement pour l’entreprise et un outil de cohésion interne. L’intéressement peut aussi jouer un rôle d’amortisseur social : certains des salariés de Poclain ont pu faire face à la crise de 2009 en mobilisant l’épargne de long terme qu’ils avaient acquise par ce biais. D’autres y trouvent un petit capital au moment où ils partent à la retraite. Laurent Bataille, le PDG de Poclain, milite d’ailleurs depuis dix ans auprès des organisations professionnelles pour obtenir que les sommes collectées via l’intéressement puissent être mutualisées entre PME et ETI, dans un fonds commun.
HRA Pharma pratique aussi la participation et l’intéressement ; les salariés détiennent 10 % du capital. La mise en place de l’actionnariat salarié a été d’une grande complexité juridique et fiscale mais cela en valait la peine aux dires de son dirigeant, André Ulmann : 75 % des salariés ont acquis des actions.
Ces dernières années, le traitement fiscal de l’intéressement est devenu moins intéressant pour les entreprises (voir encadré ci-contre). Nombreux sont les dirigeants, de Laurent Bataille (Poclain Hydraulics) à Philippe d’Ornano (Sisley), qui continuent tout de même à le promouvoir. En effet, cela oblige à être cohérent entre le discours que l’on tient aux salariés et celui que l’on tient aux actionnaires.
EN SAVOIR PLUS – Les obstacles à l’intéressement
Fiscalement, l’intéressement est de moins en moins avantageux. Le forfait social, c’est-à-dire la taxe appliquée à l’intéressement, qui était déjà passée de 2 à 8 %, atteint désormais 20 %. Après l’attribution des stock-options et des actions gratuites, c’est désormais l’intéressement qui fait l’objet d’une fiscalité renforcée, rendant plus difficile pour les ETI de trouver des incitations financières autres que la rémunération de base et les bonus annuels.
Nombreux sont en effet les parlementaires à considérer, depuis les scandales Enron ou Vivendi Universal, qu’il n’est pas souhaitable d’inciter les salariés à « mettre tous leurs œufs dans le même panier ».
Les banques ne sont pas non plus très favorables à ce que l’épargne de l’intéressement soit fléchée vers les entreprises. Elles préfèrent qu’elle soit orientée vers des sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) et des produits financiers sur lesquels elles prennent de fortes commissions.
Enfin, dernière difficulté, les salariés hors de France ne peuvent pas investir dans ce type de fonds. Dans le cas de Poclain, qui est très internationalisé, les dirigeants ont dû inventer d’autres formes de profit sharing pour que tous les salariés puissent bénéficier de l’intéressement « à la française ».
C’est important dans un contexte où l’on entend souvent opposer les salariés aux patrons, les banquiers aux industriels, les acheteurs aux vendeurs, etc. La réussite d’une entreprise repose sur sa capacité à surmonter les clivages et à créer du « liant » entre toutes les parties prenantes.
Entretenir la motivation
Compte tenu de leurs marges de manœuvre limitées en matière de politique de rémunération, la plupart des ETI optent pour des approches spécifiques afin de susciter et de maintenir la motivation des équipes. Dans le Groupe Hervé, la rémunération a de l’importance, mais ce ne peut être le facteur principal. « Les motivations financières n’ont qu’un effet de court terme. Lorsque vous accordez une prime ou une augmentation, cela produit un effet très important mais sur une très courte durée », affirme son président. Les ETI doivent donc se différencier sur d’autres valeurs que la rémunération. Elles recourent fréquemment à trois piliers pour entretenir la motivation.
Reconnaissance
Le Groupe Hervé mise sur la reconnaissance de la capacité de l’individu à prendre des initiatives et des décisions. Cette reconnaissance se traduit par le fait que, d’une part, personne n’est rémunéré au SMIC et que, d’autre part, il n’existe qu’un facteur 5 entre le salaire le plus faible et le salaire le plus élevé. Ce resserrement des rémunérations représente un signal concret donné aux salariés, que tout le monde est capable de produire de la valeur pour l’entreprise par ses idées et initiatives.
Clextral, quant à elle, joue sa carte de « multinationale de poche ». Elle réunit les avantages d’une entreprise globale qui permet de voir le monde, et les opportunités d’une petite entreprise où il est possible de faire rapidement de belles carrières. « Le responsable de la filiale du Chili a un bac +2. Il a commencé comme automaticien puis a travaillé quelque temps aux États-Unis avant d’être nommé au Chili » indique Georges Jobard.
Projet collectif
De nombreux chefs d’entreprise jouent aussi sur la capacité à donner du sens et l’aspiration des salariés à participer à un projet collectif.
Somfy a, par exemple, mis en place le plan « Let’s » : il s’agissait d’imaginer un projet collectif, une utopie commune, à un moment où, en raison de la concurrence chinoise, le business model de Somfy commençait à devenir obsolète. Le plus grand nombre possible de salariés a été associé à l’élaboration de ce plan. « Cette volonté d’associer chaque personne, qu’elle soit patron de Somfy, responsable de la qualité dans l’usine chinoise ou opératrice, s’appuyait sur un constat. Nos métiers étant extrêmement décentralisés, il ne peut pas exister de stratégie globale. L’entreprise dessine une ambition, un cadre et fournit les ressources pour investir, mais le match se joue sur le terrain et c’est à chacun d’imaginer ce qu’il peut faire pour contribuer à la victoire. » Le projet a duré un an et impliqué toutes les unités, toutes les marques et tous les pays. Au total, 600 personnes (sur un total de 7 900 salariés) ont été associées à cette concertation. « Un an plus tard, nous avons dévoilé notre nouveau plan stratégique, baptisé Let’s pour Living environment transformation by Somfy. Il reposait sur l’idée que la mission de Somfy n’est pas seulement de gagner de l’argent mais aussi de contribuer à l’amélioration du cadre de vie, et ainsi, d’apporter, à son échelle, un peu de bien à l’humanité. Pendant les six mois qui ont suivi cet événement, des “Let’s share sessions” ont été organisées. Tous les salariés devaient participer au minimum à une session de formation de quatre heures. L’objectif était de leur permettre de s’approprier le projet du groupe et de définir leur propre contribution à ce projet. »
Écoute
La motivation procède également de la capacité du management à écouter les salariés. Les agents d’exécution disposent notamment d’un potentiel énorme pour contribuer au projet de l’entreprise. Le directeur général de Somfy en apporte deux exemples éclatants.
Somfy était confronté à un problème assez grave de qualité. Les équipes dirigeantes ont passé des heures en réunion à essayer de trouver des solutions. À l’occasion d’une journée portes ouvertes de l’usine, Jean-Philippe Demaël, le DG, discute avec une opératrice qui présente son poste de travail. « En un quart d’heure, celle-ci a établi un diagnostic sur les problèmes de non qualité qui valait largement toutes les études que les consultants avaient pu mener. Quand on donne la parole aux agents d’exécution, ils font remonter une richesse d’information insoupçonnée. »
Dans le sens contraire, quand on ne les écoute pas, voici ce qui peut se produire : « Quand j’ai pris mon poste, l’entreprise était en train de lancer une gamme de produits censés révolutionner le monde. J’ai participé à une formation sur ces nouveaux produits qui s’adressait à des agents du service après-vente, situés assez bas dans la hiérarchie. Au cours de la pause, deux d’entre eux m’ont expliqué pourquoi cette nouvelle gamme ne marcherait jamais. Au bout de trois ans, nous avons dû jeter l’éponge en constatant que, de fait, cette gamme ne décollait pas. Les raisons de l’échec étaient exactement celles que ces deux personnes m’avaient expliquées. »
Plus une entreprise se développe et plus il faut se préoccuper de savoir comment recueillir le savoir des salariés.
Depuis qu’il a repris l’entreprise Rossignol Technology en 2011, Bertrand de Taisne mène une enquête de satisfaction auprès des employés. Le nombre de personnes qui se sentent informées des évolutions de l’entreprise est ainsi passé de 12 % à 84 % en deux ans. « Nos employés se sentent respectés et écoutés quels que soient leur origine et leur poste. La transparence doit néanmoins être maniée avec prudence afin de ne pas engendrer de déception ou de crainte, certaines décisions n’ayant des effets qu’à moyen et long termes. La transparence est indispensable, mais seulement sur les événements qui vont affecter l’entreprise à court terme. »
Gérer les compétences
Pour conserver leur leadership sur des marchés de niche, les entreprises doivent innover sans cesse, ce qui nécessite d’investir dans les compétences des collaborateurs.
Formation continue
La formation continue est donc très importante pour les ETI : c’est une façon non seulement d’accroître la compétitivité de l’entreprise mais également de fidéliser les personnels. Chez Mecachrome, les opérateurs qui pilotent les machines développent leurs compétences en permanence : plus ils travaillent et plus ils apprennent. Ils doivent dérouler le programme, veiller à la sécurité, savoir prendre la décision d’arrêter la machine pour éviter un problème plus grave, etc. À ces compétences, issues de l’expérience, l’entreprise ajoute des formations aux techniques d’amélioration continue, aux démarches de Lean management, 5S, etc. « Le savoir-faire de nos salariés est vraiment notre trésor de guerre. Mecachrome est connue pour disposer de véritables artistes, capables de surmonter n’importe quelle difficulté rencontrée par nos clients », s’enthousiasme Philippe Blandin.
D’autres ont une approche plus collective de la GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences), comme en témoigne Didier Fégly dans le domaine du caoutchouc : « Dans le cadre du pôle de compétitivité Elastopôle, nous avons contribué à mettre en place un programme de GPEC dont ont bénéficié 45 entreprises de la branche. Cette opération nous a donné l’occasion de mettre à jour le référentiel des savoirs et savoir-faire de la profession, ce qui constitue également un apport très important du pôle en matière de ressources humaines. »
IDEES CLES – Des programmes de formations à la carte pour monter en compétences
Poclain Hydraulics offre à ses salariés la possibilité d’accroître de façon continue leurs compétences et leur employabilité, grâce à un programme baptisé « Skill in ». Ce genre de démarche existe dans de nombreuses entreprises mais Poclain la met en œuvre à un niveau mondial, ce qui reste rare pour une ETI. Cette démarche a été appliquée à une première série de métiers (applications, méthodes, maintenance, acheteurs) et définit pour chacun un référentiel de compétences que les collaborateurs doivent posséder. Ceux-ci répondent à un questionnaire permettant d’évaluer l’écart entre leurs compétences personnelles et ce référentiel. Ils se voient alors proposer des formations à la carte. Puis ils passent une nouvelle évaluation et le cycle recommence. Au début, cette démarche a créé une certaine inquiétude mais au bout de deux ou trois cycles, les gens ont compris que l’objectif était vraiment de les faire progresser. En parallèle, Poclain met en place une gestion des potentiels. Dans ce but, la gestion de carrière amène les salariés à changer régulièrement de fonction et à voir progresser leur rémunération en conséquence.
Partage des savoir-faire
La formation passe également par des méthodes de partage des savoir-faire entre salariés, qui se concrétisent, par exemple, par l’apprentissage ou le compagnonnage. Mais cela n’est pas toujours facile. Chez Mecachrome, Philippe Blandin constate : « Notre souhait est que chaque équipe de production ait un référent qui lui apprenne les “ruses du métier”. Malheureusement, les seniors ont tendance à laisser les jeunes se “casser les dents” sur les machines au lieu de leur expliquer comment faire. Les formations que nous organisons pour le management intermédiaire ont aussi pour but de les sensibiliser à l’importance cruciale de transmettre les savoir-faire. »
Fidélité et mobilité
S’il est souvent difficile aux PMI/ETI de recruter, leurs salariés se révèlent ensuite fréquemment d’une fidélité à toute épreuve. Comme le rappelle Jean-Philippe Demaël chez Somfy : « En 45 ans, Somfy n’a connu que quatre patrons différents et le turn-over des salariés est très faible. Nous avons parfois du mal à attirer les talents mais, ensuite, ils ne partent plus. »
Les ETI connaissent un faible turn-over. Cela tient à la fois à leur fort ancrage territorial et aux relations plus « familiales » ou de proximité qu’elles entretiennent avec les salariés. Pour Elizabeth Ducottet, PDG de Thuasne, « Saint-Étienne connaît un taux de chômage élevé, de l’ordre de 10 %. L’engagement de nos collaborateurs y est très fort, mais il est à peu près équivalent sur les autres sites. Le turn-over est plus important chez les commerciaux que dans la fabrication. Cette fidélité à l’entreprise me paraît assez fréquente dans la typologie d’entreprise que nous représentons, c’est-à-dire les ETI. »
Condition de croissance et facteur de stabilité, cette fidélité pourrait cependant avoir un revers. Aujourd’hui, du fait de leur internationalisation, les ETI ont également besoin de s’assurer d’une plus grande mobilité de leurs salariés.
Chez Sacred, Didier Fégly constate que le fait de pouvoir « travailler au pays » contribue certainement à la fidélité des salariés à l’entreprise. Cela dit, il apprécierait un peu plus de mobilité, brassant les compétences. « D’un autre côté, plus on se mondialise, et plus il est important d’avoir un ancrage solide dans un territoire. Il faut trouver l’équilibre entre la culture d’entreprise et les apports externes. »
IDEES CLES – Créer un module d’expression des souhaits de mobilité
Le Groupe Hervé a créé un module d’expression des souhaits d’évolution, ouvert à tous les salariés du groupe. Ils peuvent à tout moment indiquer leurs vœux, aussi bien en termes de mobilité géographique que d’évolution fonctionnelle. Lorsque la personne a le profil adéquat pour un poste qui se libère, l’entreprise favorise sa mobilité, par exemple, en prenant en charge une partie du déménagement.
FACTEURS DE SUCCES – RH
Favoriser les échanges entre l’école et l’industrie, i.e. inviter des représentants de l’industrie pour des interventions devant les élèves/professeurs/parents et multiplier les visites d’usines.
Former en interne, notamment en misant sur l’apprentissage, pour répondre aux besoins des métiers en tension.
Attirer des collaborateurs de haut niveau en jouant sur trois leviers : les atouts du territoire, la taille humaine de l’entreprise (responsabilité, polyvalence, etc.), l’ouverture sur le monde (mobilité internationale).
Faire évoluer les formations des ingénieurs pour intégrer davantage dans leurs cursus la dimension « gestion des hommes ».
Promouvoir les managers tant en fonction de leurs capacités managériales que de leurs compétences techniques.
Offrir des formations au management et au coaching pour soutenir notamment les modes de travail plus collaboratifs et moins hiérarchiques.
En matière de rémunération, créer de la cohésion au sein de l’entreprise en appliquant des règles transparentes et en réduisant les écarts de salaire.
Simplifier le cadre juridique et fiscal de l’épargne salariale − intéressement, participation, actionnariat salarié − et promouvoir ces dispositifs qui constituent à la fois un puissant levier de motivation et un moyen efficace d’associer les salariés à la performance de l’entreprise.
Construire et entretenir la motivation en jouant sur trois leviers : la reconnaissance via des politiques de carrière transverses ou internationales, la mobilisation autour d’un projet collectif, et l’écoute.
Se doter d’outils pour recueillir le savoir des salariés et notamment des opérateurs, afin de faire remonter des informations stratégiques sur le fonctionnement (et les dysfonctionnements) de l’entreprise.
- 26 – Ifop-Institut Lilly, Les enseignants et l’adéquation entre la formation scolaire et universitaire et l’industrie, novembre 2014.
- 27 – Voir aussi La Fabrique de l’industrie, ENSCI-Les Ateliers, Regarder et montrer l’industrie : la visite d’usine comme point de contact, Cahier d’expérimentation, Presses des Mines, 2013. Accessible à partir du site www.la-fabrique.fr
- 28 – Pour un panorama détaillé de ces actions, voir la note Formation professionnelle et industrie, La Fabrique de l’industrie, Presses des Mines, 2014, p. 58 à 72.
- 29 – Voir aussi : La Fabrique de l’industrie, Osez la voie pro. 12 parcours de réussite pour s’en convaincre, La Fabrique de l’industrie/ONISEP/Presses des Mines, 2015.
Dialogue social : pour vivre heureux, vivons cachés
À RETENIR
La pédagogie et la transparence dans les périodes calmes visent à construire des relations de confiance avec les représentants du personnel pour mieux affronter ensemble les difficultés.
La crise de 2008-2009 a donné naissance à des accords compétitivité-emploi qui ont inspiré les négociateurs du volet flexibilité de l’ANI 2013 (accord national interprofessionnel).
Certaines pratiques sociales sont parfois critiquées parce qu’elles tendent à diminuer l’influence syndicale au profit d’un dialogue direct avec les salariés.
Les dirigeants d’ETI sont souvent des acteurs engagés dans les instances professionnelles ou patronales.
On présente souvent les ETI, et le capitalisme familial qu’incarnent certaines d’entre elles, comme le lieu d’un dialogue social plus apaisé et plus proche du terrain que dans les grands groupes cotés. Les liens de proximité entre la direction et les représentants du personnel et les syndicats – une certaine forme d’intimité développée au fil du temps – permettent-ils de résoudre par le dialogue et la concertation la plupart des problèmes rencontrés ? Les chefs d’entreprise de notre échantillon sont assez diserts sur les dysfonctionnements du dialogue social au niveau national, mais beaucoup plus discrets dès lors qu’il s’agit de leur propre entreprise. Certains sont d’ailleurs très engagés dans les instances patronales, locales ou nationales, ce qui dénote de leur intérêt pour le sujet.
Quels sont alors les ressorts de cette interaction supposément fructueuse entre les dirigeants, les salariés et les représentants du personnel ? Y a-t-il des pratiques qui contribueraient à la qualité et à l’efficacité des relations sociales dans l’entreprise ?
Une tradition conflictuelle dans l’industrie ?
Plusieurs patrons d’ETI font le constat que le dialogue social dans l’industrie n’a pas toujours été facile. Laurent Bataille, PDG de Poclain Hydraulics, se souvient : « Il y a une trentaine d’années, les entreprises familiales étaient très décriées, et mon père en a beaucoup souffert. Leur image est devenue plus positive depuis une dizaine d’années. Les gens sont beaucoup plus conscients de tout ce qu’elles apportent à leur territoire et à notre pays. Mon père a eu des conflits violents avec des syndicalistes pour lesquels tout ce qui venait du patron était forcément mauvais. Aujourd’hui, je constate que nous arrivons beaucoup plus facilement à discuter et à nous comprendre. Cela étant, même si aujourd’hui tout le monde prétend participer à la gouvernance, il faut quand même reconnaître que le pouvoir revient légitimement à ceux qui détiennent le capital. »
Pour Emmanuel Hervé, président du Groupe Hervé, le passage du service à l’industrie a réservé quelques surprises : « Lorsque nous avons repris, en 2008, une activité navale dans la région de Lorient et de Saint-Nazaire, nous avons vraiment vécu un choc culturel. Nous étions habitués à la participation des salariés et même à la co-construction des projets et nous avons été confrontés à des relations de pouvoir/contre-pouvoir entre la direction de l’entreprise et les représentants syndicaux. Tout ce que les dirigeants disaient était caricaturé et leurs interlocuteurs refusaient de les croire quand ils annonçaient les résultats de l’entreprise : “De toute façon, le patron s’en met de côté, c’est sûr : les pertes ne sont pas de vraies pertes”. Les salariés, loin d’être prêts à s’impliquer dans l’entreprise, étaient dans une attitude franchement cynique vis-à-vis de l’organisation. Je ne les critique pas : ce comportement était lié à la relation historique qui s’était instaurée entre les dirigeants et les salariés. »
C’est également ce qu’a découvert Éva Escandon, lors de la fusion des deux entreprises qu’elle dirige : « Chez SMSM, je n’avais aucun problème avec les délégués syndicaux. Quand une difficulté se présentait, nous en discutions et nous trouvions une solution. Les salariés savaient que lorsque je dis quelque chose, je tiens parole, et ils me faisaient confiance. Chez SMFI, la culture syndicale était beaucoup plus virulente. Les salariés ne croyaient tout simplement pas ce que je leur disais. Chaque mois, les délégués du personnel me présentaient trois pages de questions, alors même qu’il n’y avait aucun problème particulier dans l’entreprise. »
Les conditions de la confiance
Confrontés à des difficultés sociales, les chefs d’entreprise tendent spontanément à faire confiance à l’intelligence des acteurs. Pour plusieurs d’entre eux, la pédagogie assortie d’une dose de transparence représente la clé pour bâtir la confiance et, progressivement, la coopération.
Le Groupe Hervé, historiquement dans le service, a décidé lors du développement de son pôle Industrie d’appliquer la même méthode de management, en mettant en place une réunion mensuelle où chaque manager traiterait avec les salariés de niveau n-1 de l’ensemble des questions, de façon transparente. « Chacune des petites entreprises est chargée de construire l’information financière à son niveau et de faire remonter les résultats, ce qui permet à chacun de s’assurer de la véracité des chiffres. C’est avec ce genre de dispositif que l’on peut recréer la confiance et, en donnant à chacun la possibilité de comprendre ce qui se passe dans l’entreprise, inciter les salariés à s’y impliquer et à se responsabiliser. L’entreprise devient alors “leur” entreprise et non celle du patron. Il n’y a plus de pouvoir (patron) et contre-pouvoir (syndicat) qui s’affrontent au nom des salariés, mais des intra-entrepreneurs qui construisent et participent directement à leur entreprise, en toute transparence et donc en confiance. »
Lors de la fusion entre SMSM et SMFI, Éva Escandon a décidé d’organiser des actions de formation communes pour apaiser le climat plutôt contestataire. « Avec l’aide d’une consultante, j’ai monté une formation à la communication d’une durée de trois jours pour l’ensemble du personnel, en mélangeant tous les services et tous les métiers des deux entreprises. Nous avons travaillé, entre autres, sur les rumeurs, les non-dits, les malentendus, qui peuvent avoir un effet catastrophique sur le climat de l’entreprise. Je me souviens, par exemple, d’un tuyauteur expliquant à une comptable “qu’il ne comprenait pas ce qu’elle faisait et que, de toute façon, ce qu’elle faisait ne servait à rien”… Grâce à cette formation, les gens ont appris à se connaître, à se respecter, à mieux travailler ensemble. »
Quand Georges Jobard devient directeur de Clextral en 1989, l’entreprise est issue du démembrement de Creusot-Loire ; elle a été ensuite reprise, puis revendue par Framatome. Elle a une culture très forte du produit, de l’innovation et du respect du client, mais elle a aussi gardé la culture syndicale d’un grand groupe. Les cinq syndicats s’y livrent une compétition féroce et donnent dans la surenchère permanente. Georges Jobard décide alors de mettre en place une formation à l’économie pour l’ensemble des salariés, en commençant par des éléments très simples, comme la comparaison entre le budget d’une entreprise et celui d’un ménage. L’objectif est que chacun comprenne que, dans un cas comme dans l’autre, on ne peut pas dépenser plus que ce que l’on gagne sans s’exposer à de graves problèmes. « Je profitais également des comités d’entreprise pour proposer aux salariés de réfléchir aux raisons qui nous avaient permis d’emporter tel marché ou nous avaient fait perdre tel autre, et aux aspects que nous pouvions améliorer pour être plus compétitifs. Peu à peu, nous avons réussi à ajouter ces réalités économiques et cette notion de compétitivité à celle de qualité, déjà bien ancrée dans l’entreprise. »
Cet effort de pédagogie a permis, à la longue, de moderniser les relations sociales. Au bout de quelques années, le président était parvenu à ce qu’avant toute négociation salariale, les cinq syndicats se mettent d’accord sur une position commune. Quand est arrivée la loi sur les 35 heures, il a également obtenu leur accord pour que cette réforme n’entraîne aucun surcoût pour l’entreprise.
D’autres entreprises comme Daher ont joué sur la solidarité pour restaurer la confiance des acteurs. Le président du groupe, Patrick Daher, a racheté Socata, une filiale d’EADS qui avait une culture syndicale « grand groupe » : « Nous avons expliqué aux syndicats qu’en cas de succès, tout le monde en profiterait, même les unités qui rencontreraient des difficultés, mais que si les résultats n’étaient pas là, il n’y aurait de participation et d’intéressement pour personne. Cette approche collective et solidaire leur a plu. »
La crise et les accords compétitivité-emploi
La crise de 2008-2009 a donné naissance à des expérimentations qui ont ensuite inspiré les négociateurs du volet flexibilité de l’ANI (accord national interprofessionnel) du 11 janvier 2013, transposé dans la loi du 14 juin 2013. Inspirées des pratiques allemandes, ces expérimentations visaient à assurer la pérennité de l’entreprise traversant une période critique, tout en évitant les licenciements. L’accord compétitivité-emploi de Poclain Hydraulics en représente un exemple très abouti (voir encadré), mais nombreuses ont été les entreprises à recourir à des méthodes similaires.
Étienne Piot, qui dirigeait à la même période une filiale de Bosch devenue Aventics SAS, témoigne : « J’avais particulièrement apprécié, lors de la crise de 2008, la décision du groupe de préserver le patrimoine de l’entreprise et, pour cela, de ne pas licencier les salariés. Nous avons appliqué cette politique à Bonneville et, au lieu de mettre les salariés en chômage partiel, nous avons organisé un énorme programme de formation pour leur faire passer des CQPM (certificats de qualification paritaire de la métallurgie). Pour certains, il s’agissait du premier diplôme qu’ils obtenaient de leur vie. »
Il arrive donc que toutes les parties prenantes d’une entreprise (salariés, actionnaires, banquiers, fournisseurs…) se montrent solidaires pour préserver leur « bien commun », que représente la continuité de la société.
Dans d’autres configurations, ces expérimentations se sont cependant moins bien passées. À peu près à la même époque, le fabricant de lampes Osram, filiale de l’allemand Siemens, a proposé à 600 de ses 730 salariés de son usine de Molsheim (Bas-Rhin) une baisse de salaire de 12,5 % étalée sur trois ans, pour faire face à la nécessaire reconversion de l’usine suite à l’interdiction européenne des ampoules à incandescence, spécialité de ce site de production. Les 108 personnes qui ont refusé cette proposition ont été licenciées. Selon la direction, il s’agissait de sauver 400 emplois du site. L’épisode a fait grand bruit. Suite à une médiation ordonnée par le tribunal de grande instance, une solution au conflit a été trouvée fin 200930.
Selon Laurent Bataille, dans cette affaire, Orsam avait ciblé la baisse des salaires sur les ouvriers, tout en maintenant la rémunération des cadres au même niveau. « Cela ne pouvait pas marcher. Dans notre cas, je me suis appliqué une baisse de salaire supérieure à celle demandée au personnel : 20 % du salaire net au lieu de 15 % du salaire brut. » Dans ce type de configuration, il est indispensable que la hiérarchie montre l’exemple.
Pour Jean-Philippe Demaël, PDG de Somfy, l’ANI de 2013 comporte des avancées significatives, à la fois du côté des syndicats représentant le personnel et du côté des syndicats patronaux. « C’est pour moi un motif d’espoir sur la capacité de notre pays à remettre en cause certains tabous. » Laurent Bataille ajoute : « Malheureusement, la nouvelle loi a été conçue de telle sorte que, paradoxalement, elle ne nous permettrait plus de faire ce que nous avons fait en 2009. » Il se réjouit cependant que l’Accord national aille dans le sens d’une « déjudiciarisation » des relations sociales.
EN SAVOIR PLUS – Un accord chez Poclain Hydraulics
Entre 2008 et 2009, au moment de l’éclatement de la crise systémique initiée par les subprimes américains, le chiffre d’affaires de Poclain Hydraulics tombe de 250 à 145 M€. La direction cherche des solutions pour surmonter cette mauvaise passe. « Nous voulions éviter à tout prix un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi). Nous avons mis au point un accord qui comportait cinq points majeurs : engagement à ne pas licencier, chômage partiel, réduction du temps de travail, baisse des salaires, accord d’intéressement », explique Laurent Bataille, le PDG. À l’époque, le dispositif proposé était « sur le fil du rasoir » par rapport au droit social français.
Les étapes de l’accord
Les organisations syndicales ont signé l’accord, acceptant un changement d’organisation de l’entreprise qui faisait passer le nombre d’heures travaillées de 35 à 30, avec un horaire fixe de 6 heures par jour. Il a ensuite fallu obtenir la modification des contrats de travail. L’accord prévoyait des modifications substantielles pour 92 % d’entre eux, les rémunérations nettes étant réduites entre 5 et 15 %.
Chaque salarié a été reçu individuellement et s’est vu expliquer ce que serait sa rémunération nette après impôts. Les salariés ont montré une incroyable solidarité. « Pour quelques situations particulièrement difficiles, nous avons mis au point des solutions adaptées. Je pense à l’un de nos collaborateurs qui était divorcé et devait verser 50 % de son salaire à son ex-conjointe : avec 15 % de salaire en moins, il ne lui restait pas grand-chose pour vivre », précise Laurent Bataille.
Sur les 519 salariés du site de Verberie, 39 ont refusé l’accord et ont été licenciés. Environ 25 d’entre eux étaient des personnes de plus de 57 ans : au moment où l’accord a été mis en œuvre, elles ne pouvaient pas savoir que l’entreprise allait revenir à la situation antérieure moins d’un an plus tard, et elles craignaient d’être perdantes pour le calcul de leur retraite. Quelques personnes ont décidé de chercher un autre emploi pour se rapprocher de leur famille. Enfin, un petit nombre de salariés s’est lancé dans la création d’entreprise.
La troisième étape consistait à obtenir l’accord de l’Inspection du travail pour les 37 jours de chômage partiel et le licenciement des 39 salariés. L’inspectrice départementale du travail estimait qu’avec 39 départs, la loi obligeait l’entreprise à faire un PSE. Pour obtenir l’autorisation de faire cette opération sans PSE, Laurent Bataille a dû convaincre les cabinets de trois ministères, celui du Travail, celui de l’Emploi et celui de l’Industrie. La perspective de réduire les salaires allait à l’encontre des promesses du président de la République de l’époque concernant l’augmentation du pouvoir d’achat.
Ensuite, tout est allé très vite. L’accord a été négocié au mois de mars et mis en œuvre au 1er avril. « Si nous avions fait le choix d’un PSE, la procédure aurait été beaucoup plus longue, explique Laurent Bataille, et elle aurait probablement abouti au moment où les commandes reprenaient. Avec le dispositif retenu, nous avons pu remonter les salaires dès le 1er janvier suivant. » Le même principe a été appliqué aux salariés de l’étranger.
L’objectif initial était de réduire la masse salariale de 20 %. À la fin de l’année, la réduction atteignait 26 %, ce qui a permis de réaliser des bénéfices qui ont été immédiatement redistribués aux salariés et aux actionnaires. Avec six ans de recul, il s’agit d’un épisode presque « mythique » dans l’histoire de cette entreprise. Ceux qui peuvent dire qu’ils y ont participé en sont fiers.
La qualité des relations avec les partenaires sociaux
Jean-Philippe Demaël, DG de Somfy, considère important de construire de bonnes relations avec les syndicats quand tout va bien, pour mieux faire face ensemble aux éventuelles difficultés futures. Il n’a donc pas voulu se contenter d’un dialogue social limité aux négociations annuelles et à une discussion une fois par an sur la stratégie de l’entreprise avec les représentants du personnel.
Avec le responsable des ressources humaines, il a organisé une formation pilotée par Jean Kaspar, ancien secrétaire général de la CFDT, pour réfléchir à ce que pourrait être une coopération efficace entre représentants de la direction et représentants du personnel. La position défendue par Jean Kaspar peut être résumée de la façon suivante : plus on est nombreux autour de la table et plus on est intelligents, mais les salariés ne peuvent pas prétendre décider à la place des dirigeants. En d’autres termes, la discussion se partage, mais pas la décision.
Après cette formation, direction et représentants du personnel ont commencé à travailler ensemble sur deux thèmes. Le plan « Stress au travail », d’une part, qui a été imposé aux entreprises d’une certaine taille à la suite de la vague de suicides chez France Télécom ; Somfy était concernée par le sujet pour avoir enregistré quelques cas de burn-out. Le handicap, d’autre part : un certain nombre de salariés étaient très motivés par cette question pour des raisons personnelles et ont proposé de faire de Somfy l’entreprise la plus accueillante possible. La direction a également décidé de donner plus de visibilité aux partenaires sociaux et leur a ouvert la Somfy Web TV, qui diffuse des reportages sur l’Intranet.
Chez Poclain Hydraulics, le PDG juge que les relations sont plutôt bonnes avec les syndicats. « L’époque de la lutte des classes et du marxisme est un peu loin désormais. » Les relations sociales y représentent un coût annuel de 640€ € par salarié, auquel s’ajoutent environ 200€ € pour la médecine du travail. Cependant, Laurent Bataille juge ces relations extrêmement formatées, en partie à cause du cadre imposé par le droit social, parfois loin d’un dialogue « naturel » qui devrait s’instaurer pour résoudre les problèmes de l’entreprise. Ce « carcan » se traduit par des postures et des figures imposées du discours, qui témoignent en outre d’une faible connaissance des enjeux économiques et du fonctionnement des entreprises. « Je me souviens d’une négociation avec un délégué CGC, qui tirait d’un petit ouvrage, du genre Le Particulier, des arguments complètement décalés par rapport à la situation dont il s’agissait. J’ai souvent vu aussi des délégués de la CGT participer aux négociations jusqu’au bout puis finalement refuser de signer l’accord. »
Certains vont plus loin et esquissent une remise en cause du rôle des corps intermédiaires, qui seraient trop peu attachés à défendre le « bien commun » qu’est l’entreprise. Un dirigeant en témoigne : « Je préside le directoire d’une entreprise qui emploie 3 500 personnes dans le monde, dont 1 300 en France. Cette société n’a jamais autant évolué, sur le plan social, que pendant les deux années où, en raison d’une carence au premier tour des élections des délégués du personnel, une liste complètement indépendante s’était constituée au deuxième tour. Avec ces élus indépendants, nous avons vraiment pu travailler : ils faisaient remonter les vrais problèmes de l’entreprise et se préoccupaient de l’intérêt général. Je n’ai jamais retrouvé cette attitude depuis. Nos interlocuteurs ne parviennent pas à se débarrasser d’un langage conventionnel et de revendications qui sont élaborées au niveau de la centrale départementale et importées telles quelles au sein de l’entreprise. »
Cette position serait de plus en plus partagée, à en croire Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT : « Je constate qu’un nombre grandissant d’employeurs considère que les syndicats sont un problème pour les entreprises31 ». Le dialogue social sans arrière-pensées reste une pratique difficile de part et d’autre. Les patrons d’ETI, eux, rêvent d’un partenariat social à l’allemande, où chacun voit l’autre comme un partenaire et non comme un adversaire.
Des acteurs engagés dans les organisations patronales
Nombreux sont les patrons d’ETI engagés dans des instances professionnelles ou syndicales.
Il ne faut pas uniquement voir dans ces instances des outils d’influence. Elles permettent aussi d’éviter l’isolement du chef d’entreprise, toujours dangereux pour la lucidité, et de partager des problèmes et des solutions. Cet engagement peut aussi découler de convictions personnelles en faveur de l’intérêt général : attractivité de l’industrie, parité, égalité des chances, etc.
EN SAVOIR PLUS – Family Business Network
Cette association, créée il y a vingt-quatre ans par un Américain qui avait suivi des cours sur l’entreprise familiale à l’IMD (International Institute for Management Development) de Lausanne, voulait initialement permettre aux personnes ayant suivi cette formation de conserver des liens entre elles. FBN a toujours son siège à l’IMD de Lausanne mais elle compte désormais 7 000 membres représentant des entreprises familiales de toutes tailles, réparties dans le monde entier. On y trouve des familles comme Wendel, Peugeot ou encore l’Indien Tata. Chaque année, son congrès mondial réunit entre 800 et 1 000 personnes.
Quelques exemples parmi d’autres.
Alain Di Crescenzo, PDG d’IGE+XAO, a choisi de s’impliquer dans la vie économique de la région Midi-Pyrénées et est élu président de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse depuis décembre 2010. Jérôme Duprez, PDG de Moret Industries, est président de l’UIMM Picardie et membre de l’assemblée générale du Medef Picardie. Quant à Laurent Bataille, il est à la fois vice-président de l’UIMM Picardie et membre du bureau de l’UIMM Paris, entre autres mandats (FIM, Medef, Family Business Network…). Luc Darbonne, PDG de la holding du groupe Darégal, consacre une grande partie de son temps au réseau Family Business Network, dont il préside l’antenne française.
Philippe d’Ornano, président du directoire de Sisley, et Elizabeth Ducottet, PDG de Thuasne, sont coprésidents du mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI), fondé en 1995 par Yvon Gattaz. Le syndicat fait la promotion des patrons propriétaires d’une moyenne entreprise de 100 à 3 000 salariés. Le combat de Philippe d’Ornano au sein de METI « vise à faire changer les choses pour pouvoir rester en France ».
Didier Fégly de Sacred a assuré pendant six ans la présidence du SNCP (syndicat national du caoutchouc et des polymères), de l’Ifoca, organisme de formation de la branche, et du LRCCP, laboratoire de recherche de la branche, avant de créer et de présider pendant huit ans le pôle de compétitivité Elastopôle.
Pour Éva Escandon, femme industrielle, l’engagement est une seconde nature. En tant que membre du bureau de l’UIMM Flandre Maritime, elle s’est investie dans l’opération « Bravo l’Industrie », destinée à faire connaître les métiers de l’industrie à des jeunes en voie d’orientation. Comme beaucoup de patrons, elle est convaincue qu’il faudrait faire visiter davantage les entreprises industrielles aux jeunes mais aussi aux parents et professeurs pour leur faire découvrir les métiers de l’industrie, « qui ne sont pas si noirs, moches, bruyants et affreux qu’on le prétend. La réalité, c’est que ces métiers de chaudronnier, soudeur, mécanicien, sont vraiment extraordinaires et tout à fait susceptibles d’attirer des vocations. » Membre de la CCI de Dunkerque, elle a créé en 2007 le réseau les « Elles de l’industrie », qui réunit toutes les entreprises et institutions du territoire pour contribuer à la féminisation de l’industrie. Elle s’est également attelée à la féminisation des mandats au sein de la CCI de Dunkerque. Elle défend en effet la cause des femmes chefs d’entreprise. Elle a donc créé en 2008 la délégation Côte d’Opale de l’association FCE France (Femmes chefs d’entreprise), dont elle est depuis 2013 la présidente nationale. Fidèle à ce combat, elle a rejoint au Medef l’équipe de Pierre Gattaz et est vice-présidente de la commission Innovation sociale et managériale. Dans ce cadre, elle travaille principalement sur deux sujets : le surcroît de performance que la féminisation peut apporter aux entreprises et la féminisation des mandats au sein du Medef. Car, à ce jour, les mandats au sein des instances patronales sont encore détenus en majorité par des hommes.
EN SAVOIR PLUS – Femmes chefs d’entreprise
Cette association, fondée en 1945 par Yvonne-Edmond Foinant, une maître de forges qui fut également la première femme chef d’entreprise élue à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, a pour objectif d’inciter les femmes à prendre des responsabilités dans la vie économique, de renforcer leur présence dans les instances décisionnelles au niveau local, régional et national, de les informer et de les former.
FACTEURS DE SUCCES – Dialogue social
Créer de la confiance par la pédagogie, en offrant à l’ensemble des salariés des formations sur les enjeux économiques et le fonctionnement de l’entreprise.
Favoriser la transparence et l’échange d’informations, en invitant chaque manager à communiquer lors d’une réunion mensuelle avec les salariés de niveau n-1.
Instaurer un dialogue permanent avec les représentants du personnel ne se limitant pas aux réunions imposées par la loi et profiter des situations où « tout va bien » pour échanger.
S’impliquer dans les instances professionnelles ou syndicales afin de partager des « bonnes pratiques », mais aussi d’étendre sa sphère d’influence sur des problématiques d’intérêt général.
- 30 – Le plan social a été retiré et l’accord a exclu les « licenciements économiques collectifs contraints jusqu’au 1er septembre 2014 ». En échange, les salariés ont accepté un gel des salaires « à hauteur de 5 % d’économies », les cadres ont renoncé à des jours de RTT et le temps de travail hebdomadaire a été porté à 35 heures effectives, contre 33h20 auparavant.
- 31 – Cité dans Sociétal 2015, sous la direction de Jean-Marc Daniel et Frédéric Monlouis-Félicité, Institut de l’entreprise/Eyrolles, 2015.
Des entreprises citoyennes dans un environnement incertain
À RETENIR
L’écosystème français est jugé par les dirigeants d’ETI comme globalement défavorable à leur croissance par rapport à d’autres pays.
Leurs critiques portent principalement sur le différentiel de fiscalité et de coût du travail, mais aussi sur la complexité administrative, l’incohérence et l’insécurité réglementaire, le manque de vision à long terme de la sphère politique et administrative.
Les élus locaux, plus à l’écoute, remportent davantage l’adhésion.
En dépit de leurs critiques, les dirigeants d’ETI manifestent leur attachement au territoire national et, plus encore, aux bassins locaux où ils sont historiquement enracinés.
Au centre des valeurs affirmées par les ETI, le sens du long terme est revendiqué et reconnu comme une spécificité forte des entreprises patrimoniales, en particulier familiales.
Les ETI s’efforcent de préserver l’esprit PME de leur début et de donner un contenu concret aux valeurs qu’elles affichent, ce qui suscite en retour une grande fidélité chez les salariés.
Leurs actions de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) interviennent à proximité de leur territoire de légitimité (en termes géographiques ou d’activité).
Les patrons d’ETI ont souvent des mots sévères pour qualifier leur écosystème national et les entraves que celui-ci fait peser sur leur compétitivité. Ils ressentent donc une fierté légitime face aux obstacles qu’ils ont réussi à surmonter. Comme nous le confiait Laurent Bataille, « je suis un chef d’entreprise heureux ». Même s’ils sont partis à la conquête du monde, ces patrons restent profondément attachés à leur territoire d’origine, aux hommes et aux femmes de l’entreprise, et, plus généralement, à leur pays. Pour l’écrasante majorité d’entre eux, ils ne quitteraient la France qu’à contrecœur et ne l’envisagent en aucune manière. Même s’il est difficile de généraliser, cette attitude repose fréquemment sur un socle de valeurs solides, acquises tôt dans leur vie, et qu’ils déploient dans tous les aspects de la vie de l’entreprise : sens du long terme, proximité et respect des hommes, loyauté dans la pratique des affaires, approches citoyennes.
Un écosystème jugé globalement défavorable
Tous les patrons de PMI et d’ETI s’accordent sur le fait que le système fiscal et social français pèse fortement sur la croissance des entreprises et les handicape par rapport à de nombreux pays, même au sein de l’Union européenne. Compte tenu de leur structure et de leur positionnement sur des marchés internationalisés et face à la concurrence des grands groupes, cette question est pour eux cruciale. Des enquêtes32 montrent que l’environnement réglementaire et fiscal est cité comme un des principaux freins à leur croissance.
Cependant, tout se passe comme si les ETI avaient intégré cette contrainte comme un état de fait et, partant, trouvé les moyens de la surmonter. La situation est un peu différente pour les PMI qui, dans ce contexte, jouent parfois leur survie.
Se plaindre de cette situation reste cependant un passage obligé du discours patronal, quelle que soit la situation réelle de l’entreprise, ce qui fait dire au communicant Sylvain Fort : « C’est presque une entrée du Dictionnaire des idées reçues de Flaubert qu’il faudrait inventer : “Impôts : toujours trop élevés. S’en plaindre”. »33
Le différentiel de fiscalité et de coût du travail
Selon un grand nombre de chefs d’entreprise, il existe en France quatre types de surtaxation :
L’impôt sur les sociétés (IS) est l’un des plus élevés d’Europe, notamment pour les ETI qui, au-delà de 250 M€ de chiffre d’affaires, se voient imposer des surtaxes.
Les taxes hors IS, dont le produit représente 32 milliards d’euros contre 50 milliards pour celui de l’IS. L’iFRAP a dénombré 153 taxes de ce type en France contre 55 en Allemagne34. Ces taxes s’appliquent généralement sur la masse salariale et sont donc exigibles même lorsqu’il n’y a pas de bénéfices, alors qu’en Allemagne, elles portent essentiellement sur les bénéfices35. « C’est surtout dans le “hors IS” que la situation est devenue catastrophique. On voit apparaître presque tous les jours de nouvelles taxes sectorielles. Un des membres de METI paie, par exemple, 2,20 M€ de “taxe papier” chaque année. Nous avons vu également apparaître récemment une “taxe cosmétique” », s’insurge Philippe d’Ornano.
Le troisième type de surtaxation concerne l’entreprise de façon indirecte : il s’agit des dispositifs touchant les actionnaires familiaux à travers l’ISF (impôt sur la fortune) ou la fiscalité de la transmission. En Europe, la France est le seul pays à avoir conservé l’ISF, à part quelques cantons suisses. L’Irlande l’a supprimé depuis 1974 et la Suède, souvent citée, depuis 2007. En ce qui concerne la transmission, huit pays européens ont déjà supprimé tous les droits de succession sur les entreprises. Les autres appliquent des taux de 3 à 5 % contre 6 à 7 % en France (lorsqu’on est dans le cadre du dispositif Dutreil).
Le quatrième type de surtaxation concerne les charges sociales. Non seulement ces dernières sont élevées, mais elles financent des dépenses qui ne relèvent pas du domaine de l’assurance des salariés mais plutôt de la solidarité nationale, comme la politique familiale, et devraient à ce titre être financées par l’ensemble des contribuables. Les charges des entreprises privées financent également une partie de la politique culturelle nationale, à travers la prise en charge des statuts spécifiques, tels que celui des intermittents du spectacle. L’entreprise privée prend également en charge l’essentiel du coût du chômage.
« À force de surtaxer les entreprises, on prend le risque qu’elles s’affaiblissent et qu’elles disparaissent, ou qu’elles se délocalisent. On prend surtout le risque d’accroître encore le chômage, dont le niveau est déjà dramatique. Chaque mois, 40 000 personnes supplémentaires pointent au chômage, ce qui représente l’équivalent d’une ville moyenne française. C’est extrêmement déstructurant pour la société tout entière. C’est pourquoi, même s’il me paraît possible de réduire le niveau de la fiscalité, c’est avant tout sur le coût du travail que je souhaiterais qu’on agisse en priorité. En compensant par une augmentation courageuse de la TVA qui, rappelons-le, est en France inférieure de plus de 2 points à la moyenne européenne », propose Philippe d’Ornano.
Complexité et incohérence administratives à tous les niveaux
Pour reprendre le célèbre mot d’Yvon Gattaz, « les ETI n’ont pas besoin d’aides, elles ont besoin d’air ». Au-delà de la seule fiscalité, ce qui est reproché aux pouvoirs publics, c’est la complexité administrative, l’empilement de mesures déconnectées les unes des autres, l’incohérence des dispositifs et l’insécurité juridique dans laquelle les entreprises évoluent.
Comme l’explique Pascal Rémy, PDG de SNF, « les freins à notre croissance viennent essentiellement des difficultés que nous rencontrons pour construire de nouvelles capacités. En France, le nombre d’autorisations nécessaires pour pouvoir étendre un site de production sur un terrain légèrement boisé est ahurissant. De plus, il est très difficile de savoir qui prend la décision. Des instances nouvelles ne cessent d’apparaître, comme le Comité national de protection de l’environnement. En principe, cette entité n’a qu’un avis consultatif, mais en pratique, personne ne prendra une décision allant à l’encontre de ses avis. Tout cela prend énormément de temps. Aux États-Unis ou en Chine, la réglementation n’est pas forcément plus laxiste, mais les décisions sont prises beaucoup plus rapidement et on sait très exactement par qui. »
Elizabeth Ducottet, PDG de Thuasne à Saint-Étienne et co-présidente de METI, fait part de la même expérience : « Récemment, par exemple, nous avons demandé un permis de construire pour agrandir notre entrepôt de plusieurs milliers de mètres carrés ; nous n’avons obtenu qu’une autorisation partielle, qui ne nous permet pas de disposer de l’outil logistique dont nous avons besoin. Ce genre de situation nous paraît incompréhensible. »
Des aides publiques ou avantages fiscaux jugés assez sévèrement
Chez Mecachrome, l’ancien secrétaire général Philippe Blandin évoque « le sentiment d’être devant un empilement de dispositifs, tous plus imaginatifs les uns que les autres, mais pas forcément très utiles pour les entreprises Par exemple, il existe des aides à la réindustrialisation (ARI), mais elles ne concernent que les zones d’aide à finalité régionale (AFR). Or, Aubigny-sur-Nère, où nous voudrions investir dans de nouvelles machines et déployer de la formation, ne se trouve pas dans une zone AFR. Mecahers, en revanche, qui est installée à Launaguet, près de Toulouse, se trouve dans une zone AFR. »
Le CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi), adopté en 2013, ne soulève pas l’enthousiasme que son principe laissait espérer, car il se borne à rendre d’une main ce qui est prélevé par l’autre, et pas forcément dans les mêmes proportions ; il rate donc son objectif qui était de rendre des marges de manœuvre aux entreprises pour investir. « Nous avons lancé une étude pour mesurer l’impact du CICE, mesure a priori positive puisqu’elle est destinée à aider les entreprises à améliorer leur compétitivité. METI a mis en ligne un “calculateur CICE” (www.vrai-calcul-cice.fr) qui permet de mettre en regard la réduction d’impôt que les entreprises pourront percevoir en 2014, ou plus tôt si elles en font la demande, et les hausses d’impôts annoncées sur la période 2012-2014. Notre calculateur prend en compte 29 impôts qui vont augmenter mais, par définition, n’inclut pas les impôts sectoriels. Une centaine d’entreprises a déjà fait le calcul et pas une n’a obtenu un résultat positif. En moyenne, le CICE va seulement compenser 40 % des hausses d’impôt », analyse Philippe d’Ornano (Sisley), immédiatement rejoint par un autre industriel : « Je confirme votre analyse en ce qui concerne le CICE. Les impôts payés par mon entreprise ont augmenté de 800 000€ € en deux ans. Le CICE va nous rapporter 370 000€ €, ce qui ramène l’augmentation à 430 000€ €, mais ne nous permet pas d’investir. »
Enfin, les chefs d’entreprise distinguent l’attitude des pouvoirs publics au niveau local, dont ils reconnaissent le soutien, et le niveau administratif déconcentré ou national, dont ils déplorent l’absence de vision stratégique. Ainsi Philippe d’Ornano : « Je voudrais rendre justice aux maires : c’est vrai que plus on va en province, et plus ils sont présents. Lors de l’inauguration de notre site, aussi bien le maire de Saint-Ouen-l’Aumône que celui de Cergy-Pontoise ont répondu à l’invitation. De même, à Blois, les maires successifs ont été très présents, qu’ils soient de droite ou de gauche. Au niveau local, il existe une bonne compréhension des enjeux de l’industrie. C’est plutôt au plan national que nous manquons de vision stratégique. En France, on privilégie le consommateur plutôt que le producteur ». Un diagnostic partagé par Frédéric Coirier, PDG du groupe Poujoulat dans les Deux-Sèvres : « Il existe une sorte de discordance entre l’attitude de nos interlocuteurs de l’échelon local et régional, qui sont vraiment à notre écoute et comprennent parfaitement les répercussions de la bonne ou mauvaise santé de l’entreprise sur celle du territoire, et l’attitude de l’administration à l’échelon national. De façon générale, l’administration se montre suspicieuse et ses interventions ont souvent pour effet de nous dissuader d’investir ou d’augmenter tellement le coût de l’investissement que celui-ci devient inenvisageable. Nos relations avec les élus locaux sont souvent excellentes mais ils n’ont pas toujours la capacité à trouver des solutions, lorsque les dossiers relèvent de décisions de l’État. ».
Un fort attachement national et territorial
En dépit de toutes les critiques et insatisfactions qu’elles adressent à la sphère politique et publique nationale, les ETI se distinguent des grands groupes, souvent perçus comme « apatrides », par leur fort ancrage territorial, et un attachement à leur pays qui s’exprime en termes de loyauté et de responsabilité. Pour beaucoup de patrons d’ETI, une des premières responsabilités qu’ils exercent est celle de maintenir une partie substantielle de leur activité en France.
Philippe d’Ornano (Sisley) en fait partie : « La France est encore aujourd’hui le leader mondial pour la cosmétique, et elle fait référence dans ce domaine, comme l’Allemagne pour l’automobile. Nous avons bénéficié de cette référence et nous y participons par notre succès. C’est pourquoi notre souhait est de continuer à investir en France. » Même position pour André Ulmann, fondateur de HRA Pharma : « Le choix de rester en France est de nature idéologique. Nous sommes français, nous avons bénéficié de l’éducation française et d’un certain nombre d’avantages. Je trouverais déloyal de partir. J’avoue cependant qu’il est parfois tentant de céder aux sirènes de la Suisse, par exemple. Le canton de Vaud, en particulier, propose des conditions vraiment alléchantes pour les industriels de la pharmacie. Ce serait certainement plus intéressant d’aller ailleurs, mais je n’en ai pas envie. En revanche, je trouve un peu pénible d’en être à mon septième contrôle fiscal en quinze ans… ». Cette attitude est également partagée par Jean-Philippe Demaël chez Somfy : « Nous nous sommes engagés à conserver un nombre d’emplois stable en France et notamment à maintenir la conception et la fabrication des produits innovants dans notre pays. »
Cet attachement est encore plus marqué à l’égard du territoire d’origine. « Somfy est le premier employeur de Haute-Savoie et cela nous donne des responsabilités. C’est aussi une grande force des ETI que d’avoir sous les yeux, au quotidien, le résultat des décisions qu’elles prennent. Il y a quelques années, certains prétendaient que les entreprises pouvaient et devaient ne pas avoir de nationalité. C’est une erreur. Selon que votre siège est situé à Cluses, comme le nôtre, à Paris ou à Londres, les décisions que vous prendrez seront totalement différentes », déclare Jean-Philippe Demaël.
Idée reprise par Laurent Bataille : « Nous sommes implantés en Picardie, près de Compiègne, et nous sommes partie prenante des centres de formation concernant nos métiers et d’un certain nombre d’autres activités locales. Cet ancrage territorial joue un rôle très important. » Et confirmée par Frédéric Coirier, président du groupe Poujoulat : « Depuis cinq ans, nous avons investi en moyenne 10 M€ par an sur le site de Saint-Symphorien, ce qui est considérable à l’échelle de notre entreprise. J’ai autour de moi des hommes et des femmes qui me donnent envie d’aller de l’avant (…). L’entreprise communique et partage énormément avec son environnement et elle est très appréciée. Nous n’envisageons donc en aucun cas de quitter ce territoire. »
Un socle affirmé de valeurs
Dès que les dirigeants d’ETI parlent de leur entreprise, il est vite question de valeurs… spécifiques, uniques, différenciantes. Ce discours est parfois empreint d’une certaine confusion. Les valeurs qui apparaissent dans les chartes ou dans les discours explicites des chefs d’entreprise tendent parfois à se confondre avec les priorités ou les facteurs-clés de succès. Prenons par exemple des termes comme « qualité », « innovation », « international », « priorité au client », qui sont assez fréquemment cités : ces principes directeurs ou manières d’agir relèvent-ils de la morale, de l’éthique ?
Il n’en demeure pas moins que les ETI incarnent aux yeux du public quelques valeurs spécifiques et qu’elles s’efforcent de témoigner de ces principes dans la conduite de leur action.
Le sens du long terme
S’il est une valeur qui différencie profondément les PME/ETI des grands groupes, aux yeux du public, c’est leur vision à long terme. Comme l’indique Denis Muzet, directeur de l’Institut Médiascopie, dans son étude sur « Les mots de la compétitivité36 : « Si les PME sont perçues par nos concitoyens comme des moteurs fondamentaux de notre compétitivité, les grands groupes sont considérés sans grand enthousiasme, voire avec circonspection, pour ne pas dire méfiance. Perçus comme lointains en même temps qu’apatrides, ils agiraient moins en faveur de la compétitivité de notre pays que dans l’intérêt de leurs actionnaires. »
Christel Bories, qui fut PDG de Constellium et dirige aujourd’hui Ipsen dans l’industrie pharmaceutique, met l’accent sur « l’importance de l’action sur le long terme et de la persévérance. Dans l’industrie, il y a peu de choses qui s’obtiennent en claquant des doigts. Il faut sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier et travailler dans la durée ». La stabilité de l’actionnariat représenterait la condition nécessaire à la vision de long terme des ETI (voir aussi chapitre Financement, gouvernance et transmission).
C’est en tout cas une spécificité affirmée par de nombreux patrons d’entreprises patrimoniales. Selon Stéphan Guinchard, l’intérêt des entreprises familiales par rapport aux autres tient au fait qu’elles raisonnent souvent en termes de génération, c’est-à-dire sur un horizon de vingt-cinq ans environ, ce qui leur permet de relativiser le fait qu’une année ou deux soient plus difficiles. Pour Guillaume Bataille, directeur général délégué de Poclain Hydraulics et membre de la troisième génération de Bataille à la tête de l’entreprise, l’autonomie d’un actionnariat familial permet d’assurer aux salariés continuité et engagement sur le plan managérial et actionnarial. Elle permet de prendre des décisions à long terme, voire à très long terme, comme par exemple un investissement en R&D dont le CA potentiel n’est prévu qu’en 2025.
EN SAVOIR PLUS – Des valeurs citées par les ETI
Chez Poclain Hydraulics, les quatre valeurs affirmées par l’entreprise sont : « l’importance primordiale accordée aux 1 800 hommes et femmes qui la composent ; l’innovation, qui suppose une prise de risque et une remise en cause permanentes ; l’international, car nous avons choisi d’être un spécialiste mondial plutôt qu’un généraliste local ; et enfin l’indépendance, gage de notre développement et de notre pérennité. »
Alain Di Crescenzo, PDG d’IGE+XAO, le spécialiste de la CAO pour les circuits électriques, parle de 5 valeurs partagées : l’ouverture, l’audace, le professionnalisme, le dynamisme, et enfin la considération pour les clients, les équipes, les investisseurs et les partenaires. « L’adhésion à ces valeurs est déterminante lors d’un recrutement. »
Pour Claude Lenoir, président d’Affival, producteur de fil fourré et filiale d’un groupe allemand, on trouve parmi les valeurs qui animent l’entreprise : la recherche de satisfaction du trio clients/actionnaires/salariés, l’innovation, la performance, la qualité des produits et services, la protection de l’environnement et l’application d’un code de conduite dont la lutte anti-corruption fait partie.
Chez Moret Industries, Jérôme Duprez indique : « Nous demandons à nos salariés de tout faire pour satisfaire le client externe ou interne, de faire preuve de loyauté et de sincérité, de tolérance et d’esprit d’équipe, de professionnalisme, de disponibilité, d’esprit d’initiative. En contrepartie, l’entreprise et les managers s’engagent à être flexibles et à s’adapter aux besoins du client, à faire confiance aux équipes, à considérer la différence comme une richesse, à accorder autonomie et responsabilité à chacun, à reconnaître le droit à l’erreur pour tous les salariés. »
Selon Philippe d’Ornano, président de Sisley, entreprise créée par son père, « en France, on parle beaucoup de start-up et d’innovation, et beaucoup moins du temps nécessaire à la transformation d’une bonne idée en marque, voire en marque mondiale. Le long terme paye. L’entreprise familiale est un excellent outil pour travailler dans le long terme, car elle a la capacité d’investir – même à perte – pendant une période longue, convaincue de la pertinence de ses choix de développement. Mon père a fait le choix de ne pas distribuer de dividendes pendant vingt ans, ce qui lui a permis de construire la marque Sisley et donne aujourd’hui à l’entreprise une grande force. ». Pour Jérôme Duprez chez Moret Industries, « la première condition de la croissance est la stabilité de l’actionnariat. Les cinq actionnaires familiaux de la génération de mon père ont accepté, pendant treize années sur quinze, de ne pas se verser de dividendes. »
Même des entreprises rachetées par des groupes familiaux dans le cadre de stratégies de diversification et non dirigées par un membre de la famille, témoignent de l’intérêt de pouvoir compter sur un actionnariat familial. C’est le cas de Somfy, rachetée il y a 30 ans par le groupe Damart. La famille Despature en détient encore aujourd’hui 70 %. Selon le DG, Jean-Philippe Demaël, « l’indépendance de Somfy joue un rôle vraiment important pour la motivation des salariés. J’ai connu des entreprises qui étaient perpétuellement traversées par des rumeurs de revente à tel ou tel groupe ; c’était très déstabilisant. »
Si l’actionnariat familial représente une solution pour garantir le long terme, il ne saurait cependant être érigé en modèle. D’autres approches du long terme sont également possibles.
Clextral, la « multinationale de poche » de Firminy, issue du démembrement de Creusot-Loire, a connu un grand nombre d’actionnaires : Framatome, puis des fonds d’investissement, enfin aujourd’hui Legris Industrie, un groupe familial diversifié. Son président Georges Jobard, qui dirige l’entreprise depuis 1993, a vécu tous ces changements. Il témoigne qu’en dépit de la diversité des actionnaires, un management déterminé peut, lui aussi, être garant de stratégies à long terme : « Nos actionnaires successifs ont accepté de s’engager dans ces stratégies, même si cela nous a demandé beaucoup d’efforts d’argumentation et de conviction. Tous les actionnaires sont tentés, à un moment ou un autre, de vous dire “écoutez, on va déjà faire du résultat cette année, et puis après on verra”. […] Dès l’époque où j’étais cadre chez Framatome, à la fin des années 1990, on a commencé à nous expliquer qu’il fallait créer plus rapidement de la “valeur actionnariale”. Rien de plus simple, il suffisait de diminuer l’effort d’innovation. C’était la façon la plus rapide d’améliorer les résultats, mais dix ans plus tard il n’y aurait plus eu de résultats du tout. Heureusement, nous avons été quelques-uns à résister à cette mode. Nous avons bien compris que notre avenir dépendait moins des actionnaires, qui pouvaient partir à tout moment, que de la pertinence de notre stratégie. La solution consistait donc à écouter les clients et à mettre les salariés à leur service. »
Pour Alain Di Crescenzo, PDG d’IGE+XAO, c’est au contraire la Bourse qui garantit autonomie et indépendance au chef d’entreprise : « Contrairement à ce que l’on croit souvent, un patron est plus à son aise avec quelques milliers d’actionnaires que face à deux investisseurs qui, ensemble, représentent plus de 50 % du capital. Aujourd’hui, aucun actionnaire institutionnel ne participe à notre conseil d’administration et tous les administrateurs sont choisis en fonction de leur compétence. »
L’esprit PME
Autre valeur : l’esprit PME. L’Institut Médiascopie écrit : « Les PME sont ainsi associées aux valeurs positives de l’entrepreneuriat – innovation, réactivité, audace, efficacité, polyvalence… – là où la grande entreprise capitaliste est assimilée à celles, moins qualitatives, voire moins humaines, de culture du résultat, de rentabilité et de flexibilité. » Quels que soient leur taille et leurs effectifs, les ETI tiennent donc souvent à conserver l’esprit PME des débuts. Ainsi, il n’est pas rare que l’entreprise soit décentralisée et organisée en petites unités.
Comme le Groupe Hervé, le groupe ARaymond37, qui réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 700 millions d’euros et a des activités manufacturières en Europe mais aussi aux États-Unis et en Chine, se considère comme un réseau de PME et cultive la décentralisation afin de préserver la fibre entrepreneuriale en dépit du développement de la société.
Didier Fégly chez Sacred va dans le même sens : « Plutôt que de développer l’usine localement, j’ai décidé de développer de petites unités de 50 à 70 personnes dans plusieurs régions : d’abord en Alsace, puis récemment dans l’Allier et en Rhône-Alpes. »
L’esprit PME se cultive essentiellement via la proximité : proximité avec les salariés et avec les clients. Paul Rivier, ancien PDG de Tefal, filiale du groupe Seb, se souvient : « On déclare souvent que je connaissais personnellement les 3 000 salariés de Tefal : ce n’est pas tout à fait faux. Nous nous imposions de rendre des comptes au personnel sur la marche globale de l’entreprise, ce qui nécessitait au moins 30 réunions dans l’année, lorsque nous étions 3 000. » Même préoccupation pour Jérôme Duprez, PDG de Moret Industries : « Quand l’entreprise grandit, il n’est pas très facile de conserver “l’esprit PME”, qui repose sur un contact quotidien avec des personnels réunis dans la même usine. Pour tenter malgré tout de maintenir cet esprit, je me rends plusieurs fois par an sur tous les sites, ce qui m’amène à parcourir environ 65 000 kilomètres par an. Jusqu’au niveau n-3, j’ai un entretien avec tous les nouveaux collaborateurs pour leur parler des valeurs du groupe. »
La proximité avec les clients est également centrale dans les PMI/ETI. La taille réduite des entreprises et la multiplication des petites structures favorisent, en elles-mêmes, les contacts avec les clients. Mais même quand l’entreprise grandit, c’est une stratégie délibérée que de rechercher cette proximité, en particulier avec les gros clients particulièrement exigeants qui vont tirer vers le haut la performance de l’entreprise. Les clients sont par ailleurs étroitement impliqués au processus d’innovation et considérés comme une source majeure d’idées nouvelles (voir chapitre Innovation).
Le respect des personnes
Pour Jérôme Duprez, la première des valeurs est d’accompagner les personnes face aux aléas de la vie. Quand un collaborateur est confronté à un problème de santé, à un divorce, à la maladie d’un enfant, l’entreprise tient compte de ce fait et accepte que, pendant quelque temps, il ne soit pas opérationnel à 100 %. « Il y a quelques années, nous avons embauché une femme, qui, après avoir démissionné de son entreprise précédente, est venue chez nous en période d’essai. Au bout de quinze jours, elle a appris qu’elle avait un cancer du sein et elle était convaincue que nous allions la renvoyer. Je l’ai fait venir dans mon bureau et je lui ai remis sa lettre d’embauche définitive. Ce genre de geste me paraît de nature à créer des liens très forts entre les salariés et l’encadrement. »
Trouver des solutions pour conserver les salariés en période de crise grave comme l’a fait Poclain Hydraulics en 2009 témoigne aussi de ce sens des valeurs (voir aussi chapitre Dialogue social).
Une pratique loyale des affaires
Dans le cadre de la lutte anti-corruption, Affival veille à appliquer dans tous les pays des règles très strictes en la matière. Tous les directeurs généraux signent des engagements anti-corruption et sont responsables de leur mise en œuvre pour eux et auprès de leurs équipes devant la direction du groupe. Si une transaction paraît douteuse, qu’il s’agisse d’une vente ou d’un achat, une enquête est immédiatement ouverte. En cas de procédure irrégulière, le responsable peut être exclu de l’entreprise. « Nous ne pouvons pas nous permettre qu’une image de malhonnêteté soit attachée à la marque Affival ou au groupe SKW Metallurgie », explique Claude Lenoir, son président. Ce type de choix a des conséquences : « En Chine, par exemple, l’évolution de nos ventes est plus lente en comparaison à certains concurrents locaux. Il faudra encore du temps pour que nous puissions développer avec les Chinois des relations autres que celles auxquelles ils sont habitués. Même si le nouveau Président chinois affiche une volonté forte de se battre contre la corruption il y a encore fort à faire et pour longtemps. »
Des approches citoyennes
Pour tous les dirigeants, il est indispensable qu’une entreprise soit profitable : sans profit, rien n’est possible. Toutefois, pour certains d’entre eux, l’objectif ultime est autre. L’entreprise a le devoir de rendre à la société une partie des richesses que celle-ci lui a permis de créer. Elle a même la responsabilité de réinvestir le champ public pour aider les collectivités territoriales à faire face aux problèmes qu’elles doivent gérer, comme le chômage des jeunes, la promotion de la diversité ou l’égalité des chances. Quels que soient les budgets que les pouvoirs publics consacreront à ces questions, ils ne pourront pas trouver de solutions sans la participation des entreprises. Le travail est en effet l’un des facteurs d’intégration les plus efficaces ; les entreprises ont un rôle à jouer et doivent donc changer de posture et réinvestir la sphère publique. Certains parlent même d’« entreprise-providence »38.
Jean-Philippe Demaël, le DG de Somfy, croit en cette mission : « Au XIXe siècle, les entreprises jouaient un rôle citoyen dans la société à travers le paternalisme. Avec l’avènement du marxisme, cette attitude a été interprétée comme une volonté d’opprimer les travailleurs. Les entreprises se sont alors cantonnées à leur compte de résultat. Aujourd’hui, si elles veulent rendre leurs profits acceptables et éviter la fracture avec l’opinion publique et, plus largement, l’éclatement de notre modèle démocratique, elles doivent à nouveau s’occuper des problèmes de la société. Les élus ne pourront pas, seuls, faire face à ces difficultés, d’autant que la puissance publique a de moins en moins d’argent. Ce sont les entreprises, créatrices de richesses et d’emplois, qui détiennent une grande partie des leviers d’intégration sociale. Elles doivent donc se mobiliser pour rendre un peu de sérénité à notre société. »
Dans le champ de la responsabilité sociétale, les ETI ont tendance à intervenir près de leur champ de légitimité.
HRA Pharma, l’inventeur de la pilule du lendemain, travaille, par exemple, avec un réseau d’ONG et consacre des efforts importants à des programmes d’éducation à la santé féminine et à la contraception. Somfy, pour sa part, s’est penchée sur la question du mal logement. « En tant qu’entreprise du bâtiment, nous ne pouvons pas rester indifférents au fait que trois millions de personnes, en France, sont mal logées ou sans logement. Depuis trois ans, nous avons donc réorienté la fondation Somfy vers des actions en faveur de l’accès à un logement décent. Nous allouons à la Fondation 1 % du résultat annuel, ce qui nous permet de monter des partenariats avec Emmaüs France ou d’autres associations. Dans ce domaine, nous avons cherché également à être innovants. Nous avons ainsi lancé les Petites Pierres, la première plateforme de financement participative pour l’accès à un logement décent. Dans le domaine de la RSE aussi, les entreprises doivent faire preuve d’imagination. Nous proposons aussi à nos salariés de consacrer 1 % de leur travail annuel, c’est-à-dire deux journées, à faire du bénévolat auprès des associations que nous soutenons, sous forme d’opérations collectives. Il peut s’agir, par exemple, de rénover un logement pour une famille déshéritée ou un bâtiment pour une communauté Emmaüs. »
Ce type d’opération a été initié l’an dernier et deux cents salariés y ont participé, en particulier des jeunes. Ils ont eu le sentiment qu’eux-mêmes et leur entreprise étaient des « bienfaiteurs », et l’impact sur l’entreprise en termes de fierté, de climat interne et de cohésion a été très positif. Car il n’est pas interdit, en effet, de concilier intérêt général et objectifs internes.
- 32 – Asmep-ETI, KPMG, « Les ETI, leviers de la croissance en France », avril 2013.
- 33 – In Sociétal 2015, Institut de l’entreprise/Eyrolles, 2015.
- 34 – iFRAP, « Compétitivité : et si on commençait par la fiscalité ? », Société Civile, numéro 128, octobre 2012.
- 35 – Voir aussi les calculs d’Henri Lagarde, France-Allemagne : du chômage endémique à la prospérité retrouvée, Coll. Libres opinions, Presses des Mines, 2011.
- 36 – Op. cit.
- 37 – Le groupe ARaymond n’a pas été auditionné mais a été cité à de nombreuses reprises par les orateurs et les intervenants.
- 38 – Voir Sociétal 2015, Institut de l’entreprise/Eyrolles, 2015, dont le dossier spécial est consacré à « L’Etat-providence à bout de souffle ? ».
Conclusion
Les témoignages de dirigeants de PMI et ETI collectés dans cet ouvrage sont riches d’enseignements. Les performances de leurs entreprises en matière d’exportation, d’innovation, de développement des territoires et in fine d’emploi, montrent l’enjeu que constitue aujourd’hui leur croissance en France, alors que les ETI sont deux à trois fois plus nombreuses en Allemagne ou au Royaume-Uni.
Chaque entreprise est le fruit d’une histoire singulière dans un contexte spécifique. Mais la plupart des réussites présentées dans ce livre reposent sur l’innovation et l’internationalisation.
Les ETI, largement industrielles, se concentrent souvent sur des marchés de niche, en tentant de valoriser leur savoir-faire spécifique à l’échelle mondiale. Cependant, l’internationalisation demande des investissements coûteux qui ne portent pas leurs fruits immédiatement. Pour faire les bons arbitrages, les dirigeants évaluent le coût de chaque implantation en termes de ressources humaines, de capitaux et de temps à allouer. L’efficacité du soutien des opérateurs publics chargés de les aider est jugée très variable d’un pays à l’autre et les financements parfois difficiles à mobiliser.
Les ETI se distinguent souvent par une activité importante en matière de R&D et, plus largement, d’innovation. Elles savent repérer, intégrer ou adapter les innovations des autres et cibler des segments de marché négligés afin de capter une nouvelle demande. Reste que l’innovation amène souvent ces entreprises à transformer substantiellement leur business model. Parmi les nombreuses clés de succès, les dirigeants évoquent notamment l’implication de la direction dans le pilotage de l’innovation ou encore l’organisation du travail en petites équipes de chercheurs bien connectées au reste de l’entreprise. Ils relèvent a contrario des difficultés à collaborer avec la recherche publique.
Pour soutenir ces stratégies de croissance fondées sur l’internationalisation et l’innovation, les ETI ont besoin de mobiliser à la fois des ressources financières et humaines. Les choix de financement sont très liés à la structure actionnariale et à la culture de l’entreprise. Les dirigeants sont parfois partagés entre leur volonté de se développer et la crainte de perdre leur indépendance en ouvrant leur capital. Dans les entreprises familiales, une gouvernance solide est nécessaire pour concilier la stratégie patrimoniale et la stratégie entrepreneuriale.
La gestion des ressources humaines joue un rôle crucial, car une grande majorité des PMI et ETI industrielles connaît des difficultés pour recruter des profils qualifiés, que ce soit en France ou à l’étranger. Former en interne, développer des dispositifs de participation, mettre en avant les atouts du territoire, la taille humaine de l’entreprise, l’ouverture sur le monde sont autant de leviers pour attirer des collaborateurs de haut niveau malgré la concurrence des grands groupes. Les dirigeants auditionnés considèrent qu’il est primordial de préserver l’esprit PME de leurs débuts, de donner un contenu concret aux valeurs que leur entreprise affiche, d’entretenir un bon climat social, notamment grâce à un dialogue permanent avec les représentants du personnel, qui ne se limite pas aux réunions imposées par la loi. Tout ceci suscite une grande fidélité chez les salariés.
Plus globalement, ces entreprises manifestent leur attachement au territoire national et, plus encore, aux bassins locaux dans lesquels elles sont historiquement enracinées, en dépit d’un environnement réglementaire et fiscal cité comme l’un des principaux freins à leur croissance.
Avec cet ouvrage, La Fabrique de l’industrie souhaite susciter un effet d’entraînement auprès des PMI en quête de croissance, sensibiliser les pouvoirs publics aux défis spécifiques des ETI et aux manières dont elles les surmontent, et enfin faire connaître au grand public le rôle majeur que jouent ces entreprises pour la solidité de notre tissu industriel.
Annexe – Passeport des entreprises auditionnées
AFFIVAL
Structure
Créée en 1980
Siège social : Solesmes, Nord
Président : Claude Lenoir
Groupe allemand
Chiffres clés 2014
CA (2013) : environ 190 millions d’euros
Part du CA à l’export : + de 85 %
Filiales aux États-Unis, Mexique, Corée du Sud, Japon, Chine, Russie et un réseau agents répartis dans le monde.
Effectif (2013) : 250 (dont 120 à l’étranger)
R&D : une équipe « Recherche, Développement et Innovation » pour le groupe, basée à Solesmes
Activités
Le groupe Affival a construit sa place de leader mondial, depuis 1981, en développant un procédé original, le fil fourré‚ qui facilite l’injection précise d’éléments de traitement ou d’addition dans l’acier liquide. Par exemple, il facilite le traitement calcium de l’acier liquide qui peut être destiné, entre autres, à l’industrie automobile. Leader mondial dans ce domaine avec environ un tiers du marché, Affival produit du fil fourré pour la sidérurgie, la fonderie, les industries du cuivre et des métaux non ferreux.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire : www.ecole.org/fr/seances/SEM736
AVENTICS SAS
Structure
Créée en 1947
Siège social : Bonneville, Haute-Savoie
Président : Étienne Piot
Principal actionnaire : Triton (fonds d’investissement basé à Jersey)
Chiffres clés 2014
CA (2014) : 65 millions d’euros
Part du CA à l’export : NC
Usines de production en Allemagne, en France, en Hongrie, aux États-Unis et en Chine.
Réseau de distribution couvrant 40 pays Effectif : 400 pour la filiale française, 2 100 dans le monde
R&D : 8 % du chiffre d’affaires
Activités
Achetée par Bosch en 1984‚ l’entreprise devient Bosch Rexroth Fluidtech en 2003 avant d’être cédée et de devenir Aventics France en 2014, filiale du groupe Aventics basé en Allemagne. Elle conçoit et produit des valves pneumatiques‚ des vérins pneumatiques et hydrauliques pour trois secteurs cibles : l’agroalimentaire (composants pour les machines d’embouteillage)‚ l’automobile et l’industrie lourde. Elle est en 2014 le sixième acteur mondial de ce secteur.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire : http://www.ecole.org/fr/orateurs/OR1001
BERNARD CONTROLS
Structure
Créée en 1949
Siège social : Gonesse, Val d’Oise
Président : Étienne Bernard
Principal actionnaire : Famille Bernard
Chiffres clés 2014
CA (2013) : 50 millions d’euros
Part du CA à l’export : 75 %
9 filiales en Asie, en Europe et aux États-Unis. 3 bureaux régionaux à Bangkok, Dubaï et Moscou et 50 agents ou distributeurs répartis dans le monde entier
Effectif : 400 contre 320 en 2009 (110 en Chine)
R&D : NC
Activité
BERNARD CONTROLS est le troisième acteur mondial sur le marché de la motorisation électrique (servomoteurs) pour la commande des robinets et vannes utilisés dans les industries pétrolières, chimiques et nucléaires. Destinés à des utilisations dans des domaines critiques comme l’industrie énergétique, où les conditions peuvent être extrêmes (séismes, radioactivité ou explosions), les servomoteurs sont des moteurs chargés d’assurer l’ouverture ou la fermeture de vannes.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
CLEXTRAL
Structure
Créée en 1956
Siège social : Firminy, Loire
Président : Guillaume Pasquier depuis le 1er janvier 2015
Principal actionnaire : groupe Legris Industries, groupe industriel familial
Chiffres clés 2013
CA : 54,9 millions d’euros
Part du CA à l’export : 81 %
10 bureaux et filiales sur les cinq continents pour soutenir ses clients dans 92 pays
Effectif : 277 (dont 60 à l’étranger) contre 210 en 2006
R&D : 3,6 % du chiffre d’affaires
Activités
Leader mondial de l’extrusion bi-vis, Clextral conçoit et produit des machines spéciales destinées à plusieurs industries : l’agroalimentaire (cornflakes, snacks apéritifs, aliments pour poissons d’élevage, croquettes pour chiens et chats, semoule de couscous…), à l’industrie papetière (pâte à papier pour billets de banque et sécurité…), la plasturgie (fabrication de compounds), l’industrie chimique (extrusion réactive…) et le nucléaire (pompes de sécurité).
Retrouvez les comptes-rendus des séminaires :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
http://www.ecole.org/fr/orateurs/OR0891
DAHER
Structure
Créée en 1863
Siège social : Marseille, Bouches-du-Rhône
Président : Patrick Daher
Principal actionnaire : Sogermarco-Daher (actionnariat familial)
Chiffres clés 2014
CA : 970 millions d’euros
Part du CA à l’export (en 2013) : 2 %
Filiales en Grande Bretagne, Allemagne, République Tchèque, Russie, Canada, Algérie, Maroc et au Mexique
Effectif : 8 300 en 2014 contre 2 800 en 2008 R&D : NC
Activités
Historiquement, Daher s’est spécialisée dans les transports maritimes et la logistique. Elle prend, à partir de 1998, un tournant industriel, bien que la moitié de son activité relève encore des services. Cette réorientation fait de Daher un des grands équipementiers du secteur aéronautique, mais également le constructeur des avions six places TBM. Enfin, le groupe a poursuivi son activité de diversification par la production de vannes pour le secteur nucléaire et énergétique. En résumé, Daher est un équipementier qui développe des systèmes industriels intégrés pour l’aéronautique et les technologies avancées.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire : http://www.ecole.org/fr/seances/SEM751
DARÉGAL
Structure
Créée en 1887
Siège social : Milly-la-Forêt, Essonne
Président : Charles Darbonne
Principal actionnaire : Darome, holding familiale (famille Darbonne)
Chiffres clés 2014
CA : 120 millions d’euros
Part du CA à l’export : 70 % Deux sites de production en Espagne et aux États-Unis
Effectif : 500 contre 422 en 2012
R&D : 7 % du chiffre d’affaires
Activité
Darégal est le premier producteur mondial d’herbes aromatiques et culinaires, à la fois pour l’industrie agroalimentaire, la grande distribution et la restauration. Darégal se distingue par sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de production. La production passe ainsi de la sélection des herbes à la transformation (surgélation, lyophilisation, poudre). Cette étape du processus de fabrication, particulièrement délicate, vise à préserver la saveur des herbes. À ce titre, Darégal doit une partie de son leadership à sa maîtrise de techniques de surgélation complexes.
Retrouvez les comptes-rendus de séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
http://www.ecole.org/fr/seances/SEM716
ERMO
Structure
Créée en 1979
Siège social : Marcillé-la-Ville, Mayenne
Président : Maurizio Bazzo depuis juin 2014
Principal actionnaire : INglass (société industrielle italienne)
Chiffres clés 2014
CA (2013) : 23,5 millions d’euros
Part du CA réalisé à l’export : 70 %
Filiales en Pologne et au Canada
Effectif : 180 employés contre 124 en 2011
R&D : 5 millions d’euros entre 2007 et 2012
Activités
Le groupe ERMO est spécialisé dans la conception et la réalisation de moules d’injection pour l’industrie plastique. Ses moules d’injection, dits « multi-empreintes », permettent de produire en série des pièces en très grand nombre. Suite à la délocalisation des secteurs automobile, électroménager et téléphone, l’entreprise s’est repositionnée sur la production à haute fréquence de bouchons de bouteilles d’eau. Parallèlement, l’entreprise produit également des moules pour les bouteilles de gel douche ou du matériel médical.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire : http://www.ecole.org/fr/seances/SEM724
EUROTAB
Structure
Créée en 1957
Siège social : Saint-Just Saint-Rambert, Loire
Président : Olivier Desmarescaux
Principal actionnaire : famille Desmarescaux
Chiffres clés 2014
CA (2014) : 43 millions d’euros
Part du CA à l’export : >50 % Trois usines en France, une usine en Turquie, une autre en Espagne.
Présence dans 25 pays
Effectif : 230 contre 190 en 2012
R&D : 7 % du chiffre d’affaires
Activités
Eurotab est aujourd’hui le seul prestataire technologique et industriel dans l’univers du tabletting (ensemble des technologies de compression de poudre), qui couvre l’ensemble du processus de production. À ce titre, Eurotab participe à la recherche fondamentale dans ce secteur, assure la fabrication d’équipements spécifiques et la production de tablettes sur commande. Les applications de cette technologie sont nombreuses, de l’agroalimentaire (bouillons cubes, additifs, nutriments animaux) à l’entretien ménager (détergents, désinfectant, traitement d’air) ou les minéraux industriels.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
GROUPE HERVé
Structure
Créée en 1972
Siège social : Joué-les-Tours, Indre-et-Loire
Président du Directoire : Emmanuel Hervé
Principal actionnaire : Financière Hervé, holding de la famille Hervé
Chiffres clés 2014
CA : 500 millions d’euros
Part du CA à l’export : NC
55 agences en France et en Suisse
Effectif : 2 800 contre 1 600 en 2006
R&D : NC
Activités
Le Groupe Hervé est organisé en trois pôles d’activité très diversifiés. Le principal pôle « Énergie Services » (90 % du CA) regroupe toutes les activités de gestion des énergies et du bâtiment pour tous les lots du second œuvre dans une logique exclusivement B to B : prestations de services en maintenance, d’exploitation et de travaux d’installation dans les métiers du génie climatique, du génie électrique, des piscines et du traitement de l’eau, des énergies renouvelables et de la performance énergétique. Le pôle « Industrie » regroupe les activités de conception, réalisation, calibrage des équipements et ouvrages sur mesure en aéronautique, construction navale, tuyauterie industrielle et chaudronnerie, destinés à des applications industrielles. Le pôle « Numérique » regroupe les activités de création, conception, intégration et réalisation de solutions adaptées aux besoins d’infrastructures informatiques, d’applications Web, d’outils collaboratifs, de formation et de supports de communication actuels et émergents.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire : http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
GYS
Structure
Créée en 1964
Siège social : Saint-Berthevin, Mayenne
Président : Bruno Bouygues
Principal actionnaire : NC
Chiffres clés 2014
CA : 61 millions d’euros
Part du CA l’export : 50 %
Présence en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Inde et Chine
Effectif : 520 salariés contre 350 en 2008
R&D : 5,5 % du chiffre d’affaires
Activités
Fabricant de postes à soudure et de chargeurs de batteries à destination de la réparation automobile, GYS est l’un des premiers acteurs mondiaux du secteur. L’entreprise se caractérise par son haut degré d’intégration : la tôlerie, les fils de cuivre, la découpe, la peinture et l’usinage sont ainsi réalisés en interne.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
HRA PHARMA
Structure
Créée en 1996
Siège social : Paris 3e
Présidente : Erin Gainer-Monange depuis 2009
Principaux actionnaires : quatre personnes fondatrices (65 %), Riverside (25 %), personnel (10 %)
Chiffres clés 2014
CA (2014) : 70 millions d’euros
Part du CA à l’export : > 85 %. 50 partenaires dans le monde. Filiales en Italie, Espagne et Portugal, Royaume-Uni et Irlande, Allemagne, Belgique et Suisse
Effectif : 150 employés contre 130 en 2013
R&D : 15 % du chiffre d’affaires
Activités
HRA Pharma est une entreprise pharmaceutique spécialisée dans les domaines de la santé de la femme et de l’endocrinologie. À ce titre, HRA Pharma a mis sur le marché le premier contraceptif d’urgence disponible en grande diffusion et est leader dans le domaine de la santé reproductive de la femme.
Retrouvez les comptes-rendus de séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
http://www.ecole.org/fr/seances/SEM708
IGE+XAO
Structure
Créée en 1986
Siège social : Colomiers, Haute-Garonne
Président : Alain di Crescenzo
Principal actionnaire : Alain di Crescenzo
Chiffres clés
CA (2014) : 26,3 millions d’euros
Part du CA à l’export : NC
30 filiales et succursales présentes dans 19 pays ; 32 partenaires commerciaux présents dans 27 pays
Effectif : 388 employés en 2014
R&D : 25,5 % du chiffre d’affaires
Activités
Depuis plus de 28 ans, le groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise et assure la maintenance d’une gamme de logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO), de gestion du cycle de vie « Product Lifecycle Management » (PLM) et de simulation dédiée à l’électricité. Ces logiciels ont été élaborés pour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique de tout type d’installation. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels de CAO/PLM/Simulation électrique destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAO est une référence dans son domaine.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.ecole.org/fr/seances/SEM746
MECACHROME
STRUCTURE
Créée en 1937
Siège social : Amboise, Indre-et-Loire
Président : Arnaud de Ponnat depuis avril 2014
Actionnariat : 3 fonds (ACE à 35 %, FTQ à 35 %, BPI à 30 %)
Chiffres clés 2014
CA (2013) : 315 millions d’euros
Part du CA à l’export : 50 %
Implanté en France, Canada et Maroc sur 10 sites de production
Effectif : 2 500 contre 2 200 en 2007
Activités
Mecachrome conçoit, usine et assemble des pièces et des ensembles nécessitant une haute précision ou l’application de nanotechnologies. Si son principal client est l’aéronautique, à la fois pour la structure et les moteurs des avions civils et militaires, son expertise s’étend également aux domaines automobile (Formules 1, véhicules de série), spatial et nucléaire.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
MORET INDUSTRIES
Structure
Créée en 1868
Siège social : Saint Quentin, Aisne
Président : Jérôme Duprez
Principaux actionnaires : trois holdings familiales
Chiffres clés 2014
CA : 350 millions
Part du CA à l’export : 80 %
12 sites de production et 15 centres de services clients implantés dans 12 pays, sur 5 continents
Effectif : 1 750 personnes contre 1 260 en 2010
R&D : NC
Activités
Le groupe Moret industries se compose de deux pôles d’activité. Le cœur de métier du premier pôle, Ensival-Moret, est la conception et la fabrication de pompes adaptées à des produits qui peuvent être acides ou abrasifs, et utilisables sous des températures allant de – 160° à + 900°. Ces pompes sont à destination de l’industrie pétrolière, chimique ou agroalimentaire. Le second pôle est regroupé sous la société Maguin, qui propose des équipements pour les industries agroalimentaires et, plus particulièrement, les sucreries et distilleries.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.ecole.org/fr/seances/SEM735
MULTIPLAST (aujourd’hui société du groupe Carboman)
Structure
Créée en 1981
Siège : Vannes, Morbihan
Président : Dominique Dubois
Principal actionnaire : groupe Carboman Depuis janvier 2014, Multiplast s’est allié à l’entreprise Décision SA pour créer le groupe Carboman
Chiffres clés 2014
CA : 8,5 millions d’euros
Part du CA à l’export : 65 %
Effectif : 105 contre 49 en 2010
R&D : 7,5 % du chiffre d’affaires
Activités
Multiplast est une des premières entreprises mondiales dans la conception et la fabrication de bateaux de compétition. Une telle position s’est construite par une spécialisation dans la production de matériaux composites pour les multicoques et les monocoques. Cette compétence permet désormais à l’entreprise de se diversifier en direction de l’aéronautique, de l’industrie et des télécommunications.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.ecole.org/fr/seances/SEM768
POCLAIN HYDRAULICS
Structure
Créée en 1926
Siège social : Verberie, Oise
Président : Laurent Bataille
Directeur Général Délégué : Guillaume Bataille
Principal actionnaire : holding familiale (Bataille)
Chiffre clés 2014
CA (2013) : 300 millions d’euros
Part du CA à l’export : 85 % 10 usines en France, États-Unis, Slovénie, République Tchèque, Italie, Inde, Chine. 18 filiales en Europe, Asie, États-Unis
Effectif : 2 000 employés (dont 1 400 à l’étranger) contre 1 500 en 2009
R&D : 7 % du chiffre d’affaires
Activités
Poclain Hydraulics s’est spécialisé dans la conception, fabrication et commercialisation de transmissions hydrauliques de puissance pour engin mobile. Leader mondial du secteur, elle a initié son succès au sein de Poclain qui a inventé la pelle hydraulique en 1950, et fut l’une des plus importantes firmes mondiales produisant des engins de travaux publics. Ses systèmes hydrauliques trouvent aujourd’hui leurs applications dans la fabrication de matériel de travaux publics ou agricoles, mais aussi de camions, de véhicules légers ou d’équipements industriels fixes.
Retrouvez les comptes-rendus de séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
http://www.ecole.org/fr/seances/SEM731
POUJOULAT
Structure
Créée en 1950
Siège social : Saint-Symphorien, Deux-Sèvres
Président : Frédéric Coirier
Principal actionnaire : Famille Coirier
Chiffres clés
CA (2013) : 273 millions d’euros
Part du CA à l’export : 30 % Exportations dans 30 pays.
16 sociétés dans 7 pays : France, Allemagne, Belgique, Angleterre, Hollande, Pologne, Turquie
Effectif : 1 500 contre 990 en 2008 R&D : 2 % du chiffre d’affaires
Activités
Le groupe Poujoulat est le leader européen des systèmes d’évacuation de fumée métalliques (conduit de cheminée et sortie de toit) pour la maison individuelle, l’habitat collectif, l’industrie, le tertiaire et la production d’énergie. Depuis 2007 le groupe s’est diversifié dans les énergies renouvelables en investissant dans le développement du bois énergie (granulés de bois, bûches densifiées et bois de chauffage).
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
ROSSIGNOL TECHNOLOGY
Structure
Créée en 1976
Siège social : Scionzier, Haute-Savoie
Président : Bertrand de Taisne
Principal actionnaire : Bertrand de Taisne
Chiffres clés 2014
CA : 12 millions d’euros Part du
CA à l’export : 90 % Usine de finition et de traitement de surface en République tchèque.
Clients en Europe, États-Unis, Mexique, Brésil, et Chine
Effectif : 130 contre 70 en 2013 R&D : néant
Activités
Rossignol Technology est le leader européen de la tige de frein et d’embrayage automobile, dans toutes ses étapes, du prototypage à la livraison en grande série. Cette pièce qui relie la pédale de frein au système de freinage doit être extrêmement fiable.
Retrouvez le compte-rendu de séminaire :
http://www.ecole.org/fr/seances/SEM755
SACRED
Structure
Créée en 1947 Siège social : Saint-Lubin-les-Joncherets, Eure-et-Loir
Président : Didier Fegly, à la suite d’un RES/LMBO en 1984.
Principal actionnaire : Compagnie Financière de l’Avre (CFA)
Chiffres clés 2014
CA (2014) : 50,2 millions d’euros
Part du CA à l’export : 50 % Antennes de développement et de production en Europe (Roumanie) et dans des pays émergents (Chine, Mexique, Maroc)
Effectif : 550 (dont 200 à l’étranger) contre 500 en 2013
R&D : 2,5 % du chiffre d’affaires
Activités
Sacred est la première ETI française indépendante de la branche caoutchouc. Sacred conçoit et produit des pièces moulées destinées à assurer l’étanchéité des carrosseries et de la mécanique automobile ou encore l’amortissement acoustique. Sa maîtrise du caoutchouc lui permet également de produire des semelles techniques, des produits antivibratoires, des fonctions pour l’industrie électrique. Sacred travaille pour toutes les branches d’industrie (pièces et mélanges).
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
SISLEY
Structure
Créée en 1976
Siège social : Paris
Président : Philippe d’Ornano
Principal actionnaire : actionnariat familial (d’Ornano)
Chiffres clés 2014
CA : 550 millions d’euros
Part du CA à l’export : 89 %
Marque présente dans plus de 90 pays, 33 filiales en Europe, Asie, Amérique et Moyen Orient
Effectif : 5 000 dont 3 850 à l’étranger. Ses effectifs en France ont augmenté de 35 % depuis 2009
R&D : NC
Activités
Sisley est un leader mondial dans la cosmétique haut de gamme. Ce positionnement haut de gamme se double d’une spécialisation dans la phyto-cosmétologie (cosmétique et soins par les plantes). La marque crée et fabrique en France des produits de soins, démaquillages et des parfums.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
SMSM
Structure
Créée en 1976
Siège social : Dunkerque, Nord
Présidente : Eva Escandon
Principal actionnaire : actionnariat familial
Chiffres clés 2014
CA : 5 millions d’euros
Part du CA à l’export : néant
Activité internationale limitée à l’accompagnement de partenaires
Effectif : 70
R&D : NC
Activités
Le groupe SMSM comprend deux entités. La première, SMSM (Société Maritime de Soudure et de Montage), réalise des ouvrages chaudronnés et des ensembles mécano-soudés complexes‚ depuis la conception jusqu’à la mise en place sur les sites industriels et à leur maintenance. La deuxième, SMFI (Société Mécanique Foulon Industries), située à Merville, a été rachetée par SMSM en 2001. Elle se spécialise en mécanique et en chaudronnerie industrielle pour les industries agroalimentaires, chimiques et pharmaceutiques. Le groupe SMSM comprend aussi des services généraux qui travaillent pour les deux entités.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.ecole.org/fr/seances/SEM792
SNF
Structure
Créée en 1978
Siège social : Andrézieux-Bouthéon, Loire
Président : Pascal Rémy
Principal actionnaire : famille René Pich
Chiffres clés 2014
CA : 2,1 milliards d’euros
Part du CA à l’export : 97 %
Présence dans 130 pays, filiales et coentreprises dans plus de 40 pays. 23 usines en Europe, en Asie, en Australie et aux Amériques
Effectif : 4 600 contre 1 300 en 2003 R&D : 1,8 % du chiffre d’affaires
Activités
SNF est un chimiste de spécialité, premier producteur mondial de polyacrylamides, polymères hydrosolubles utilisés pour le traitement d’eau, la récupération assistée du pétrole, l’exploitation des pétroles et gaz de schiste, l’extraction minière, la production papetière et diverses applications de spécialités. SNF est un spécialiste de la chimie de l’eau.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
SOMFY
Structure
Créée en 1969
Siège social : Cluses, Haute-Savoie
Président : Jean-Philippe Demaël
Actionnariat : Damart (famille Despature)
Chiffres clés 2014
CA : 981,7 millions d’euros
Part du CA l’export : 73 %
Présence dans 60 pays sur 5 continents
Effectif : 8 400 contre 7 800 en 2011
R&D : environ 10 % du chiffre d’affaires sont investis dans la marque Somfy (le groupe dispose de plusieurs marques)
Activités
Somfy (Société d’Outillage et Mécanique du Faucigny) est le leader mondial de l’automatisation des ouvertures et fermetures de la maison et du bâtiment. Elle conçoit, développe et produit des moteurs, des télécommandes, des points de commande, des capteurs pour des stores extérieurs et intérieurs, des volets roulants, des fenêtres, portails et portes de garages.
Retrouvez les comptes-rendus de séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
http://www.ecole.org/fr/seances/SEM761
THUASNE
Structure
Créée en 1847
Siège social : Levallois-Perret, Ile-de-France
Président : Elizabeth Ducottet Principal actionnaire : famille Ducottet
Chiffres clés 2014
CA (2014) : 180 millions d’euros
Part du CA à l’export : 37 % Filiales en Europe, en Israël et aux États-Unis. Un bureau au Japon Effectif : 1 650 contre 1 500 en 2013.
R&D : 7 % du chiffre d’affaires
Activités
Leader français et troisième acteur européen sur le marché des dispositifs médicaux textiles, l’entreprise est spécialisée dans les produits élastiques médicaux pour traitements compressifs (ceintures lombaires, bas de contention, orthèses…) et commercialise également une gamme de produits d’aide à la mobilité et de maintien à domicile.
Retrouvez le compte-rendu du séminaire :
http://www.la-fabrique.fr/projet-en-cours/histoires-de-croissance-seminaires-dedies-aux-dirigeants-d-eti
Bibliographie
Asmep-ETI, KPMG, « Les ETI, leviers de la croissance en France », 2013.
Bas O., L’envie, une stratégie, Dunod, 2015.
Bertrand B., Bodenez P., Hans E., « Le patron de PME ou le syndrome de Peter Pan », La Gazette de la société et des techniques, n° 55, janvier 2010.
Bidet-Mayer T. et Toubal L., Formation professionnelle et industrie : Le regard des acteurs de terrain, La Fabrique de l’industrie/Presses des Mines, 2014.
Bpifrance, PME 2014, Rapport sur l’évolution des PME, La Documentation française, 2015.
Bpifrance, PME 2013, Rapport sur l’évolution des PME, La Documentation française, 2014.
Bpifrance, « PME et ETI manufacturières stratégies de rebond face à la crise », octobre 2014.
CCIP, Entreprises de taille intermédiaire : mode d’emploi pour retrouver la croissance, La Documentation française, 2010.
Chan Kim W., Mauborgne R., Stratégie Océan bleu. Comment créer de nouveaux espaces stratégiques, Pearson-Village mondial, 2008.
Daniel J-M., Monlouis-Félicité F. (sous la dir. de), Sociétal 2015, Institut de l’entreprise/Eyrolles, 2015.
Daniel J-M., Monlouis-Félicité F. (sous la dir. de), Sociétal 2014, Institut de l’entreprise/Eyrolles, 2014.
DG Trésor – Pôle commerce extérieur, « L’internationalisation des PME et ETI françaises : principaux chiffres », décembre 2014.
Gattaz Y., Les ETI champions cachés de notre économie, 30 histoires d’entreprises de taille intermédiaire, Francois Bourin, Paris, 2010.
Gariel S. et Lherbier G., Développer les entreprises patrimoniales, un défi pour les héritiers et les managers, Eyrolles, 2014.
Ifop-Institut Lilly, « Les enseignants et l’adéquation entre la formation scolaire et universitaire et l’industrie », novembre 2014.
iFRAP, « Compétitivité : et si on commençait par la fiscalité ? », Société Civile, numéro 128, octobre 2012.
INSEE, « Quelles nouvelles catégories d’entreprise – une meilleure vision du tissu productif », INSEE Première n° 1321, novembre 2010.
Kohler D. et Weisz J-D., Pour un nouveau regard sur le Mittelstand, La Documentation française, 2012. KPMG, « Voyage au cœur des entreprises de taille Intermédiaire : une stratégie de conquêtes », 2012.
Lagarde H., France-Allemagne : du chômage endémique à la prospérité retrouvée, Coll. Libres opinions, Presses des Mines, 2011.
La Fabrique de l’industrie, ENSCI-Les Ateliers, Regarder et montrer l’industrie : la visite d’usine comme point de contact, Cahier d’expérimentation, Presses des Mines, 2013.
La Fabrique de l’industrie, Osez la voie pro : 12 parcours de réussite pour s’en convaincre, La Fabique de l’industrie/ONISEP/Presses des Mines, 2015.
Muzet D., « Les mots de la compétitivité », Sociétal 2014, Institut de l’entreprise/Eyrolles, 2014.
Simon H., Guinchard S., Les champions cachés du XXIe siècle. Stratégies à succès, Économica, 2012.
Simon H., Hidden Champions, Harvard Business School Press, 1996. Traduction en langue française : Les Champions cachés de la performance, Dunod, 1998.
Remerciements
Cette publication a été réalisée par La Fabrique de l’industrie, grâce au concours de nombreux partenaires. Nous tenons ici à remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation des séminaires de dirigeants, sur lequels repose cet ouvrage.
Nous souhaitons plus particulièrement remercier Isabelle Bébéar (Bpifrance), Michel Berry (École de Paris du management), Denis Boissard (UIMM), Elisabeth Bourguinat (qui a rédigé les comptes-rendus des séances), Diane de Ferron (FBN France), Thibaut de Jaegher (L’Usine nouvelle), Hervé de Vaublanc (Collège des Bernardins), Pierre Deschamps (CapitalDon), Marianne Faucheux (Caisse des Dépôts), Pauline Garagnani (Bpifrance), Annie Geay (Bpifrance), Jean-Yves Gilet (Bpifrance), Catherine Goulmot (Bpifrance), Eric Jourde (Fieec), Dorothée Kohler (Kohler Consulting & Coaching), Jean-Baptiste Marin-Lamellet (Bpifrance), Caroline Mathieu (FBN France), Alexandre Montay (METI), Vincent Moulin-Wright (GFI), Magalie Parrenin (Caisse des Dépôts), Baudoin Roger (Collège des Bernardins) pour leur précieuse collaboration.
Marie-Laure Cahier et Louisa Toubal
Marie-Laure Cahier, diplômée de Sciences Po Paris, après avoir été pendant 15 ans directrice éditoriale dans l’édition universitaire et professionnelle, fonde en 2010 Cahier&Co, structure de Conseil éditorial. Elle conçoit, coordonne, produit et gère des contenus, print ou web, pour le compte de maisons d’édition, d’entreprises, d’associations professionnelles ou de think tanks. Elle a été rédactrice en chef pour plusieurs Mooks(c) aux éditions Autrement. www.cahierandco.com
Louisa Toubal est chef de projet au sein de La Fabrique de l’industrie, notamment chargée des réflexions menées avec les dirigeants d’ETI. Elle supervise également plusieurs projets liés aux compétences, à la formation et à l’attractivité des carrières industrielles auprès des jeunes. Dans le cadre de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, elle a rédigé l’ouvrage Entreprises de taille intermédiaire : mode d’emploi pour retrouver la croissance (la Documentation française, mars 2010). Elle est titulaire d’un DEA d’économie internationale de l’université de Paris I Panthéon-Sorbonne.
Marie-Laure Cahier et Louisa Toubal, Paroles d’ETI. Les entreprises de taille intermédiaire à la conquête de la croissance, Paris, Presses des Mines, 2015.
ISBN : 978-2-35671-221-9
© Presses des Mines – TRANSVALOR, 2015
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de lʼindustrie
81, boulevard Saint-Michel -75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr