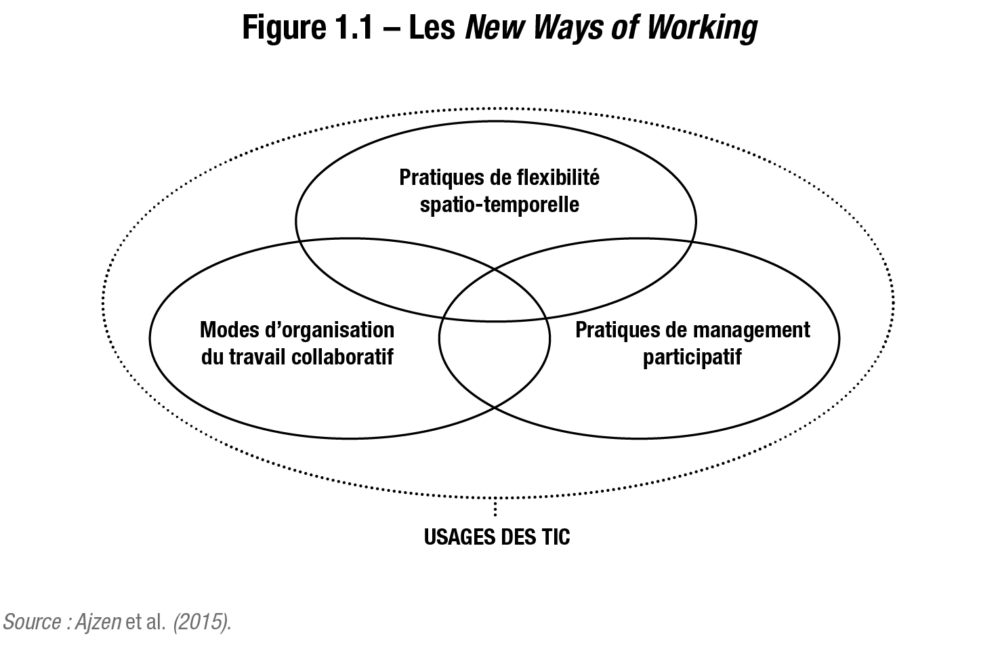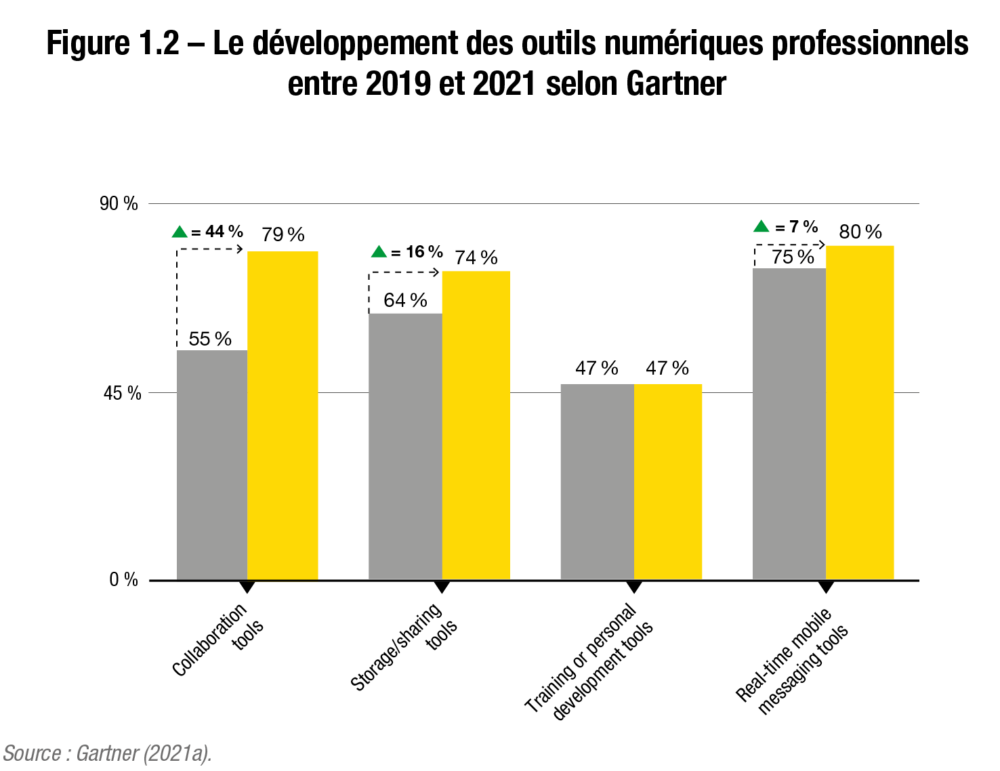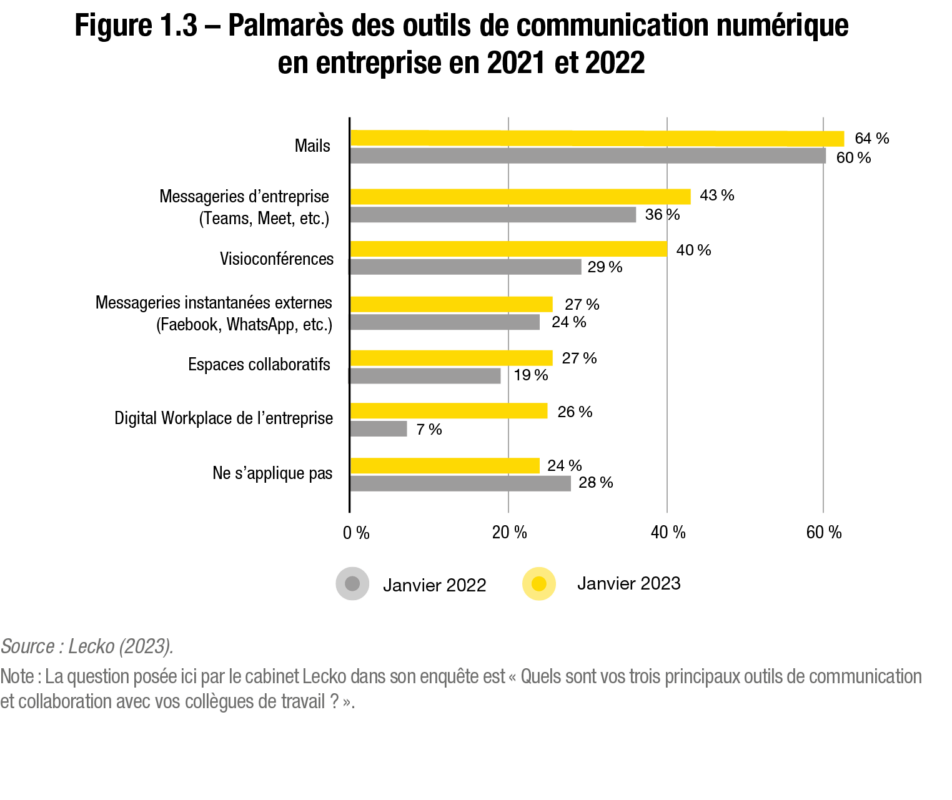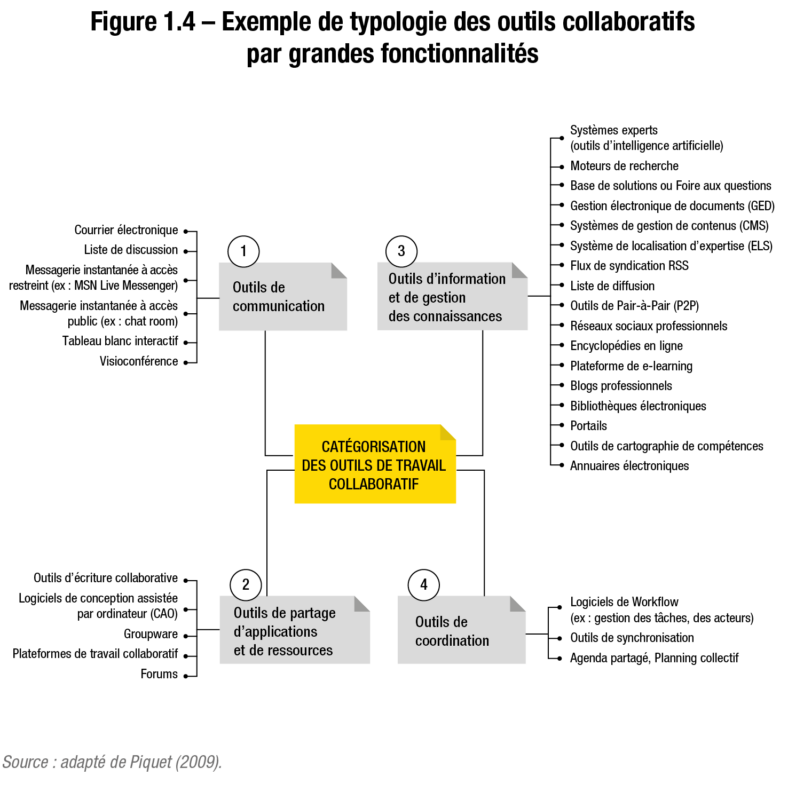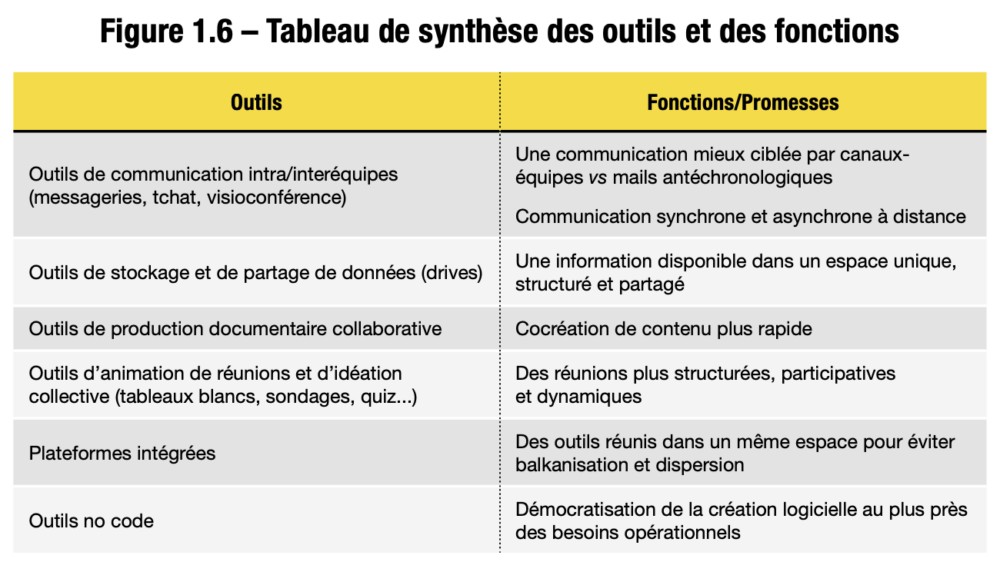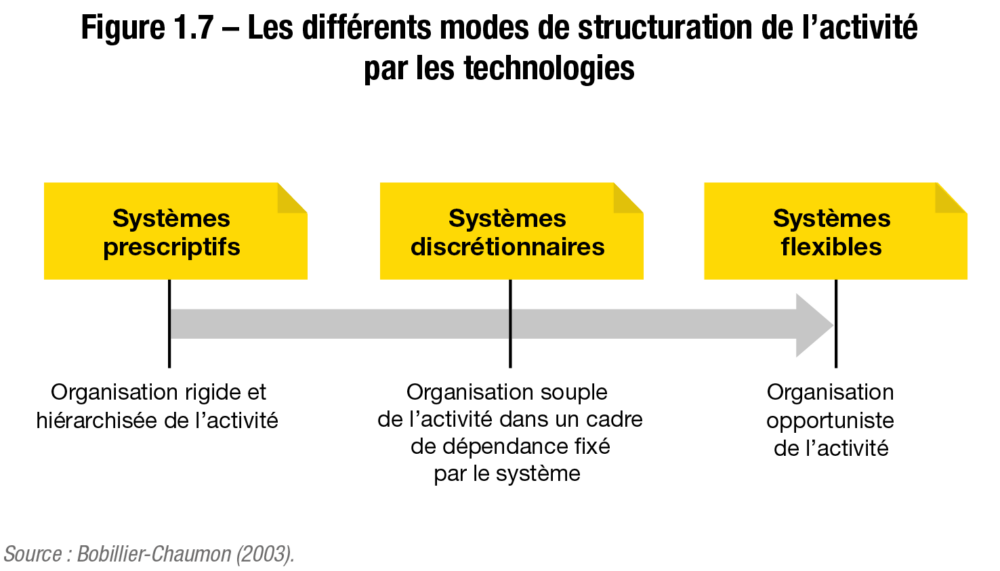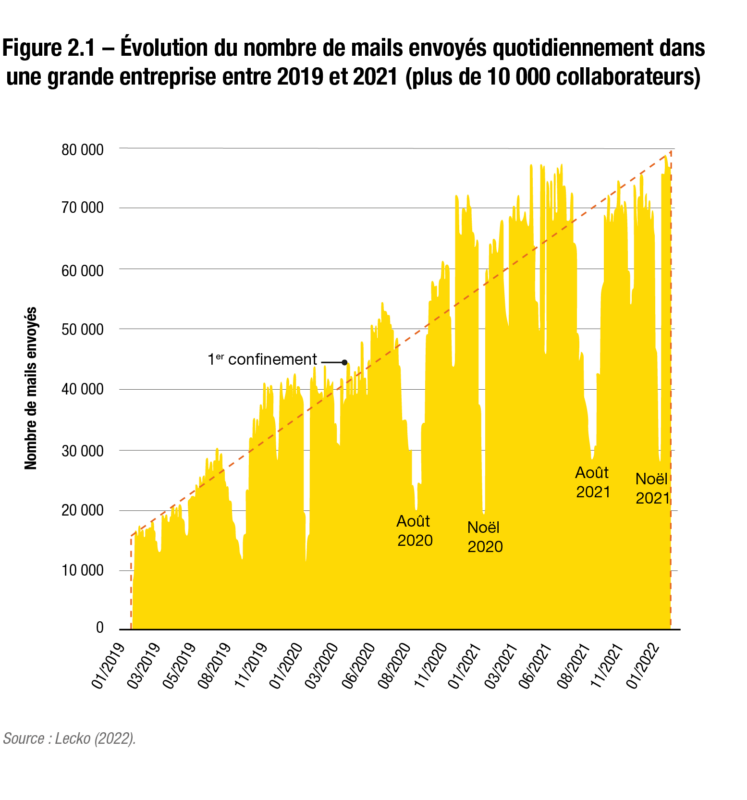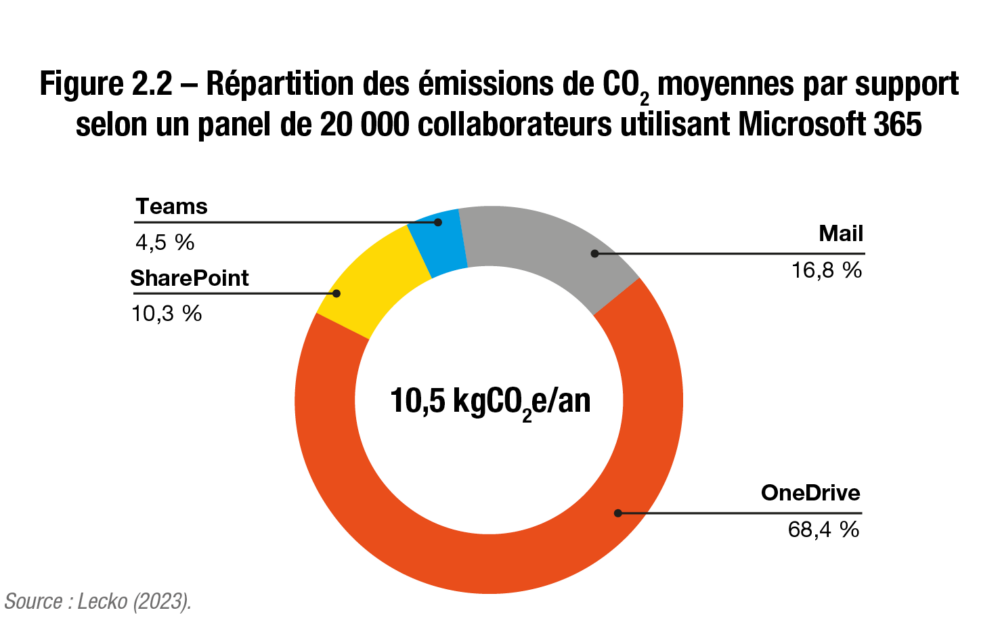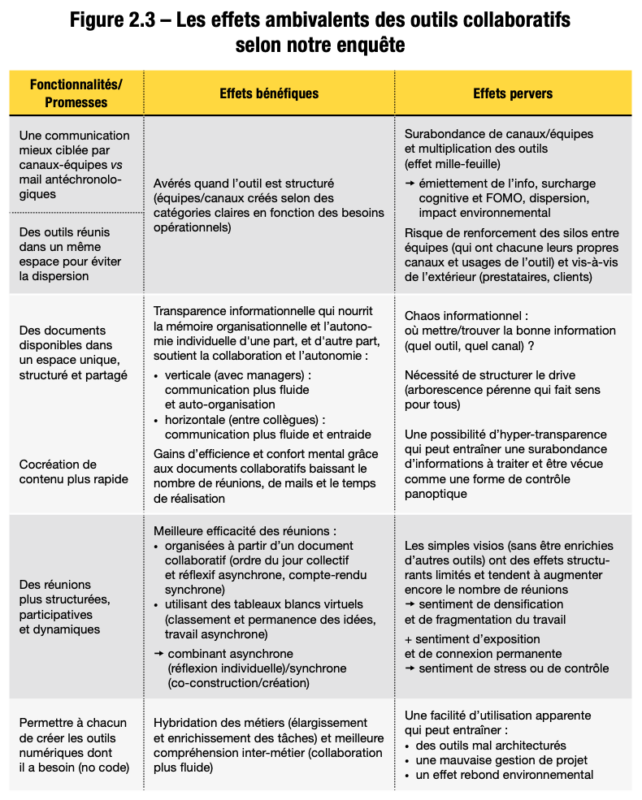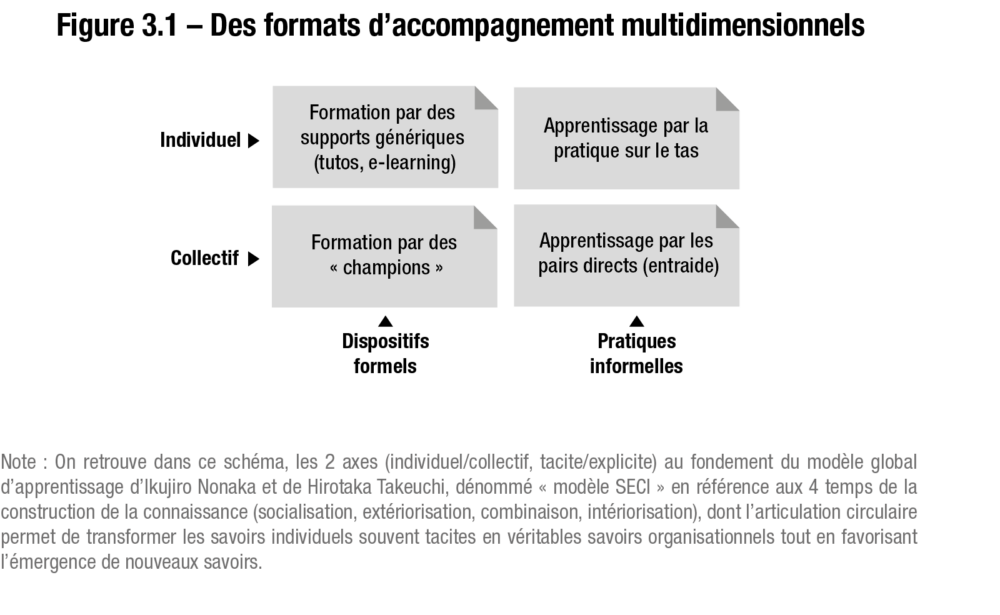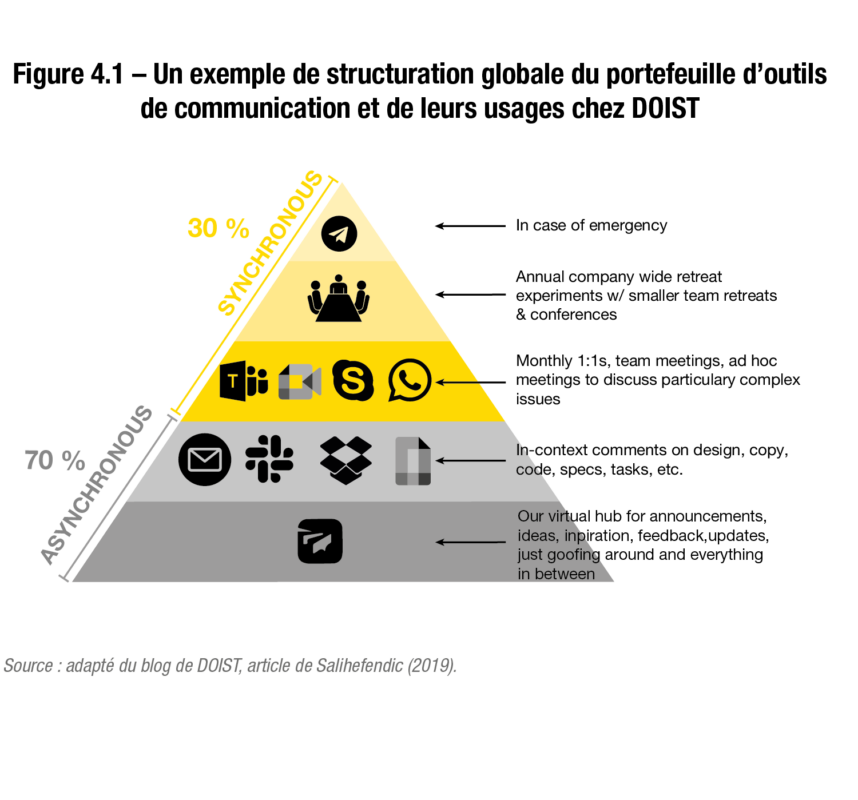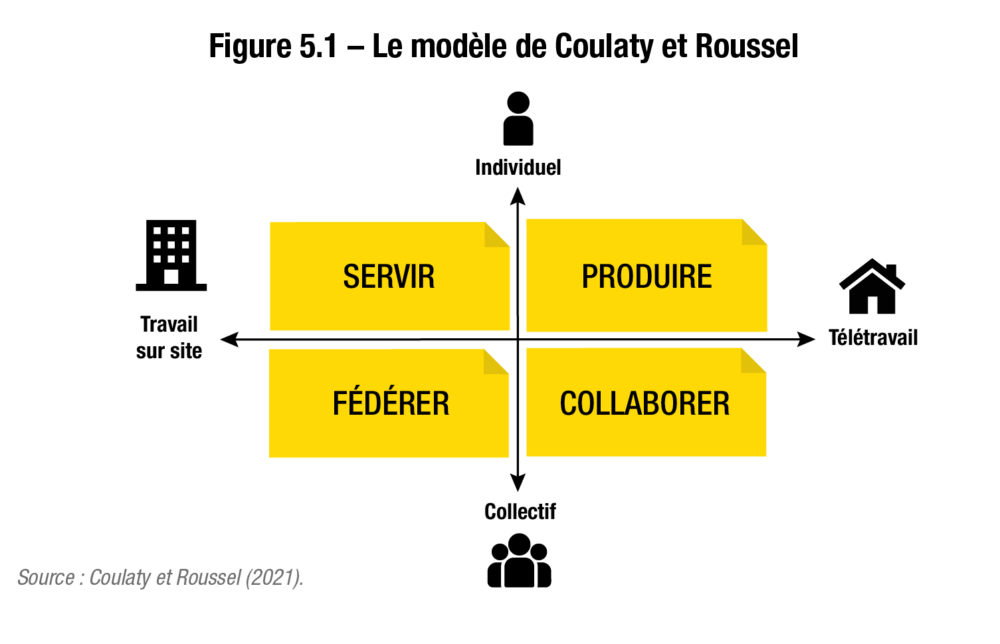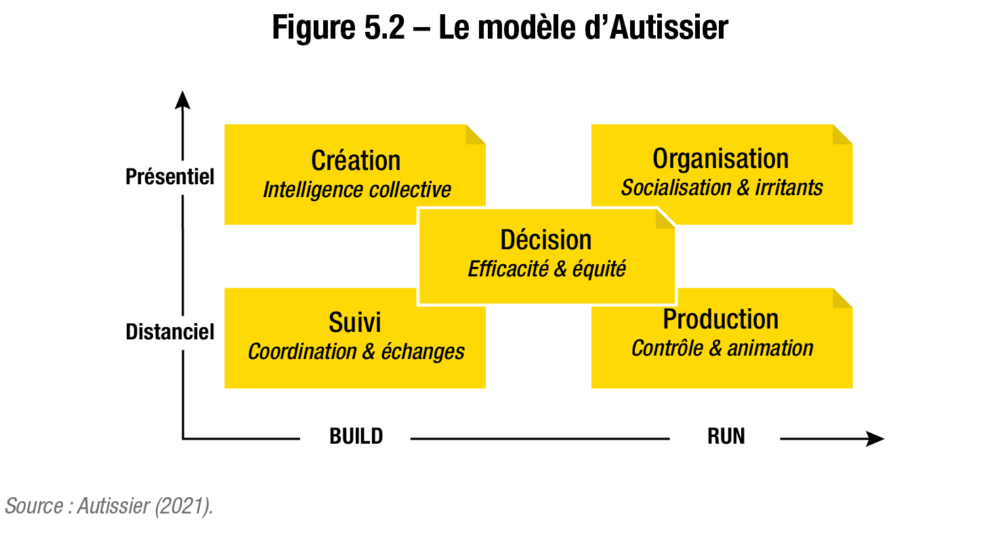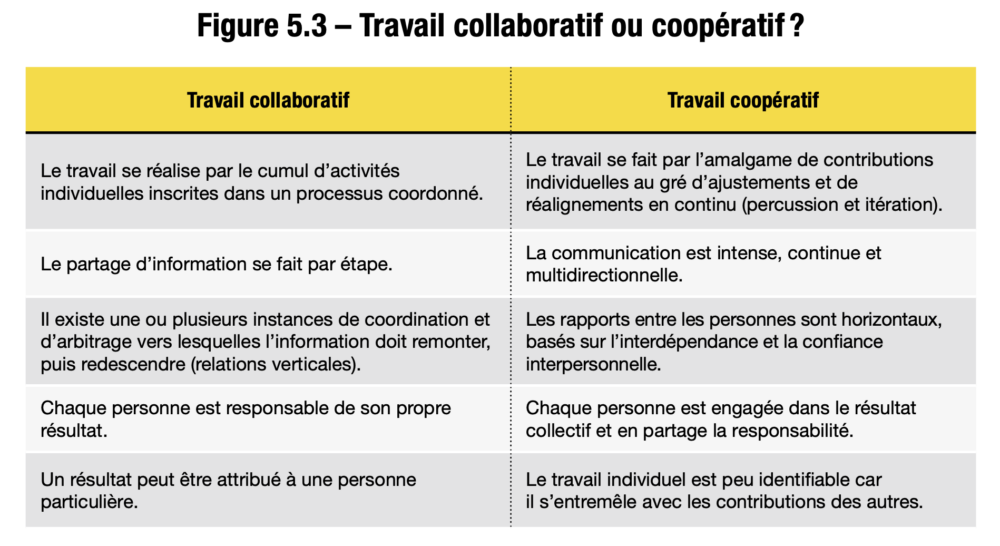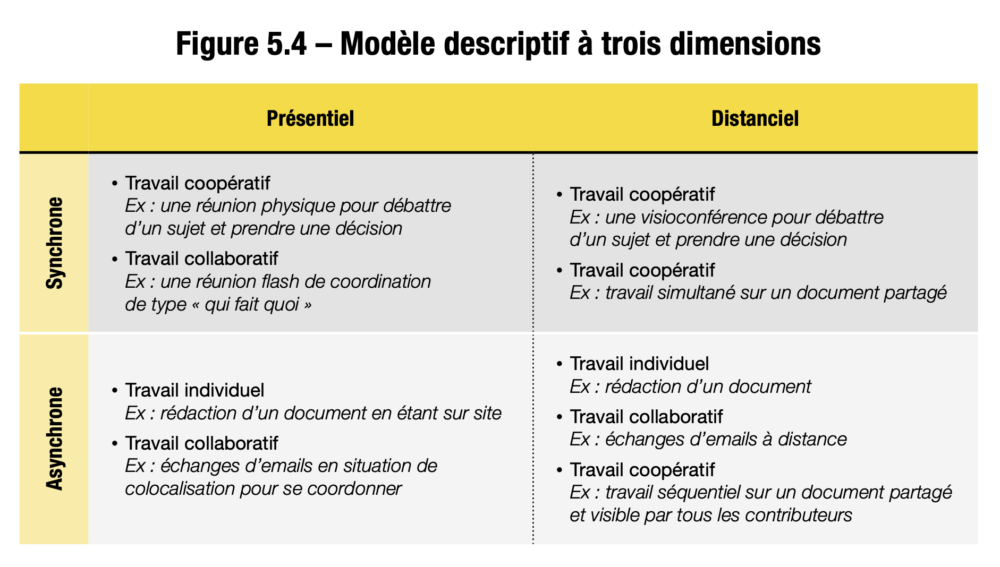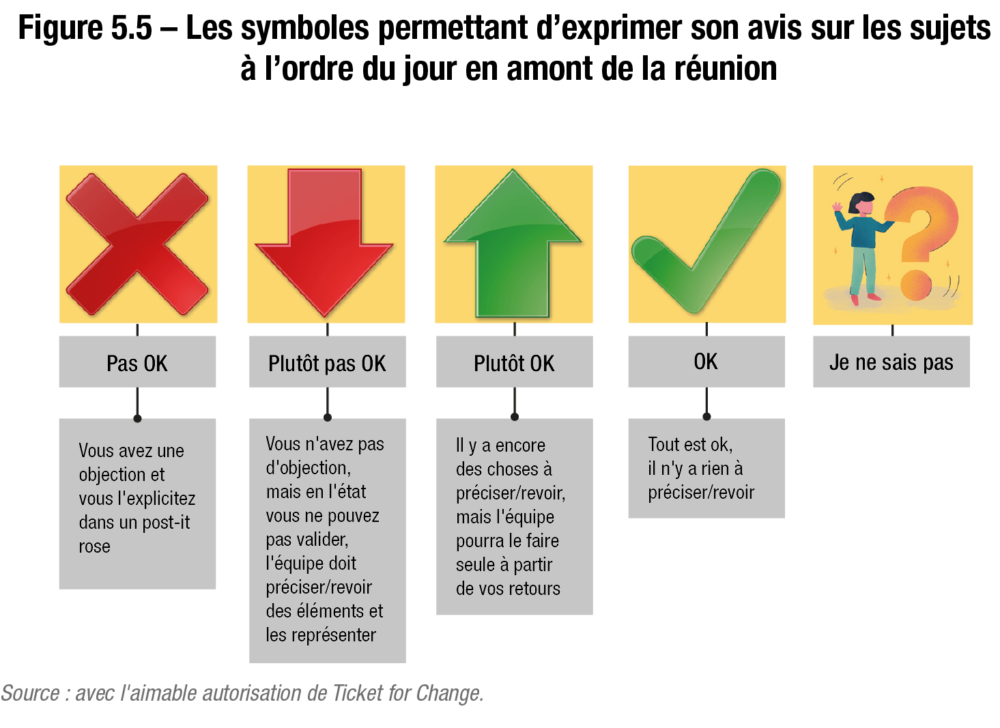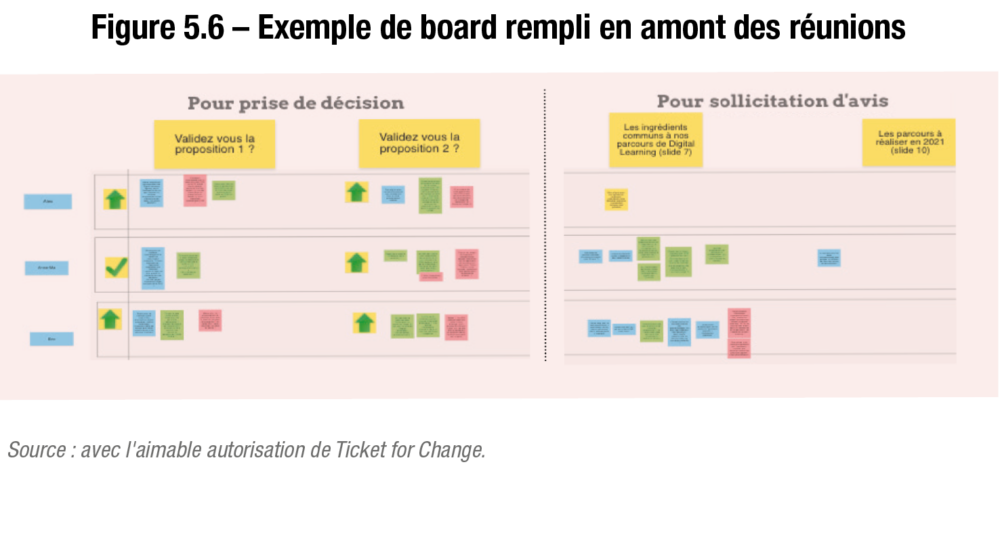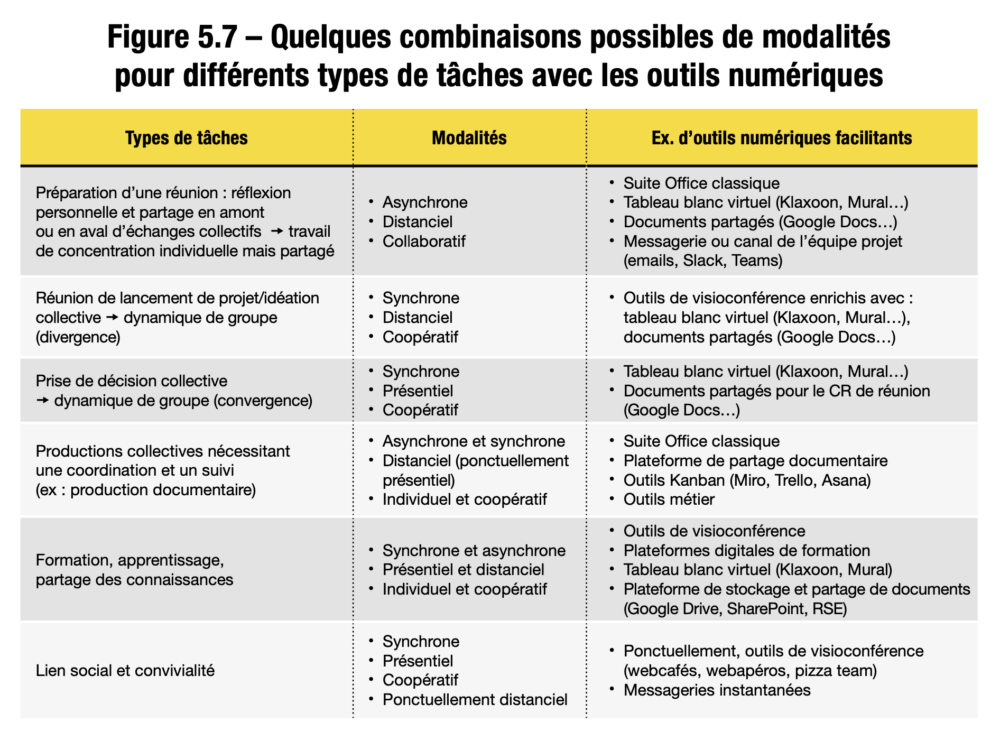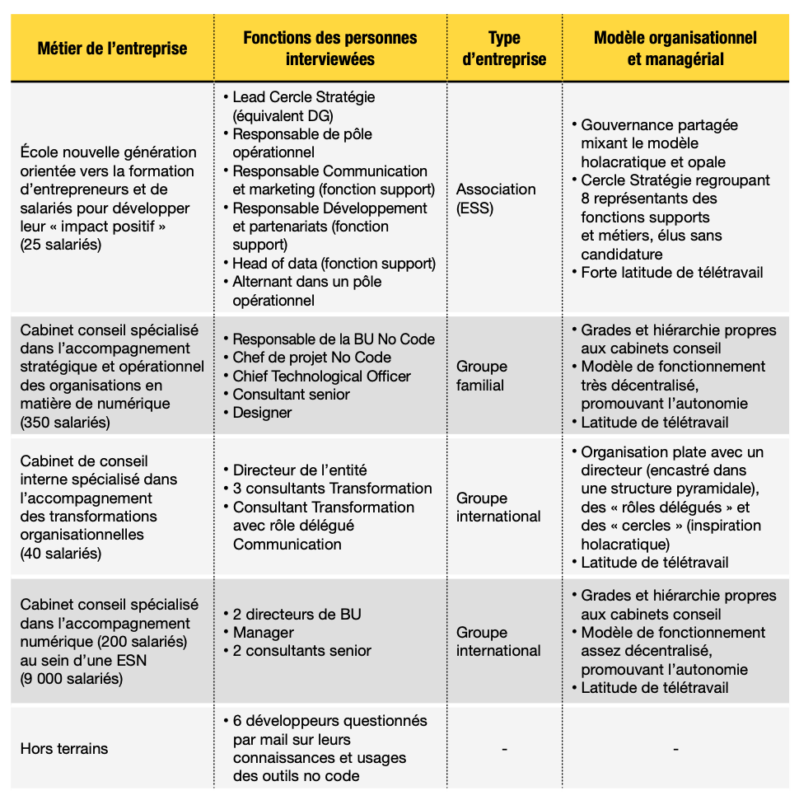Numérique collaboratif et organisation du travail – Au-delà des promesses

Cercles dans un cercle Vassily Kandinsky (1866-1944) États-Unis, Philadelphie, Philadelphia Museum of Art ©The Philadelphia Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais/image Philadelphia Museum of Art
Avant-propos
Depuis 2018, la chaire FIT2 et ses mécènes, parmi lesquels figure La Fabrique de l’industrie, se sont fixé pour projet d’explorer les futurs du travail sous l’angle du sens et de la qualité du travail, de l’autonomie des travailleurs et du développement des compétences.
Les difficultés de recrutement éprouvées par les entreprises dans de nombreux secteurs d’activité – notamment l’industrie –, le souci de la rétention des talents face à des demandes de flexibilité spatio-temporelle de plus en plus pressantes, et aussi l’agilité, la réactivité et la créativité qui reposent sur les personnes, représentent des enjeux cruciaux sur lesquels se joue la performance à moyen terme des organisations.
Tout le monde ou presque s’entend sur la nécessité d’accorder davantage de considération et de sens au travail réel, et de parvenir à une meilleure satisfaction des collaborateurs tout en préservant l’efficacité collective. Les manières d’y parvenir demeurent en revanche beaucoup plus floues. Étudier le « comment faire » représente justement l’une de nos principales missions. C’est dans ce cadre que nous labourons plusieurs terrains : les mécanismes d’autonomisation et de responsabilisation des travailleurs, le design du travail dans les usines pour les opérateurs et les techniciens de production, le télétravail et le travail hybride, l’impact des outils numériques sur l’organisation et les représentations du travail chez les jeunes.
Le présent ouvrage s’inscrit dans un triptyque commencé avec Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? (2021) et poursuivi avec Les nouveaux modes de management et d’organisation (2022). Cet ensemble vise à explorer « à chaud » les pratiques concrètes de travail qui se dessinent dans les organisations, notamment depuis la crise sanitaire. Nous ne pouvons que conseiller à nos lecteurs d’aborder de concert ces trois publications pour en tirer toutes les implications et bénéfices en matière de qualité du travail.
Vincent Charlet, Délégué général de La Fabrique de l’industrie
Thierry Weil, Titulaire de la chaire FIT2 Mines Paris – PSL
Préface
Pour beaucoup, la crise sanitaire que nous avons connue, avec le passage par un télétravail contraint pendant le confinement, a conduit à un changement des représentations et des pratiques en matière de télétravail. Celui-ci s’est traduit par l’augmentation du nombre de télétravailleurs. Ce développement plus massif du télétravail a entraîné ensuite un renforcement des équipements numériques au sein des entreprises et, en particulier, la mise en place des outils collaboratifs, voire le remplacement des outils existants par des nouvelles suites collaboratives.
Face à ce « travail hybride » où les équilibres entre présence et distance ont été bousculés et, avec eux, les liens entre les collaborateurs, ces outils collaboratifs sont parfois apparus comme une solution pour retrouver la fluidité des modes de fonctionnement.
Si du côté de leurs concepteurs et de leurs promoteurs en entreprise, ces outils portent des « visées organisationnelles » (flexibilité, transversalité, réactivité…), de l’autre côté, les salariés se les approprient (ou pas) en fonction de la valeur ajoutée qu’ils trouvent à ces outils par rapport à leur travail, en fonction de la place qu’ils arrivent à leur faire dans leurs activités, au quotidien. La manière dont ces visées se traduisent concrètement en termes de pratiques dépendra donc, entre autres, de l’activité réelle et du profil des acteurs auprès desquels ces outils ont été déployés.
Dans ce contexte de large diffusion des outils collaboratifs, le livre que vous avez entre les mains est très utile puisqu’il rappelle à quel point la prise en compte de l’organisation du travail est importante dans l’appropriation des outils en contexte professionnel. En effet, le développement des usages est le résultat d’un processus social. Par conséquent, il dépend aussi bien de l’épaisseur sociale des acteurs (leur appartenance identitaire, le sens même qu’ils donnent à leurs pratiques…) que des contextes dans lesquels se déroule leur activité. Autrement dit, les usages ne sont pas réductibles à une affaire d’habileté individuelle. Ils sont aussi une affaire de collectif et d’organisation. Dans l’appropriation de ces outils en contexte professionnel, il est donc nécessaire de s’intéresser non seulement aux facteurs individuels (parcours et position de la personne en entreprise, ses usages préalables des outils semblables dans la sphère privée ou professionnelle…), mais aussi aux facteurs collectifs (entraide, représentations construites collectivement, des savoirs partagés, qu’ils soient formels et informels, des règles métier, des stéréotypes qui nous présentent des écarts entre les jeunes et les seniors en matière d’aisance avec le numérique…) et organisationnels (processus métier, politiques d’entreprise en termes de transformation numérique, dispositifs mis en place au niveau de l’entreprise pour aider à la maîtrise des fonctionnalités d’un nouvel outil, actions de communication/sensibilisation…).
En filigrane de ces processus sociaux qui sous-tendent le développement des usages collaboratifs, apparaît la question des inégalités d’usages. Celles-ci ne sont pas uniquement une question d’accès (le réseau ou les équipements dont les salariés disposent), mais aussi de contexte. Or ces inégalités de contexte dépendent des facteurs collectifs et organisationnels évoqués. En d’autres termes, même si des inégalités d’usages existent au niveau individuel, des leviers sont à rechercher au niveau collectif et organisationnel pour atténuer ces inégalités.
Dès lors, la compréhension de ce processus d’appropriation des outils collaboratifs en entreprise donne des clefs pour réfléchir l’accompagnement de leur déploiement. Ce dernier ne peut donc pas se résumer à la sensibilisation des salariés à l’intérêt d’utiliser ces outils dans le cadre de leur travail ou à la nécessité de mettre en place des dispositifs leur permettant de se familiariser avec leurs fonctionnalités (ateliers, tutoriels, webinaires…). En plus de ces deux registres qui portent sur la communication et la maîtrise individuelle des fonctionnalités d’un outil collaboratif, un troisième registre se révèle être essentiel : celui qui porte sur la mise en discussion de ces outils par rapport à l’activité individuelle et collective. Souvent oublié dans les processus d’accompagnement au déploiement de ces outils collaboratifs, ce dernier registre souligne tout d’abord l’importance de discuter collectivement de la valeur ajoutée de ces outils par rapport à l’activité, dans des contextes locaux. De ce point de vue, l’appropriation de ces outils au sein des équipes ou au sein des collectifs de travail (plus ou moins éphémères qui se construisent ou se dispersent en fonction de l’activité ou de l’avancement des projets) dépend donc de la capacité de leurs membres à discuter localement de la manière dont ces outils peuvent être mobilisés pour soutenir encore mieux leur travail. Cela revient, par exemple, à discuter des fonctionnalités qui leur paraissent intéressantes à utiliser à un moment donné pour leur activité, des manières d’utiliser ensemble ces outils, mais aussi des changements éventuels à opérer dans leur activité et des moyens à dégager pour réussir ces changements visant l’amélioration de la réalisation de leur travail à l’aide de ces outils. Ce troisième registre souligne donc aussi l’importance de coconstruire des règles d’usages qui permettent d’éviter des risques, par exemple, en termes de surcharge informationnelle et cognitive ou de multiplication d’interruptions, risques que ce livre pointe également.
Le rôle des managers devient alors primordial, aussi bien dans l’orchestration de ces discussions que dans la mise en place des évolutions de l’activité qui en découlent. De leur part, cela suppose aussi bien une connaissance et une prise en compte des contraintes réelles de l’activité, qu’une bonne connaissance de ces nouveaux outils proposés à leur équipe .
Ce livre permet donc d’insister sur le fait qu’il n’y a pas de déterminisme technologique et de sensibiliser les acteurs à la prise en compte de l’activité et des contextes locaux dans l’accompagnement du déploiement des outils collaboratifs et du développement de leurs usages. Il constitue ainsi une aide précieuse pour réfléchir à la mise en place de ces outils, en soutien du travail de chaque jour, en évitant qu’ils deviennent des entraves au « travail bien fait ».
Ne l’oublions pas : ce qui compte dans le développement des usages est d’une part, la capacité des acteurs à personnaliser les outils mis à leur disposition, en fonction de leur activité et de leur contexte local et d’autre part, leur capacité à s’organiser ou se réorganiser autour de ces outils.
Anca Boboc, Sociologue du travail et des organisations, chercheure dans le département des sciences sociales d’Orange Innovation
Résumé
À la faveur de la crise sanitaire et de la massification du travail à distance, une nouvelle vague d’outils numériques, souvent désignés par le terme générique « outils collaboratifs », a été déployée dans les organisations. Ils sont très divers, recouvrant une large palette de fonctionnalités qui va de l’échange d’information à la possibilité de réaliser des productions partagées en temps réel, en passant par du stockage-partage de documents dans le cloud ou de l’animation de réunions à distance, etc. Les fournisseurs de solutions les présentent comme des instruments capables de rendre les organisations plus agiles et fluides, en abolissant les contraintes de temps et d’espace, et en favorisant la collaboration, la créativité et la performance de leurs membres. La réalité se révèle assez éloignée de ces promesses.
Du fait de la brutalité de l’épisode pandémique, le recours à ces outils s’est fait, souvent dans le plus grand désordre, de manière à maintenir la continuité de l’activité. Ce n’est souvent qu’en sortie de crise qu’ils ont fait l’objet d’un déploiement formel. Ces outils ne se sont pas substitués aux dispositifs de communication préexistants, mais sont venus s’y ajouter, produisant un effet « millefeuille » nuisible à la santé psychique des salariés. Plusieurs enquêtes récentes témoignent du mal-être croissant ressenti
Les effets ambivalents des outils collaboratifs
Notre enquête de terrain montre que les effets de ces outils sur l’organisation du travail sont de plusieurs natures. Au rang des effets bénéfiques, les salariés indiquent la possibilité de communications mieux ciblées qu’avec les e-mails, un renforcement de l’autonomie verticale et horizontale avec les pairs et les managers grâce à la transparence de l’information, ainsi que des gains de temps et d’efficacité quand les fonctionnalités de ces outils sont bien maîtrisées et partagées – ce qui est rare. Mais il importe de souligner que cette évaluation positive est énoncée comme une potentialité offerte par ces outils et non comme une réalisation effective qui émergerait « spontanément » de leur implantation. Les outils n’ont pas le pouvoir magique de structurer les processus organisationnels et sociaux. En l’absence de pratiques régulées et partagées, les usages spontanés de ces nouveaux outils aboutissent souvent à une somme de méfaits organisationnels.
Le millefeuille numérique se traduit non seulement par une multiplication de canaux de communication et de notifications (e-mails, messageries professionnelles de type Teams ou Slack, visioconférence, messageries grand public de type WhatsApp ou Messenger, espaces documentaires partagés, etc.), mais aussi par une intensification de leurs usages (effet rebond). Ces deux phénomènes conjugués débouchent souvent sur un chaos informationnel, de même que sur une fragmentation de l’activité venant alourdir la charge cognitive, avec une tendance à l’hyperconnexion des collaborateurs en dehors des plages horaires normales de travail. Les effets de ces outils sont donc très ambivalents.
Pour assurer à la fois l’efficience et la qualité de vie au travail, les usages de ces outils doivent alors être régulés en lien avec le « travail réel » des équipes.
Des modes de déploiement multidimensionnels
Cette régulation commence par la manière dont les outils sont déployés. Le mode de déploiement traditionnel, hiérarchique et descendant (top-down), paraît inadapté et contradictoire avec l’esprit de ces outils censés favoriser des pratiques collaboratives horizontales. Mais, symétriquement, le mode « laisser-faire » (dit aussi provide and pray, i.e. fournir et prier) semble tout aussi insatisfaisant. En effet, puisqu’il s’agit de dispositifs communicants, ils ne peuvent produire des effets structurants que s’il existe au moins deux personnes qui les utilisent de la même manière. Des accompagnements paraissent donc nécessaires. Et ils auront intérêt à combiner des approches à la fois centralisées et locales, formelles et informelles, imposées et émergentes, descendantes et ascendantes, pour assurer l’appropriation de l’outil et son adaptation aux activités de travail au sein d’un même collectif. La précipitation est souvent mauvaise conseillère en matière de déploiement : il faut laisser du temps au temps, et ne pas « forcer » l’adoption.
Structuration des outils et régulation multiscalaire des usages
Au-delà de la phase de déploiement, il faut travailler conjointement la structuration de l’outil technique et la régulation des comportements d’usage. L’effort de structuration doit concerner chaque outil (arborescence pour les drives , squelette des canaux pour Teams ou Slack, etc.), et plus globalement l’ensemble du portefeuille d’outils de communication.
Compte tenu de sa complexité, la régulation des usages du numérique collaboratif doit s’envisager de manière multiscalaire ou « gigogne » : à la fois individuelle, managériale, collective et institutionnelle.
La régulation individuelle est celle que les salariés mettent spontanément en œuvre pour réduire les contraintes et les effets nuisibles que les outils numériques font peser sur leur travail et leur équilibre mental (éteindre son téléphone, ne regarder ses comptes que quelques fois par jour, désactiver les notifications, ne pas travailler le soir, le week-end, etc.). Cependant, ces marges de manœuvre restent fortement cadrées en pratique par le fonctionnement du collectif dans lequel les individus s’insèrent, et notamment par les exigences de la hiérarchie.
Les managers ont donc un rôle d’exemplarité important à jouer, tant en amont, dans l’adoption des outils, qu’en aval, dans la régulation des usages, notamment en respectant le droit à la déconnexion, y compris pour eux-mêmes.
La régulation des pratiques aura tout intérêt à se déplacer des managers vers l’équipe dans le cadre d’un véritable dialogue professionnel collectif, partant de l’analyse des irritants, des besoins du terrain et des réalités des métiers. Cette régulation devra rester évolutive pour intégrer l’amélioration continue et les effets d’expérience.
Enfin, une régulation institutionnelle reste nécessaire pour favoriser la diffusion des meilleures pratiques entre les équipes et éviter ainsi les effets de silos, ou encore pour garantir la cybersécurité.
Toutefois, les tentatives de régulation resteront impuissantes si elles se heurtent à des normes culturelles souvent implicites, notamment le culte de l’urgence, qui dévoie les usages asynchrones des outils vers des pratiques synchrones, ou encore l’acceptation systématique des horaires atypiques (travail le soir, le week-end, en vacances) en lien avec une charge de travail excessive.
Mettre en œuvre des pratiques de travail innovantes avec les outils numériques
Au-delà de ces indispensables régulations, une analyse des méthodes et des processus de travail peut permettre de faire émerger des pratiques innovantes grâce à de nouveaux usages des outils collaboratifs. À cet égard, par la complémentarité entre des temps de réflexion asynchrones et des temps d’échanges synchrones, et ce où que l’on se trouve. Une telle logique secondarise la question spatiale, sans la faire disparaître, au profit d’une réflexion axée sur la flexibilité temporelle.
Cet ouvrage permet ainsi de relativiser l’idée selon laquelle l’adoption généralisée des outils collaboratifs déboucherait mécaniquement sur des améliorations pour les salariés en termes de gain de temps et d’autonomie. Ces outils sont surtout des révélateurs permettant d’objectiver des situations de travail et de les mettre en débat pour s’ouvrir à l’expérimentation de nouvelles pratiques.
Introduction
À la faveur de la crise sanitaire et du développement du travail à distance1, une nouvelle vague d’outils numériques a été déployée dans les organisations. Ils sont généralement désignés sous le terme générique d’« outils collaboratifs ». La notion même de « collaboration » qu’ils véhiculent est assez floue, car ils sont en réalité très divers, recouvrant une liste à la Prévert de fonctionnalités : de l’échange d’information à la possibilité de réaliser des productions partagées en temps réel, en passant par du stockage-partage de documents dans le cloud, de la programmation et de l’animation de réunions à distance, de la gestion de projets ou encore de la création de logiciels sur mesure.
Ces outils n’ont par ailleurs rien d’intrinsèquement nouveau. Ni sur un plan strictement technologique, ni sur le plan de l’intention organisationnelle qu’ils cherchent à soutenir. En revanche, en accroissant notablement la part de travail à distance, la crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur dans la nécessité de les adopter pour maintenir l’activité.
La dernière génération d’outils collaboratifs est l’héritière des groupwares2 des années 1990, des développements d’Internet – à commencer par l’e-mail –, puis du web 2.0 avec les intranets et les réseaux sociaux d’entreprise, et enfin du cloud, qui favorise la plateformisation des services logiciels. Elle vise encore et toujours à intensifier les échanges horizontaux et à fluidifier les communications dans une perspective de rapidité et d’efficience. La bascule dans la société de la communication et du savoir a, en effet, rendu les facteurs immatériels – information, communication et mise en relation des « intelligences » – beaucoup plus déterminants pour la réussite des organisations que par le passé. Les entreprises doivent s’adapter à « un environnement économique où la réactivité, la flexibilité, la capacité d’ innover – pour reprendre quelques-uns de ces termes si couramment invoqués – sont les nouveaux mots d’ordre » (Mariotti, 2005). Les pratiques de travail collaboratives mobilisant l’intelligence collective sont supposées venir soutenir ces objectifs d’innovation, d’agilité, de simplification et de vitesse. S’y ajoutent aujourd’hui des attentes de flexibilité spatio-temporelle et d’autonomie des salariés, qui étaient déjà latentes mais sont sorties renforcées par l’ expérience vécue lors de la crise sanitaire. Les technologies « collaboratives » entrent donc assez massivement dans les organisations afin de jouer un rôle capacitant pour ces New Ways of Working (Jemine, 2017) .
Du fait du caractère inattendu et brutal de l’épisode pandémique, le recours à ces nouveaux outils s’est fait dans le plus grand désordre. Contrairement à l’approche top-down qui préside habituellement au déploiement des systèmes d’information, la crise du Covid a favorisé l’émergence de bricolages d’outils et d’usages sans le contrôle exercé habituellement par les DSI. Certains outils numériques ont ainsi été adoptés dans l’urgence, sous le radar hiérarchique et par propagation virale. Des décisions centralisées de déploiement formel ne sont souvent intervenues qu’une fois le gros de la crise passé. Les nouveaux outils se sont la plupart du temps ajoutés aux dispositifs de communication existants, engendrant le « phénomène du millefeuille ».
À l’issue de cette période (2020-2022), plusieurs enquêtes témoignent du mal-être croissant éprouvé par les salariés face à cette digitalisation chaotique à l’origine de techno- stress et d’infobésité : 40 % des collaborateurs se disent stressés par la mauvaise gestion de l’information dans leur entreprise, notamment par le trop grand nombre d’applications à consulter chaque jour (OpenText, 2022). Les trois quarts des employés estiment que leur travail est devenu plus complexe, et 42 % en attribuent la responsabilité à la transformation digitale (PEGA, 2022). Selon les salariés interrogés par Malakoff Humanis (2022), la première difficulté générée par les nouveaux modes hybrides de travail concerne le renforcement de la digitalisation des activités professionnelles. Même Microsoft (2021, 2022) alerte les entreprises sur l’épuisement numérique des salariés. Quant à l’Institut Montaigne (2023), il souligne « un accroissement de l’intensité ressentie au travail » et une charge psychique de plus en plus lourde « d’autant qu’on ne se déconnecte plus ». La conjonction de la flexibilité spatio-temporelle et des usages des outils numériques constituerait-elle un cocktail explosif, conduisant directement les salariés à la surchauffe ?
Clouer au pilori les outils numériques (ou le télétravail) peut sembler un réflexe commode. Mais comme le disait déjà Karl Popper (1992), les objets techniques ne font qu’accompagner des « propensions », entendues comme des tendances, des dispositions. Ces propensions ne sont pas à appréhender comme des « propriétés inhérentes à un objet mais comme des propriétés inhérentes à une situation, dont l’objet en question fait naturellement partie ». C’est donc « la situation » qu’il nous faut considérer si nous voulons comprendre la dynamique à l’œuvre. Avec le travail hybride rendu possible par le numérique, les perceptions et représentations du travail ont changé chez les salariés, mais pas grand-chose d’autre n’ a bougé dans les organisations. Il n’est guère étonnant de constater qu’en plaquant des outils nouveaux sur des logiques de fonctionnement anciennes, les résultats obtenus soient peu probants. Les outils n’ont pas le pouvoir magique de structurer les processus socio-organisationnels ; ils ouvrent simplement des pistes dont les organisations peuvent se saisir… ou non.
Nous sommes encore au milieu du gué. Certaines entreprises « avancées » essayent de tirer tous les fils logiques de la combinaison du travail hybride, de la montée en autonomie des salariés et du déploiement d’outils numériques de travail. D’autres (et non des moindres) militent pour le back to the office3 et le retour à des pratiques connues et stabilisées. D’autres enfin sont arrêtées à mi-chemin et attendent de savoir de quel côté penchera la balance. Pour les organisations dont l’activité et la culture sont compatibles avec les nouvelles formes d’organisation du travail et qui souhaitent avancer dans cette direction, le chemin qui reste à parcourir relève bien d’une reconception des processus de travail et de leurs régulations à la lumière des possibilités ouvertes par les outils numériques.
Le présent ouvrage vise à examiner « à chaud » les effets de quelques-uns de ces nouveaux outils sur les pratiques de travail au sein des équipes. Les questions que nous nous posons sont les suivantes : à la sortie de la crise sanitaire qui a accéléré leur adoption, les outils collaboratifs semblent-ils réaliser les promesses qu’ils affichent ? Que changent-ils dans les manières perçues de travailler ? Soutiennent-ils l’avènement des New Ways of Working et, si oui, à quelles conditions ? Produisent-ils des effets indésirables et, si oui, lesquels et pourquoi ? Nous avons délibérément choisi nos terrains au sein de structures que l’on peut qualifier d’avancées. D’une part, parce que leur métier les rend a priori très compétentes en matière de maîtrise des outils numériques. D’autre part, parce qu’elles sont engagées dans la mise en œuvre des nouvelles pratiques de flexibilité spatio-temporelle (travail à distance, horaires souples) ou dans des modèles organisationnels peu hiérarchiques (agilité, holacratie, gouvernance partagée) (Canivenc, 2022a). Ces organisations permettent ainsi de mettre en lumière non seulement les liens qui existent entre numérique collaboratif et organisation du travail, mais aussi les difficultés rencontrées et les pistes d’amélioration possibles.
Méthodologie de l’étude
L’analyse proposée dans cet ouvrage s’appuie sur une série d’études de terrain réalisées de l’automne 2021 à l’été 2022 dans quatre entités de tailles variées :
• Une association de l’ESS4 organisée en « gouvernance partagée5 », sorte d’école « nouvelle génération » destinée à accompagner les entrepreneurs et les salariés vers une transformation sociétale de l’économie (25 salariés).
• Une société de conseil en stratégie et développement numériques, chargée d’accompagner les entreprises dans leurs démarches d’innovation digitale. Cette entreprise de type familial est organisée en mode décentralisé et agile, avec une certaine dose de « laisser-faire » et un accès assez aisé à la direction générale (350 salariés).
• Deux cabinets de conseil appartenant à un grand groupe international technologique (plus de 100 000 salariés) :
– Le premier (40 salariés) est chargé d’accompagner les transformations organisationnelles des entités du groupe, en lien avec la stratégie centrale. Il est organisé en mode plat avec des références à des modèles organisationnels de nature peu hiérarchique (agilité, holacratie), et avec un directeur encastré dans un système pyramidal hiérarchique classique.
– Le second (200 salariés) fait partie de l’ESN6 du groupe qui compte 9 000 salariés. Il est chargé d’accompagner les transformations numériques au sein du groupe et chez les clients du groupe. S’il est organisé selon le mode pyramidal traditionnel des cabinets conseil avec une hiérarchie de titres et de grades, il fonctionne au quotidien de manière très décentralisée et agile.
Dans chacune de ces structures, des entretiens semi-directifs basés sur un guide d’entretien commun ont été conduits avec cinq salariés de statuts et de fonctions diversifiés (directeur d’entité, responsable technique, manager de proximité, collaborateur : voir Annexe). Les entretiens ont passé en revue les outils numériques utilisés (typologie, fonctionnalités, déploiement, appropriation, usages), ainsi que l’organisation de l’entité (culture d’entreprise, design organisationnel, pratiques managériales, organisation du travail).
Cela nous a permis de mieux cerner les pratiques et les perceptions de chacun et les interdépendances entre usages du numérique et évolutions dans l’organisation du travail. Ces entretiens ont été complétés par un questionnaire administré par courriel auprès de six développeurs (hors de ces terrains) pour mieux comprendre l’impact spécifique des technologies no code sur les stratégies d’acteurs. Le décryptage des entretiens a ensuite été rapproché des résultats d’autres études, enquêtes et sondages, et d’une revue de la littérature.
L’accès à ces terrains a été facilité par les représentants des mécènes de la Chaire FIT2 que nous remercions vivement.
Un grand merci à nos interlocuteurs impliqués et avertis dans chacune des organisations visitées. Nous avons pu aussi compter sur l’appui de Marie Baléo (agence Manifeste) qui a participé à certains entretiens.
- 1. Le sujet du présent ouvrage s’inscrit dans la continuité des travaux de la chaire FIT2 sur le télétravail, le travail hybride, les nouveaux modes de management et d’organisation, et le design du travail.
- 2. Logiciels permettant à un groupe de réaliser un travail collectivement.
- 3. Retour au bureau 5 jours sur 5, comme cela a récemment été annoncé par Amazon, Tesla, Disney, JPMorgan, etc.
- 4. Économie sociale et solidaire.
- 5. Le terme générique de « gouvernance partagée » regroupe plusieurs modes de structuration des prises de décision, et de leur mise en œuvre dans une organisation ou un collectif, visant à réduire ou à supprimer la concentration des pouvoirs entre les mains d’un petit nombre de personnes, pour les répartir parmi celles qui réalisent le travail. On peut parler aussi de gouvernance « horizontale » ou d’organisation « plate ».
- 6. Entreprise de services du numérique, nouveau nom donné aux anciennes SSII.
Des outils numériques collaboratifs : pour quoi faire ?
La dernière vague d’outils de travail numériques, dont les usages se sont renforcés à la faveur de la crise sanitaire, apparaît riche de promesses : ils pourraient supposément révolutionner nos fonctionnements collectifs. Ces outils ont pour objectif de soutenir de nouvelles pratiques de travail flexibles, en abolissant les contraintes de temps et d’espace pour permettre aux équipes de « travailler n’importe où, n’importe quand, mais pas n’importe comment7». Si l’on en croit certains éditeurs, le numérique collaboratif permettrait de résoudre tous les problèmes de communication des organisations, depuis le cloisonnement jusqu’au manque de collaboration inter et intra-équipes, grâce à de nouvelles manières de travailler plus simples et plus fluides. La messagerie instantanée Slack8 promet ainsi de « simplifier le travail d’équipe », tout en travaillant « quand, où et comme vous le souhaitez [pour] accroître votre productivité » (site de Slack, 2022). Dans un registre similaire, l’espace collaboratif Teams permet de « gagne[r] en concentration et en efficacité » en « facilit[ant] la collaboration en temps réel ou au rythme de chacun » (site de Teams, 2022) Quant à la plateforme de management visuel Klaxoon (Crochet-Damais, 2022), elle promet de « développer l’intelligence collective » et de « libérer la parole » pour « rendre le travail d’équipe plus efficace » (Bembaron, 2016).
De telles promesses ne sont guère nouvelles. Cette dernière vague d’outils s’inscrit dans un continuum chronologique d’outils informatiques professionnels destinés à la collaboration. Cependant, par le passé, ces promesses n’ont été que rarement tenues. La foi aveugle dans le pouvoir structurant des outils technologiques sur les modes de travail a toujours été source d’errements et de déceptions. En ira-t-il différemment cette fois ?
Une brève histoire des outils collaboratifs
Les premiers outils informatiques destinés à travailler collectivement apparaissent dès le début des années 1990.
Les premières générations d’outils collaboratifs : du mode projet aux New Ways of Working
À la fin des années 1980, le mot groupware est sur toutes les lèvres. Le concept a été défini de manière théorique par Peter et Trudy Johnson-Lenz (1982) comme « l’ensemble des processus et procédures d’un groupe de travail devant atteindre un objectif particulier, plus les logiciels conçus pour faciliter ce travail de groupe ». Cette définition s’inscrit dans la logique d’organisation en « mode projet » alors en émergence (Boltanski et Chiapello, 1999). Les « projets » se distinguent des opérations par leur caractère temporaire, unique ou reconfigurable (innovation, développement de produit, transformation). Ils mobilisent plusieurs métiers ou experts internes et externes à l’entreprise, qui doivent collaborer de façon étroite pendant la durée du projet, nécessitant la définition d’un langage commun et de modalités de coopération et de coordination spécifiques. Les groupwares apparaissent alors comme une réponse à ces problématiques. À cette époque, le plus répandu est Lotus Notes, lancé en 1989 par IBM après plusieurs années de mise au point : « C ’ était excentrique de penser à un logiciel de communication de groupe en 1984, quand la plupart des gens n’avaient jamais vu un système de mail… Le produit était vraiment très loin de son temps » , indique Tom Diaz, premier vice-président d’une société qui a participé au développement de la première version de Lotus Notes (Bodhaine, 2016). Les effets de ces outils sur les pratiques de travail resteront cependant limités (Orlikowski, 1993), d’autant que les groupwares de première génération vont bientôt être balayés par la généralisation d’Internet. Mais, dès cette époque, la graine du « collaboratif » est plantée, à défaut d’avoir germé.
Le premier outil de communication professionnelle issu d’Internet est l’e-mail (le courriel) qui va devenir « incontournable » (Boudokhane-Lima et Felio, 2015), au point de représenter encore aujourd’hui « l’épine dorsale de la communication organisationnelle » (Bertin et al ., 2020). Cet outil laisse une grande autonomie à l’individu pour organiser son travail et ses communications. L’émergence de la logique décentralisée du web va ainsi s’accompagner d’une réflexion concomitante (toujours en avance sur les pratiques) portant sur de nouvelles formes organisationnelles en émergence, désignées sous le sigle NFO ou NFOT9, qui promeuvent plus d’autonomie, d’initiative et de collaboration entre les travailleurs ( Veltz et Zarifian, 1993 ; Jacot, 1994 ; Louart, 1996 ; Ajzen et al. , 2015 ). Toutefois le succès de ce premier outil décentralisé deviendra par la suite la cause de son revers : son usage semble devenu incontrôlable et l’e-mail est aujourd’hui attaqué de toutes parts pour les effets pervers qu’il occasionnerait (voir chapitre 2).
Dans la première décennie des années 2000, on voit apparaître les premiers intranets10, suivis par les réseaux sociaux d’entreprise (RSE), inspirés par le succès des plateformes numériques grand public du web 2.0 (blogs, wikis puis réseaux sociaux). Ils vont incarner des promesses de collaborations plus transverses et d’un engagement direct des salariés dans la production de contenus et leur partage. Ces outils se révéleront globalement assez décevants sur le plan de la participation des salariés (Monneuse, 2014) et ne feront guère évoluer les pratiques de travail (Boboc et al. , 2015).
Au tournant des années 2010, avec l’avènement du « modèle start-up » et la popularité grandissante des méthodes agiles (Manifeste agile, 2001), l’intensité des échanges et les partages horizontaux deviennent une exigence de plus en plus revendiquée au sein des organisations. Des expériences intéressantes sont conduites autour de la constitution de communautés de pratiques en innovation, grâce à des réseaux sociaux internes ( Arzumanyan et Mayrhofer, 2016 ). Les outils numériques sont supposés soutenir cette (r)évolution organisationnelle désormais désignée par l’acronyme NWoW ( New Ways of Working ). Cette appellation renvoie à un « mix organisationnel » de pratiques de flexibilité spatio-temporelle (travail à distance, hybride, horaires flexibles), de modes d’organisation collaboratifs de travail et de pratiques de management participatif, le tout étant rendu possible par l’usage des TIC11 (Taskin, 2012 Ajzen et al. , 2015 ).
Le numérique collaboratif apparaît alors aux yeux de beaucoup d’organisations comme un levier pour faire évoluer le management « command and control » afin de libérer la capacité d’initiative des équipes et de les rendre plus adaptables face aux aléas de la vie économique ( Jemine, 2017) . Mais, en dépit d’une diversité toujours plus grande d’outils et de logiciels sur le marché, leur adoption reste timide et les pratiques de communication organisationnelle évoluent peu. C’est alors que va intervenir la crise sanitaire de 2020 et ses différents confinements.
La crise sanitaire et l’accélération de la digitalisation collaborative
L’année 2020 est marquée par une forte accélération de la pénétration des outils collaboratifs dans les entreprises. La bascule vers le télétravail forcé pour raison sanitaire va contraindre les travailleurs à précipiter le rythme pour s’adapter rapidement à cette situation inédite. Face à l’absence d’outils installés répondant aux besoins d’un travail à distance massif, les salariés ont « bricolé » avec les moyens du bord, parfois sans aucune approbation ni autorisation de leur DSI. En témoigne le directeur d’une practice dans un cabinet conseil pourtant spécialisé dans le numérique : « On était totalement en souffrance. Les plus habiles allaient chercher des solutions alternatives, les moins habiles subissaient les outils imposés par l’entreprise. On est arrivés dans la pandémie dans ces conditions-là, il était donc assez difficile de collaborer . » Ce n’est que dans une phase ultérieure, en sortie de crise sanitaire, que certains de ces outils seront « officiellement » intégrés et généralisés, voire remplacés par des espaces numériques de travail ou digital workplaces plus ambitieux car offrant une diversité de fonctionnalités.
L’étude comparée menée par Gartner (2019, 2021a) à travers le monde révèle ainsi une augmentation de 24 points de pourcentage de l’usage des outils collaboratifs (voir figure 1.2). Cette hausse vertigineuse s’explique avant tout par la généralisation rapide de la visioconférence, l’outil qui a connu la plus forte progression en 2021. La visioconférence est considérée comme le système ayant le plus contribué à maintenir l’activité des salariés français pendant la crise sanitaire (Slack, 2021).
Selon les études annuelles du cabinet Lecko12 (2022, 2023) (voir figure 1.3), l’e-mail conserve, voire renforce, sa place prépondérante dans les pratiques de communication professionnelles, mais il est désormais talonné par les nouvelles messageries d’entreprise (Teams, Meet), puis par la fameuse visioconférence, ainsi que par les messageries instantanées grand public dont l’usage professionnel s’est accentué pendant et depuis la crise sanitaire (WhatsApp, Messenger). Les digital workplaces sont également mentionnées plus fréquemment. Pour toutes ces catégories d’outils, on note une intensification de leur utilisation. Il reste cependant toujours un quart des salariés qui ne sont pas concernés par ces différents outils, même si leur proportion décroît entre 2021 et 2022. Pour mieux comprendre qui sont ces actifs éloignés des outils numériques professionnels, notons qu’un grand groupe industriel nous indiquait très récemment que 40 % de ses opérateurs en usine dans le monde ne disposaient pas d’adresse électronique au nom du groupe « parce qu’ils n’ont pas d’ordinateur » ( sic ).
Du fait du caractère brutal et inattendu de la pandémie, l’accélération de la digitalisation s’est faite dans un grand désordre et dans la plus grande improvisation. À l’issue de la crise, on constate une diversification et un empilement des canaux de communication, auxquels s’ajoute un accroissement de leur usage. Plusieurs enquêtes laissent apparaître des signes de mal-être chez les salariés, dont certains sont directement imputables au sentiment d’une intensification du travail liée aux outils numériques.
L’INRS13 note « parmi les préoccupations, relayées tant par la recherche et les médias que par les partenaires sociaux français ou européens, […] la multiplication des outils sans priorisation et sans structuration des stratégies d’usage » (Grosjean et Morand, 2021).
Une vaste famille d’outils aux fonctions diverses
Face à cette montée en puissance des outils collaboratifs et à leur diversité, le besoin de saisir précisément leur nature se fait sentir. Or, il n’existe pas d’acception univoque ni de définition standard de ce que recouvre cette catégorie aux frontières mouvantes.
On peut tenter de la segmenter par les métafonctions que remplissent ces outils, comme dans le mapping de la figure 1.4.
Mais cela finit vite par ressembler à une liste à la Prévert, rappelant la « balkanisation » de fonctionnalités qui caractérisait déjà les premières générations de réseaux sociaux d’entreprise (Monneuse, 2014).
Nous proposons pour notre part une typologie par fonctionnalité plus générique, mais aussi plus simple14, en nous limitant aux outils les plus souvent cités dans le cadre de nos terrains. Certains, spécifiques, n’effectuent qu’une seule fonctionnalité ; d’autres, transversaux, en recouvrent plusieurs. D’autres enfin peuvent être intégrés au sein d’une seule et même plateforme multitâches.
Les outils de communication interne au sein des équipes de travail
Face au déferlement d’e-mails qui encombrent les boîtes de réception et fragmentent l’activité de travail, une nouvelle génération de plateformes de messagerie d’entreprise, comme Slack ou Teams, a fait son apparition pour communiquer en interne.
Leur principal apport consiste à ne plus organiser les messages de manière antéchronologique, sans autre distinction de pertinence que leur intitulé et leur ordre d’arrivée, mais de les classer au travers de « canaux » thématiques pour Slack ou d’« équipes » de travail pour Teams. Ces messages peuvent bien entendu être accompagnés de toutes sortes de pièces jointes (documents, images), comme les e-mails. L’initiateur du canal ou de l’équipe inscrit les destinataires qui, selon lui, sont concernés par le thème ; les messages ne parviennent ensuite qu’aux personnes faisant partie de l’équipe créée dans l’outil, ce qui permet de trier les messages en fonction de leur pertinence pour celui ou celle qui les consulte. En définitive, ces plateformes doivent permettre de regrouper au sein d’un même espace les informations qui concernent les « bonnes » personnes pendant une durée donnée (le temps d’un projet par exemple). Comme l’explique l’un de nos témoins, qui installe Teams chez des clients : « Demain, notre objectif, c’est de ne plus ouvrir que deux outils, Teams [pour l’interne] et l’outil d’e-mail [pour l’externe]. »
Les plateformes de stockage et de partage de documents
Des plateformes, comme Google Drive, OneDrive, Dropbox, SharePoint ou Notion, se spécialisent dans le stockage et le partage de documents. L’idée est ici de pouvoir sauvegarder, stocker et retrouver facilement des documents – qui plus est, dans leur dernier état d’actualisation –, et de donner des autorisations à qui peut les consulter ou les modifier. Ces bibliothèques de contenus partagés doivent obéir à un classement permettant à tout un chacun de les retrouver, ce qui nécessite d’utiliser un système d’arborescence connu et compris par tous.
Ces espaces de partage documentaire peuvent en outre se coupler à des outils de collaboration documentaire comme Google Docs, Microsoft Office Online, etc., qui permettent à l’ensemble des personnes autorisées d’intervenir simultanément ou séparément sur un même document, visible en permanence. Cette façon de produire est censée diminuer le temps passé en synchronisation par réunion ou par échange d’e-mails, et donc de gagner en productivité. Elle est néanmoins loin d’être généralisée : selon les traces numériques enregistrées en 2022 par la société Mailoop (2023) auprès de 9 000 collaborateurs, près d’un tiers (31,4 %) ne travaillent jamais sur des fichiers collaboratifs et 34 % en font un usage rare (moins d’une fois par mois). L’usage tend cependant à se développer, puisqu’en 2021 ils étaient 57 % à n’avoir jamais partagé un fichier pour travailler en mode collaboratif (Mailoop, 2021).
Les outils de réunion et d’animation
Au-delà de la communication écrite, de nouveaux outils cherchent également à mieux structurer et dynamiser les échanges verbaux, et plus particulièrement les réunions, point noir récurrent de la vie des organisations. Le passage de la réunion physique à la visioconférence, pendant la pandémie, a eu tendance à augmenter encore la fréquence des réunions, même si leur durée a diminué (DeFilippis et al., 2020), sans transformer pour autant en profondeur la manière dont elles sont organisées15. Ces visioconférences à répétition engendrent des phénomènes psychologiques particuliers, tels que la Zoom fatigue16 (Bailenson, 2021). Des recherches ont montré depuis longtemps que « la vidéo est plus appropriée pour transmettre des images du travail lui-même que des vues des participants » (Navarro, 2001). Enfin, les réunions hybrides, où certains sont en présentiel et d’autres à distance, sont venues accentuer encore la difficulté de gestion des réunions.
Pour toutes ces raisons, de nouveaux outils sont apparus pour structurer et dynamiser l’animation des réunions à distance. Klaxoon, par exemple, propose un ensemble d’applications favorisant l’interactivité et l’implication de chacun des participants : tableaux blancs de management visuel, fonctionnalités d’animation de type sondages et quiz, ainsi que de nombreuses matrices d’animation (les templates) issues des méthodes agiles, du design thinking et d’autres « bonnes pratiques » à la mode (icebreakers17, world café, ateliers de codéveloppement, hackathons18, etc.). Cet outil a été particulièrement utilisé durant la période pandémique pour animer des réunions et des formations à distance. Mais, comme le dit l’un de nos interviewés, l’outil ne remplace pas la maîtrise des techniques d’animation sous-jacentes aux templates : « Klaxoon, c’est comme un marteau ou un tournevis. Si vous vous en servez bien, ça fait un super bricolage, si vous vous en servez mal, vous bousillez la table. » Depuis la crise sanitaire, la plateforme s’est encore enrichie pour accompagner plus globalement l’organisation du travail à distance et en mode hybride ; elle se présente de plus en plus comme une plateforme intégrée.
Les plateformes intégrées
La balkanisation des outils numériques est un enjeu clé de la gestion de la communication en entreprise. Au fur et à mesure que l’offre s’étoffe, la situation empire d’année en année : en 2021, la moitié (48 %) des salariés utilisaient trois outils numériques collaboratifs différents (Atlassian, 2021) ; en 2022, ils sont désormais 57 % à en utiliser pas moins de six (OpenText, 2022) !
Les éditeurs ont tout d’abord proposé des passerelles entre les outils dans le cadre de partenariats. Ainsi, avant de développer son propre outil de visio intégré à sa plateforme, Klaxoon proposait déjà de s’interfacer avec le système de visioconférence de Teams ou encore avec Google Meet et Zoom. La gestion des interconnexions entre outils peut cependant venir complexifier les processus de collaboration, alors que la promesse est justement de les fluidifier. Face à cet écueil, certains outils proposent d’intégrer un maximum d’applications sur une seule et même plateforme, de manière que les collaborateurs d’une même organisation puissent disposer d’un seul point d’accès aux mêmes outils. Ce concept, auparavant nommé ENT, pour environnement numérique de travail, est désormais plus souvent désigné sous le terme de digital workplace.
La plus répandue des plateformes intégrées est la suite Microsoft Office 365, à côté de concurrents comme Google Workspace. La force d’Office 365 réside bien évidemment dans le fait d’intégrer la suite bureautique classique de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) à laquelle s’ajoutent sa célèbre messagerie Outlook, l’espace de stockage OneDrive, l’espace de partage documentaire SharePoint, ainsi que d’autres applications (comme One Note pour prendre des notes ou Forms pour créer des questionnaires), et enfin l’espace de collaboration Teams qui cherche à devenir l’espace central de communication et de gestion de projets des équipes19. Au sein de cet ensemble, la visioconférence et la programmation de réunions virtuelles via les agendas partagés sont les fonctionnalités auxquelles les salariés ont le plus recours. Les autres restent assez peu utilisées. Ainsi, parmi les 9 000 collaborateurs disposant de la suite Office 365 et dont l’activité numérique a été monitorée par Mailoop (2023), 73 % ne postaient aucun message dans les groupes de discussion Teams (le nombre de messages n’étant que de 0,2 en moyenne par semaine), préférant le mail ou le tchat (représentant respectivement 145 et 90 messages envoyés par semaine). Monneuse (2014) notait déjà dans sa description des premiers RSE que la plupart de leurs fonctionnalités étaient sous-utilisées et soulignait la préférence des utilisateurs pour des « dispositifs simples, décentralisés, [même s’ils sont] incohérents ». Les digital workplaces pourraient bien connaître le même destin.
Les plateformes no code
Face à ce besoin d’adaptation et de personnalisation, une autre catégorie d’outils semble également commencer à susciter l’intérêt des entreprises : les plateformes dites no code. Ces solutions partagent avec les outils collaboratifs le fait d’encourager chez les salariés un « pouvoir d’agir », en leur ouvrant la possibilité de créer des outils logiciels sur mesure pour les besoins de leur équipe ou de leur travail, sans devoir recourir à de la programmation « en code ». Cependant, à la différence des outils collaboratifs, l’utilisation des plateformes no code est encore embryonnaire et n’a pas vocation, en pratique, à se généraliser à tous les salariés.
Le no code renvoie à une méthode de réalisation de produits logiciels (sites web, applications, chatbots, automatisation de process, etc.) ne nécessitant aucune ou très peu de connaissances en programmation informatique, grâce à un environnement de développement basé non plus sur l’écriture de lignes de code en langage expert (Java, C++, Ruby, Python, etc.) mais sur une interface visuelle simplifiée : les lignes de code sont déjà préprogrammées dans des composants (ayant chacun une fonction) qu’il suffit de glisser-déposer ( drag and drop ) ou de relier entre eux, un peu comme des briques de Lego. Les plateformes no code ont donc vocation à être prises en main par des non-développeurs – contrairement au low code qui, lui, nécessite des bases en programmation – et elles foisonnent dans tous les domaines d’application (figure 1.5).
Au-delà de la promesse centrale qui est de faire baisser les coûts et le temps de développement des produits logiciels, les plateformes no code ont l’ambition de nous rendre « tous no-codeurs », afin de démocratiser notre « pouvoir numérique » d’agir sur le monde. Milind Govekar, vice-président de Gartner, a ainsi prédit en 2021 que, d’ici à 2025, 70 % des nouvelles applications seront développées à partir d’outils low code ou no code par les usagers eux-mêmes (Gartner, 2021b). En décloisonnant la création logicielle hors des différents départements où elle est habituellement cantonnée (DSI, digital factories ou ESN), les outils no code favoriseraient ainsi une montée en compétences des collaborateurs et leur autonomisation, en même temps qu’une meilleure coopération autour des enjeux IT et une accélération de la digitalisation des entreprises.
L’enchevêtrement de fonctionnalités proposées par ces outils numériques illustre bien la complexité à saisir précisément leur spécificité. Si nous avons segmenté ici les différentes fonctionnalités dans un but pédagogique, il va de soi qu’elles ont souvent été conçues dans une perspective de complémentarité des usages. De ce fait, elles doivent être pensées de façon systémique dans les organisations pour exécuter certaines activités, ce qui présuppose de les articuler, d’établir et de stabiliser de nouvelles routines autour de nouveaux usages.
Deux spécificités des outils collaboratifs
Au-delà de ces nombreuses fonctionnalités, la dernière génération d’outils collaboratifs présente deux caractéristiques importantes qui distinguent ces derniers à la fois des outils précédents et d’autres outils informatiques à vocation professionnelle.
Coopérer plus que collaborer
Ces outils se distingueraient par la combinaison inédite de trois grandes capacit és : échanger, coordonner et produire collectivement – combinaison que ne permet pas l’e-mail, limité à l’échange d’informations, mais qui était déjà en germe dans les groupwares.
Comment distinguer coopération et collaboration ?
Le verbe « collaborer » vient du latin cum signifiant « avec » et laborare signifiant « travailler, prendre de la peine ». Il renvoie à l’origine aux « travaux communs du mari et de la femme » (Le Robert). Le verbe « coopérer » accole le même préfixe cum au verbe operare qui signifie « faire quelque chose, agir, œuvrer ». Il renvoie à la « part prise à une œuvre réalisée en commun ». L’étymologie de ces deux termes fait écho aux travaux d’Hannah Arendt (1961), qui distingue le travail selon qu’il est labeur ou œuvre20. Si les deux termes font référence à l’idée d’une production collective, la coopération renverrait à une activité dans laquelle l’« intensité relationnelle » et l’interdépendance entre les membres impliqués sont supérieures à celles qui existent dans la simple collaboration. Selon notre analyse21, l’ambition des nouveaux outils numériques serait donc plus proche du terme « coopérer », bien que ce soit le terme « collaborer » qui ait été choisi pour les désigner. Comme le soulignent Benedetto-Meyer et Boboc (2021), « il ne s’agit plus, ou plus seulement, de diffuser de l’information, de coordonner des salariés ou de rationaliser des process, mais de coproduire ».
On sent donc bien que les outils « collaboratifs » emportent avec eux une logique de dépassement de l’organisation « mécaniste » (division du travail) au profit d’une logique plus « organique » (Burns et Stalker, 1961), mais la question subsidiaire est : sont-ils à eux seuls en mesure de la concrétiser ?
Des outils non prescriptifs mais communicants
Contrairement à des logiciels de pilotage comme les ERP22 ou les MES23 qui nécessitent un séquencement précis d’actions des utilisateurs en termes d’input et d’output, les outils numériques collaboratifs se caractérisent par l’absence de prescription organisationnelle dans la manière de les utiliser (Dudézert, 2018 ; Guesmi et Rallet, 2012). Parmi les trois catégories de systèmes techniques identifiées par Bobillier-Chaumon (2003) dans leur rapport à l’activité de travail, les outils collaboratifs appartiendraient à la troisième : la catégorie des systèmes flexibles offrant « un “espace du possible” au service de l’usager ». Autrement dit, il est possible en principe pour un utilisateur de s’emparer de ces objets comme il l’entend et, grâce à leur caractère « intuitif », de découvrir pas à pas, en liberté, les fonctionnalités qui lui sont utiles. Cependant, à la différence d ’un traitement de texte ou d’un tableur, ce sont aussi des objets communicants qui nécessitent d’ être au moins deux à les utiliser pour un même usage. Ces deux caractéristiques conjointes (non-prescription et communication) induisent plusieurs conséquences en matière d’apprentissage de ces outils par les utilisateurs, de mode de déploiement et de règles d’usage, comme nous le découvrirons dans les chapitres qui suivent.
- 7. Titre de l’intervention de Suzy Canivenc et Jean de Maupeou à la Convention Apm (Association progrès du management), Nantes, 16 mars 2023.
- 8. La citation de marques et de produits dans cet ouvrage a vocation à faciliter la compréhension du lecteur. Elle n’emporte aucune valorisation ni adhésion des auteures à une marque par rapport à une autre. Ces mentions correspondent aux produits et marques les plus souvent cités par les personnes que nous avons interviewées.
- 9. Nouvelles formes d’organisation ou nouvelles formes d’organisation du travail.
- 10. Un intranet est un réseau de communication interne à une organisation, par opposition à l’Internet qui, lui, est ouvert au grand public.
- 11. Technologies de l’information et de la communication.
- 12. Lecko est un cabinet de conseil en organisation et fournisseur de solutions pour porter la transformation numérique. Il publie chaque année l’État de l’art de la transformation interne des organisations.
- 13. Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
- 14. Sachant que, selon les mots de Paul Valéry : « Le simple est toujours faux. Ce qui ne l’est pas est inutilisable » (Œuvres II, 1942, Gallimard).
- 15. Les réunions continuent bien souvent de pâtir des mêmes irritants qu’avant la pandémie : « Un ordre du jour manquant ou peu précis, un timing glissant, un plan d’action peu clair ou non défini, le sentiment de ne pas être utile à la réunion » (Mailoop, 2021).
- 16. Cette expression désigne une forme de fatigue spécifique engendrée par les visioconférences et liée à divers facteurs tels que : visages en gros plan ou absence totale de visages qui rendent nerveux, effet miroir de son propre visage produisant une autoreprésentation dérangeante, difficultés à décrypter la communication non verbale, etc.
- 17. Littéralement : qui permettent de briser la glace entre des participants à une réunion.
- 18. Événement au cours duquel des développeurs se réunissent durant plusieurs jours autour d’un projet collaboratif de programmation informatique ou de création numérique.
- 19. L’espace Teams propose à son tour plusieurs fonctionnalités : une messagerie instantanée ; un agenda partagé, permettant entre autres de programmer et de lancer des invitations aux visioconférences; un système de visioconférence qui intègre Whiteboard, le tableau blanc interactif de Microsoft ; un espace « équipes » permettant d’échanger des messages et des fichiers au sein de groupes prédéfinis; diverses applications (un planificateur de type Kanban, un système de partage de vidéos, des ressources en matière de formation, la plateforme de développement d’outils no code Power Automate, etc.) et plusieurs applications tierces mais compatibles avec la plateforme (Pipedrive, Prezi Video, Wooclap, etc.).
- 20. Arendt distingue également une troisième acception du mot «travail» comme possibilité d’«action sur le monde», qui renvoie directement aux promesses du mouvement no code à travers la figure du citizen developer.
- 21. Notons cependant que cette interprétation coexiste avec d’autres. Piquet (2009) souligne qu’«il n’y a actuellement pas, dans le domaine de la recherche scientifique, de véritable consensus sur une définition précise de la collaboration du fait de sa proximité avec d’autres notions. Il règne en effet encore une certaine confusion, ambiguïté, autour des notions de coopération et de collaboration permettant de caractériser clairement un collectif de travail. Ces termes sont ainsi parfois utilisés indistinctement. »
- 22. Enterprise Resource Planning ou progiciels de gestion intégrés (PGI) qui permettent d’activer des flux de données entre de multiples processus métier, pour produire in fine des états financiers relatifs à la performance de l’entreprise.
- 23. Manufacturing Execution System : logiciel de pilotage de la production dont le rôle est d’assurer la gestion et le suivi de la production en cours dans un atelier, en fournissant une traçabilité complète des informations de fabrication (machines et opérateurs).
Pratiques et effets organisationnels des outils collaboratifs
L’usage des outils ne se confond pas avec leur utilisation. Si l’utilisation peut être mesurée sur la base d’indicateurs quantitatifs (taux, fréquence et durée d’utilisation, par exemple), l’analyse des usages nécessite d’adopter une approche qualitative24 pour comprendre les « manières de faire » (Benedetto-Meyer et Boboc, 2021) et leurs incidences sur le travail réel. Certains chercheurs préfèrent même le terme de « pratiques » à celui d’« usages » pour englober dans leurs analyses les comportements et les représentations que les individus développent face aux objets techniques (Jouët, 1993 ; Boutet et Trémenbert, 2009 ; Felio, 2016a). Ce sont ces pratiques, bien plus que la nature intrinsèque des outils, qui déterminent leurs effets réels sur l’organisation du travail.
Des effets bénéfiques quand les usages sont maîtrisés et innovants
Parmi les effets bénéfiques des nouveaux outils collaboratifs les plus souvent cités par les utilisateurs lors de notre enquête, on trouve : une communication mieux ciblée, le sentiment de renforcement de l’autonomie verticale et horizontale, ainsi que des gains d’efficience et de confort mental quand certaines conditions sont réunies. Toutefois, on soulignera que ce ne sont pas les outils en tant que tels qui déterminent ces effets bénéfiques, mais les bonnes pratiques et les usages innovants qui en sont faits. Les outils numériques n’ont intrinsèquement aucun pouvoir magique pour faire advenir des changements organisationnels, tout au plus peuvent-ils ouvrir des possibilités de changement.
Communication interne mieux ciblée et priorisation des messages
Comme indiqué au chapitre précédent, les outils collaboratifs comme Teams ou Slack permettent d’envoyer des messages à une communauté prédéterminée concernée par un certain type de message. « La fonctionnalité la plus déterminante, c’est de pouvoir regrouper un certain nombre d’informations (à la fois d’un fil de discussion et des documents associés) sur un même espace qui concerne les mêmes personnes et qui permet à chacun de contribuer avec son propre apport sur le sujet », explique un directeur de business unit (BU). Pour que cela fonctionne, l’une des premières bonnes pratiques à suivre consiste à structurer l’outil en autant d’« équipes », puis de « canaux », que de fils de discussion, afin de toucher les personnes directement concernées par l’information.
Le témoignage d’un jeune alternant permet cependant de comprendre que l’on peut se saisir du même outil de manière bien différente : « Slack, je l’utilisais déjà avant dans l’association où je travaillais, mais je l ’utilisais différemment. Ça servait le même but, c’est-à-dire la communication interne, mais il y avait beaucoup plus de messages individuels, ce n’ était pas catégorisé selon les activités de chacun. La façon dont c ’est organisé ici paraît beaucoup plus pertinente. On a le système des différents channels qui permettent à chaque fois de toucher les bonnes personnes. Donc, si on n’a pas envie de voir des informations parce qu’on n’est pas concerné, on n’est pas obligé de les voir, et ça évite de recevoir trop de messages. On évite aussi de s’adresser directement à la personne en message privé et on utilise principalement les chaînes de discussion qui sont relatives au travail de cette personne-là. » Ainsi, dans cette organisation, les usages de Slack ont été subordonnés à des principes d’utilisation pour que chacun apprenne à définir ses canaux prioritaires et à se désabonner de ceux qui lui sont moins utiles. Autrement dit, pour que ça fonctionne, il faut comprendre l’esprit sous-jacent à l’outil et installer les usages qui lui correspondent et qui sont adaptés aux besoins opérationnels.
Renforcement de l’autonomie verticale et horizontale grâce à la transparence informationnelle
De l’avis unanime de nos témoins, les nouvelles plateformes de communication fluidifient les relations horizontales comme verticales, tout en démocratisant l’accès à l’information (qu’elle soit opérationnelle ou d’ordre plus stratégique).
Verticalement, l’outil permet d’aplanir la distance hiérarchique et de favoriser le partage d’informations : « On est beaucoup plus proches de notre management dans le sens où on peut les contacter beaucoup plus facilement, il n’y a plus cette barrière du mail officiel. Le directeur de notre communauté poste régulièrement les chiffres de la communauté, il y a beaucoup plus d’ échanges et moi je trouve ça top. »
L’outil favorise également le partage d’informations qui étaient auparavant réservées à la hiérarchie. Ainsi, au sein d’un même département « métier » d’un des cabinets conseil étudiés, des tableaux sont désormais disponibles pour tous les collaborateurs, indiquant les zones de compétence de chacun, leur niveau de spécialisation dans chaque domaine d’expertise, ainsi que la ventilation des clients passés pour lesquels chaque collaborateur a travaillé. « L’information existait avant, mais seuls les directeurs l’ avaient », précise une cheffe de projet. Cette information augmente la capacité des consultants à s’organiser par ajustements mutuels en fonction de leurs compétences et connaissances des clients.
Cette capacité accrue d’auto-organisation des équipes ébranle cependant le rôle et la posture du manager, ce qui peut être mal vécu. Ainsi que le souligne un de nos témoins, « ça change complètement la position managériale, c ’est clair. Le management n’est plus là pour apporter des solutions à ses équipes. Il y a tout un écosystème qui permet à chacun d’avancer. » Les outils collaboratifs véhiculent clairement, sans pour autant la déterminer, une logique d’aplatissement de la structure et d’autonomisation des collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes.
Horizontalement, la communication entre pairs et la connaissance du « qui fait quoi » sont renforcées, ce qui dynamise les relations et l’entraide interpersonnelles : « Il y a des collaborateurs avec lesquels je ne parlais jamais, et grâce à Teams, maintenant, je leur parle, je sais quelles sont leurs zones de compétence, sur quoi ils travaillent, c’est beaucoup plus facile de leur parler, de leur demander quelque chose […]. Ça intensifie encore l ’entraide, le partage. On connaît mieux les chantiers de chacun. Ça noue des liens, je pense, pas forcément plus forts mais a minima mieux renseignés. »
Dans les trois organisations observées ayant implanté Teams ou Slack, un canal de type « appel à un ami » ou « I need you » permet de poser des questions à l’ensemble d’une équipe pour obtenir rapidement une réponse. Non seulement les personnes obtiennent généralement une réponse en moins de 10 minutes, mais cela évite en outre d’avoir à reposer une même question plusieurs fois, puisque les réponses déjà données sur un sujet peuvent être facilement retrouvées grâce à une fonctionnalité de recherche. L’accès à l’information utile est donc distribué. De même, un canal « outils » est dédié aux questions portant sur le fonctionnement des outils numériques. Les réponses données par les pairs sont souvent plus pédagogiques, moins techniques, plus adaptées aux besoins opérationnels et souvent beaucoup plus rapides que ne le seraient celles d’un technicien informatique.
Globalement, cette égalité d’accès à l’information réduit la redondance des demandes utilitaires et permet de concentrer les communications interpersonnelles sur des sujets à plus forte valeur ajoutée.
Les plateformes de stockage et de partage de l’information permettent à chacun d’accéder à la mémoire organisationnelle et d’être ainsi beaucoup plus autonome dans sa recherche d’information sans être dépendant de ses collègues, ce qui facilite le travail à distance. Les possibilités de capitalisation des connaissances, à la fois pour les individus et pour l’organisation, sont d’ailleurs citées comme un grand atout de ces outils. Encore faut-il que cette capitalisation des connaissances fasse l’objet d’un process bien défini, sans quoi l’existence de l’outil ne détermine rien.
L’élargissement25 et l’enrichissement26 des tâches sont également mentionnés comme étant des vertus liées à l’usage des plateformes no code. Ces dernières sont susceptibles de bousculer les frontières entre les métiers, en stimulant à la fois une plus grande autonomie individuelle et une meilleure coopération (voir encadré ci-contre). Ces bénéfices potentiels ont ainsi poussé une très grande organisation à former largement ses salariés au no code pour augmenter leur autonomie en matière de production logicielle (et de ce fait, leur productivité) et accélérer la digitalisation de toute l’entreprise. Le but poursuivi est que les collaborateurs puissent eux-mêmes créer des petits outils logiciels afin d’automatiser les tâches les plus fastidieuses au sein de leurs équipes. Dans cette entreprise, le sujet du no code est envisagé sous un angle RH (développement des compétences), en partenariat avec la Tech Factory de l’organisation (digitalisation des pratiques).
No code : hybridation et coopération des métiers
Au sein de l’une des entreprises de conseil numérique que nous avons étudiées, l’usage des outils no code a provoqué une hybridation de métiers qui étaient séparés par des cloisons étanches27.
Auparavant, pour réaliser des sites web, la division horizontale du travail prédominait : « Hier, le designer créait une maquette, puis la passait à une autre personne en charge de la transformer en produit numérique, qui la modifiait sans toujours expliquer pourquoi. C’étaient des étapes assez étanches, et finalement ça amenait tout un tas de problèmes. » Désormais, les métiers non techniques intègrent aussi un aspect technique : « Maintenant, le designer crée la maquette et puis il va plus loin et il crée aussi tout le site Internet. Il n’a même plus forcément besoin des développeurs sauf pour des fonctionnalités vraiment complexes. » Au passage, les tâches de chacun sont enrichies : « Avec le no code, je peux me positionner dans des secteurs créatifs avec un peu une étiquette de technicien », explique un designer ; et de son côté, le développeur peut se concentrer sur des projets plus complexes et enrichissants : « Je constate que je ne traite plus aucun sujet répétitif. Je ne me concentre plus que sur la valeur ajoutée qui n’est pas accessible en no code. »
Cependant, certains salariés ayant désormais la capacité de prendre en charge l’ensemble d’un processus de production logicielle, depuis sa conception jusqu’à son exécution, on pourrait imaginer que l’entreprise s’expose alors au risque d’une individualisation des activités de travail et d’une indépendance de chaque salarié au détriment de la fameuse collaboration tant recherchée. Pour autant, dans cette entreprise, ce risque semble compensé par la capacité des outils no code de faciliter la compréhension et le dialogue intermétiers au profit d’une meilleure ambiance et d’un travail de plus grande qualité. Les projets réalisés en no code aident, en effet, chacun à mieux comprendre les préoccupations et les soucis de ceux avec qui il collabore. Côté développeurs, « le design arrive à comprendre pourquoi le développeur parle de la maintenance de demain. Alors qu’avant il n’en avait pas conscience. Donc, ça augmente le dénominateur commun entre les différents métiers. » Côté design, « la casquette de “bébé développeur” nous rend meilleurs quand les projets sont gros et qu’on a des rôles vraiment distincts : on comprend mieux pourquoi les “devs” nous demandent de faire des choses, ce n’est plus quelque chose d’abstrait. »
Gains d’efficience et de confort mental à certaines conditions
Des gains d’efficience et de confort mental sont attestés quand les usages de certaines fonctionnalités des outils collaboratifs sont maîtrisés et partagés.
Compte tenu de la charge de travail que représente la production documentaire chez les consultants (réponses aux appels d’offres, livrables de mission, restitutions), les outils d’édition collaborative en ligne sont plébiscités par les acteurs interrogés dans les organisations visitées. Cette production collective permet de réduire considérablement les temps de réunion consacrés à cette activité, de même que le nombre d’échanges de pièces jointes par e-mail pour la mise au point et la finalisation des documents. Une fois la notion d’enregistrement des versions bien maîtrisée, les risques d’erreur ou de contradiction entre documents via les échanges d’e-mails avec pièces jointes s’en trouvent également diminués. Le gain opérationnel de temps est jugé assez spectaculaire avec une division au moins par deux, voire par trois, du temps de production.
Pour tout ce qui concerne les réunions d’idéation ou de créativité (ateliers de brainstorming ou de design thinking ), les outils numériques à base de tableau blanc et de post-it facilitent grandement le post-traitement des réunions, qui consiste à saisir et à classer des centaines de post-it. L’outil garde en mémoire les idées exprimées, et le paramétrage des post-it par catégories ou par couleurs permet de les classer beaucoup plus aisément que dans le format manuel « physique », produisant ainsi un gain de temps considérable.
L’une des grandes vertus des nouveaux outils collaboratifs est également d’ouvrir la possibilité de renforcer les pratiques de travail asynchrones qui sont ressenties par les salariés comme favorables à la concentration profonde, au sentiment d’autonomie dans le travail et au respect du temps de chacun (Canivenc et Cahier, 2021b). « Les outils collaboratifs permettent de compléter une activité synchrone avec de l ’asynchrone », déclare ainsi un dirigeant de business unit . Cette combinaison vaut, comme nous venons de le voir, pour des activités de production documentaire, mais aussi pour d’autres usages innovants, par exemple avec l’outil Klaxoon. Généralement utilisé pour dynamiser l’animation de réunions de créativité synchrones, cet outil est apparu comme pouvant aussi offrir des possibilités intéressantes en asynchrone. En effet, la persistance numérique de l’environnement de travail (le tableau blanc avec ses post-it) permet de poursuivre le travail en mode asynchrone après la fin de la réunion synchrone, soit que des personnes aient été absentes, soit que les présents veuillent continuer à réfléchir et à ajouter de nouvelles idées : « On voit de plus en plus de personnes qui continuent à travailler sur le board ou qui réorganisent des réunions après l’atelier pour finaliser des choses qu’ils n’avaient pas eu le temps de finir. Et du coup, la “réunion” peut continuer même après la réunion. C’est une richesse qui n’existait pas avant. »
Toutefois, pour que les bénéfices de l’asynchrone puissent se déployer, il est nécessaire d’avoir une culture organisationnelle propice à ces pratiques, qui accepte les horaires flexibles et les temps décalés. Les pratiques asynchrones dépendent moins des seuls outils que d’une culture organisationnelle d’ensemble et de nouvelles routines (voir chapitre 5). Comme l’explique une salariée au sein d’une association en gouvernance partagée : « L’outil ne fait pas tout. C’est vraiment la manière dont on définit collectivement l’usage de l’outil qui compte. »
Or, les changements de culture, la définition collective d’usages innovants et l’implantation des nouvelles routines nécessitent du temps. En leur absence, c’est plutôt une somme de « méfaits » organisationnels que les outils collaboratifs engendrent.
Des effets organisationnels pervers
Les usages spontanés qui suivent la mise en place des outils suscitent généralement une forme de désorganisation du travail. Comme pour les effets bénéfiques, ce ne sont pas les outils en eux-mêmes qui engendrent ces effets pervers, mais leur interaction avec les choix (ou plutôt les non-choix) organisationnels. La mise en place de ces outils souffre, en effet, trop souvent (et les salariés avec) de n’être pas pensée en lien avec la culture organisationnelle et les processus de travail des équipes. Comme le souligne un consultant, « généralement, on met d’abord en place les outils, puis on demande aux personnes de s’en saisir, et seulement après, on réfléchit à la culture. Ce n’est clairement pas la bonne façon de faire. » Il rejoint ainsi le diagnostic posé par le dirigeant d’une grande entreprise mutualiste : « On refait les mêmes erreurs qu’avec l’informatique dans les années 60-70, c’est-à-dire qu’on parle d’outils au lieu de parler d’organisation [du travail] » (Deshayes, 2019).
Un exemple emblématique : les usages dévoyés de l’e-mail
Le courrier électronique illustre parfaitement les effets pervers engendrés par les usages dévoyés d’un outil numérique. Selon l’enquête menée par Ipsos pour Lecko (2023), 64 % des sondés le positionnaient encore en 2022 à la première place des outils de communication professionnelle utilisés (voir chapitre 1, figure 1.3). Dès son entrée dans la sphère professionnelle, l’e-mail a été conçu avec une grande latitude d’usage – ce qui explique son succès. Grosjean et Morand (2021) voient dans la messagerie électronique « le modèle emblématique » des systèmes techniques dits flexibles (voir chapitre 1), mais signalent rapidement le dévoiement dont cette flexibilité a fait l’objet.
L’usage des e-mails semble en effet être devenu complètement incontrôlable : « 293 milliards de mails échangés par jour en 2019 (hors spams) et 36 consultations chaque heure de la boîte de réception de cadres dès 2016. Des publications plus récentes évoquent le chiffre de 10 mails reçus par heure pour un salarié non cadre du tertiaire » (Grosjean et Morand, 2021). Ce volume se traduit par un temps colossal passé à les traiter. Il révèle aussi à quel point les tâches de coordination et de communication sont devenues prédominantes dans notre économie tertiarisée, expliquant l’engouement dont font l’objet les outils collaboratifs.
Cet usage frénétique de l’e-mail est considéré comme générant d’importants risques psychosociaux. 70 % des cadres indiquaient répondre sans distinction à tous les mails professionnels reçus, une activité qui se poursuit hors de l’entreprise sur leur temps personnel de façon quasi permanente, voire permanente pour 33 % (Soubiale, 2016b). Cette surcharge informationnelle et cognitive entraîne un sentiment de « densification du travail » ( Ibid. ) qui conduit les salariés, et plus particulièrement les cadres, à la surchauffe.
Ces effets ne sont pas dus à l’outil lui-même, mais à l’usage qui en est fait. Alors que l’e-mail est typiquement un outil de communication asynchrone, il est souvent dévoyé en « dispositif synchrone » (Boudokhane-Lima et Felio, 2015). Une étude menée par des chercheurs de Yahoo Labs et de l’Information Sciences Institute (Kooti et al. , 2015), portant sur plus de 16 milliards de mails dans le cadre d’échanges commerciaux (et non personnels), a ainsi montré que le temps de réponse médian était de 47 minutes et le temps de réponse le plus fréquent de 2 minutes. Les mesures plus récentes enregistrées par la société Mailoop (2023) auprès d’un panel plus restreint de 9 000 collaborateurs indiquent un temps de réponse inférieur à une heure pour 51,4 % des e-mails reçus (et inférieur à 5 minutes pour 17,4 %). Cette « dictature de la réponse immédiate » (Grosjean et Morand, 2021) se serait encore amplifiée avec la démocratisation des smartphones et des notifications. 70 % des collaborateurs du panel de Mailoop (2023) interrompent en effet leurs tâches en cours quand surgit une notification. La non-qualité du travail réalisé et/ou la décompensation (qui peut prendre une forme proche du burn-out) (Jauréguiberry, 2014) sont deux conséquences possibles de cette situation. Une célèbre étude (Mark et al. , 2008) avait déjà montré que les employés tentaient de compenser le temps perdu par ces interruptions en essayant de travailler plus vite, ce qui entraîne un stress accru, un sentiment de frustration, de perte de temps, et d’efforts. Les e-mails nous montrent ainsi la distorsion qui peut s’opérer entre les promesses d’un outil (flexibilité asynchrone) et les usages qui en sont faits (contrainte synchrone). Les dérives occasionnées par les mails sont l’un des grands arguments des éditeurs pour inciter à basculer vers de nouvelles solutions collaboratives.
Le phénomène du millefeuille
Depuis l’introduction des nouveaux outils collaboratifs, l’un des constats majeurs sur lequel l’ensemble des avis concorde est celui du développement d’un « phénomène de millefeuille ». Le plus souvent, les nouveaux outils ne se substituent pas aux précédents (même quand ils le pourraient), ils se surajoutent. « Avant, j’avais les mails, c’était simple, j’allais éventuellement de temps en temps sur Skype pour demander si la personne était libre pour un appel. Tandis que maintenant il y a des discussions sur SMS, sur WhatsApp, sur Teams, par mail, éventuellement des contenus sur le réseau social d’entreprise… C’est très difficile de gérer le flux d’informations, on peut louper des informations parce qu ’on ne regarde pas le bon canal. Donc on perd tous du temps », témoigne un manager, pourtant spécialisé dans l’accompagnement des outils numériques.
Les recherches ont montré depuis longtemps que les réunions n’étaient pas remplacées par les mails (Kalika et al., 2007), qui eux-mêmes n’étaient pas remplacés par les réseaux sociaux d’entreprise (Boukef et Charki, 2019), qui eux-mêmes ne sont pas remplacés par les plateformes collaboratives actuelles. Une étude américaine a montré que le cerveau humain se tourne naturellement vers l’ajout de nouveaux éléments pour résoudre un problème, même lorsqu’il serait plus logique d’en retrancher (Adams et al. , 2021). Les auteurs avancent deux hypothèses explicatives : d’une part, soustraire demanderait plus d’efforts cognitifs qu’additionner ; d’autre part, notre inconscient associe la soustraction à la perte. La conjonction de ces deux éléments nous conduit à voir dans le plus un mieux, même quand l’accumulation nous complique la vie. Cet effet avait déjà été théorisé dans les années 1970 par Ivan Illich avec la notion de contre-productivité : un outil (objet ou institution) tend à croître jusqu’à dépasser un seuil où il devient dysfonctionnel et nuit au but qu’il était censé servir.
L’effet millefeuille est particulièrement bien illustré par le fait que les messages via les nouveaux outils (Teams, Slack) s’ajoutent le plus souvent aux mails, au lieu de les remplacer. Lecko (2022) a ainsi mesuré l’accroissement vertigineux des mails dans une grande entreprise « et ce, malgré le déploiement de Teams » (voir figure 2.1). Les messages peuvent en effet à la fois être poussés par mail et sur le nouvel outil, par crainte qu’ils ne soient pas vus par les personnes idoines, du fait de la dispersion des canaux. Au phénomène de zapping entre les outils s’ajoute aussi un « effet domino » (Boukef et Charki, 2019), quand l’usage d’un nouvel outil numérique entraîne de nouvelles notifications, multipliant ainsi leur nombre au lieu de le réduire.
Si certains de nos interviewés ont quand même le sentiment d’une baisse du nombre d’e-mails reçus (sans pour autant l’avoir précisément mesurée), il n’y a pas en soi de baisse du nombre de messages reçus ou envoyés (et des notifications associées) : ces derniers sont, dans le meilleur des cas, simplement transférés d’une solution (les mails) à une autre (Slack, Teams, etc.).
L’impact environnemental du millefeuille
Cet effet millefeuille vient aussi renforcer l’impact environnemental du numérique. Les nouvelles plateformes d’échanges, de même que les espaces de stockage-partage, ont souvent été promus comme réduisant la consommation énergétique du numérique engendrée par les allers-retours de mails avec de multiples pièces jointes28. Ce bénéfice est en réalité largement contrebalancé par l’usage des drives pour synchroniser les disques durs de chaque collaborateur en vue de les sauvegarder, ce qui apparaît comme « une aberration environnementale » (Lecko, 2023). Les documents nécessitant réellement d’être stockés et accessibles facilement depuis n’importe où sont en fait minoritaires ; la consommation énergétique découlant de cette facilité (disponibilité et sécurité associée) apparaît comme disproportionnée par rapport à l’utilité de cet usage.
La multiplication des outils s’accompagne en outre d’une intensification de leurs usages qui produit un effet rebond sur les émissions de CO2. Lecko (2023) a étudié les émissions d’un panel de 20 000 utilisateurs de Microsoft 365 sur deux années (2021 et 2022) : le cabinet constate que la moyenne des émissions journalières du panel a augmenté de 62 % en deux ans. Quant aux plateformes no code, elles peuvent participer à l’augmentation du millefeuille et de son impact environnemental en raison de la facilité qu’elles offrent de créer toutes sortes d’applications : « Si tout le monde peut créer des outils numériques, il va y avoir une multiplication d’outils et, du coup, un impact environnemental qui va être de plus en plus important », indique un consultant chef de projet dans le numérique.
Chaos informationnel
Le millefeuille numérique peut aussi conduire à déstructurer les flux d’information au lieu de les fluidifier : les personnes ne savent plus où elles doivent ranger ni où aller chercher l’information, ni si cette information est effectivement la plus à jour. En témoigne une ingénieure dans un grand groupe qui a basculé sur Microsoft 365 mais où existaient auparavant d’autres outils historiques : « Pour le partage de données, on a à la fois SharePoint, mais aussi notre réseau social d’entreprise et maintenant Teams. ça fait beaucoup de stockage de données : vous avez des documents stockés dans plusieurs endroits, ce qui crée des tensions. »
Ce chaos informationnel peut aussi se retrouver au sein de chaque outil, quand les canaux de Teams et de Slack, par exemple, ne sont pas structurés, ni les routines installées, ainsi qu’en témoigne le directeur d’une BU : « Chacun crée des équipes comme il veut, et ça fait qu’on a une liste longue comme le bras d’équipes avec des notifications », produisant « une surabondance de collaboratif ».
De même, les plateformes de stockage (les drives) ont besoin d’une arborescence de classification. Les logiques de classement, souvent décidées par un individu qui centralise ou par un groupe de travail ad hoc, sont loin d’être évidentes pour tous les collaborateurs qui n’ont pas participé à cette construction. Les erreurs de classement sont donc fréquentes. Au fil du temps, ces arborescences deviennent de moins en moins lisibles : d’une part, elles peuvent ne plus correspondre à l’organisation du travail (changement d’organigramme ou du « qui fait quoi ») ; d’autre part, les pratiques de classement se détériorent, chacun faisant un peu à sa manière. Arrive un moment où il devient nécessaire de tout remettre à plat : « On a profité du Covid pour faire un groupe-projet “knowledge management” qui a travaillé sur notre usage de Google Drive, parce que c’était un bordel sans nom, et de Slack, parce que ça devenait incompréhensible », explique un dirigeant. Dans la pratique toutefois, ce travail de structuration est perçu comme long et fastidieux, et souvent repoussé à plus tard ou non pris en charge.
Augmentation de la fréquence des réunions virtuelles
Les nouveaux outils de visioconférence augmentent la fréquence des réunions virtuelles, même si celles-ci sont devenues plus courtes que ne l’étaient les réunions physiques. Pendant la pandémie, une étude portant sur les métadonnées de plus de 3 millions de salariés dans des aires métropolitaines en Amérique du Nord, en Europe (dont Paris) et au Moyen-Orient (DeFilippis et al., 2020), a montré qu’entre la période prépandémique et la fin du premier confinement le nombre de réunions par personne et le nombre de participants par réunion avaient augmenté, et que la durée moyenne des réunions avait en revanche diminué. Toutefois, l’effet de fréquence a produit chez les salariés un sentiment de densification et de fragmentation du travail.
En octobre 2021, près de la moitié des cadres interrogés par l’Ifop (Speechi, 2021) déclarent ainsi assister à 5 réunions et plus par semaine, soit un doublement net comparé à la même enquête menée en 2015. Dans le détail, ce sont les cadres appartenant à des entreprises de grande taille (plus de 500 salariés) qui participent au plus grand nombre de réunions par semaine (6,3 en moyenne), quand les cadres travaillant pour de plus petites entités (moins de 50 salariés) n’en ont que 2,7, du fait d’une moindre dispersion. le ressenti d’inefficacité des réunions par les salariés reste élevé : 58 % d’entre eux pensent que la moitié des réunions pourraient être raccourcies ou évitées et 22 % que cela concerne 8 réunions sur 10.
Or, es outils collaboratifs facilitent la convocation de réunions grâce aux agendas partagés et à la possibilité d’« appeler » son ou ses interlocuteurs en visio, avec un effet rebond sur le nombre de réunions. De fait, même pour des échanges en one-to-one, la convocation à une visio devient plus fréquente. Comme le raconte une de nos interviewées dont l’entreprise a installé Teams, « ce genre d’ outils vous oblige à être en visio tout le temps. Je suis environnée de gens qui ne vous appellent plus par téléphone, ils vous appellent en visio, alors que la visio n’a aucun intérêt si on ne doit pas partager des documents. »
Charge mentale et épuisement cognitif
Les nouveaux dispositifs numériques semblent tomber rapidement dans les mêmes travers que ceux que l’on impute aux mails, et même ils les amplifient en s’y surajoutant : surcharge informationnelle, fragmentation de l’activité, perte de temps et d’information, surconnexion. Autant de facteurs qui accroissent la charge mentale des salariés et leur épuisement cognitif. « C’est ça le risque de Slack : développer une charge mentale énorme. Se dire “en fait il faut que je lise tout” », témoigne une salariée. « On a envie de savoir tout ce qui se passe, ce qui augmente le risque de FOMO29 et peut générer d’importantes pertes de temps. On peut clairement passer la moitié de la journée à explorer, à regarder les channels, à commenter par-ci par-là avec deux effets négatifs : 1) l’effet de dispersion parce qu’on va regarder à droite et à gauche au lieu de se concentrer sur ce qui est important, 2) le fait d’être submergé d’informations : il y a beaucoup trop de trucs et, du coup, on est complètement perdu », indique le leader d’une association étudiée. Ce phénomène a été renforcé du fait de la crise sanitaire, les personnes compensant le manque de communication verbale par un flot de conversations dans les nouveaux canaux.
L’ensemble de ces constats de terrain recoupent les résultats de sondages et d’enquêtes récents, pointant le fait que les salariés témoignent d’un mal-être croissant face à cette digitalisation chaotique, à l’origine de technostress et d’infobésité. 40 % se disent stressés par la mauvaise gestion de l’information dans leur entreprise ; 47 % passent une heure ou plus par jour à rechercher des informations en interne (10 % y consacrent même plus de 3 heures) (OpenText, 2022).
Ces méfaits peuvent par ailleurs être aggravés par les effets du numérique sur les hormones du plaisir30 : « Je fais partie des gens qui sont plutôt excités quand il y a de nouveaux mails qui arrivent, de nouvelles choses, ça me maintient sous tension, mais à la fin de la journée, je suis fatigué », confie un directeur de département dans l’un des cabinets conseil étudiés.
No code et surcharge
Les outils no code peuvent eux aussi accroître la charge mentale comme la charge de travail des salariés. Leur facilité d’usage apparente fait courir le risque de surévaluer les capacités des plateformes no code mais aussi celles des no-codeurs, dont l’entreprise peut être tentée de réduire les moyens alloués : « Comme il y a beaucoup de bidouille, ça peut donner l’impression qu’on peut tout faire avec rien en deux secondes. Typiquement, pour le site Internet [de l’entreprise], l’équipe qui a fait la version actuelle disposait d’une sprint-room, donc une salle dédiée avec six personnes qui ont bossé pendant quasiment deux mois à temps plein dessus. Là, pour le nouveau site, sous prétexte de no code, nous sommes un noyau dur de deux personnes qui avons en plus plein d’autres projets en parallèle. »
La pseudo-facilité d’utilisation des outils no code ne doit ainsi pas faire oublier que tout développement logiciel, qu’il soit réalisé avec du code ou non, nécessite un minimum de gestion de projet. À défaut, il faut s’attendre à d’importants coûts de non-qualité auxquels pourrait s’ajouter une montée des risques psychosociaux, eux-mêmes porteurs de nouveaux coûts cachés.
L’effet panoptique de l ’hypertransparence
Comme nous l’avons vu plus haut, les outils collaboratifs portent en eux l’idée de transparence informationnelle. Toutefois, ici encore, ils ne la déterminent pas, ils la favorisent seulement. Il reste tout à fait possible de continuer à verrouiller des pans entiers d’information via des systèmes d’autorisation si on le souhaite. En revanche, lorsque les possibilités de ces outils entrent en résonance avec une philosophie organisationnelle très horizontale et démocratique, on peut alors aboutir à une situation d’hypertransparence, parfois perçue comme inconfortable.
Dans l’association fonctionnant en gouvernance partagée que nous avons étudiée, cette logique a été poussée très loin, puisque toute l’information est disponible, ouverte et accessible à tous les collaborateurs via les outils numériques mis à leur disposition. L’outil Slack y remplace les mails internes qui sont proscrits (ils restent autorisés vers l’extérieur de l’organisation) et tous les canaux de Slack sont ouverts à l’ensemble des salariés. Le principe promu par l’organisation est de décourager les messages privés via cet outil (avec une certaine tolérance), l’idée organisationnelle sous-jacente étant que n’importe qui peut être intéressé par n’importe quelle information relative à la vie de l’entreprise. Le choc de pratiques peut être ressenti comme violent quand on arrive de l’extérieur : « Quand je suis arrivée, on m’a dit : pas de mails en interne. J’étais très embarrassée, j ’avais l’impression de devoir m’afficher sur la place publique et je ne savais pas où mettre le curseur entre ce qui relève de la conversation privée et ce qui relève du domaine public », raconte une salariée de cette association. De même, le drive est totalement ouvert et partagé : ici encore, le principe promu par l’organisation est de ne conserver aucun document professionnel sur son ordinateur. La même salariée témoigne de ce qu’elle a ressenti à son arrivée : « Ce sentiment un peu bizarre que mes brouillons, mes notes, mes projets de mails, qui ne concernent que moi, vont se retrouver dans l’espace public . » Les membres de l’association veillent à la bonne application de ces principes, en les rappelant de façon respectueuse aux « mauvais élèves » pour éviter que des dérives ne s’installent.
On retrouve ici l’une des caractéristiques importantes des organisations horizontales dans lesquelles le contrôle est transféré de la hiérarchie au groupe (Weil et Dubey, 2020). Ce « contrôle social » finit par produire une autorégulation des comportements, mais il peut aussi être vécu comme pesant ou conduire à des conflits si les rappels à l’ordre ne sont pas faits avec bienveillance. Cette hypervisibilité renvoie directement au système panoptique de Foucault et à la société de contrôle de Deleuze, engendrant une forme d’autocontrôle doublé d’un contrôle par les pairs, généralement considérés comme totalitaires et aliénants.
Dans cette association, cependant, l’hypertransparence est perçue comme légitime du fait de l’aspiration de tous les membres à un mode de fonctionnement horizontal et en gouvernance partagée ; les nouvelles recrues s’y habituent rapidement et en viennent à l’apprécier, comme les autres membres : « On découvre ainsi des choses qui se passent dans l’entreprise qu ’on ne soupçonnait pas et cela favorise vraiment les liens directs, ça ouvre des opportunités de créativité. C’est bien pour l’efficience, c’est bien pour l’autonomie.»
Renforcement des silos
Enfin, à rebours des effets escomptés en matière de décloisonnement de l ’entreprise, les outils collaboratifs peuvent entraîner un effet de repli des équipes sur elles-mêmes par un effet d’ autocentrage. Si chaque équipe se met à construire ses propres modes de fonctionnement en matière de communication numérique, ils peuvent se retrouver en décalage avec ceux des autres entités. Sauf à considérer que la collaboration s’arrête à la frontière de chaque équipe, il paraît nécessaire d’instaurer a minima quelques principes de fonctionnement communs ; le risque étant sinon de renforcer les silos, de réduire le sentiment d’appartenance collective et d’inciter au repli sur sa communauté. Ainsi, dans ce cabinet conseil de 200 personnes, divisé en quatre entités métiers, chaque équipe utilise Microsoft 365 à sa manière. Une phrase récurrente entendue est : « ça se passe comme ça dans ma communauté, chez les autres, je ne sais pas. »
Dans les grands groupes, il peut aussi arriver que les logiciels ne soient pas exactement les mêmes ou qu’ils ne soient pas encore parfaitement harmonisés. Comme le souligne une de nos témoins dans un grand groupe mondialisé : « On travaille aussi avec des pays qui n’ont pas encore eu accès à Teams. Je travaille actuellement à l’international avec des gens qui n’ont pas accès à la partie collaborative. »
La question des espaces de communication « enclos » se pose aussi vis-à-vis de l’extérieur, à l’égard des clients, des partenaires ou des free-lances. En effet, pour des raisons de sécurité des données et de risques de cyberattaques, de nombreuses DSI ont imposé des règles impliquant d’exclure tous les externes de l’accès aux plateformes collaboratives, même si les outils en eux-mêmes permettraient de les inclure (via des systèmes d’ autorisation). La collaboration s’arrête ainsi aux frontières juridiques de l’entreprise : il peut, par exemple, être impossible à un externe de participer à la coédition d’un document partagé. Ce qui fait dire à une consultante experte de la digitalisation : « À mon avis, le next step , c’est une organisation en réseau, pas seulement au niveau de l’entreprise, mais au niveau des entreprises. » Un autre expert s’interroge sur la manière d’utiliser les outils collaboratifs pour créer demain des services dans l’intérêt des clients : « Je vois la possibilité de mettre un jour Teams au service de la relation client, en incluant le client dans des micro-communautés avec toutes les fonctions nécessaires à la résolution de son problème. » En attendant, pour communiquer vers l’extérieur, il reste… l’e-mail.
Des effets organisationnels ambivalents
Notre enquête montre donc que les outils collaboratifs produisent des effets ambivalents sur l’ organisation du travail, à l’échelon à la fois individuel et collectif, et que ces effets sont essentiellement conditionnés par les usages qui en sont faits (voir figure 2.3).
Ces effets ambivalents du numérique sur le travail ont été soulignés depuis longtemps par la littérature académique consacrée aux TIC31, « entre autonomie et contrôle, nouveaux collectifs et isolement, injonction à collaborer et responsabilisation individuelle […], procéduralisation et agilité organisationnelle » (Benedetto-Meyer et Boboc, 2021). Beaucoup de nos propres constats rejoignent ces analyses.
Les effets ambivalents des outils numériques s’opposent souvent point par point. Ainsi, le fait que l’information soit accessible aide à travailler en autonomie, mais peut entraîner de fortes contraintes et de la perturbation lorsqu’elle devient pléthorique. La possibilité de partager et de capitaliser les informations et les connaissances est puissante, mais elle est également à l’origine d’une infobésité difficile à gérer. Les outils numériques collaboratifs offrent une plus grande autonomie à chacun dans la gestion de son temps de travail et la réalisation de ses tâches, qui peut être contrecarrée par une culture de l’urgence, de la réactivité et de l’immédiateté. L’intensification des échanges intra-équipes peut être perçue autant positivement avec le développement de l’entraide que négativement avec les contraintes de la synchronisation, et peut aussi conduire à un autocentrage de l’équipe et au renforcement des silos entre équipes. Enfin, la plus grande transparence de l’information suscite, en contrepartie, un sentiment d’exposition permanente (via par exemple les agendas partagés ou la visio), entraînant un effet de disponibilité accrue, y compris en dehors des horaires normaux de travail.
D’autres constats, en revanche, qui reviennent fréquemment dans la littérature consacrée aux TIC, n’ont pas été observés dans notre échantillon, ce qui ne veut pas dire bien entendu qu’ils n’existent pas. La thématique du contrôle du travail et du détournement associé des outils, présente dans de nombreux travaux de recherche, semble absente du discours des acteurs interrogés, à contre-courant des récits médiatiques sur la surveillance numérique des salariés (notamment avec le développement du télétravail et des outils de télésurveillance). On peut voir là un effet de la nature intrinsèquement flexible de ces nouveaux outils : dans la mesure où ils ne s’accompagnent d’aucune prescription d’usage ni ne s’articulent à aucun modèle organisationnel précis (au-delà des injonctions enthousiastes et creuses à « partager, collaborer, innover »), il devient impossible en soi de les détourner de leurs objectifs, puisqu’ils n’en ont pas vraiment (Benedetto-Meyer, 2017).
La dernière vague d’ outils numériques continue donc de s’inscrire dans des relations ambiguës, à la fois source d’apports et de nuisances pour l’activité de travail, de bénéfices et de risques pour les usagers. Comme le soulignait Stiegler (2014), toute technique est ambivalente à l’image du pharmakon, à la fois remède et poison. Ce qui invite à la vigilance, ou tout au moins à relativiser « l’idée que leur adoption généralisée dans le travail débouche[rait] mécaniquement sur de l’innovation organisationnelle et “naturellement” sur des améliorations pour les salariés en termes de gain de temps et d’autonomie » (Soubiale, 2016a).
- 24. L’analyse qualitative est ici fondée sur vingt entretiens approfondis conduits par les auteures dans quatre organisations (voir liste en introduction et en annexe), recoupée avec des données et des analyses disponibles issues d’autres sources.
- 25. Regroupement de tâches auparavant distribuées entre des travailleurs spécialisés.
- 26. Délégation de tâches auparavant prises en charge par le niveau hiérarchique supérieur.
- 27. Pour une vision plus complète de ce cas, voir Canivenc S. (2022b) et Canivenc S. et Cahier M-L. (2022).
- 28. Pour une approche comparée de l’impact environnemental du mail et des plateformes d’échanges et de partage de documents, voir The Shift Project (2018) et Lecko (2023), partie dédiée au numérique responsable.
- 29. Fear of Missing Out : anxiété sociale liée à la peur de manquer une information importante.
- 30. Voir à ce sujet Favier, L. (2019). Dopamine. Arte. Cette série de documentaires s’intéresse aux applications numériques qui jouent explicitement sur la dopamine pour capter et conserver l’attention des utilisateurs.
- 31. Voir notamment : Bobillier-Chaumon, 2003; Khalil et Dudézert, 2014; Mallard, 2014; Felio, 2016; Benedetto-Meyer, 2017 ; Benedetto-Meyer et Klein, 2017 ; Brasseur et Biaz, 2018 ; Ciampi et Berland, 2019.
Les modes de déploiement : une clé déterminante pour l ’appropriation des outils collaboratifs
Des recherches académiques ont montré que la réussite d’une transformation digitale du travail, c’est-à-dire son inscription dans les pratiques quotidiennes de travail, dépendait de trois conditions d’ordre psycho- sociologique (Talukder, 2014 ; Chevallier et Coallier, 2021) : i) l’« acceptabilité » de la technologie tant d’un point de vue pratique que moral ; ii) son « acceptation », soit son aptitude à faire sens au regard de l’activité de travail ; iii) son appropriation, qui renvoie à sa capacité d’être effectivement intégrée dans l’activité de travail, dans un jeu d’allers-retours entre l’usager et l’outil, comme l’expliquent également Boboc et Bobillier-Chaumon (2017) : « L’appropriation, c’est ramener à soi une technologie, mais aussi évoluer pour s’ajuster à la technologie. […] L’appropriation, c’est adapter une technologie et s’y adapter, dans un jeu continuel. »
Les modes de déploiement adoptés par les entreprises peuvent venir favoriser l’acceptation et l’appropriation, ou au contraire l’entraver.
D’une logique top-down à des déploiements non prescriptifs
Les méthodes de déploiement et d’accompagnement traditionnelles en matière de systèmes d’information ont souvent souffert de leur caractère hiérarchique et descendant. Une telle approche paraît paradoxale lorsqu’il s’agit d’implanter des outils censés favoriser des pratiques collaboratives horizontales : « Comment imposer ou penser pour autrui la coopération et la collaboration, alors même qu’elles passent par la prise d’initiative individuelle, la construction de réseaux et la transversalité ? » Monneuse (2014) soulignait déjà au sujet des réseaux sociaux d’entreprise qu’« on observe […] des contradictions entre la volonté des entreprises d’accroître la collaboration horizontale via un RSE et le lancement de celui-ci sur un mode top-down ! ».
Conformément à la logique non prescriptive véhiculée par ces outils (voir chapitre 1), les chercheurs en sciences sociales préconisent depuis longtemps de les déployer en laissant des marges d’action aux acteurs « pour opérer des compromis entre leurs activités et les fonctionnalités proposées par les outils » (Benedetto-Meyer et Boboc, 2021). Dudézert (2018) indique que « les démarches les plus efficaces en matière de transformation ne sont pas forcément les démarches les plus planifiées et programmées. […] Il vaut donc mieux se mettre dans la posture du bricoleur que du planificateur. » Dans ce but, Boboc incite les entreprises à « sortir d’un accompagnement qui s’appuie sur des modes descendants ou une “communication massive”, pour faire davantage place aux expérimentations ou aux espaces de discussions autour de l’usage du numérique au sein des équipes de travail par rapport à leur activité » (Boboc, 2017). Soulignons que la crise sanitaire a justement créé les circonstances d’une expérimentation à grande échelle et d’un bricolage généralisé.
Des accompagnements multidimensionnels et locaux
Lors des déploiements post-crise sanitaire visant à généraliser l’accès à certains de ces outils, les entreprises semblent avoir pris en compte en grande partie les conseils des chercheurs en sciences humaines et sociales. Si la décision de déploiement de tel ou tel outil reste majoritairement centralisée, les entreprises tendent ensuite à le « lâcher » dans l’entreprise, à charge pour chacun de s’en emparer. Le modèle de déploiement dominant est ainsi qualifié de provide and pray (fournir et prier), dans une logique de « laisser faire et voir ce qui se passe » (Dudézert, 2018). Mais cette méthode présente d’évidentes limites.
Parce qu’ils sont précisément collaboratifs, ces outils ne supposent pas un usage solitaire comme pour un tableur ou un traitement de texte. Dès lors qu’il s’agit de collaborer, de coopérer, ou même simplement de se coordonner, des pratiques de travail partagées sont nécessaires. Une absence de prescription d’usage ne doit pas conduire à une absence de pratiques communes, ni de règles d’ usage (voir aussi chapitre 4), sous peine de voir ces outils dits collaboratifs manquer leur objectif. Le mode de déploiement choisi peut venir précisément favoriser la construction de ces pratiques communes « à la source ».
Un accompagnement multidimensionnel. Traditionnellement, l’effort d’accompagnement se concentrait le plus souvent sur une formation générique à l’outil, au moment de la phase d’implantation (Comtet, 2009), qui plus est sans toujours prendre en compte les besoins opérationnels réels ni les pratiques digitales préexistantes (Dudézert, 2018). Aujourd’hui, l’accompagnement proposé par les organisations n’est plus seulement censé viser l’apprentissage des fonctionnalités techniques de l’outil, mais doit également chercher à favoriser son intégration aux pratiques de travail (l’appropriation). De ce fait, cet accompagnement devient souvent multidimensionnel, c’est-à-dire qu’il recourt à une diversité de dispositifs.
Pour ce qui concerne l’apprentissage des fonctionnalités, l’e-learning a eu le vent en poupe jusqu’au début des années 2010. Beaucoup d’espoirs avaient été placés dans l’autoformation en autonomie des collaborateurs via des plateformes de learning internes ou externes. Mais des limites sont vite apparues. Le caractère souvent homogène et indifférencié des formations proposées (tutoriels et autres vidéos), de même que l’apprentissage en solitaire, se sont révélés en grande partie insuffisants, surtout pour des populations réfractaires ou en difficulté. Les entreprises recourent désormais à un panachage de dispositifs formels et informels, inspirés des théories de l ’apprentissage social qui reposent sur l’activité collective et le groupe social (imitation, rôles modèles). Cet apprentissage dit social peut s’effectuer : i) grâce à la formation de champions ou d’ambassadeurs pour qu’ils aillent sensibiliser leurs collègues et leur proposer de l’aide ; ii) à travers des ateliers collectifs entre pairs au cours desquels les collaborateurs découvrent ensemble les fonctionnalités dont ils ont besoin ; iii) ou encore via de courts moments de partage réguliers au sein des équipes pour connaître des fonctionnalités plus avancées. Comme l’explique une consultante spécialisée dans le « social collaboratif », « tout ce qui va créer un réseau de facilitation fonctionne beaucoup mieux » pour surmonter les difficultés techniques d’apprentissage et les craintes.
Un accompagnement local. L’appren-tissage social au sein de l’équipe de travail permet d’aller au-delà du simple apprentissage des fonctionnalités et d’entrer dans une logique d’intégration de l’outil aux pratiques de travail. Établir un lien direct entre transformation numérique et organisation du travail implique de faire appel à la participation active des acteurs de terrain, qui vont alors coconstruire des usages adaptés à leurs besoins, en limitant ainsi les apprentissages à ce qui est « juste nécessaire » et pertinent pour eux (voir encadré ci-contre).
Pour inscrire durablement les outils dans des changements des pratiques de travail, il paraît nécessaire de coupler la traditionnelle approche centralisée et massive par ces approches à la fois multidimensionnelles et locales, en reconnaissant l’importance de l’apprentissage par la pratique et par les pairs.
Apprentissage numérique et organisationnel à la direction juridique d’un grand groupe
Un consultant spécialisé dans les transformations organisationnelles rapporte cet exemple : « J’ai travaillé sur le terrain d’une direction juridique. Ce n’est pas une catégorie de population qui a une grande habitude des outils numériques. Lors d’un premier atelier avec une soixantaine de juristes, le problème d’organisation qui avait été identifié était qu’ils disposaient de trop d’outils numériques différents et que chacun les utilisait en fonction de ses habitudes et préférences, avec en outre un niveau de maîtrise des outils qui était assez varié. Ils ne savaient jamais dans quel outil les documents étaient rangés et ils devaient aller chercher à gauche et à droite dans les différents outils pour collaborer. Leur demande était très carrée : “On aimerait avoir un seul outil et on aimerait savoir s’en servir tous de la même manière.” Coup de chance, le groupe auquel appartient cette direction avait justement décidé à ce moment-là d’installer la suite Office 365 avec l’espace de collaboration Teams. On a donc embarqué une quarantaine de juristes dans la phase pilote du déploiement pour qu’ils testent l’outil. Ils se sont rendu compte que cela leur amenait des possibilités de partage et de collaboration très intéressantes, mais aussi que c’était très compliqué de monter en compétences sur toutes les facettes de cet outil. Le temps d’apprentissage leur paraissait beaucoup trop important et, par définition, un juriste n’a jamais de temps. Ils ont donc décidé de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles à leur fonctionnement. Pour cela, ils ont construit ensemble le “parcours du juriste”, en ne retenant que les fonctionnalités clés pour eux. Ils l’ont formalisé dans un document puis décliné dans une formation. Ce sont maintenant des juristes qui forment des juristes à travers une formation d’une heure. 70 à 80 % de la population a été formée de cette manière, et c’est évidemment beaucoup plus adapté qu’une formation standard qui aurait été dispensée par un geek de Teams. »
L ’émergence non planifiée de nouveaux outils et leur progressive inscription dans l’organisation
La diffusion de nouveaux outils numériques peut, en sens inverse, s’opérer de façon totalement décentralisée et bottom-up, à partir de phénomènes émergents au niveau des individus ou des équipes, qui s’inscriront progressivement dans l’organisation (voir encadré ci-contre).
Dans deux cabinets de conseil appartenant à un grand groupe, l’outil Klaxoon s’est révélé déterminant lors de la crise sanitaire pour animer les ateliers de brainstorming et ainsi assurer la continuité des activités auprès des clients. L’outil a également été mobilisé en interne pour animer les séances d’ équipe hebdomadaires à distance. Cet outil n ’ était cependant pas inscrit dans le catalogue officiel des outils validés par la DSI. Son usage a émergé spontanément dans les entités où les salariés en ressentaient le besoin, via ceux qui l’utilisaient déjà avant la crise sanitaire. Nécessité faisant loi, les consultants se sont formés par eux-mêmes, majoritairement en tâtonnant, même si de petits ateliers internes ont pu être ponctuellement organisés pour former les nouveaux et les stagiaires au travers de cas d’usage propres au métier du conseil. Depuis, Klaxoon a intégré le catalogue officiel des outils de l’organisation, des personnes ont été « certifiées Klaxoon », et le nombre de licences a doublé, même s’il était encore jugé insuffisant à l’époque où nous avons mené nos entretiens. La reconnaissance officielle a également permis de renforcer la gouvernance des usages : « Oui, c’est bien le bon outil pour faire les ateliers ; si vous avez besoin de support, voilà les certifiés ; si vous avez besoin de licences, voilà le process ; et si vous avez besoin de templates, voilà où les trouver » , explique un des managers.
Ces études de cas révèlent ainsi la double facette des processus de déploiement et d’appropriation des outils numériques : à la fois centralisés et locaux, imposés et émergents, descendants et ascendants. Loin de s’opposer, ces facettes finissent par s’articuler : l’approche centralisatrice et descendante se combine avec des approches très locales pour assurer l’appropriation de l’outil et son adaptation aux activités de travail. En sens inverse, une approche émergente et locale peut finir par s’inscrire dans l’ensemble de l’organisation. Les transformations digitales ne sont donc pas à appréhender de manière linéaire et binaire (soit top-down, soit bottom-up) mais circulaire : les niveaux macro et micro, officiels et officieux, s’alimentent de manière réciproque pour, d’une part, assurer l’appropriation effective des outils numériques et, d’autre part, leur permettre de déployer leur potentiel organisationnel. Dans ce cadre, l’outil devient un moyen matériel d’engendrer un dialogue entre les niveaux organisationnels et individuels, qui ne peut qu’être bénéfique dans le cadre d’une transformation numérique comme organisationnelle.
L’émergence non planifiée des outils no code dans un cabinet conseil du numérique
Dans ce cabinet conseil spécialisé dans les transformations numériques, les outils no code ont été investis d’abord de manière officieuse, grâce à la large part d’autonomie dont jouissent les salariés de cette structure32.
Ces outils ont été utilisés, à l’origine, par certains membres « non développeurs » à l’occasion de projets personnels extérieurs à l’entreprise, puis officieusement pour améliorer et accélérer la gestion de leurs opérations professionnelles. Progressivement, deux passionnés de no code vont développer un microcentre de ressources interne pour aider leurs collègues, soit en les assistant dans leur usage des plateformes no code, soit en leur fournissant des livrables. Parallèlement, quelques designers découvrent l’extraordinaire facilitation que peut leur procurer la plateforme no code Webflow pour réaliser des sites web conciliant rapidité d’exécution et effet waouh. Ils se passent le mot, entraînant une diffusion virale (mais limitée) au sein de cette population.
À cette époque, l’usage du no code ne semble avoir été ni entravé par la hiérarchie, ni explicitement soutenu par elle, du fait de la culture d’initiative et d’autonomie propre à ce cabinet. Petit à petit, les réseaux interpersonnels ont commencé à s’inscrire dans une logique organisationnelle : « Il y a une rencontre qui s’opère entre une curiosité naturelle et un besoin potentiel pour un projet, puis deux, puis trois. Ça a fait comme un effet boule de neige. » Enfin, dernière étape de l’officialisation, les deux no-codeurs à l’origine du centre de ressources y ont vu une nouvelle opportunité d’affaires pour le cabinet et ont proposé au dirigeant-fondateur de créer un centre de profit dédié à l’accompagnement no code des clients. Le lancement de cette entité plurimétiers est ainsi venu formaliser le déploiement des outils no code, qui étaient déjà utilisés de manière souterraine par certaines équipes et qui sont désormais officiellement investis par une équipe dédiée.
Des points de vigilance trop souvent oubliés
Au-delà des manières de déployer, il existe des points de vigilance à garder en tête lors des déploiements, si l’on veut que les salariés s’approprient durablement les outils et les intègrent à leurs pratiques de travail.
Laisser du temps au temps
L’appropriation de ces outils – aussi intuitifs semblent-ils sur le papier – nécessite souvent un temps de tâtonnement assez long pour en comprendre le fonctionnement et surtout l’intérêt d’usage au regard de l’activité de travail réelle (Comtet, 2009 ; Boboc et Bobillier-Chaumon, 2017 ; Benedetto-Meyer et Klein, 2017). Or ce facteur temps est généralement sous-estimé par les décideurs, qui sont souvent pressés d’accélérer la bascule vers les nouveaux outils, que ce soit pour montrer le succès de l’implémentation, pour pouvoir débrancher les outils préexistants ou encore parce qu’ils espèrent ainsi accélérer l’adoption des nouvelles pratiques de travail associées à ces outils.
Le temps est d’abord nécessaire sur un plan technique, car les bugs sont souvent nombreux au démarrage : « Il y avait quand même pas mal de bugs au début [sur Teams]. Nous avons chez nous des milliers d’applications métiers, qui n’ étaient pas forcément compatibles pour s ’afficher dans Teams. Donc les tests ont été un peu longs […]. Sur la période pilote, c’ était une catastrophe », témoignent ainsi des salariés. Tant que les bugs ne sont pas résolus, il paraît légitime aux collaborateurs de maintenir leurs usages sur les outils préexistants et de ne pas opérer la migration vers les nouveaux outils : « Quand ça ne fonctionne pas, même si on vous dit que c’est merveilleux, vous revenez aux outils historiques. ». L’urgence d’un déploiement techniquement imparfait peut ainsi se retourner contre l’adoption de l’outil, voire créer un rejet ou un dégoût.
Le temps est aussi un facteur à prendre en compte pour l’apprentissage, car tous les salariés ne disposent ni des mêmes appétences, ni des mêmes compétences face au numérique, comme en témoignent ces employés de différentes organisations lors de l’installation de Teams : « Évidemment, pour les geeks, tout est évident mais pour moi ça a été très difficile ; Personnellement, je suis très dans le digital parce que je suis ingénieur de formation. Je vois que c’est un peu compliqué, mais j’arrive à me dépatouiller. Mais pour les autres, c’est vraiment compliqué.»
Des consultants impliqués dans les transformations digitales constatent qu’on ne laisse généralement pas assez de temps aux personnes pour qu’elles puissent s’investir dans l’apprentissage, puis dans la construction de pratiques communes : « Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas ce qu’il faut [en termes d’accompagnement], c’est qu’ on ne prend pas en considération le temps qu’il va falloir y consacrer. »
« On vous dit que vous allez pouvoir prendre deux heures par semaine, mais vous allez en fait prendre beaucoup plus de votre temps […] . On pourrait imaginer des formes d’engagement réciproque : on vous donne le temps de le faire et donc vous vous engagez à le faire vraiment. Mais dans la réalité, ça se rajoute toujours au temps de travail. »
L’appropriation des outils no code : des profils particuliers
Ce temps long de la montée en compétences est encore plus flagrant pour les outils no code, ce qui explique que leur utilisation résulte encore du volontariat. Par exemple, dans un cabinet conseil que nous avons étudié, les utilisateurs du no code ont un profil bien particulier : sans être des experts de la programmation, ils ont une appétence très prononcée pour le numérique et ont déjà mis « les mains dans le cambouis ». Ils semblent ainsi présenter un profil intermédiaire entre des non-techniciens qui n’ont aucune appétence pour ces outils numériques et les développeurs pour qui le développement de logiciels est un métier qui nécessite des compétences spécialisées. Ces no-codeurs ont en général un tempérament débrouillard et tenace, proche de celui des hackers33 (Himanen, 2021) : ils aiment chercher, tâtonner, expérimenter… D’autres collaborateurs, au contraire, sont rebutés à l’idée du temps qu’il faudrait y consacrer : « On dit que c’est simple, qu’on l’a tout de suite en mains, mais c’est faux. Il faut passer pas mal de temps sur l’outil pour apprendre à le maîtriser. » On constate ainsi dans cette entreprise que l’intérêt et l’engagement envers les outils no code peinent à se propager au-delà de ces profils particuliers.
Quand on implante des outils numériques, il ne sert donc à rien de vouloir brûler les étapes. Quel que soit l’accompagnement proposé, l’apprentissage et l’appropriation demandent du temps pour permettre l’expérimentation, la génération de pratiques de travail nouvelles et la « cristallisation » de nouvelles routines.
Prendre en compte les stratégies d ’acteurs
Non seulement les individus n’ont ni les mêmes appétences, ni les mêmes compétences face au numérique, mais en outre ils n’ont pas tous le même intérêt à l’adopter. Comprendre les raisons profondes qui peuvent amener certains acteurs à « résister » à ces outils peut permettre de contourner l’obstacle. La sociologie des organisations (Crozier et Friedberg, 1977) nous enseigne depuis longtemps que tout changement implique des gains et des pertes pour les acteurs en place (parfois financiers, mais le plus souvent symboliques, tels que les marges de manœuvre, les relations, le pouvoir, le confort, etc.). Le déploiement des outils numériques n’échappe pas à cette règle. Lors de notre enquête, nous avons identifié deux populations concernées par ce phénomène pour des raisons différentes : les dirigeants et les managers, d’une part ; les développeurs, d’autre part, pour ce qui concerne l’usage du no code.
Dirigeants et managers. Censés donner l’exemple, les plus hauts gradés ont parfois tendance à ne pas jouer le jeu de l’adoption des nouveaux outils. Par exemple, dans ce cabinet conseil pourtant spécialisé dans l’accompagnement digital, plusieurs témoignages concordants indiquent que plus on monte dans la hiérarchie, moins les personnes utilisent Teams. L’explication donnée à cet état de fait est que les directeurs sont déjà noyés sous les informations et qu’ils éprouvent des réticences à se rajouter un canal supplémentaire d’alertes et de notifications. L’un d’entre eux le reconnaît d’ailleurs franchement : « J’ai assez de notifications comme ça, donc je refuse d’installer Teams sur mon téléphone, sinon je deviendrais fou. »
Si l’hypersollicitation à laquelle sont soumis les managers peut en partie expliquer cette situation, un autre facteur doit aussi être pris en compte. Parce que les outils numériques collaboratifs favorisent l’autonomie horizontale et verticale des collaborateurs, ils bouleversent l ’identité professionnelle des managers en réduisant l’étendue de leurs prérogatives. « L’accompagnement de la transformation numérique consiste, d’une certaine manière, à demander aux managers de mettre en œuvre des changements qui remettraient en cause leur savoir, leur légitimité et qui sont source d’incertitudes sur leur propre activité » (Benedetto-Meyer et Boboc, 2021). En témoigne ainsi ce salarié : « Auparavant, le rôle du manager consistait à distiller l’information et à la remonter. Aujourd’hui, grâce à tous ces outils, l’information, elle est dans tous les sens et donc le manager est totalement court-circuité. » On ne peut donc guère s’étonner de ne pas les voir exprimer un enthousiasme immodéré face à ces nouveaux outils. Et cela indique en creux que c’est précisément la transformation de leur rôle qu’il s’agit prioritairement d’accompagner (Canivenc, 2022a).
Développeurs. On retrouve ce phénomène dans les réticences des développeurs à intégrer les outils no code dans leur pratique professionnelle. Ces réserves sont généralement analysées comme une peur d’être à terme remplacés et de perdre leur emploi. En réalité, ce qui semble ici en jeu, bien plus qu’une menace sur leur emploi, c’est la profonde remise en cause que les plateformes no code exercent sur leur légitimité professionnelle et leur « fierté métier ». Parmi six développeurs interrogés hors de nos terrains, un seul utilise des outils low code/no code car ils lui sont imposés par son employeur. Les cinq autres, tous codeurs, semblent soit ne pas les connaître, soit ne pas vouloir les utiliser, l’un d’eux affirmant même « les fuir ». D’une part, ces outils leur paraissent trop limités techniquement pour répondre à leurs besoins d’experts. D’autre part, ils arguent qu’ils n’ont pas besoin de gagner du temps grâce à ces outils et utilisent déjà d’autres astuces professionnelles. Il en résulte que les outils no code ne font pas sens au regard de la conception qu’ils ont de leur activité (Benedetto-Meyer et Boboc, 2021) : ils trouvent alors légitime de s’y opposer, allant même jusqu’à « recoder des choses qui peuvent être automatiquement réalisées par le compilateur ». La Logique de l’honneur34 identifiée par Philippe d’Iribarne (1989) explique pour une grande part leur inintérêt, voire leur mépris, pour ces outils. Dans le cabinet conseil digital qui a intégré les outils no code, des inquiétudes similaires existent au sein de l’équipe de développeurs. Mais, ici, les réticences exprimées sont pleinement écoutées par l’équipe en charge du no code non seulement pour ménager cette catégorie de professionnels précieuse, mais aussi pour mieux comprendre les enjeux et les limites de ces outils : « On est vraiment conscient des limites et on n’a pas envie de vendre le no code à tout prix. Et je trouve ça bien aussi qu’il y ait des personnes un peu méfiantes, parce que ça ouvre les discussions. » Cette attitude ouverte permet de réduire les inquiétudes et les attitudes de rejet. On voit ici tout l’intérêt de la « dispute professionnelle » (Clot, 2014 2021) autour des outils numériques pour réussir à les déployer de manière constructive. Il paraît toujours utile de prendre en considération les stratégies des acteurs, plutôt que de les stigmatiser comme des résistances.
- 32. Pour une approche plus détaillée de ce cas, voir Canivenc S. (2022b) et Canivenc S. et Cahier M.-L. (2022).
- 33. Ce terme fait l’objet de multiples incompréhensions l’assimilant à la figure du pirate. Si to hack into signifie effectivement « entrer par effraction », le terme argotique hack renvoie plus globalement au fait de « bidouiller » pour résoudre des problèmes de manière ingénieuse, sans nécessairement passer par des procédures conventionnelles.
- 34. Dans ce classique de la sociologie et du management, l’auteur identifie que chaque pays a ses traditions, sa manière de définir les droits et les devoirs de chacun, sa façon de commander, d’obéir, de coopérer et de s’affronter. La France se caractériserait par la logique de l’honneur, fondée sur la fierté que l’on a de son rang et la crainte d’en déchoir. Le sens de l’honneur « incite à défendre son rang », il « interdit de défendre ses intérêts, et même ses droits de manière vile… il pousse à se sentir responsable ». Dans l’entreprise, on retrouve cette logique de l’honneur à l’intérieur de chaque métier ou service.
L’indispensable régulation des usages
Quand le déploiement des outils n’intègre pas les pratiques de travail réelles, leurs usages spontanés et non coordonnés sont souvent déstructurants, produisant chaos informationnel, surcharge et épuisement cognitif. Il importe donc de souligner les dangers d’une approche qui assimilerait trop rapidement « absence de prescription » de ces outils à « absence de régulation » de leurs usages. Les « bonnes pratiques » qui peuvent permettre de maximiser les effets bénéfiques des outils tout en minimisant leurs effets pervers ne peuvent résulter que d’une conjonction de régulations.
La « tyrannie de l’absence de structure »
Les effets pervers de l’absence de structuration des outils et de leurs usages peuvent apparaître dans n’importe quel type d’organisation, qu’elle soit hiérarchique ou plate. Ils ne dépendent pas du modèle organisationnel, mais sont la conséquence de la faible attention accordée à cet effort de structuration. Cette absence traduit souvent une sorte de confiance aveugle dans le pouvoir des outils eux-mêmes de structurer les pratiques de travail, ce qui se révèle généralement un piège. Quand s’y ajoute une foi tout aussi aveugle dans les principes d’auto-organisation spontanée, le cocktail peut devenir détonant.
En témoigne ainsi une structure autogérée spécialisée dans le domaine informatique, étudiée au tournant des années 2010 (Canivenc, 2012). Cette structure aspirait à une forme de démocratie directe radicale, qui était soutenue dès cette époque par une multitude d’outils numériques multi-usagers et collaboratifs (éditeur de texte collaboratif, wiki). La nature démocratique de l’organisation impliquait que chacun puisse s’emparer de ces outils. Cependant personne ne se préoccupait ni de la structuration ni de la mise à jour des informations ainsi stockées, ce qui engendrait un véritable chaos informationnel : « Quelqu’un vient, il met quelque chose sur le wiki, il s’en va, personne n’a la responsabilité de mettre à jour. » Comme le soulignait parfaitement un membre de cette structure, « au lieu d’être facilitateur, de retrouver une information, [avec ces outils] on se perd dans l’information ». Ces ingénieurs en informatique tentaient de résoudre les problèmes d’organisation grâce à de nouveaux outils et fonctionnalités techniques, oubliant le corollaire organisationnel indispensable à l’hypertransparence : la régulation des usages des outils.
A contrario On pourrait même aller jusqu’à dire qu’une organisation plate a encore plus besoin de structurer ses process qu’une organisation hiérarchique, afin que chacun puisse réellement prendre une part active à l’œuvre censée être commune. L’association figurant parmi nos terrains a réfléchi à la manière de mettre ces outils numériques ouverts et collaboratifs au service de son modèle horizontal. Elle a constaté, chemin faisant, que ces outils ne déterminaient pas eux-mêmes ces fonctionnements, et qu’ils pouvaient au contraire produire un grand désordre. À la différence de l’organisation autogérée décrite ci-dessus, il y a eu une prise de conscience que le modèle ne pouvait fonctionner qu’avec des règles d’utilisation partagées. S’est ensuivie une intense structuration des processus organisationnels et informationnels, menée par un collectif knowledge management , afin qu’ils deviennent des appuis au fonctionnement démocratique : structuration de chaque outil (canaux, arborescence), conception innovante des réunions, mode de prise de décision partagée entre asynchrone et synchrone, règles d’usage, rappel bienveillant des règles par les membres du groupe, etc. Cet effort soutenu d’organisation est reconnu par les membres comme l’une des principales clés du succès de leur gouvernance partagée : « Mon sentiment est que la gouvernance partagée, l’intelligence collective, tout ce fonctionnement de groupe, cela ne marche que si c’est hyperencadré, processé, formalisé … ». La structuration n’est donc pas oppressante en soi : selon la manière dont elle est conçue et mise en œuvre, elle peut au contraire représenter une source d ’ émancipation individuelle et collective. « Ça peut paraître rigide, mais en fait ça nous a libérés. Comme souvent, la liberté se trouve dans le cadre… », témoigne une salariée.
Le modèle organisationnel et l’usage des outils collaboratifs sont ici profondément imbriqués, et cette imbrication résulte d’un travail de coconstruction avec les salariés, travail qui permet à son tour au modèle d’évoluer par effet d’expérience.
La structuration des outils de communication et de leurs usages
L’un des premiers constats opérés est que les usages spontanés de Slack ou de Teams produisent un foisonnement des canaux : « Je me retrouve avec une liste de projets interminable », indique un manager. Un premier niveau de structuration consiste donc à réfléchir de manière globale au squelette des canaux d’échange en les adaptant aux besoins professionnels des utilisateurs. Cet effort de structuration doit être maintenu dans la durée, notamment en effectuant le nettoyage périodique des canaux et des documents devenus obsolètes, comme le souligne cet autre salarié : « Quelqu’un va devoir faire le ménage parce qu’on est en train de produire, produire, produire. Et personne ne se pose la question de supprimer ou de fermer des canaux. » Lecko (2023) parle de digital cleanup collectif sur lequel les salariés doivent être mobilisés (via des challenges, par exemple) tant pour des raisons de confort mental que d’impact environnemental du numérique. Il en va de même pour les drives qui doivent être architecturés en continu et régulièrement nettoyés (voir encadré ci-après).
La régulation passe toujours par deux aspects : l’organisation de l’outil lui-même et la responsabilisation conjointe des émetteurs et des destinataires. Comme toujours avec les outils numériques, il faut travailler conjointement l’outil technique et les comportements.
L’effort de structuration doit concerner chaque outil ou chaque usage, et plus globalement l’ensemble du «portefeuille d’outils de communication » (Kalika et al., 2007). Comme le soulignent les théoriciens du millefeuille, « les organisations doivent examiner attentivement la manière dont les différents médias sont utilisés et se complètent en fonction de leurs possibilités et contraintes associées » (Boukef et Charki, 2019). Cette structuration consiste à recenser tous les outils utilisés pour effectuer les différentes activités récurrentes au sein d’une équipe (intégrer une nouvelle recrue, se former, animer chez un client, organiser une réunion, que faire en cas d’urgence, etc.), de manière à choisir quels seront les meilleurs outils et les meilleurs usages de l’outil par rapport à telle ou telle activité. Si des règles d’usage communes sont clarifiées et respectées, il devient alors possible de laisser coexister un certain nombre d’outils, chacun ayant sa fonction, ses vertus et ses limites.
La structuration de l’outil et les bonnes pratiques d’usage sur Slack
Dans l’association en gouvernance partagée que nous avons étudiée, la plateforme Slack est rapidement devenue ingérable : la multiplication des canaux, alliée à la peur de rater une information, a entraîné une forte surcharge informationnelle à l’origine d’inefficiences organisationnelles.
Face à cette situation, l’outil a été restructuré et les usages, régulés à l’initiative d’une salariée qui avait une expérience préalable d’un Slack mieux organisé dans un emploi précédent.
Le nombre de canaux a tout d’abord été drastiquement réduit (passant de 50 à 20) et ils ont été mieux structurés : à côté des canaux relatifs à la vie de l’entreprise et qui concernent tout le monde, chaque équipe et chaque projet transversal ont désormais un canal dédié (qui peut lui-même se subdiviser en activités ou en projets).
Les règles d’usage ont ensuite été clarifiées : « Elle nous a fait une remise à niveau sur les bonnes pratiques à adopter pour l’usage de Slack : la priorisation des canaux auxquels s’abonner bien sûr, mais aussi le respect de la vie personnelle (désactiver les notifications, ne pas aller sur Slack sur son temps perso, ne pas poster sur Slack sur le temps perso des autres, etc.). » Ces règles de base ont été consignées dans un guide pratique et sont régulièrement rappelées à ceux qui y contreviennent pour éviter que des dérives ne s’installent.
Une solution plus radicale peut consister à « débrancher » purement et simplement des outils qui préexistaient pour tout concentrer sur une nouvelle plateforme et réduire ainsi (en théorie) le millefeuille. Certaines organisations, de même que certains de leurs membres, peuvent en effet avoir une préférence pour un cadre intégré et simplifié, avec quelques outils bien identifiés, plutôt que pour un foisonnement qui serait cadré par les seules règles d’usage (dont le respect peut en outre sembler incertain). Il y a donc toujours des arbitrages à opérer entre richesse des possibles et standardisation.
Cette réflexion sur le portefeuille d’outils et de leurs usages, conduite en petits groupes de travail, était en cours dans plusieurs organisations de notre enquête ; elle semblait toutefois difficile à faire aboutir au moment de nos entretiens – preuve sans doute que ces arbitrages ne sont pas évidents à opérer. Des incertitudes existaient encore concernant les outils qui allaient ou non être débranchés en central.
À titre d’exemple, nous montrons ici la pyramide des usages des différents outils de communication de l’entreprise DOIST, qui compte environ 90 salariés (voir figure 4.1). En raison de son fonctionnement en full-remote, DOIST a ressenti le besoin de formaliser précisément les outils de communication à utiliser selon les cas d’usage (faire une annonce, partager des idées ou des feedbacks, commenter le travail d’autres personnes, organiser des échanges bilatéraux, des réunions d’équipe ou des groupes de travail, organiser un événement de team building, agir en cas d’urgence). Cette mise à plat lui a permis d’objectiver le rôle essentiel que tiennent les communications asynchrones dans son fonctionnement (voir chapitre 5).
Le besoin d’une régulation multiscalaire des usages
Compte tenu de sa complexité, la régulation des usages du numérique collaboratif doit s’envisager de manière multiscalaire ou gigogne : à la fois individuelle, managériale, collective et institutionnelle.
La régulation individuelle
Une première forme de régulation, qui est aussi la plus courante, est celle que les salariés mettent spontanément en œuvre pour réduire les contraintes et les effets nuisibles que les outils numériques font peser sur leur travail et leur équilibre : éteindre son téléphone, ne regarder ses comptes (e-mails ou plateformes) que quelques fois par jour, désactiver les notifications, prendre des pauses, se réserver des plages dans l’agenda pour la concentration profonde, ne pas travailler le soir, le week-end, etc. L’un de nos interviewés appelle ces comportements « avoir sa propre arme décisionnelle : on se concentre, on éteint l’ordinateur. Le téléphone, quand on est en réunion, on le met en mode avion. On regarde Teams seulement à la fin de la journée. » En un mot, il s’agit pour chacun d’exercer son droit à la déconnexion, comme le souligne cet autre témoignage : « Je me cale des plages en disant “de telle heure à telle heure, on ne m’embête pas”. »
Les recherches menées sur ce sujet distinguent deux formes de régulation individuelle (Boudokhane-Lima et Felio, 2015) : la préservation (indiquer « absent » ou « occupé » dans l’agenda) et le filtrage (désactiver ses notifications, éteindre sa fenêtre Internet, mettre son téléphone en mode silencieux, filtrer les appels ou les mails en fonction de l’émetteur, etc.). Ces formes de régulation individuelle ou d’hygiène mentale du salarié sont d’autant plus justifiées que les autres niveaux de régulation sont défaillants ; elles viennent alors combler « un vide ».
Toutefois, ces bonnes pratiques individuelles « de survie » atteignent rapidement leurs limites. Du fait de la nature collaborative de ces outils, « ce qui compte, ce n’est pas vous ou votre décision, c’est le collectif avec lequel vous travaillez ». Ces mesures « prophylactiques » peuvent être « difficile[s] à tenir dans la durée, dès lors qu’elles entrent en contradiction avec des normes collectives » (Grosjean et Morand, 2021). Il serait donc risqué et inefficace « de faire peser la dimension de régulation des usages professionnels sur les [seuls] salariés » (Boudokhane-Lima et Felio, 2015).
La régulation managériale
Les marges de manœuvre des individus restent donc fortement cadrées par le fonctionnement du collectif dans lequel ils s’insèrent, et notamment par les exigences de la hiérarchie. Les hiérarchiques ont donc un rôle d’« exemplarité » (Benedetto-Meyer et Boboc, 2021) important à jouer, tant en amont, dans l’adoption des outils, qu’en aval, dans la régulation des usages.
Mais, ici encore, cette exemplarité peut rester individuelle, avec des effets de concurrence insidieux entre les managers qui cherchent à faire respecter le droit à la déconnexion pour leur équipe comme pour eux-mêmes, et ceux qui restent constamment connectés, incitant ainsi les autres à l’être aussi (Felio, 2016b).
La régulation collective
La régulation aura grand avantage à s’opérer en concertation avec l’ensemble des membres d’une équipe, afin de construire sa propre pyramide des usages, à l’image de celle de DOIST (voir figure 4.1). « Les modes de fonctionnement se définissent avec les personnes qui les mettent en œuvre, qui les vivent », insiste cette consultante spécialisée dans le numérique collaboratif.
Une nuance qui ne va pas toujours de soi, la régulation collective étant parfois confisquée par le manager de l’entité. Si le manager a un devoir d’exemplarité, il ne doit pas pour autant imposer sa vision unilatérale des usages. Il paraît primordial de fonder cette régulation sur un véritable dialogue professionnel collectif, en partant de l’analyse des pratiques, des irritants et des besoins du terrain. Boudokhane-Lima et Felio (2015) citent, dans ce but, une diversité de « méthodes valides et reconnues par les communautés scientifiques : l’analyse de pratiques, la technique des incidents critiques ou encore les groupes de codéveloppement professionnel », mais on trouve aussi le Community Canvas et les arbres de décision, cités par quelques-uns de nos interviewés. Ces dispositifs ont pour point commun d’aider à objectiver non seulement les problématiques mais également les ressources que les acteurs mobilisent en situation pour « mutualiser leurs expériences d’échec et de réussite au service du collectif ». En définitive, cette manière de réguler les usages des outils numériques n’est pas très différente de celle que nous évoquions pour organiser le télétravail au niveau de l’équipe (Canivenc et Cahier, 2021a), les deux dimensions se complétant d’ailleurs.
Cette régulation au plus près des besoins du terrain permet d’adapter les usages des outils à la réalité des métiers. Comme le souligne le rapport de l’INRS (Grosjean et Morand, 2021), un commercial et un cadre technique n’ont pas les mêmes besoins en matière d’outils numériques, « pour l’un, le numérique est le vecteur par lequel il alimente normalement son agenda de travail ; pour le second, c’est le perturbateur principal de ce même agenda de travail ». Cette régulation au niveau collectif permet ainsi de « construire des analyses différenciées selon les corps de métier », leurs besoins et contraintes respectifs.
Une fois cette régulation collective trouvée, elle doit aussi être explicitée et documentée de façon à pouvoir servir de référence à tous. Or, trop souvent, ces régulations restent implicites et sont juste supposées être connues. Cette documentation doit en outre rester évolutive de manière à intégrer l’idée d’amélioration continue (Boudokhane-Lima et Felio, 2015).
L’intérêt de la régulation collective coconstruite : une expérimentation menée par l’INRS
Dans le cadre d’un partenariat avec un groupe industriel, l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) est intervenu pour aider les acteurs à objectiver leurs usages des outils numériques et à identifier les déterminants organisationnels et humains les plus problématiques.
Une analyse collective des difficultés rencontrées a été conduite auprès d’un groupe de cadres techniques (ingénieurs) très qualifiés, affectés à un même secteur. Face à l’analyse de leurs difficultés d’usage, les participants ont proposé de se doter d’un groupware : un espace virtuel unique permettant de suivre les différentes tâches, désormais gérées non plus de manière individuelle mais collective pour mieux réguler la charge de travail et ainsi « réduire la pression exercée sur les individus » (Grosjean et Morand, 2021), grâce à une responsabilité partagée.
Cet exemple souligne que si les outils peuvent permettre l’émergence de nouvelles formes d’organisation du travail plus coopératives, ce processus ne se met en branle que lorsqu’on débat réellement de leurs usages au regard des besoins opérationnels.
La régulation institutionnelle
Une régulation d’ensemble reste cependant nécessaire pour assurer une certaine homogénéité des pratiques, dictée par l’impératif même de communication, qui ne s’arrête pas à la frontière d’une ou de plusieurs équipes. Toutefois, dans les organisations étudiées, nous avons constaté une certaine réticence à imposer des régulations centrales et contraignantes concernant les usages des outils collaboratifs, au risque de renforcer les silos entre équipes (voir chapitre 2). Le top-down semble être passé de mode, sauf sur des dimensions critiques, par exemple, dans des univers où les astreintes sont fortes pour des raisons de sécurité et d’urgence (hôpitaux, nucléaire, armée), ou en matière de cybersécurité, ou encore relativement à l’impact environnemental du numérique. Des outils sont alors prohibés en fonction de certains risques, ou des pratiques sont privilégiées pour ne pas peser sur le bilan carbone de l’entreprise.
Au-delà de ces aspects critiques, des règles d’usage plus génériques peuvent exister, souvent sous la forme de recommandations ou de chartes des usages mentionnant les règles imposées (en principe) par le code du travail (droit à la déconnexion). Ces mesures se révèlent souvent inefficaces. Les bonnes pratiques incitatives peuvent aboutir à des effets contre-productifs (le conseil de ne pas se connecter le soir ou le week-end entraînant, par exemple, une démultiplication des messages à traiter le lundi matin, ce qui aboutit à l’accroissement du sentiment de surcharge et de stress que l’on cherchait pourtant à amoindrir). Les règles imposées (par exemple, police des mails ou interdiction des mails en interne) ne sont pas toujours suivies et sont souvent mal perçues par les salariés qui se sentent infantilisés et se retrouvent à composer avec des règles qui ne correspondent ni à leurs pratiques, ni à leurs besoins. Notons en outre que ces règles et bonnes pratiques ont parfois une finalité formelle et ne sont pas forcément destinées à être suivies d’effet dans l’esprit même de ceux qui les édictent : le but est de montrer aux instances représentatives du personnel que l’entreprise prend en compte le code du travail, droit à la déconnexion en tête. Une étude de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) et de Réalités du dialogue social (2022) portant sur 3 000 accords de télétravail montre que seulement 47 % des accords mentionnent effectivement le droit à la déconnexion, sans pour autant spécifier de mesures concrètes visant à le mettre en œuvre.
D’une manière générale, les règles institutionnelles auront intérêt à ouvrir le champ des possibles plutôt qu’à contraindre les usages. « La préservation du sentiment d’autonomie apparaît primordiale » (Boudokhane-Lima et Felio, 2015) dans la régulation d’usage des TIC, d’autant que les salariés « acceptent également mieux les règles lorsqu’elles sont négociées et instaurées de manière consensuelle que lorsqu’elles sont imposées par la direction » (Bia et Kalika, 2004). Si cette régulation d’ensemble est nécessaire, elle n’a donc pas nécessairement besoin de tomber « d’en haut » ; elle peut aussi se concevoir par viralité, de façon pragmatique, à partir des meilleurs usages développés par telle ou telle équipe et qui sont diffusés lorsqu’ils sont pertinents pour les autres. Encore faut-il que ce partage de bonnes pratiques soit organisé et soutenu à l’échelle de l’entreprise.
Interroger les normes culturelles implicites
Toutes les tentatives de régulation – qu’elles soient issues du code du travail tel le droit à la déconnexion, ou des pratiques d’entreprise – peuvent cependant être vidées de leur substance si elles se heurtent à des normes culturelles d’autant plus puissantes qu’elles restent souvent implicites. Le culte de l’urgence et la densification du travail contribuent directement à l’hyperconnexion des salariés et à la surcharge cognitive. Si l’on ne s’attaque pas fondamentalement à ces deux maux, les régulations ciblant les usages des outils de communication ne peuvent que rester vaines et créer en outre une dissonance cognitive chez les salariés.
Le culte de l’urgence
Si le droit français est venu inscrire dans le code du travail un droit à la déconnexion dès 2017, force est de constater que les usages ne suivent pas, en particulier chez les managers, qui sont les premières victimes (parfois consentantes) de cette hyperconnexion et tendent à la répercuter sur leurs équipes. L’INRS pointe la « dictature de la réponse immédiate » qui incite à rester connecté presque en permanence, notamment chez les cadres. Les travaux de recherche sur lesquels s’appuie l’INRS (Morand, 2020) indiquent que cette catégorie subit une forte pression normative, l’amenant à craindre une désapprobation de la part de l’environnement professionnel en cas de déconnexion, même temporaire. Ce constat est confirmé par les travaux de
Dans ce contexte où accélération et condensation du temps se combinent, l’INRS observe une dérive d’usage des outils asynchrones en dispositifs synchrones : « Les outils pensés techniquement dans une perspective de latitude d’usage voient leurs usages dériver vers une normalisation de la réactivité quasi immédiate, dictée par des normes sociales plus ou moins explicites qui finissent par s’imposer subrepticement. » Une dérive qui n’est donc pas propre à l’e-mail.
Certains de nos interviewés témoignent de cette dérive inconsciente : « Il ne faut pas oublier que Slack n’est pas un outil de messagerie instantanée. En principe, il ne faut pas l’utiliser comme ça. Si on a vraiment besoin d ’une réponse urgente sur quelque chose, le mieux est de prendre son téléphone et d’appeler la personne . » Tel est bien l’enjeu majeur du travail réflexif consistant à structurer son portefeuille d’outils de communication en fonction des cas d’ usage, en gardant à l’esprit autant l’efficacité que le respect du temps des collaborateurs.
La densification du travail
Les nouveaux outils numériques se sont déployés dans un contexte sanitaire particulier ayant conduit à une massification du télétravail. Celui-ci a contribué à déstructurer les temps habituels de travail (9 heures-18 heures) et semble avoir engendré un sentiment de densification du temps de travail.
Nombre d’enquêtes avaient déjà souligné que le télétravail de confinement avait occasionné un allongement de l’amplitude horaire travaillée, du fait du temps économisé dans les transports largement reporté sur les activités professionnelles (Canivenc et Cahier, 2021a). Début 2022, en France, sur 62 minutes de temps économisé dans les transports grâce au télétravail, 44 minutes étaient reportées sur les activités de travail (Aksoy et al., 2023). Une étude internationale de l’ADP Research Institute (2022) montre que 76 % des télétravailleurs effectuent des heures supplémentaires non rémunérées (contre 51 % pour ceux travaillant sur site), à hauteur de 7,65 heures par semaine (contre 4,3 heures pour les travailleurs en présentiel).
Le développement du télétravail s’est donc accompagné d’une plus grande flexibilité horaire qui est venue banaliser les horaires atypiques, comme l’indiquent trois récents rapports. L’Institut Montaigne (2023) souligne qu’une majorité de travailleurs (60 %) déclarent désormais travailler parfois après 20 heures et pendant le week-end. Selon le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CRÉDOC, 2023), « 60 % des personnes en emploi déclarent avoir déjà utilisé, pour des raisons professionnelles, des équipements numériques en dehors de leurs horaires et lieux de travail habituels, soit une augmentation de 19 points par rapport à 2013 ». Enfin, le rapport Lecko (2023) montre que seuls 15 % des salariés de son panel (20 000 salariés) interagissent sur les outils numériques uniquement durant les plages usuelles de travail : 75 % ont des pics de surcharge de travail occasionnels qui les contraignent à outrepasser les horaires habituels et 10 %, les hyperconnectés, le font en permanence.
Dans ce contexte, le temps de travail, même lorsqu’il ne s’allonge pas forcément, se met à envahir tous les temps de la vie : ce phénomène semble occasionner un sentiment de surcharge psychique. L’Institut Montaigne (2023) souligne ainsi « un accroissement de l’intensité ressentie au travail, sans que la durée du travail soit en cause. […] Une forte majorité des actifs (60 %) considèrent que leur charge de travail a augmenté au cours des cinq dernières années ». 47 % des actifs interrogés estiment que leur travail est psychologiquement pénible et 24 % déclarent avoir une quantité de travail « excessive ». « On peut avoir une charge psychique lourde en travaillant trente-cinq heures, d’autant qu’on ne déconnecte plus », souligne Bertrand Martinot, spécialiste de l’emploi à l’Institut Montaigne (Rodier, 2023). Le phénomène récent appelé par les médias « démission silencieuse (ou quiet quitting 35) pourrait ainsi être une forme de réaction à cette déstructuration des temps des salariés et à leur sentiment de surinvestissement.
Le temps de travail, même lorsqu’il ne s’allonge pas forcément, se met à envahir tous les temps de la vie : ce phénomène semble occasionner un sentiment de surcharge psychique.
Des phénomènes imbriqués aux effets paradoxaux
Culte de l’urgence et sentiment de densification du travail sont intimement liés. Ainsi, l’extension du temps de travail « pour effet de dilater, en même temps que de durcir, la charge de travail des équipes » (Célérier et Monchatre, 2022), amenant paradoxalement certains syndicats à réclamer le retour de la pointeuse (autrefois symbole de contrainte aliénante, désormais perçue comme protectrice). Un phénomène auquel les outils numériques participent activement, comme le soulignent les travaux de Felio (2016a) selon qui le détournement synchrone des outils numériques ce qui, paradoxalement, réduit concrètement leur autonomie »
La flexibilité spatiale du travail à laquelle s’ajoute désormais la flexibilité temporelle, toutes deux soutenues par les outils numériques, ne peuvent donc se concevoir que conjuguées à une objectivation et une régulation de la charge de travail, pour qu’elles puissent rester porteuses de qualité de vie au travail autant que de qualité du travail.
- 35. Certains salariés ne veulent plus s’investir dans le travail au-delà des tâches précisément fixées dans leur fiche de poste.
Reconcevoir les processus de travail avec les outils numériques : le cas du travail hybride
Si les entreprises continuent de plaquer les outils numériques sur des processus inadaptés, le risque est grand de voir le mal-être des salariés augmenter à mesure que le travail hybride s’installe dans la durée. L’intensité d’usage des outils numériques peut venir réduire les bénéfices qui étaient attendus du travail à distance, tant par les salariés que par les entreprises. Il devient alors facile de le remettre en cause – quoiqu’il ait pu être perçu comme un progrès social – pour revenir au statu quo antérieur. Pour échapper aux dérives induites par l’intensification d’usage des outils numériques, il est important de saisir en profondeur toutes les implications du travail hybride et d’adapter en conséquence les manières de travailler en lien avec les outils numériques.
Imbrication et asymétrie du travail hybride
Le travail que l’on qualifie d’hybride est trop souvent conçu comme une simple alternance ou juxtaposition de lieux et de temps : des temps de travail à distance alterneraient avec des temps de travail sur site. Cette conception – celle qui est considérée dans la plupart des accords de télétravail (combien de jours de télétravail ?) – passe complètement à côté de la nature profonde de l’hybridité. « L’hybride, ce n’est pas ceci ou cela, un support ou un autre, un canal ou un autre, trois jours au bureau, puis deux en télétravail… Ce n’est ni de l’alternance ni de la juxtaposition ; c’est un entrecroisement, un mariage improbable d’activités… » débouchant sur « une tierce manière de travailler », nous dit la philosophe Gabrielle Halpern (2020).
Pour mieux saisir ce qui se joue dans le cadre du travail hybride, il importe de garder en tête deux mots-clés : imbrication et asymétrie.
Imbrication. Il s’agit de tresser ensemble des temps d’activité sur site (souvent sur plusieurs sites) et à distance, qui peuvent certes être vécus comme séquentiels du point de vue de la personne (elle est individuellement soit à distance, soit sur site) mais qui, sur un plan collectif, sont simultanés et doivent se fondre dans un processus de travail continu, destiné à réaliser une production donnée. Le processus doit rester fluide, quels que soient le lieu et les horaires auxquels les personnes travaillent. La coordination de l’action s’en trouve compliquée et nécessite de revoir les moments clés où la synchronisation est nécessaire. Toutefois, ce phénomène n’a rien de fondamentalement nouveau : il existait déjà largement du fait de l’éclatement des espaces et des temps entre sites, villes, pays, voire continents différents (lorsqu’on travaille sur plusieurs fuseaux horaires). Il s’agit donc surtout d’un changement d’échelle, puisque la complexité de la coordination se déplace au niveau micro de l’équipe, donc de l’unité de base. Notons que la colocalisation des équipes pouvait donner l’illusion aux managers de proximité de mieux maîtriser et contrôler cette intrication des actions, mais celles-ci étaient en fait déjà éclatées et « médiées » par de nombreux dispositifs numériques, y compris en situation de colocalisation – ne serait-ce que par les échanges de mails, dont le nombre s’est paradoxalement accru avec la généralisation des open spaces (Bernstein et Turban, 2018).
Asymétrie. Les personnes qui concourent au processus productif sont donc subjectivement soit à distance, soit sur site, mais elles sont collectivement à distance et sur site, ce qui produit entre elles une asymétrie. L’exemple le plus courant de cette asymétrie est la réunion dans laquelle certains sont collectivement présents dans une même pièce tandis que d’autres sont individuellement seuls derrière un écran. Si les réunions hybrides permettent d’impliquer des catégories de personnel auparavant non conviées aux réunions en présentiel du fait de leur éloignement géographique, elles peuvent aussi engendrer une mise à l’écart des participants à distance, par exemple
L’inconfort de l’asymétrie invite à réfléchir à de nouvelles manières de réaliser l’imbrication, et les outils collaboratifs peuvent précisément y aider, à condition de les coupler à une réflexion sur l’organisation du travail. La réflexion sur la nature réelle de l’hybridité commence tout juste à émerger. Comme l’explique Martin Richer, spécialiste de la RSE, « construire une culture d’entreprise repose sur un certain nombre de process qu’il faut mettre en marche et qui peuvent se faire en grande partie, et parfaitement, à distance. La raison pour laquelle ces idées reçues existent toujours est justement parce que le travail qui consiste à reconstruire et à faire vivre la culture d’entreprise en environnement hybride n’a pas été fait » (Entreprise & Carrières, 2023).
Des modèles à deux dimensions pour guider la mise en œuvre du travail hybride
Plusieurs modèles ont émergé dans le but de guider l’organisation du travail hybride.
Un premier modèle a été proposé par Bernard Coulaty et Caroline Roussel (2021), enseignants à l’IÉSEG School of Management (figure 5.1). Ils proposent de distinguer les activités selon qu’elles sont réalisées de manière individuelle ou collective, afin de déterminer celles qui peuvent s’exercer à distance et celles qui doivent s’exercer sur site, en fonction de l’objectif visé par l’activité : servir, produire, collaborer, fédérer.
Ce modèle croise des modalités d’exercice du travail (sur site ou à distance) et des types d’activités (en individuel ou en collectif).
Parmi les activités individuelles, « servir » (travail sur machine ou relation client) se ferait obligatoirement sur site, alors que « produire » (réfléchir, préparer des décisions, rédiger, etc.) recouvrirait des tâches préférablement réalisables à distance. Pour les activités collectives, « collaborer » pourrait se faire à distance grâce aux outils numériques collaboratifs, alors que « fédérer », qui repose sur un partage émotionnel, nécessiterait une coprésence physique.
Cette matrice est intéressante, mais la terminologie choisie pour sa nomenclature laisse perplexe : pourquoi « produire » serait-il réservé aux tâches intellectuelles et « servir » à la production en atelier ou en magasin ? En outre, la segmentation proposée paraît datée par certains aspects : il est parfaitement possible de « servir » les clients à distance, comme en témoigne le développement de l’e-commerce ou le service client multicanal de la MAIF multirécompensé36. La segmentation de Coulaty et Roussel peut paraître en revanche un peu optimiste sur d’autres aspects : il semble en effet prématuré d’affirmer que les seuls outils numériques permettront d’assurer des collaborations fluides – ce que les auteurs s’empressent d’ailleurs de nuancer en recommandant aussi des temps de collaboration sur site.
De son côté, Autissier (2021) propose de croiser distanciel et présentiel avec des types d’activités qu’il nomme Run pour celles qui renvoient à des tâches récurrentes, connues et répétées, et Build pour les tâches relatives au lancement de nouveaux projets, aux activités créatives mais également aux moments de socialisation et d’émulation collective (figure 5.2). Contrairement au modèle précédent, l’auteur se place clairement ici dans un cadre où les activités non éligibles au télétravail ne sont pas considérées.
Il serait tentant de conclure rapidement que les activités Run sont réalisables à distance, alors que les activités Build nécessitent d’être sur site. En réalité, l’auteur distingue cinq configurations possibles : Run à distance pour le contrôle et l’animation d’une production balisée et récurrente ; Run en présentiel lorsque cette production nécessite des échanges de coordination ou de traitement des dysfonctionnements ; Build sur site pour les lancements de projets, l’intelligence collective, les brainstormings créatifs, etc. ; Build à distance pour le suivi du projet lorsque les personnes se connaissent déjà. À ces quatre types d’activités s’ajoutent les prises de décision, qui peuvent se faire à distance pour les décisions courantes mais préférablement en présentiel pour les décisions les plus structurantes nécessitant des explications.
L’enrichissement par rapport au modèle précédent réside dans le fait que, pour choisir entre le mode présentiel et le mode distanciel, Autissier ne se contente pas d’utiliser le caractère individuel ou collectif des tâches. Partant du principe qu’à l’ère de la société de la communication et du savoir tout travail est structurellement collaboratif, il utilise comme critère principal de segmentation entre présentiel et distanciel l’intensité de la relation humaine requise par l’activité collective : moindre pour les tâches routinières ou déjà balisées entre personnes qui se connaissent, plus forte lorsqu’il s’agit de créer du lien ou une dynamique de groupe particulière.
Toutefois, aussi éclairants qu’ils soient, ces modèles à deux dimensions en sous-estiment une troisième qui est celle qu’apportent justement les usages des outils collaboratifs, à savoir la possibilité de travailler en mode asynchrone ou synchrone, quel que soit le lieu où l’on se trouve.
Une grille d’analyse à trois dimensions
La mise en œuvre du travail hybride au moyen d’outils numériques nécessite de prendre en compte trois dimensions : la dimension spatiale (présentiel ou distanciel), la dimension d’intensité relationnelle requise par l’activité, et enfin la dimension temporelle, qui reste la plus négligée dans l’analyse du travail hybride. En effet, bien plus que le lieu de travail, le travail à distance déstabilise le rapport au temps, traditionnellement l’un des plus structurants dans l’organisation du travail. Au sujet du travail à distance, les commentateurs ont beaucoup parlé du « travailler de n’importe où » et pas assez du « travailler n’importe quand ». Comme l’explique Isabelle Barth (2022), rendre en partie aux collaborateurs la « propriété » de leur temps de travail revient à s’attaquer directement à la relation de subordination dans sa manifestation la plus essentielle, ce qui est extrêmement déstabilisant pour le management, mais représente aussi un sujet clé pour s’ouvrir à de nouvelles perspectives.
C’est pourquoi, déterminer ce qui peut être accompli en mode synchrone ou asynchrone selon la nature de l’activité, ou selon différentes phases d’une même activité, revêt un potentiel de changement considérable. L’ ajout de cette troisième dimension (synchrone ou asynchrone) secondarise sans l’ éliminer la question de la localisation, puisque synchrone et asynchrone sont deux modes de travail pouvant tous deux être réalisés à distance par le biais des multiples outils de communication à notre disposition. Nos trois axes de réflexion sur la manière de considérer une activité en travail hybride deviennent ainsi : présentiel/distanciel ; individuel/collaboratif-coopératif ; synchrone/asynchrone, chacun de ces axes appelant un certain nombre de précisions.
L’axe spatial : présentiel ou distanciel
La première phase de réflexion concernant le travail hybride a consisté à rechercher quelles étaient les activités qui justifiaient d’être présent sur site et celles qui pouvaient être effectuées aussi, voire plus efficacement, à distance (voir ci-dessus les deux modèles).
Relevant d’activités de services, les entreprises de notre échantillon ont plus ou moins adopté la segmentation proposée par Autissier. Les réunions de routine (par exemple réunions hebdomadaires d’équipe, réunions de coordination simple, réunions d’informations générales) sont programmées en mode distanciel, même quand quelques personnes sont colocalisées. La présomption des individus est aujourd’hui que la réunion de travail se déroulera à distance, sauf spécification contraire37. En revanche, les réunions d’intelligence collective, les réunions de recherche de solutions ou les réunions de convivialité tendent à s’organiser avec une consigne de présentiel (avec possibilité d’hybride). Il existe néanmoins des segmentations plus subtiles et controversées (voir encadré ci-contre) entre lesquelles il paraît difficile de trancher sans les avoir soi-même expérimentées.
Concluons provisoirement sur l’idée qu’il y a matière pour chaque organisation à expérimenter les combinaisons de présentiel/distanciel qui s’avéreront les plus pertinentes. Même les entreprises en full-remote – qui restent rares – prévoient des temps de présentiel pour l’accueil des nouveaux, les célébrations, les situations d’urgence ou le lien collectif annuel.
Réunions de divergence et réunions de convergence : quelle modalité choisir entre présentiel et distanciel ?
Dans l’un des cabinets conseil de notre étude, dont une part de l’activité consiste à animer des séances de brainstorming et de génération d’idées chez des clients, les dirigeants et les consultants interrogés considèrent qu’avec les bonnes techniques numériques d’animation (par exemple l’usage d’un tableau blanc et de post-it numériques) les phases de divergence et de créativité peuvent tirer un bénéfice substantiel du distanciel. À distance, les personnes peuvent être moins inhibées qu’en présentiel ou moins soumises au « conformisme de groupe » : « Quand on est en phase de divergence, la distance peut se révéler favorable, car les personnes qui posent les post-it ne sont pas forcément identifiées à leur post-it ; du coup, elles s’expriment plus librement. » En revanche, les réunions de convergence, impliquant des prises de décision, sont beaucoup plus compliquées à réussir à distance et il est donc préférable de les organiser en présentiel : « Dans les ateliers en distanciel, la difficulté est d’aboutir à des décisions. En présentiel dans une salle de réunion, il y a un petit côté escape game : tant qu’on n’a pas pris de décision, on ne sort pas. »
Toutefois, cette approche empirique semble a priori battue en brèche par les résultats d’une étude récente comparant la capacité à générer des idées (créativité) selon qu’on soit en visioconférence ou en coprésence physique (Brucks et Levav, 2022). Selon cette étude38, les interactions en personne produiraient environ 15 % d’idées de plus que les interactions virtuelles (divergence). En revanche, quand les équipes doivent choisir leur meilleure idée (convergence), les échanges virtuels s’avèrent tout aussi fructueux qu’en présentiel, voire parfois légèrement supérieurs. Les chercheurs en ont déduit que seule la créativité était inhibée par la visioconférence, quand d’autres compétences ne semblaient pas affectées.
Cependant, l’article ne dit rien sur la manière dont la visioconférence a été utilisée dans le cadre de ces expériences de « créativité ». Les visios étaient-elles enrichies de tableaux blancs virtuels, comme dans l’exemple du cabinet conseil ? Ou la visio n’était-elle que le partage d’une galerie de visages, ce qui n’a effectivement guère d’intérêt pour réfléchir ensemble et peut même engendrer un épuisement cognitif entravant directement les processus créatifs ? La non-prise en compte de ces facteurs peut venir lourdement interférer sur la créativité individuelle et de groupe. Il paraît donc prématuré de conclure de façon définitive sur le lien absolu entre présentiel et créativité, car des usages innovants des outils numériques peuvent tout au contraire préserver, voire stimuler, la créativité à distance.
L’ axe de l’intensité relationnelle : travail individuel, collaboratif ou coopératif
Nous postulons qu’aujourd’hui la complexité des opérations rend en grande partie obsolète la dichotomie simple entre travail individuel et collectif. Même un travail partiellement réalisé en solo s’inscrit en fait dans une production collective. De ce fait, la distinction entre collaboration et coopération, dont nous avons déjà parlé au chapitre 1, nous paraît plus féconde, notamment au regard des usages liés aux nouveaux outils dits collaboratifs. Rappelons les principaux éléments distinctifs entre ces deux modalités de travail collectif (voir figure 5.3).
Beaucoup d’outils numériques permettent de travailler sur un projet commun, mais chacun à son tour, de manière séparée, séquentielle et discontinue (par exemple avec l’e-mail), le résultat étant produit par une juxtaposition d’actions individuelles. Cette manière de procéder est ce que nous appelons le « travail collaboratif », qui maintient une approche divisionnelle du travail. Il est intéressant, car il donne le temps à chacun de développer une réflexion propre, mais c’est aussi une manière de fonctionner assez lente car elle est séquentielle. D’autres outils numériques, comme Google Docs pour l’écriture collaborative ou Klaxoon pour les animations à distance, favorisent au contraire ce que nous désignons sous le terme de « travail coopératif » (production documentaire, brainstorming, prise de décision, etc.) : ils permettent de travailler ensemble à distance, de manière simultanée ou quasi simultanée, afin de permettre une percussion rapide et une fusion accélérée des idées ou des productions de chacun.
L’axe temporel : synchrone ou asynchrone
La communication synchrone s’effectue par principe en temps réel : les échanges se font en direct et de manière instantanée (conversation en présentiel, réunion physique, téléphone, audio et visioconférence, tchat, etc.). Le synchrone a l’avantage de la rapidité issue de l’instantanéité. En personne, il s’agit aussi de la communication la plus riche, car le verbal y est complété par des éléments contextuels liés à la voix (intonation, débit), au corps (posture, gestuelle, expressions du visage) qui suscitent des réactions et des ajustements. La visioconférence permet aussi d’avoir accès à ces deux aspects, mais ils sont atténués ou déformés, et donc plus difficiles à décrypter. Appels téléphoniques et audioconférences conservent les subtilités vocales sans celles du corps, quand le tchat présente la communication synchrone la plus pauvre, compensée par pléthore d’émojis.
La communication asynchrone, elle, se déroule en différé : elle consiste à envoyer un message sans attendre de réponse immédiate (courrier postal, e-mail, SMS, forum, blog, wiki, plateformes collaboratives et de partage de documents, outils de coordination et de gestion de projets, etc.). La communication asynchrone permet l’assimilation et la réflexion : elle donne le temps à l’ émetteur de formuler un message de bonne qualité tout en permettant au récepteur de l ’assimiler avec recul. Elle est aussi plus respectueuse du temps de chacun, et en particulier de la nécessité d’un temps de travail sans interruptions pour les tâches cognitives. En contrepartie, la communication asynchrone requiert la tolérance à un certain délai de réponse s’opposant ainsi au culte de l’urgence qui règne dans un grand nombre d ’organisations. Les pratiques consistant à inscrire dans l’objet d’un mail TU ou TTU39 font partie de celles qui contribuent à dévoyer un outil pensé pour l’asynchrone en communication synchrone ou quasi synchrone, comme nous l’avons vu au chapitre 4.
La revalorisation de l’asynchrone semble être l’un des premiers leviers à activer pour l’organisation du travail hybride. Il correspond en outre à une attente forte des salariés. Ces derniers semblent en effet encore plus demandeurs de flexibilité temporelle que de flexibilité spatiale. Une étude conduite par OpinionWay (Slack, 2022) souligne ainsi que si 55 % des salariés souhaitent bénéficier de conditions de travail plus flexibles en termes de lieux, ils sont 64 % à rechercher une flexibilité en termes d’horaires, des chiffres qui montent respectivement à 66 % et 72 % pour la génération Z (Canivenc, 2023b). Selon cette même enquête, un tiers des actifs (29 %) aimeraient travailler davantage de manière asynchrone pour gagner en flexibilité ; ce chiffre monte à 44 % chez les moins de 35 ans.
Cette flexibilité des temps de travail induit, pour la jeune génération, une exigence de révision des processus organisationnels pour atteindre davantage d’efficacité. Ces derniers sont, en effet, actuellement jugés comme fastidieux, confus ou démotivants : ces jeunes sont 45 % à penser qu’une amélioration des processus leur ferait gagner entre 7 et 20 heures par semaine, bien plus que les autres salariés (30 %) qui paraissent davantage résignés à toutes les formes de dysfonctionnements (Asana, 2021). En cause : non seulement des processus trop lents, des responsables débordés qui ne peuvent donner leur aval à temps et leur font rater des échéances, mais également des réunions et des appels vidéo (synchrones) chronophages et inutiles qui leur donnent l’impression de perdre leur temps et qui nourrissent leur frustration.
De façon encore plus intéressante, le parti pris d’une organisation du travail plus asynchrone devient un facteur de structuration des processus de travail : « Lorsque les demandes de dernière minute, “ASAP”, ne sont plus une option, une planification minutieuse est indispensable. Chacun apprend à planifier sa charge de travail et ses collaborations avec le plus grand soin, et prévoit le temps nécessaire pour que ses collègues puissent lire et répondre à ses demandes. Les collaborations sont moins stressantes et le travail est de meilleure qualité in fine » ( Salihefendic , 2019). On voit apparaître ici l’idée que la communication synchrone pourrait être un recours commode pour ceux qui ne savent pas organiser le travail (le leur et celui des autres), sont toujours en retard, changent d’avis en permanence, déportent leurs urgences sur leurs collaborateurs ou privilégient encore un microcontrôle des tâches.
La combinaison des trois axes (spatial, relationnel et temporel) permet ainsi de décrire un modèle à trois dimensions (voir figure 5.4).
Articuler les trois dimensions pour un modèle de travail full-flexible et efficient
Mettre en œuvre un travail hybride efficient nous invite à rechercher, de façon dynamique, de nouvelles manières de travailler à travers des combinaisons originales de ces trois dimensions, en mixant l’action synchrone et asynchrone, présentielle et à distance, individuelle, collaborative et coopérative, d’une façon qui soit propre et adaptée à chaque entité, à chaque équipe et surtout à chaque activité particulière. Dans cette perspective, l’enjeu se déplace de la question de la localisation des personnes à la gestion des phases d’une activité donnée, dont certaines ont besoin d’ être asynchrones et d ’autres synchrones, en lien avec le niveau d’intensité relationnelle requis (ou recherché) par l’activité.
Pour comprendre comment ces dimensions peuvent se combiner différemment grâce aux outils numériques par rapport à ce qui se faisait auparavant, donnons-en deux exemples.
1. Produire collectivement un document pour répondre à un appel d’offres
Pour répondre à un appel d’offres, une cheffe de projet senior explique ce que les outils collaboratifs ont changé pour elle et son équipe : « Aujourd’hui, quand on est consultant sur un gros appel d’ offres, on peut être à quinze sur le même document. Avant, on avait autant de documents que de personnes : “Tu fais ta partie, je fais la mienne, il y en a un qui consolide, je te renvoie un mail, attends j’ai oublié quelque chose, je te le renvoie.” C’est vraiment comme ça que l’on fonctionnait. Maintenant, ce qu’on fait, tout simplement, c’est une équipe [Teams] avec le nom de l’appel d’ offres. On a uniquement le dossier dessus et on peut tous travailler ensemble séparément ou en même temps. On a une petite pastille, et on voit directement ce que font les personnes, on peut même discuter autour du document. Si j’ai le document ouvert, il y a à côté une petite barre de conversation, je peux dire : “Attends, Elvira, tu as changé un truc, je ne suis pas d’accord”, elle me dit “voilà pourquoi j’ai fait ça” et on n’est obligées ni forcément d’ être ensemble ni de travailler sur deux documents différents, c ’est un gain de temps extraordinaire . Pour la consolidation, pour la mise en forme et même pour la relecture, c’est beaucoup plus simple . »
Autrement dit, la production documentaire peut alterner une phase synchrone (par exemple une réunion de lancement du nouvel appel d’offres en visio ou physique pour fixer les orientations, préciser les délais et se répartir les tâches), une phase de travail individuel asynchrone et plusieurs phases de mise au point synchronisées, partagées directement sur le document, sans nécessité d’organiser à nouveau une ou plusieurs réunions. Là où le travail était auparavant essentiellement asynchrone, individuel et séquentiel (de type collaboratif), il devient davantage coopératif, en mixant des phases asynchrones et synchrones beaucoup plus rapides et partagées. Le gain opérationnel est jugé assez spectaculaire avec une division au moins par deux, voire par trois, du temps de production.
2. Prendre une décision coopérative en réunion
L’un des leviers fondamentaux pour le renouvellement des réunions passe, ici encore, par la complémentarité entre des temps de réflexion asynchrones et des temps d’ échange synchrones. Actuellement, la réflexion partagée commence le plus souvent seulement au moment de la réunion synchrone (qu’elle soit physique ou virtuelle). Les temps de réflexion et d’échange sont donc entremêlés, ce qui conduit à une moindre qualité de réflexion et à un allongement de la réunion, sans que la prise de décision n’en soit forcément améliorée.
En revanche, l’association que nous avons étudiée utilise systématiquement deux temps distincts pour les réunions, des plus routinières aux plus stratégiques : le premier temps concerne la préparation de chacun à la réunion sur un document partagé qui agrège les réflexions et propositions de chaque participant ( i. e. collaboratif) ; le second concerne la discussion et la prise de décision collective ( i. e. coopératif). Pour les réunions stratégiques et budgétaires, cette organisation mobilise l’outil Klaxoon de la manière suivante : un board partagé est créé en amont de la réunion pour préciser l’ordre du jour. Puis chacun des participants à la réunion doit l’alimenter et exprimer (publiquement mais en asynchrone) sa position sur chaque sujet au travers de symboles : « favorable » via une coche verte ; « défavorable » via une croix rouge ; « plutôt favorable mais besoin d’en discuter » via une flèche verte ; « plutôt défavorable mais prêt à en discuter » via une flèche rouge ; « je ne sais pas » via un point d’interrogation (figure 5.5).
Les participants formulent également des commentaires sur le board à l’aide de différentes catégories de post-it : avis et recommandation sur un post-it jaune ; questions de clarification sur un post-it vert ; objection argumentée sur un post-it rose ; émotion et ressenti sur un post-it bleu (figure 5.6).
Ce travail en asynchrone permet de réfléchir en profondeur au sujet sur lequel on est invité ensuite à discuter et à réagir, plutôt que de le faire à chaud en réunion, ainsi que l’explique une participante : « Le fait de devoir poser ce qui se joue par écrit, sur un post-it versus le verbaliser, ce n’est pas du tout pareil. Et comme l’espace du post-it n’est pas grand, cela oblige vraiment à réfléchir à ce qu’on veut dire. Il n’est pas rare que mon post-it, je le réécrive quinze fois jusqu ’ à trouver la bonne formulation. Alors qu ’ à l ’oral j’aurais été beaucoup plus approximative . »
C’est seulement dans un second temps, une fois ce travail collaboratif de réflexion achevé et visible par tous, que la réunion se tient en mode synchrone (ce qui peut se faire autant en présentiel qu’en distanciel), afin d’aboutir à une décision. Les participants peuvent ainsi se concentrer sur l’essentiel : « Si la tendance est verte, on regarde directement les recommandations. Si la tendance est rouge, on rentre dans le sujet, on regarde ce qui bloque et on refait un tour. Cette manière de procéder nous permet de nous concentrer sur ce qui fait débat . »
Cette décomposition des réunions en deux étapes a permis un gain de temps considérable : « Avant, on se noyait dans la décision en oubliant pourquoi nous étions là. La prise de décision durait en moyenne trois heures. Nous avons divisé par trois en moyenne notre temps de réunion. »
Pour des réunions plus courantes, la préparation reste à peu près la même, sauf qu’elle se fait via un simple document partagé (sur Google Docs, par exemple) que les personnes enrichissent et annotent. Ici encore, l’intérêt de cette méthode est de permettre à chaque participant de s’approprier le sujet de la réunion, d’y réfléchir et de prendre connaissance d’une partie des arguments qui seront évoqués par les autres participants lors de la réunion.
***
La figure 5.7 rend compte de quelques exemples d’activités avec la combinaison possible des modalités et des outils pouvant être mobilisés. Ce tableau ne doit pas être vu comme une prescription relative à la combinaison des modalités ; ce n’est pas un modèle à copier-coller mais un guide pour entamer une réflexion dont le résultat pourra être différent selon les équipes et les entreprises, en fonction de leur culture et de leurs besoins opérationnels spécifiques. Les outils numériques ne sont que des instruments au service de ces combinaisons, et l’on voit d’ailleurs qu’ils sont assez interchangeables selon les activités.
Si chaque équipe doit évidemment construire ses propres combinatoires selon ses aspirations, culture et types d’activités, cette approche a le mérite d’enrichir la réflexion sur la conception des processus de travail. Elle ouvre la voie à un dépassement de la survalorisation habituellement accordée au couple synchrone/présentiel, au profit d’une nouvelle structuration de chaque processus, permettant de tirer parti des avantages respectifs de l’asynchrone comme du synchrone, du présentiel comme du distanciel, du travail individuel comme du travail collectif.
Ces nouvelles manières de travailler requièrent un temps d’apprentissage portant à la fois sur les outils et sur l’organisation du travail lui-même, ainsi que de la discipline. Un tel investissement peut souvent paraître fastidieux ou disproportionné, et ainsi les potentialités dont ces nouvelles solutions sont porteuses ne sont ni testées, ni adoptées. C’est pourtant à travers ces expérimentations que de nouvelles manières de travailler pourront émerger et se cristalliser.
- 36. La MAIF a été récompensée quatorze fois au Podium de la Relation Client depuis 2003.
- 37. À titre d’exemple : nous avions précisé à nos « terrains » que nous souhaitions réaliser nos entretiens d’enquête en présentiel. Au jour dit, nous nous sommes donc rendues dans les organisations concernées. À deux reprises, nos interlocuteurs n’y étaient pas et se sont connectés à distance. Quand nous leur avons demandé pourquoi, ils nous ont indiqué qu’à partir du moment où un rendez-vous est inscrit à leur agenda, ils considèrent que celui-ci a lieu en visio, sauf indication contraire (qui, en l’occurrence, ne leur avait pas été signalée).
- 38. Les auteurs de l’étude, experts en marketing à Columbia et Stanford, ont d’abord mené des tests en laboratoire avec 602 participants volontaires (des étudiants) appariés de manière aléatoire. Les paires étaient soit disposées en face à face dans une même pièce, soit séparées dans deux espaces distants, se parlant par appel vidéo. Chaque équipe avait 5 minutes pour trouver des usages créatifs à un frisbee et à du papier bulle (divergence). Puis chacune devait sélectionner son idée la plus créative (convergence). L’expérience a ensuite été reproduite en entreprise auprès de 1 490 ingénieurs en Finlande, Hongrie, Portugal, Inde et Israël. Lors d’ateliers dans leurs propres locaux, les groupes étaient invités à proposer des produits innovants pour leurs sociétés soit dans une même salle, soit en visio à distance.
- 39. TU = très urgent, TTU = très très urgent
Conclusion
Loin des promesses simples et séduisantes de certains fournisseurs de solutions, les « effets » des outils numériques de dernière génération sur l’organisation du travail se révèlent ambivalents, tout simplement parce qu’ils ne dépendent pas des outils mais des usages qu’on en fait en situation de travail. Nos études de terrain soulignent de nombreux effets bénéfiques possibles sur l’autonomie individuelle ressentie, sur la coopération, la proximité avec les managers et la transparence de l’information, mais ils ne se réalisent ni spontanément, ni systématiquement. Même dans des entreprises avancées en matière de maîtrise technique et sociale de ces outils, les usages spontanés qui en sont faits montrent un risque réel de désorganisation et de déstructuration des flux d’information. Ils aboutissent fréquemment à des formes de fragmentation de l’information et de morcellement de l’activité, qui viennent peser sur la charge mentale des salariés, affectant la qualité du travail autant que la productivité. Les outils sont incapables à eux seuls de déterminer l’émergence de pratiques de travail innovantes. Tout au contraire, quand ils sont greffés sur les anciennes manières de faire, sans autre considération, ils produisent des effets exactement inverses à ceux qui étaient attendus. Il s’agit donc de les faire entrer en dialogue et en résonance avec l’organisation, les membres qui la composent et les pratiques de travail existantes, pour espérer déployer leur potentiel.
La première embûche se situe dès la phase de déploiement. Pour rester cohérentes avec la logique flexible et non prescriptive de ces outils, les entreprises ont tendance à les déployer selon une approche qualifiée de provide and pray , qui peut s’apparenter à une forme de laisser-faire. Cette approche engendre des effets pervers. Pour la bonne raison qu’ils sont collaboratifs – c’est-à-dire qu’ils présupposent des usages collectifs et non solitaires –, ces outils ne peuvent se passer de pratiques communes, s’appuyant sur la connaissance intime des besoins opérationnels et des contraintes des équipes. Un accompagnement multidimensionnel et local associant des dispositifs formels et informels est nécessaire non seulement pour l’apprentissage fonctionnel, mais surtout pour faire émerger des pratiques collectives partagées et potentiellement innovantes.
L’absence de prescription encapsulée dans ces outils ne doit donc pas être confondue avec une absence de régulation de leurs usages. L’émergence de pratiques de travail innovantes soutenues par les outils numériques ne peut résulter que d’une conjonction de régulations gigognes : individuelle, managériale, collective et institutionnelle. Prendre conscience de la nécessité de ces régulations constitue une étape importante pour que ces outils puissent produire des effets bénéfiques pour l’organisation et pour ses membres. Si les organes de direction conservent bien entendu un rôle structurant sur plusieurs plans (cybersécurité, astreintes), le centre de gravité de la régulation tend à se déplacer vers les équipes de travail. Ce sont d’elles que peut émerger une forme de régulation collective issue du dialogue professionnel, collant au plus près des réalités opérationnelles. Les instances dirigeantes ont intérêt à encourager et à soutenir l’instauration de ce dialogue professionnel local intra et interéquipes, sans pour autant y intervenir directement. Un tel dialogue n’émergera, en effet, que rarement de façon spontanée, du fait des habitudes installées, de la « paresse » managériale ou de l’existence d’un grand nombre de priorités concourantes. En l’absence de ces régulations, un cercle vicieux déstructurant s’installe avec sa cohorte d’effets pervers : chaos informationnel, infobésité, surcharge cognitive, épuisement, etc.
Toutefois ces régulations resteront en partie impuissantes si elles ne tiennent pas compte d’un phénomène déterminant en toile de fond : les mésusages des outils numériques – souvent déjà dévoyés en outils de travail synchrones par le culte de l’urgence – se conjuguent avec les pratiques spatio-temporelles flexibles pour produire un morcellement du travail et un recours accru aux horaires atypiques qui finissent par « manger » tous les temps de la vie. Ce cocktail détonant agit négativement sur la santé psychique et physique des salariés, ainsi qu’à terme sur l’efficience de l’organisation, comme le montre un certain nombre d’études récentes.
Faudrait-il dès lors renoncer à la flexibilité spatio-temporelle soutenue par les outils numériques – même si elle reste éminemment désirée par les salariés – au nom des risques psychosociaux ? Cette hypothèse régressive est malheureusement déjà envisagée par d’aucuns. De nombreuses déclarations de grands patrons dans le monde anglo-saxon laissent penser que les pratiques issues de la crise du Covid pourraient être mises en cause (Primeum, 2022). Les arguments invoqués mélangent souvent des préjugés récurrents (Canivenc et Cahier, 2021a) et des risques réels (Canivenc, 2023a, 2023b) : le télétravail nuirait à la cohésion d’entreprise, à l’engagement, à la valeur « travail », à la créativité (les préjugés), à l’intégration des jeunes et à l’égalité entre les hommes et les femmes (les risques réels). Selon ces dirigeants, « les salariés sont heureux de venir au bureau », ou encore « c’est pour préserver la qualité du travail que nous refusons le télétravail » (Cadremploi, 2022). « C’est un peu court, jeune homme ! » aurait dit Cyrano.
Personne ne conteste que le travail hybride puisse être compliqué à faire fonctionner, mais il l’est d’autant plus que la nature de l’hybridité au travail n’est en réalité que peu analysée. Loin de se réduire à une juxtaposition binaire entre présentiel et distanciel qui déterminerait les activités à réaliser de manière collective ou individuelle, l’hybride est un tressage complexe qui peut ouvrir sur une multitude de combinaisons de présentiel et distanciel, d’activités synchrones et asynchrones, de travail individuel, collaboratif et coopératif, rendues justement possibles par des usages innovants des outils numériques. C’est donc à une réflexion approfondie sur la manière de faire évoluer les processus de travail conjointement aux usages des outils numériques que nous sommes invités, plutôt qu’au repli sur les anciennes formes de travail.
L’ensemble de ces constats nous incite à sortir définitivement des illusions déterministes. Les outils ne vont pas résoudre les problèmes socio-organisationnels auxquels les entreprises et les travailleurs sont confrontés. Inversement, ce n’est pas non plus le modèle organisationnel de l’entreprise qui déterminera à lui seul l’expression du potentiel positif de ces outils. Les organisations, qu’elles soient hiérarchiques ou horizontales, peuvent toutes tomber dans le même travers : oublier l’importance des processus de régulation et de structuration. In fine , c’est un cercle vicieux qui se met en place, venant renforcer les dysfonctionnements socio-organisationnels que l’on tentait de résoudre par l’introduction de ces outils. Comme le recommandait déjà en son temps Simondon (1958), il ne s’agit ni d’ être maître ni d ’ être esclave des outils numériques, mais d ’entrer en dialogue avec eux en comprenant que les processus techniques et les processus sociaux sont profondément imbriqués. L’apparition de ces nouveaux outils, de même que les nouvelles modalités de travail flexibles qu’ils autorisent, se révèle finalement une occasion de mettre le travail réel au cœur du débat et de faire émerger des pratiques de « design du travail » (Pellerin et Cahier, 2021).
À cet égard, les outils numériques nous permettent d’ailleurs de faire un pas de côté : en partant non plus seulement de l’activité pour penser la technologie, comme le préconisent les ergonomes, mais également des technologies pour « repenser » et « repanser » le travail (Boboc et Bobillier-Chaumon , 2017). Plutôt que de se reposer passivement sur les outils, il s’agit au contraire de les mettre au cœur du dialogue professionnel et des questions organisationnelles. La mise en débat de l’usage des outils numériques est une porte d’entrée pour parler concrètement de notre activité de travail, objectiver nos besoins et nos contraintes en relation avec les réalités auxquelles sont également confrontés nos collègues : « [L’outil] permet de faire comprendre au service de marketing que le service de recherche et développement n’a pas la même façon de travailler, qu’il est important d’être respectueux de la manière dont ils réagissent, de ne pas avoir des exigences qui ne correspondent pas à leurs façons de faire le travail » ( Ibid. ). Que ce soit «en creux» (Monneuse, 2014) ou par « effet de loupe » (Boboc et Bobillier-Chaumon, 2017), les outils numériques sont des révélateurs permettant d’objectiver l’organisation du travail pour s’ouvrir à l’expérimentation de nouvelles pratiques.
Ne ratons pas cette chance qui s’offre à nous avec l’accélération soudaine de la digitalisation collaborative des entreprises. Née des contraintes de la crise sanitaire, elle est également une occasion à saisir pour renouveler notre conception du travail et de nos pratiques.
Bibliographie
Études, rapports et enquêtes
ADP Research Institute (2022). People at Work 2022: A Global Workforce View. Rapport issu d’une enquête menée en novembre 2021 auprès de 32 924 actifs dans 17 pays, dont 1 951 en France, https://www.adpri.org/wp-content/uploads/2022/04/PaW_Global_2022_GLB_US-310322_MA.pdf
Asana (2021). L’Anatomie du travail – rapport spécial : le leadership face aux besoins de la génération Z. Étude menée par GWI en septembre 2021 auprès de 10 624 travailleurs en Allemagne, Australie, États-Unis, France, Japon, Royaume-Uni et Singapour. https://resources.asana.com/france-gen-z-anatomy-of-work-report-2022.html?utm_source=bdm&utm_medium=paid&utm_campaign=genz
Atlassian (2021). Collaboration Maturity Survey. Enquête YouGov menée en France et en Allemagne auprès de 254 décideurs informatiques et 1 032 salariés du 29 avril au 3 mai 2021.
CR É DOC (2023). Baromètre du numérique, édition 2022. Enquête sur la diffusion des TIC dans la société française. Enquête menée auprès de 4 184 personnes de 12 ans et plus.
Gartner (2019, 2021a). Digital Worker Experience Survey. Le premier rapport est basé sur une enquête menée de mars à avril 2019 auprès de 7 261 répondants aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Le second se fonde sur une enquête menée de novembre à décembre 2020 auprès de 10 080 employés des mêmes aires géographiques. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-08-23-gartner-survey-reveals-44-percent-rise-in-workers-use-of-collaboration-tools-since-2019
Gartner (2021b). Gartner Says Cloud Will Be the Centerpiece of New Digital Experiences. Press release, November 10, 2021. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-11-10-gartner-says-cloud-will-be-the-centerpiece-of-new-digital-experiences
Institut Montaigne (2023). Les Français au travail : dépasser les idées reçues. Enquête menée auprès de 5 001 actifs en emploi, février 2023.
Lecko (2022). État de l ’art de la transformation interne des organisations. Enquête YouGov menée auprès de 1 007 personnes travaillant dans des entreprises de plus de 500 employés en France en janvier 2022. https://referentiel. lecko.fr/etat-de-lart-2022/
Lecko (2023). État de l ’art de la transformation interne des organisations. Enquête Ipsos auprès de 1 000 salariés travaillant dans des entreprises de plus de 500 employés en France. https://referentiel.lecko.fr/etat-de-lart-2023/
Mailoop (2021). Baromètre des usages numériques et de la déconnexion.
Mailoop/Observatoire de l ’infobésité et de la collaboration numérique (2023). Référentiel annuel 2023 de l’infobésité et de la collaboration numérique. https://www.infobesite.org/
Malakoff Humanis (2022). Baromètre annuel Télétravail et organisations hybrides. Regards croisés salariés et dirigeants du secteur privé, 24 février 2022. Étude basée sur les baromètres annuels menés de 2017 à 2021 et sur plusieurs études « flash » réalisées de février 2020 à janvier 2022 auprès de salariés (1 000 à 1 600) et de dirigeants (400 à 450).
Microsoft (2021). The Next Great Disruption Is Hybrid Work – Are We Ready? Work Trend Index Annual Report. Rapport basé sur une enquête menée en janvier 2021 auprès de 30 000 personnes travaillant dans 31 pays et sur une analyse de milliards de signaux de productivité sur Microsoft 365 et LinkedIn.
Microsoft (2022). Hybrid Work Is Just Work. Are We Doing It Wrong? Work Trend Index Annual Report. Rapport basé sur une enquête menée entre juillet et août 2022 auprès de 20 000 personnes dans 11 pays et sur une analyse de milliards de signaux de productivité sur Microsoft 365 et LinkedIn.
OpenText (2022). Les effets de la surcharge d’informations sur les Français en 2022. Enquête menée par 3Gem auprès de 27 000 actifs de 12 pays (dont la France), mars 2022.
ORSE et Réalités du dialogue social (2022). Benchmark des accords sur le télétravail depuis l’accord national interprofessionnel de 2020. mars 2022. https://www.orse.org/fichier/4744
PEGA (2022). Tout savoir sur la complexité du travail moderne. Rapport sur l’évolution de la main-d’œuvre 2022. Enquête menée auprès de 4 017 employés dans 14 pays (dont 256 en France) entre le 24 janvier et le 13 février 2022.
Slack (2021). Les employés de bureau et les technologies (mise à jour 7 sept. 2021). Sondage OpinionWay pour Slack mené auprès de 1 032 employés de bureau français travaillant dans des entreprises de 20 salariés et plus, du 5 au 9 juillet 2021. https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinionway-pour-slack-les-employes-de-bureau-et-les-technologies-juillet-2021/download.html
Slack (2022). Les actifs et les conditions de travail flexibles. Enquête OpinionWay pour Slack menée en octobre 2022 auprès de 1 075 actifs. https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-slack-les-actifs-et-les-conditions-de-travail-flexibles-novembre-2022/viewdocument/3024.html?Itemid=0
Speechi (2021). Quand la visioconférence change la vie des cadres (et des entreprises).
https://www.speechi.net/fr/home/dossier-visioconference/sondage-ifop-visioconference-entreprise/
The Shift Project (2018). Rapport Lean ICT – Pour une sobriété numérique. Groupe de travail dirigé par H. Ferrebœuf, octobre 2018.
Articles et ouvrages
Adams, G. S., Converse, B.A., Hales, A.H. , & Klotz L. E. (2021). People systematically overlook substractive changes. Nature, 592, pp. 258-261.
Ajzen, M., Donis, C., & Taskin, L. (2015). Kaléidoscope des Nouvelles Formes d’Organisation du Travail : l ’instrumentalisation stupide d’un idéal collaboratif et démocratique. Gestion 2000 , vol. 32, mai-juin, pp. 125-147.
Aksoy C. G., Barrero J. M., Bloom N., Davis S. J., Dolls M., & Zarate P. (2023). Time Savings When Working from Home. Global Survey of Working Arrangements (G-SWA) . National Bureau of Economic Research (NBER), January 2023.
Arendt, H. (1961). Condition de l’homme moderne. Calmann-Lévy.
Arzumanyan L., & Mayrhofer U. (2016). L’adoption des outils numériques dans les communautés de pratique. Le cas du Groupe SEB. Revue française de gestion, 2016/1, n° 254, pp. 147-162.
Autissier, D. (2021). Vers des organisations Build & Run. In Autissier, D., Peretti, J.-M., & Besseyre des Horts, C.- H. (dir.). Travail & organisation hybride. Organiser le travail et manager en mode présentiel/distanciel . MA éditions.
Bailenson, J. N. (2021). Nonverbal overload: A theoretical argument for the causes of Zoom fatigue. Technology , Mind, and Behavior, vol. 2, n° 1, February 23, 2021.
Barth, I. (2022). Le télétravail déstabilise toutes nos conceptions du temps. Xerfi Canal , 21 novembre 2022. https://www.xerficanal.com/strategie-management/emission/Isabelle-Barth-Le-teletravail-destabilise-toutes-nos-conceptions-du-temps_3750846.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=XC211122&utm_medium=email
Bembaron, E. (2016). Klaxoon, la start-up qui veut réveiller les réunions. Le Figaro , 26 septembre 2016.
Benedetto-Meyer, M. (2017). Des outils numériques en quête d’inscription organisationnelle. Le cas d’une plateforme interne de compétences dans une entité de recherche & innovation. Réseaux , 2017/5, n° 205, pp. 203-233.
Benedetto-Meyer, M., & Boboc, A. (2021). Sociologie du numérique au travail . Armand Colin.
Benedetto-Meyer, M., & Klein, N. (2017). Du partage de connaissances au travail collaboratif : Portées et limites des outils numériques. Sociologies pratiques , vol. 34, n° 1, pp. 29-38.
Bernstein, E., & Turban, S. (2018). The impact of the “open” workspace on human collaboration. Philosophical Transactions of the Royal Society B , vol. 373, August 2018.
Bertin, E., Colléaux, A., & Leclercq-Vandelannoitte, A. (2020). Collaboration in the digital age: From email to enterprise social networks. Systèmes d’information & management , vol. 25, n ° 1, pp. 7-46.
Bia, M., & Kalika, M. (2004). Les chartes d’ utilisation des TIC : facteurs organisationnels de contingence d’une pratique émergente en France. European & Mediterranean Conference on Information Systems, Tunis, 25-27 juillet 2004.
Bobillier-Chaumon, M.- É . (2003). Évolutions techniques et mutations du travail : émergence de nouveaux modèles d’activité. Le travail humain , 2003/2, vol. 66, pp. 161-192.
Boboc, A. (2017). Numérique et travail : quelles influences ?, Sociologies pratiques , 2017/1, n° 34, pp. 3-12.
Boboc, A., & Bobillier-Chaumon, M.- É . (2017). Entretien avec Marc-Éric Bobillier-Chaumon. Sociologies pratiques , 2017/1 , n° 34, pp. 15-19.
Boboc, A., Gire, F., & Rosanvallon, J. (2015). Les réseaux sociaux numériques. Vers un renouveau de la communication dans les entreprises ? Sociologies pratiques , vol. 30, n° 1, pp. 19-32.
Bodhaine, L. (2016). L’histoire de Lotus Notes. SIKIA, mai 2016.
Boltanski, L., & Chiapello, È . (1999). Le Nouvel Esprit du capitalisme . Gallimard.
Boudokhane-Lima, F., & Felio, C. (2015). Les usages professionnels des TIC : des régulations à construire. Communication & Organisation , 2015/2, n° 48, pp. 139-150.
Boukef, N., & Charki, M. H. (2019). The Millefeuille theory revisited. New theoretical lenses to understand the Millefeuille effect. Systèmes d’information & management , 2019/2, vol. 24, pp. 47-83.
Boutet, A., & Trémenbert, J. (2009). Mieux comprendre les situations de non-usages des TIC. Le cas d’internet et de l’informatique. Réflexions méthodologiques sur les indicateurs de l’ exclusion dite numérique. Les Cahiers du numérique , 2009/1, vol. 5, pp. 69-100.
Brasseur M., & Biaz F. (2018). L’impact de la digitalisation des organisations sur le rapport au travail : entre aliénation et émancipation. Question(s) de management, 2018/2, n° 21, pp. 143-155.
Brucks , M. S., & Levav, J. (2022). Virtual communication curbs creative idea generation. Nature, 605, May 5, 2022, pp. 108-112.
Burns, T., & Stalker, G. M. (1961). The management of innovation . Tavistock Publications.
Cadremploi (2022). Les employeurs qui disent « non » au télétravail sont-ils has been ? 25 avril 2022 . https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/teletravail-que-penser-des-entreprises-qui-refusent-le-travail-a-distance
Canivenc, S. (2012). L’autogestion dans la société de l’information québécoise. Cahiers du Crises (Centre de recherche sur les innovations sociales), Collection É tudes théoriques, n° ET1115, février 2012.
Canivenc, S. (2022a). Les nouveaux modes de management et d’organisation : innovation ou effet de mode ? Les Notes de La Fabrique, Presses des Mines.
Canivenc, S. (2022b). Le no code et les effets organisationnels de la démocratisation logicielle : du mythe aux pratiques. Relations industrielles/Industrial Relations , vol. 77, n° 3.
Canivenc, S. (2023a). Télétravail des femmes : des effets ambigus sur la santé et l’ égalité . Repère Futurs du travail, n° 11, Chaire FIT 2 , janvier 2023.
Canivenc, S. (2023b). Génération Zèbre : les jeunes et le travail hybride, Repère Futurs du travail, n° 12, Chaire FIT 2 , février 2023.
Canivenc , S., & Cahier, M.-L. (2021a). Le travail à distance dessine-t-il le futur du travail ? Les Notes de La Fabrique, Presses des Mines.
Canivenc, S., & Cahier, M.-L. (2021b). Proximité et distance, communication synchrone et asynchrone, Repère Futurs du travail, n° 1, Chaire FIT 2 , août 2021.
Canivenc, S., & Cahier, M.-L. (2022). Comment les usages du no code impactent le travail. Repère Futurs du travail, n° 4, Chaire FIT 2 , février 2022.
Célérier, S., & Monchatre, S. (2022). Nouvelles temporalités du travail : de l’éclatement à l’hégémonie ? Questions de communication [en ligne], n° 41.
Chevallier, É., & Coallier, J.-C. (2021). De la transformation digitale de l’outil de travail à la transformation des pratiques de travail. Comment créer les conditions de réussite par le sens au travail. In Edey Gamassou, C., & Mias, A. (coord.). Dé-libérer le travail, démocratie et temporalités au cœur des enjeux de santé au travail , Teseo.
Ciampi, C., & Berland, N. (2019). Usages des technologies et dissolution du contrôle social : cas de l’appropriation d’une base de données à visée collaborative. Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, 2019/61, vol. XXV, pp. 25-59.
Clot, Y. (2014). Réhabiliter la dispute professionnelle. Le Journal de l’ É cole de Paris du management , 2014/1, n° 105, pp. 9-16.
Clot, Y. (2021). Le Prix du travail bien fait . La coopération conflictuelle dans les organisations . Paris, La Découverte.
Comtet, I. (2009) . Entre usage professionnel des TIC et structure organisationnelle : la capacité au bricolage comme compétence adaptative. Études de communication , 2009/2, n° 33, pp. 119-134.
Coulaty , B., & Roussel C. (2021). Piloter l’engagement des télétravailleurs dans l’espace et le temps, nouveau défi du leadership. Harvard Business Review, 18 mai 2021.
Crochet-Damais, A. (2022). Klaxoon : la plateforme de management visuel universel. JDN , 5 juillet 2022.
Crozier, M., & Friedberg, E. (1977). L’Acteur et le Système. Paris, Seuil.
DeFilippis, E., Impink, S. M., Singell, M., Polzer, J. T., & Sadun, R. (2020). Collaborating during Coronavirus: The impact of Covid- 19 on the nature of work. National Bureau of Economic Research (NBER), Working paper series, July 2020.
Deshayes, C. (2019). La transformation numérique et les patrons . Les Docs de La Fabrique, Presses des Mines.
Dudézert, A. (2018). La Transformation digitale des entreprises . Paris, La Découverte.
Entreprise & Carrières (2023). Table ronde : L’hybridation du travail n’est pas la cohabitation du présentiel et du télétravail, 4 janvier 2023.
Favier, L. (2019). Dopamine. Arte. https://www.arte.tv/fr/videos/085801-009-A/dopamine/
Felio, C. (2016a). In Carayol, V., Felio, C., Boudokhane-Lima, F., & Soubiale, N. (dir.). La laisse électronique. Les cadres débordés par les TIC. Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine.
Felio , C. (2016b). Une étude qualitative longitudinale sur un échantillon régional de 62 cadres. In Carayol, V., Felio, C., Boudokhane-Lima, F., & Soubiale, N. (dir.). La laisse électronique. Les cadres débordés par les TIC.Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine.
Freeman, J. (1970). La tyrannie de l’absence de structure . Traduit dans : https://infokiosques.net/spip.php?article2
Grosjean, V., & Morand, O. (2021). TIC, hyperconnexion et surconnexion : comprendre la dynamique des atteintes psychosociales pour les prévenir. Note technique de l’INRS, Hygiène & sécurité du travail , n° 265, décembre 2021.
Guesmi, S., & Rallet, A. (2012). Web 2.0 et outils de coordination décentralisée. Un entrelacement des sphères privées et professionnelles. Revue française de gestion , 2012/5, n° 224, pp. 139-151.
Halpern, G. (2020). Tous centaures ! Éloge de l’hybridation . Paris, Le Pommier.
Himanen, P. (2021). L’ É thique hacker et l’esprit de l’ ère de l ’information . Exils.
Iribarne, P. (d’) (1989). La Logique de l’honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales . Paris, Seuil.
Jacot, J.-H. (1994). Formes anciennes, formes nouvelles d’organisation. Presses universitaires de Lyon.
Jauréguiberry, F. (2014). La déconnexion aux technologies de communication. Réseaux , 2014/4, n° 186, pp. 15-49.
Jemine, G. (2017). Déploiement de dispositifs numériques au sein de nouvelles formes d’organisation : de l’émergence à la stabilisation. Sociologies pratiques , 2017/1, n° 34, pp. 49-59.
Johnson-Lenz, P., & Johnson-Lenz, T. (1982). Groupware : the process and impacts of design choices. In Kerr, E., & Hiltz, S., (dir.). Computer-mediated communication systems . Academic Press.
Jouët, J. (1993). Pratiques de communication et figures de la médiation. Réseaux, 1993/4, n° 60, pp. 99-120.
Kalika, M., Boukef-Charki, N., & Isaac, H. (2007). La théorie du millefeuille et l’usage des TIC dans l’entreprise. Revue française de gestion , 2007/3, n° 172, pp. 117-129.
Khalil, C., & Dudézert, A. (2014). Entre autonomie et contrôle : quelle régulation pour les systèmes de gestion des connaissances ? Systèmes d ’information & management , 2014/1, vol. 19, pp. 51-76.
Kooti, F., Aiello, L. M., Grbovic, M., Lerman, K., & Mantrach, A. (2015). Evolution of conversations in the age of email overload. International World Wide Web Conference , Florence, May 18-22, 2015.
Louart, P. (1996). L’apparente révolution des formes organisationnelles, Revue française de gestion n° 107, janvier-février, pp. 74-85.
Mallard, A. (2014). Métamorphoses d’une question scientifique. Trente ans de recherches sur l ’inscription des TIC dans les univers productifs. Réseaux , 2014/2-3, n° 184-185, pp. 33-69.
Manifeste agile (2001). http://agilemanifesto.org/
Mariotti, F. (2005). Qui gouverne l ’entreprise en réseau ? Presses de Sciences Po.
Mark, G., Gudith, D., & Klocke, U. (2008). The cost of interrupted work: more speed and stress. SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems , April 6, 2008, pp. 107-110.
Monneuse, D. (2014). Les réseaux sociaux d ’entreprises : entre promesses et illusions . Les Notes de l’Institut, Institut de l’entreprise.
Morand, O. (2020). Mise en débat des pratiques liées à la connexion et à la surconnexion . Thèse de doctorat, Télécom Paris IPP.
Navarro, C. (2001). Partage de l’information en situation de coopération à distance et nouvelles technologies de la communication : bilan de recherches récentes. Le travail humain , 2001/4, vol. 64, pp. 297-319.
Orlikowski, W. (1993). Learning from notes: Organizational issues in groupware implementation. The Information Society , vol. 9, n° 3, pp. 237-250.
Pellerin, F., & Cahier, M.-L. (2021). Le design du travail en action. Transformation des usines et implication des travailleurs . Les Notes de La Fabrique, Presses des Mines.
Piquet, A. (2009). Guide pratique du travail collaboratif : théories, méthodes et outils au service de la collaboration. https://www.a-brest.net/IMG/pdf/Guide_pratique_du_travail_collaboratif.pdf
Popper, K. (1992). Un univers de propensions. Deux études sur la causalité et l’évolution . Collection : tiré à part, Éditions de l’éclat.
Primeum (2022). Faut-il mettre un terme au télétravail ? [Blog ], 6 septembre 2022. https://www.primeum.com/fr/blog/faut-il-mettre-un-terme-au-teletravail
Rodier, A. (2023). Des salariés satisfaits mais tendus : l’intensification du travail a augmenté la charge mentale. Le Monde, 2 février 2023. https://www.lemonde.fr/emploi/article/2023/02/02/des-salaries-satisfaits-mais-tendus-l-intensification-du-travail-a-augmente-la-charge-mentale_6160210_1698637.html#xtor=AL-32280270-%5Bdefault%5D-%5Bios%5D
Salihefendic, A. (2019). La communication asynchrone : la vraie raison pour laquelle les employés en télétravail sont plus productifs [Blog]. D oist. https://blog.doist.com/communication-asynchrone/
Simondon, G. (1958). Du mode d’existence des objets techniques. Éditions Aubier-Montaigne.
Soubiale, N. (2016a). Déconnexion, idéologie managériale et communication numérique dans les organisations. In Carayol, V., Felio, C., Boudokhane-Lima, F., & Soubiale, N. (dir.). La laisse électronique. Les cadres débordés par les TIC. Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine.
Soubiale, N. (2016b). Une enquête en ligne auprès de 613 cadres sur l’hyperconnexion, le stress professionnel et la déconnexion. In Carayol, V., Felio, C., Boudokhane-Lima, F., & Soubiale, N. (dir.). La laisse électronique. Les cadres débordés par les TIC . Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine.
Stiegler, B. (2014). Pharmacologie de l’ épistémè numérique. In Stiegler, B. (coord .). Digital Studies. Organologie des savoirs et technologies de la connaissance . FYP éditions .
Talukder, M. (2014). Managing Innovation Adoption : From Innovation to Implementation . Surrey, Routledge.
Taskin , L. (2012). Déspatialisation : enjeux organisationnels et managériaux. Perspective critique et études de cas sur la transformation du contrôle dans le cadre du télétravail à domicile. Éditions universitaires européennes.
Veltz, P., Zarifian, P. (1993). Vers de nouveaux modèles d’organisation. Sociologie du travail , n° 1, pp. 3-25.
Weil T., & Dubey A.-S. (2020). Au-delà de l’entreprise libérée : enquête sur l’autonomie et ses contraintes , Les Notes de La Fabrique, Presses des Mines.
Annexe
Détail méthodologique de l’étude. Par convention, les titres des fonctions sont donnés au masculin sans préjuger du genre de l’interlocuteur.
Suzy Canivenc et Marie-Laure Cahier, Numérique collaboratif et organisation du travail. Au-delà des promesses, Paris, Presses des Mines, 2023.
ISBN : 978-2-38542-397-1 ISSN : 2495-1706
© Presses des Mines ‒ Transvalor, 2023
60, boulevard Saint-Michel ‒ 75272 Paris Cedex 06 ‒ France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel ‒ 75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr