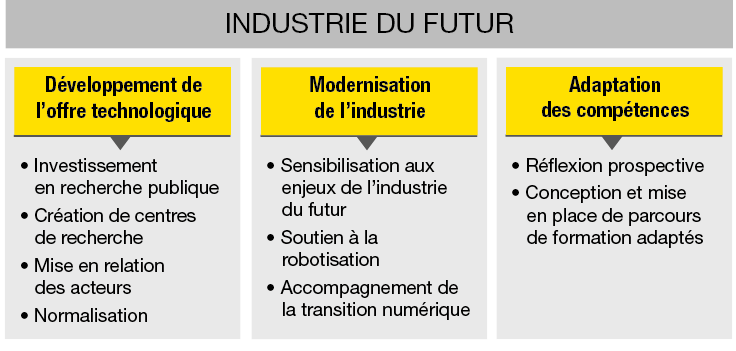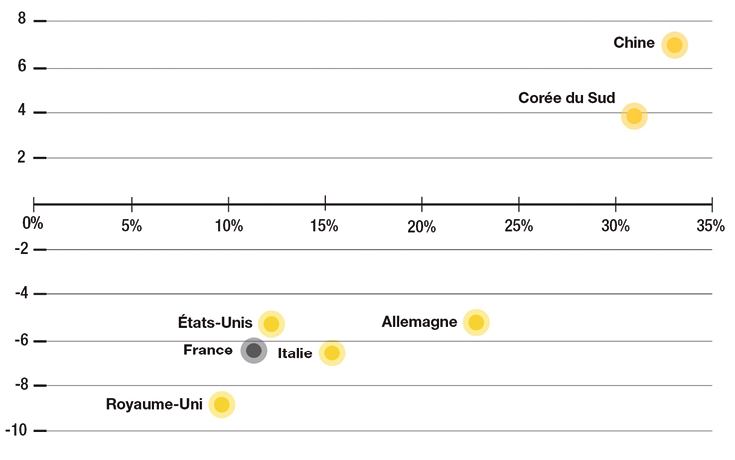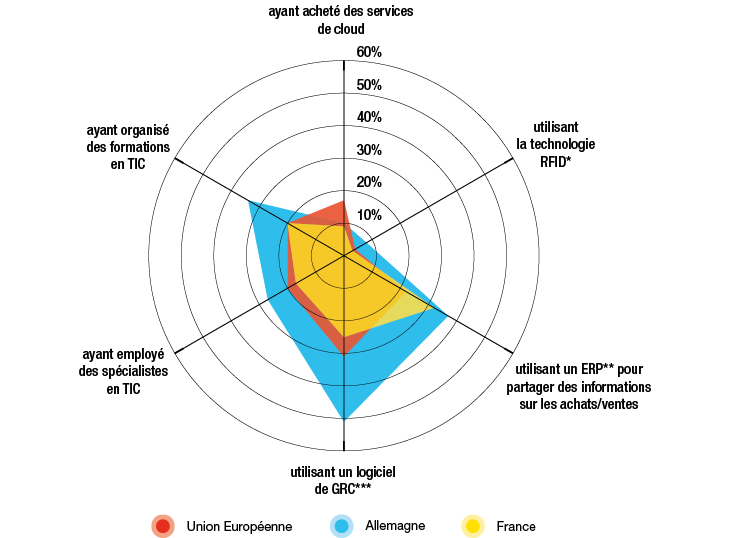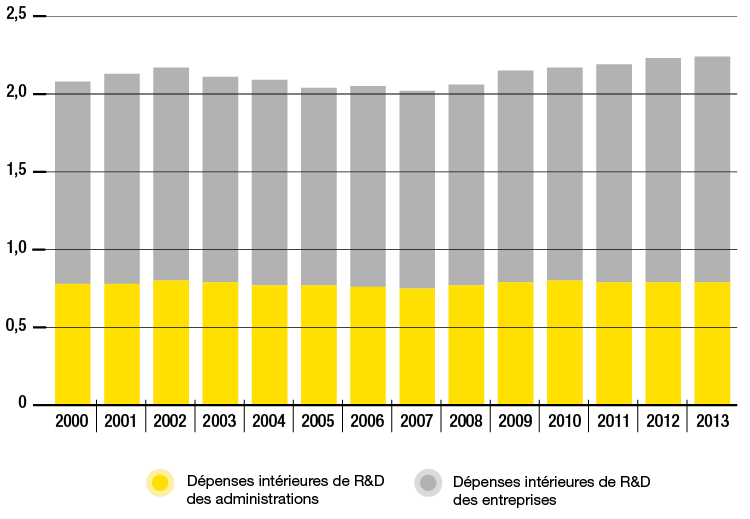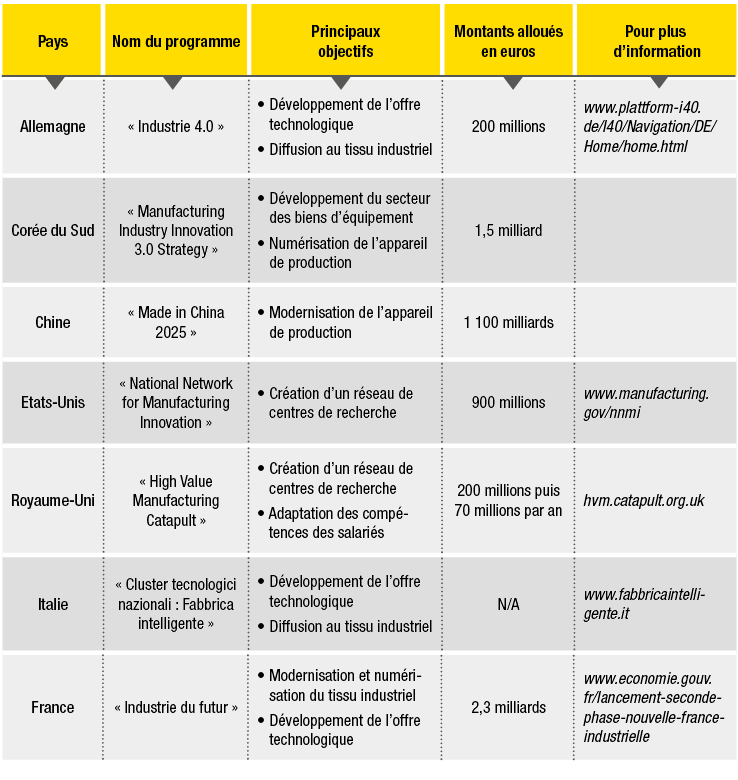L’industrie du futur : une compétition mondiale

Klee Paul (1879-1940), Felsenkammer © BPK, Berlin, Dist. RMN-Grand Palais / Jens Ziehe
Préface
La révolution digitale qui déferle aujourd’hui sur le monde modifie en profondeur le visage de l’industrie. Elle représente une formidable opportunité de repenser les produits, les process et les modèles d’affaires pour faire face aux défis économiques, sociaux ou environnementaux.
Grâce à la diffusion de nouveaux outils numériques et de nouvelles technologies de production, l’industrie du futur pourra fabriquer plus rapidement des produits personnalisés, tout en limitant les coûts, en optimisant l’utilisation des ressources, et avec de nouvelles solutions pour réduire la pénibilité du travail et augmenter la capacité de l’homme à maîtriser son activité.
Le digital, en rendant possible ces changements profonds, permet désormais à nos industries de s’inscrire dans une modification des attentes sociétales vers des besoins personnalisés et une économie plus économe en ressources. Il conduit les industriels à repenser leurs modèles d’affaires afin de mettre le client au centre de leur stratégie, en l’associant aux étapes de conception, en perfectionnant leur offre grâce au big data ou en élargissant les offres de produit à des solutions ou des services.
Dans le cadre de sa volonté de voir émerger une « Nouvelle France Industrielle », le gouvernement a lancé en 2015 le programme « Industrie du futur » pour accélérer la modernisation de notre outil productif, accompagner sa transformation numérique, revitaliser le tissu industriel français et rendre notre territoire plus attractif à l’activité économique.
L’Alliance Industrie du futur, que j’ai l’honneur de présider depuis sa création au mois de juillet 2015, a pour mission de mettre en œuvre sur le terrain cette stratégie nationale, auprès notamment des 2 000 entreprises que nous allons accompagner et conseiller d’ici la fin de l’année ainsi que des 15 000 qui seront sensibilisées. Les vitrines technologiques sont déjà l’illustration de la capacité de l’industrie française à initier cette transformation industrielle.
La France n’est pas seule et de nombreux autres pays ont lancé l’offensive pour soutenir la compétitivité de leur industrie nationale et se positionner sur les marchés d’avenir. Il nous faut donc agir sans retard, sans oublier que l’industrie du futur ouvre également le champ à de nombreuses possibilités de coopération, notamment avec nos voisins allemands. Conscients de nos atouts respectifs, nous devons unir nos forces pour peser dans la compétition mondiale. C’est une des priorités que s’est fixée l’Alliance Industrie du futur pour gagner le combat de la réindustrialisation et réinventer un futur industriel pour la France.
Philippe Darmayan,
Président de l’Alliance Industrie du futur
Résumé
Les processus, les chaînes de valeur et les modèles d’affaires industriels sont à l’aube d’une transformation profonde, liée notamment à l’intégration des technologies numériques. Les États interviennent de diverses manières pour accompagner la transition des entreprises industrielles afin que celles-ci restent en pointe ou en profitent pour revenir dans la course
Des conceptions diverses et complémentaires de l’industrie du futur
L’Allemagne a formalisé dès 2011 un concept d’Industrie 4.0, reposant sur la vision d’usines connectées, rendues flexibles et intelligentes grâce à la mise en réseau des machines, des produits et des individus. Les processus peuvent être modélisés à toutes les échelles et les « systèmes cyberphysiques » sont optimisés pour fournir des produits personnalisés pour chaque client au coût d’une production de masse. L’internet des objets permet de suivre la vie et l’usage du produit et d’offrir des services complémentaires inédits.
D’autres technologies, comme la fabrication additive et diverses améliorations des procédés et des matériaux, permettent d’améliorer l’efficacité des processus, de réduire leur impact environnemental et la pénibilité du travail.
Au-delà des aspects technologiques, la diffusion des outils numériques ainsi que la prise en compte des contraintes environnementales et des attentes des salariés comme des autres parties prenantes conduisent à repenser les modes d’organisation, les stratégies et les modèles d’affaires des entreprises.
Comment différents pays accompagnent cette transition
L’Allemagne a rapidement pris conscience de l’impact considérable de la révolution numérique sur le secteur manufacturier et des menaces lourdes qui pesaient sur le leadership de ses industriels spécialisés dans les équipements de production. Engagée dès les années 2000, la réflexion s’est d’abord articulée autour des nouvelles exigences et tendances de consommation, pour ensuite formaliser des solutions technologiques permettant d’y répondre.
Des pays comme la Corée du Sud ou la Chine, dont la base manufacturière est en développement rapide, ont des plans ambitieux de robotisation et de montée en gamme de leurs produits. La Corée est déjà le pays le plus équipé en robots (437 robots par employé de l’industrie en 2013, contre 282 en Allemagne et 125 en France).
Enfin, pour des pays ayant connu un fort déclin de l’industrie comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, l’industrie du futur peut être un levier de renouveau et de reconquête.
Les modalités concrètes du soutien des pouvoirs publics reflètent la diversité de ces réalités industrielles nationales et des traditions d’intervention. Là où les États-Unis financent surtout des programmes de recherche, avec une vision très large de l’industrie du futur (fabrication additive, intégration numérique mais aussi nouveaux matériaux), la Chine veut profiter de la digitalisation des process pour se moderniser et accélérer la montée en gamme de ses entreprises manufacturières. Malgré leurs différences, toutes ces politiques s’articulent autour de trois axes principaux : le soutien à l’émergence d’une offre de nouvelles technologies de production, l’aide à la modernisation du tissu productif et l’adaptation du système de formation face à ces mutations.
Que peut faire la France ?
Dans ce paysage, le programme « Industrie du futur », lancé en 2013 par Arnaud Montebourg et revisité par Emmanuel Macron deux ans plus tard, vise surtout à rattraper le retard d’investissement des industriels français dans leur outil de production. Toutefois, la modernisation ne portera ses fruits que si elle s’articule avec un repositionnement des entreprises. L’industrie du futur relance donc les débats autour de la montée en gamme de l’industrie française et de sa capacité à tirer parti des technologies numériques pour transformer ses modèles d’affaires. Par ailleurs, l’hybridation entre les technologies existantes et les nouvelles technologies numériques laisse entrevoir de belles perspectives pour les fournisseurs hexagonaux de solutions, qu’il s’agisse des grands groupes spécialisés dans les systèmes embarqués et la cybersécurité ou de jeunes entreprises développant leur activité dans l’internet des objets ou le big data. La France devra mobiliser mieux qu’aujourd’hui ses atouts que sont d’une part l’excellence de sa recherche publique, en améliorant la qualité de ses interfaces avec les entreprises, et ses formations d’ingénieurs d’autre part, dont les bénéficiaires sont encore trop peu nombreux à s’orienter vers les PME.
La France a une bonne tradition de gestion des grands programmes et de soutien à l’émergence de nouvelles technologies. Ses grands groupes savent s’approprier ces technologies, mais leur diffusion dans les ETI et surtout les PME est un enjeu essentiel. Le programme national prévoit d’accompagner 2 000 entreprises en trois ans grâce à la mobilisation des régions et des fédérations industrielles. Cela ne représente toutefois qu’une faible part du tissu industriel et il faut espérer que les initiatives et les succès des pionniers encourageront les autres à leur emboîter le pas rapidement.
Le problème majeur reste cependant l’accompagnement des personnes dont la nature du travail va être profondément affectée. Une note spécifique1 sera consacrée à la gestion des compétences et aux adaptations nécessaires de notre système de formation initiale et surtout permanente.
- 1 – Bidet-Mayer T., Toubal L., 2016, « Mutations industrielles et évolution des compétences », La Fabrique de l’industrie, (à paraître).
INTRODUCTION
Le secteur industriel n’échappe pas à la révolution numérique. Le concept « d’industrie du futur » porte ainsi la vision d’usines connectées, rendues flexibles et intelligentes grâce à la mise en réseau des machines, des produits et des individus. Au-delà de cet aspect purement technologique, la diffusion des outils numériques conduit à repenser les modes d’organisation, les stratégies et les modèles d’affaires des entreprises. Ce bouleversement profond exige une réponse adaptée de la part de la puissance publique, afin d’accompagner la transition du secteur industriel.
L’Allemagne a été la première à organiser un programme de soutien avec son concept d’Industrie 4.0, dès 2011. Cette vision a depuis essaimé et de nombreux pays se sont engagés dans une course à la digitalisation de l’industrie. La diversité des approches traduit toutefois celle des réalités industrielles nationales, et donc des priorités des politiques de soutien.
Après une présentation du concept d’industrie du futur et de ses différentes dimensions, cette note dresse un panorama des politiques mises en œuvre à travers le monde. Elle s’intéresse ensuite à l’initiative française et aux atouts sur lesquels notre industrie peut s’appuyer pour réussir dans cette transition. Elle montre surtout qu’un pays comme l’Allemagne a réussi à faire de son Industrie 4.0 un véritable projet de société. La mobilisation actuelle, en France, constitue une formidable occasion pour relancer une réflexion sur la place et l’avenir de l’industrie dans notre économie.
« Industrie du futur » : de quoi s’agit-t-il ?
« Industrie du futur », « Industrie 4.0 », « smart manufacturing »… les déclinaisons sont nombreuses pour décrire un même phénomène : l’évolution des méthodes de production dans l’industrie. Bien que ces différentes expressions se rejoignent autour de quelques caractéristiques centrales, ce foisonnement induit un certain flou. La notion d’industrie du futur a inévitablement un caractère abstrait car elle offre une vision prospective de la transformation du secteur industriel face à l’introduction de nouvelles technologies qui ne sont parfois pas encore arrivées à maturité, et dans un contexte de numérisation de la société qui induit des bouleversements importants tant sur les manières de produire que sur le positionnement des acteurs sur la chaîne de valeur. Plus qu’une image précise de l’industrie dans quelques décennies, cette notion propose l’esquisse d’un nouveau modèle industriel permettant de répondre aux nouvelles exigences des consommateurs en termes de réactivité, de qualité, de personnalisation des produits, d’impact environnemental et social.
1. Aux origines de l’Industrie 4.0
L’Allemagne s’est très tôt lancée dans la course vers l’industrie du futur. Angela Merkel a officiellement donné en 2011 le coup d’envoi du programme Industrie 4.0, initiative nationale visant à réunir l’ensemble des parties prenantes autour d’un objectif : la sauvegarde du leadership allemand dans la production de biens d’équipement industriels haut de gamme. Au cours des dernières années, celles-ci ont en effet pris conscience de la menace qui pesait sur leur industrie, prise en étau entre des concurrents coréens ou chinois toujours plus sérieux et les géants américains du numérique s’insinuant progressivement dans le jeu industriel grâce à leur maîtrise de la relation avec le consommateur.
Le gouvernement allemand a donc souhaité réagir. Il a pris soin de mûrir la réflexion, en veillant à y associer les acteurs du monde économique et de la recherche. Ces derniers ont d’abord identifié les principales tendances de société, les évolutions des modes de consommation – notamment la multiplication des objets connectés – avant d’imaginer leur impact sur les modes de production. C’est ainsi qu’a émergé le concept d’Industrie 4.0, dont nous mesurons aujourd’hui la portée et le succès.
Ses déclinaisons hors d’Allemagne sont en effet nombreuses. Il n’existe d’ailleurs pas de définition canonique, universellement acceptée de ce concept. L’association des entreprises de télécommunications allemandes BITKOM relève ainsi, dans son document de présentation de l’Industrie 4.0, pas moins de 104 définitions, caractérisations et descriptions différentes. Certaines sont même antérieures au concept allemand : si l’Industrie 4.0 de 2011 fait aujourd’hui figure de référence fondatrice, c’est aussi du fait de la mobilisation inédite à laquelle elle a donné lieu.
Chaque pays, chaque acteur, insiste sur des priorités différentes. Là où les producteurs de solutions mettent naturellement en évidence leurs technologies spécialisées, les acteurs publics insistent sur les modalités d’action publique qui varient selon les atouts et faiblesses de l’industrie nationale.
Ce flou provoque parfois un certain scepticisme. Dorothée Kohler et Jean-Daniel Weisz, auteurs du premier rapport complet écrit en France sur l’initiative allemande, soulignent toutefois que « ramener l’Industrie 4.0 au rang d’un simple concept marketing reviendrait à méconnaître quelques particularités allemandes. Les Allemands sont des champions pour définir des concepts de ce type, au contenu protéiforme, mais qui ont des effets socio-économiques très concrets. L’Industrie 4.0, comme le concept de l’économie sociale de marché (soziale Marktwirtschaft) ou celui de Mittelstand, fait partie en Allemagne de ces concepts emblématiques. À l’instar de ces notions, l’Industrie 4.0 représente un mythe qui crée des effets mobilisateurs au sein de la société civile. »2
Dans sa publication de référence sur l’usine du futur, la Fédération française des industries mécaniques (FIM) estime qu’elle est « une réponse à plusieurs transitions simultanées : énergétique, écologique, numérique, organisationnelle et sociétale. Chacune de ces transitions fait appel à de nombreuses nouvelles technologies ou modes d’organisation arrivant à maturité, en cours de développement ou à concevoir. »3 Le caractère abstrait du terme « industrie du futur » est inévitable dans la mesure où ce projet doit être pertinent aussi bien pour un grand groupe automobile que pour une PME de l’agroalimentaire, qui n’envisagent évidemment pas de la même manière la modernisation de leur appareil de production ni l’évolution de leur business model. Comme le fait remarquer Tahar Melliti, directeur général de l’Alliance Industrie du futur, « il n’y a pas de modèle unique [pour l’industrie du futur]. Aucune entreprise n’est comparable à une autre. »4
Ce concept est donc difficile à décrire, autrement que par ses finalités :
« L’usine du futur sera plus agile et flexible, moins coûteuse et plus respectueuse de ses travailleurs et de l’environnement, grâce à un fort niveau d’automatisation et une intégration numérique de l’ensemble de la chaîne de production. »
On prend parfois une perspective qui dépasse les seules modalités de fabrication et intègre notamment le renouvellement des modèles d’affaires et du contenu même de l’offre. On parle alors d’industrie du futur plutôt que d’usine du futur.
2. Une nouvelle révolution industrielle ?
Selon certains auteurs, l’industrie du futur serait la marque d’une nouvelle révolution industrielle à l’œuvre. Les typologies varient mais on retient souvent l’apparition de la machine à vapeur comme la marque du premier âge industriel, le passage à la production de masse et l’apparition de l’électricité comme celles du deuxième, puis l’informatisation et l’automatisation des chaînes de production comme celles du troisième. La quatrième évolution, à laquelle nous assisterions actuellement, repose sur l’extension massive du numérique et le développement d’une économie de la fonctionnalité.
Les historiens diront plus tard si l’intuition d’un quatrième âge industriel était justifiée, à la mesure des trois précédents bouleversements. Quoi qu’il en soit, sur les sites industriels, on assiste au développement d’un pilotage « intelligent » de la production, intégrant toute la chaîne de valeur et la relation avec le client. L’usage de nouvelles technologies, notamment numériques, permet également de personnaliser l’offre sans surcoût important, ce qui constitue une deuxième rupture.
Ces technologies sont nombreuses et leur seule énumération (big data, fabrication additive, réalité augmentée, analyse et traitement des données à grande échelle, développement des réseaux de communication, modélisation et simulation numériques, etc.) peut donner l’impression d’un ensemble de briques hétérogènes et isolées (cf. Encadré 1). Tout l’intérêt des démarches mises en place dans le cadre de l’industrie du futur consiste justement à les articuler. Ainsi, le big data peut par exemple traiter les données recueillies grâce à l’internet des objets, stockées sur le cloud grâce à des systèmes de cybersécurité fiables.
Dès 2005 et sous l’impulsion du Centre de recherche allemand pour l’intelligence artificielle (DFKI), la plateforme technologique SmartFactoryKL se lançait dans le développement d’un « système cyber-physique », consistant à transposer les technologies numériques de pointe sur une ligne de production afin d’en accroître l’efficience et la flexibilité. La combinaison de ces briques technologiques permet d’imaginer de nouvelles manières de produire : on passe de l’ère de la production de masse à celle de la « personnalisation de masse ». La flexibilité très élevée de l’outil de production permet de répondre à une demande croissante de différenciation, tout en conservant des coûts unitaires de production comparables à ceux de la production de masse.
Au début du XXe siècle, le seul moyen de rendre l’automobile accessible aux classes moyennes était de miser sur une production standardisée. Comme le résumait Henry Ford dans une petite phrase devenue célèbre, « tout le monde peut avoir une Ford T de la couleur qu’il souhaite, à condition que ce soit le noir. » Aujourd’hui les possibilités de personnalisation sont quasi-infinies. Par exemple, grâce à la multiplication de capteurs à la fois dans les produits en cours de fabrication et les machines qui les manipulent, chaque produit connaît un traitement spécifique à chacune des étapes de fabrication. En plus de réduire les coûts de production de produits toujours plus individualisés, ces technologies permettent aussi de détecter et de corriger des défauts ou d’organiser la maintenance prédictive5.
Si certains auteurs parlent d’une quatrième « révolution industrielle », c’est parce que les bouleversements générés par ces technologies ne s’arrêtent pas aux frontières de l’usine. C’est tout le sens de la distinction entre « l’usine du futur » et « l’industrie du futur ». En effet, si le numérique permet d’améliorer l’efficacité productive, il conduit également des industriels, sous l’effet de la multiplication des objets connectés par exemple, à repenser totalement leur modèle d’affaires. Rappelons qu’il y a encore quinze ans, l’informatique était structurée autour de la bureautique et des ordinateurs personnels. Depuis le début des années 2000, la miniaturisation des composants, la baisse des prix des capteurs, la diffusion des connexions sans fil, etc. l’ont projetée dans une nouvelle ère, celle de la mobilité. Smartphones, tablettes, voitures, appareils électroménagers, etc., on dénombre aujourd’hui environ cinq milliards d’objets connectés à travers le monde6. L’informatique est devenue ubiquitaire : chacun peut accéder à une information de manière directe, instantanée et en tout endroit, ce qui modifie en profondeur la manière de consommer.
Le numérique offre ainsi aux industriels l’opportunité de se repositionner sur la chaîne de création de valeur. Une première étape consiste à améliorer la qualité ou les fonctionnalités d’un produit en y intégrant des capteurs remontant des informations sur son utilisation. On peut aussi associer les clients au processus de conception, en leur donnant par exemple la possibilité de donner leur avis par le biais des médias sociaux. Plus généralement, le numérique permet de développer des services, associés à la vente du produit : maintenance, paramétrage personnalisé, etc. Le modèle en la matière est le smartphone, devenu support d’une multitude d’applications. Mais plusieurs industriels positionnés sur le BtoB le font aussi. C’est le cas de Lectra, qui ne vend pas uniquement des machines de découpe pour textile mais des « solutions » intégrant du conseil, des logiciels de gestion de production, des outils de conception destinés aux professionnels de la mode, etc. Ces services associés à la vente de la machine sont autant de moyens de différencier son offre et de générer des revenus réguliers, moins soumis aux fluctuations économiques.
L’économie de la fonctionnalité est la forme la plus poussée de cette imbrication entre produits et services7. Selon ce concept, apparu en Europe à la fin des années 1980, ce n’est plus la propriété d’un produit qui importe mais l’usage qui en est fait. Certains industriels ont fait le choix de ce revirement stratégique. C’est le cas de Michelin, qui propose depuis 2008 aux professionnels du transport routier des contrats de location de ses pneumatiques sur la base d’un prix au kilomètre. Pour l’industriel, cette formule se révèle plus intéressante que la simple vente car elle rétablit un contact direct avec les usagers de ses produits, les fidélise et permet de développer une offre en accord avec leurs attentes.
La notion d’économie de la fonctionnalité est nettement antérieure à celle d’industrie du futur, mais elle occupe une place essentielle dans la représentation qui est en train de se stabiliser de ce que pourraient être la quatrième « révolution industrielle » et, plus particulièrement, l’industrie du futur.
Encadré 1 – L’industrie du futur : une mosaïque technologique
Big data et analytics. La présence de capteurs sur les machines et les produits permet de collecter d’importantes sommes de données. Avec les bons outils de traitement et d’analyse, ces données permettent d’optimiser la chaîne de production en identifiant de manière très fine les problèmes qui surviennent. Elles permettent également d’accroître la connaissance sur les habitudes et préférences des consommateurs.
Robotisation. On sait aujourd’hui créer des robots travaillant de façon plus autonome, plus flexible, et en plus grande coopération avec les opérateurs.
Simulation. La simulation 3D de produits, matériaux ou procédés s’étend à l’ensemble de la chaîne de production ; l’acquisition de données réelles permet d’affiner les modèles.
Systèmes d’information horizontaux et verticaux. Les systèmes d’information doivent faciliter l’intégration et la communication intra- et inter-entreprises. Ils aident à l’automatisation des chaînes d’approvisionnement, de production et de distribution, mais également à la création de liens plus étroits entre les différents départements des entreprises, afin de répondre au mieux à la demande.
L’internet industriel des objets. Grâce aux capteurs sur les machines et les objets en cours de fabrication, les machines peuvent connaître l’historique de production de l’objet, la demande finale correspondante afin d’y répondre de manière automatisée ou via un poste de contrôle central. On peut aussi, grâce à l’internet des objets, collecter des données pendant l’utilisation du produit afin d’apprendre quelles fonctionnalités sont utilisées et de découvrir les modes de défaillance.
Cybersécurité. La diffusion du numérique et l’augmentation des communications qui l’accompagne font de la cybersécurité un enjeu majeur pour les entreprises industrielles. De nombreux fournisseurs de matériel « 4.0 ready » se sont ainsi rapprochés de spécialistes de la cybersécurité afin de proposer des offres intégrant cet aspect.
Cloud. Le cloud est déjà très répandu pour la gestion de logiciels et de données. La plus grande interconnexion des sites de production et des départements au sein de l’entreprise requiert un partage de grandes quantités de données, rendue plus facile grâce au cloud.
Fabrication additive. Cette technologie suscite de nombreux espoirs. Au-delà de la production de prototypes, la fabrication additive permet déjà la production en petites séries de pièces complexes, de pièces de rechange et même d’outils personnalisés. La vitesse et la précision de l’impression devraient augmenter et permettre la production à plus grande échelle.
Réalité augmentée. Une utilisation possible vise à fournir à l’opérateur de maintenance des informations sur les techniques de réparation d’une pièce, par exemple via le port de lunettes de réalité augmentée. Cette technologie peut également être utilisée pour faire de la formation, ou rendre des étapes de conception moins abstraites afin d’y associer plus de parties prenantes.
The Boston Consulting Group (2015).
3. Répondre aux défis de l’industrie du XXIe siècle
Les bouleversements évoqués plus haut dépassent largement le cadre de la technique. Que ce soit en France ou en Allemagne, la réflexion comporte des dimensions économiques et sociales. Il s’agit d’esquisser un nouveau modèle industriel, à même de répondre aux contraintes et aux défis des décennies à venir.
D’abord, l’industrie du futur en France est un moyen de revitaliser un tissu industriel affaibli par des années de sous-investissement. En modernisant leur outil de production, en s’automatisant, les entreprises substituent du capital au travail. Cela leur permet de gagner en productivité ou de monter en gamme, et donc d’améliorer leur volume d’affaires et leurs marges. Les activités de production moins intensives en main d’œuvre sont moins contraintes par le coût du travail, d’autant que l’avantage comparatif de certains pays émergents en la matière commence à se réduire8. Inversement, le positionnement sur des activités à forte valeur ajoutée, la complexification des outils de production et les nouveaux modes d’organisation du travail qui en découlent nécessitent une main d’œuvre qualifiée, comme les pays développés savent la former.
L’industrie du futur renouvelle donc les avantages comparatifs des différentes économies. Nous ne parlons pas ici de relocalisations en masse. D’abord parce que les implantations industrielles sont avant tout fonction de la progression de la demande, qui reste bien plus forte dans les pays émergents. Il faut également rappeler que certaines activités intensives en main d’œuvre resteront durablement soumises à la concurrence exercée par les pays à bas salaires, en raison de la persistance d’obstacles techniques à l’automatisation. C’est le cas par exemple du secteur de l’habillement, pour lequel il est plus difficile d’introduire des robots car il s’agit de manipuler des matières souples9.
L’industrie du futur offre toutefois aux pays développés une opportunité de réaffirmer leur compétitivité, dans la perspective d’une fragmentation plus fine des chaînes de valeur à l’échelle régionale. On s’achemine ainsi vers un schéma où les activités concurrentielles, caractérisées par de faibles barrières à l’entrée et employant une main d’œuvre peu qualifiée, continueront à être localisées dans des pays à bas coût, mais où les activités de production à plus forte valeur ajoutée, nécessitant une proximité avec le client et requérant des travailleurs qualifiés, retrouveront toute leur place dans les économies développées. À condition que la France joue la carte de la montée en gamme et de l’innovation (cf. Chapitre 3).
Pour aller plus loin, l’industrie du futur est l’occasion de renouveler la réflexion sur la place de l’industrie dans nos sociétés, sur sa mise en conformité avec nos exigences, tant en termes de conditions de travail que de respect de l’environnement. L’évolution des modes de production doit réduire la pénibilité du travail industriel, améliorer son efficacité énergétique, mieux intégrer les usines dans leur environnement, etc.
Ces aspects sont développés dans le rapport de la FIM : « le nouveau modèle d’usine est pensé pour être au cœur de son écosystème et répondre aux nouveaux besoins sociétaux : une usine innovante, compétitive, performante, sûre et attractive, […] une usine propre, silencieuse, impliquée dans son écosystème industriel, économe en matières premières et en énergie, une usine centrée sur l’humain, pour mieux prendre en compte les attentes des collaborateurs tout au long de leur vie active et mieux attirer les talents dont elle a besoin, une usine qui affranchit, grâce à l’automatisation et la robotique collaborative, l’homme des tâches pénibles ou répétitives pour mettre ses fonctions cognitives au service de la qualité. »
- 2 – Kohler, Weisz (2016).
- 3 – Fédération des industries mécaniques (2015).
- 4 – Raynal (2015).
- 5 – Voir le commentaire de Tommaso Pardi (page 26) pour une analyse plus approfondie de l’industrie du futur dans le secteur automobile.
- 6 – Selon différentes estimations (Cisco, Gartner, Juniper Research, Oliver Wyman), ils seront entre 20 et 75 milliards en 2020.
- 7 – Weil (2016).
- 8 – Les salaires dans l’industrie ont plus que doublé en Chine entre 2007 et 2013 (source : National Bureau of Statistics of China). Par ailleurs, l’avantage financier que procure la délocalisation est contrebalancé par les nombreux coûts cachés qu’un éclatement de la chaîne de valeur entraîne, comme les problèmes logistiques, les barrières douanières, etc.
- 9 – Direction générale des entreprises (2013).
Tommaso Pardi – L’industrie du futur dans l’automobile : un concept made in Germany – Commentaire
Tommaso Pardi est directeur du GIS Gerpisa dont il a lancé cette année le sixième programme international de recherche sur les nouvelles frontières de l’industrie automobile mondiale : technologies, usages, innovation, marché (http://gerpisa.org/node/3137). Il est sociologue, chargé de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur les transformations du travail et des marchés dans l’industrie automobile mondiale avec une attention particulière aux dimensions institutionnelles et politiques.
Selon la plupart des grands cabinets de consultants, l’industrie automobile devrait jouer un rôle central dans le développement de l’industrie du futur et bénéficier très largement des nouvelles technologies qui lui sont associées. Ce consensus se base fondamentalement sur trois arguments : le rôle historiquement pionnier de l’industrie automobile dans l’introduction de nouvelles technologies de production ; l’intensité capitalistique très élevée de la production automobile qui concentre à elle seule plus de 40 % des robots installés au niveau mondial ; et l’évolution vers une production automobile sur mesure, customisée aux moindre besoins et envies du client.
Lorsque l’on cherche cependant à comprendre plus concrètement ce que cela implique en termes d’investissements en cours ou planifiés, de taux de diffusion de ces nouvelles technologies dans les usines automobiles, et de bénéfices attendus par les constructeurs et les équipementiers, ce constat se fait beaucoup moins évident. Mis à part chez les spécialistes allemands, et exclusivement sur des lignes de production en petits volumes de modèles très haut de gamme, on ne trouve pratiquement aucune trace de ces nouvelles technologies (production additive, cobotique, internet des objets, etc.) ni dans les usines automobiles existantes, ni dans les rapports annuels des constructeurs et équipementiers.
Même dans les visions les plus optimistes quant à l’impact de ces nouvelles technologies dans le secteur automobile, comme celle défendue par le rapport du Boston Consulting Group sur l’Industrie 4.010, les gains de productivité supplémentaires attendus pour les cinq à dix années à venir ne dépassent pas une fourchette de 6 à 9 % au total. Et encore, ces données prévisionnelles ne concernent que l’industrie automobile allemande.
Interrogé le 20 novembre 2015 par la mission parlementaire d’information sur l’offre automobile française, Louis Schweitzer, à la fois Commissaire général à l’investissement et ancien PDG de Renault, s’est montré quant à lui bien plus prudent :
« Mon expérience de l’automobile me fait dire que les chaînes flexibles ne sont pas une bonne solution au long cours pour les gros volumes, car elles induisent des surcoûts et une perte d’efficacité. Elle peut être intéressante pour les petites séries, par exemple pour la construction de V6 ou V8. Par ailleurs, la flexibilité n’est souvent que théorique : les besoins réels liés à l’innovation supposent des changements qui ne sont pas ceux qui avaient été envisagés initialement. Cela dit, nous soutenons les automatisations dans des domaines où la flexibilité est un atout. Nous aidons ainsi les projets d’usine du futur, mais dans des secteurs où l’on n’est pas, comme dans l’automobile, à cinq centimes près sur le prix d’un moteur – l’industrie automobile est toujours près de ses sous : gagner un euro par véhicule suppose un énorme effort. »
Pour mieux illustrer les propos de Louis Schweitzer, on peut comparer le prix de vente au kilogramme d’une voiture de moyenne gamme comme la Golf Volkswagen (1,6 L. Blue-motion), qui se situe autour de 22 euros en 2015, à celui d’un Airbus A350 – 1 300 euros – ou d’un Iphone 6s – 5 244 euros. Pour être rentable à un tel niveau de prix, les constructeurs doivent produire de très grands volumes qui se chiffrent aujourd’hui près du million de véhicules par plateforme. Or les nouvelles technologies associées à l’Industrie 4.0 ne sont pas compatibles avec ce niveau d’économies d’échelle. Leur potentiel se situe dans la production en petits lots de biens à très haute valeur ajoutée auxquels ces technologies sont susceptibles d’apporter de nouvelles propriétés, comme dans l’aviation ou l’industrie militaire. C’est aussi la raison pour laquelle on ne trouve leur application dans le secteur automobile que chez les spécialistes allemands, dont certains produits très haut de gamme possèdent ce type de caractéristiques.
S’il n’est pas à exclure qu’avec le temps, et une plus large diffusion dans d’autres secteurs, l’industrie automobile finira par adopter certaines de ces technologies, leur introduction se fera de manière sélective et progressive. Même les robots de nouvelle génération arriveront dans les usines automobiles avec parcimonie. D’une part, parce qu’il s’agit d’un secteur déjà très automatisé, où les temps d’amortissement des investissements en production sont très longs (on parle souvent d’une vingtaine d’années pour une usine). D’autre part, parce que la tendance depuis le milieu des années 1990 a plutôt été à la réduction des taux d’automatisation, en particulier dans les phases d’assemblage, compte tenu de la plus grande adaptabilité et flexibilité des êtres humains aux transformations de plus en plus rapides des véhicules mis sur le marché.
On pourrait objecter à cette analyse « réaliste » des dynamiques du secteur que le bouleversement dans les systèmes de production automobile ne viendra pas des constructeurs, forcément conservateurs, mais des consommateurs, qui exigeront des produits de plus en plus customisés que seule une production flexible en petits lots parfaitement incarnée par les technologies de l’Industrie 4.0 permettra de réaliser. Or, cet argument avait été déjà utilisé dès le début des années 1980, pour justifier la diffusion en Occident du système de production Toyota, puis rebaptisé Lean production, sauf s’apercevoir par la suite qu’il ne s’agissait pas d’un système de production flexible et que l’avantage concurrentiel des Japonais n’avait rien à voir avec la customisation de leurs véhicules, mais avec leur rapport qualité-prix très compétitif11. Depuis, poussée par le jeu concurrentiel, la variété synchronique et diachronique de l’offre automobile n’a pas cessé de croître, mais seulement entre un quart et un tiers de cette offre est aujourd’hui produite sur commande, c’est-à-dire à peu près le même ratio qu’il y a trente ans.
A cette époque, comme aujourd’hui, les spécialistes allemands font exception, avec des ratios de production à la commande plus élevés liés à la nature premium de leurs produits. L’Industrie 4.0, concept made in Germany, leur va logiquement bien. Reste maintenant à savoir si ce concept de plus en plus populaire en France pourra s’adapter aux besoins très différents des généralistes français. Dans un contexte où la montée en gamme est souvent évoquée comme la seule solution pour sauver l’automobile made in France, l’enjeu est important. Derrière, il y a la question de savoir si l’industrie automobile du futur sera, elle aussi, allemande ou pas.
- 10 – The Boston Consulting Group, 2015, « Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries », avril.
- 11 – Jullien B., Pardi T., 2011, « In the name of consumer: The social construction of innovation in the European automobile industry and its political consequences », European Review of Industrial Economics and Policy , vol. 3.
L’industrie du futur à travers le monde
Nous proposons dans ce chapitre une comparaison internationale des politiques publiques en faveur de l’industrie du futur, exercice qui n’a pas encore été mené en France à notre connaissance. L’industrie du futur embrasse un large champ de technologies et soulève de nombreux problèmes (investissement des PME, formation, recherche). Pour ces raisons, on en trouve la marque dans la plupart des politiques industrielles des grandes puissances économiques mondiales. Leurs approches diffèrent, en fonction des réalités nationales particulières, mais tous les programmes étudiés s’articulent autour de trois axes : le développement d’une offre de technologies, le soutien à leur intégration dans les entreprises et l’adaptation des compétences des salariés.
1. Pourquoi un benchmark ?
On veut ici présenter, de manière synthétique, les approches et les axes thématiques mis en avant par un certain nombre de pays pour le développement d’une industrie du futur. Les pays étudiés (Allemagne, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Italie, Royaume-Uni) sont choisis pour illustrer la diversité de ces approches.
Les politiques de tous ces pays s’organisent autour de trois axes : le développement de l’offre de technologies, le soutien à la modernisation de l’appareil de production et le développement des compétences pour faire face à ces transformations (cf. Figure 1). Bien que les États partagent des visions assez proches de l’avenir, les politiques déployées varient significativement selon les pays et ne mettent pas l’accent sur les mêmes aspects.
Figure 1 – Principales thématiques des politiques « Industrie du futur »
Source : La Fabrique de l’industrie
La première raison à cette variété est que les enjeux socio-économiques des États diffèrent largement. Il faut d’abord distinguer les pays, majoritaires, dont le secteur industriel est en perte de vitesse des quelques exceptions dont l’industrie connaît au contraire une progression plus ou moins forte (cf. Graphique 1). Deuxième distinction : des pays sont plutôt producteurs, c’est-à-dire dotés d’offreurs de solutions liées à l’industrie du futur, quand les autres sont principalement acheteurs-utilisateurs. Enfin, soulignons les différences notables en termes de robotisation et d’intégration numérique des entreprises selon les pays.
Graphique 1 – Part de l’industrie dans le produit intérieur brut (niveau et variation) (*)
(*) Données 2012, variations entre 1990 et 2012 (en points de pourcentage)
Sources : National Accounts Main Aggregates Database, UNIDO
Ces différences appellent des réponses adaptées de la part des pouvoirs publics. Pour autant, les politiques nationales ne sont pas focalisées sur des objectifs uniques : au contraire, tous les pays allient ces multiples finalités, dans des proportions diverses. L’Allemagne, qui mise principalement sur le développement d’une offre technologique, ne néglige pas pour autant la modernisation de son appareil productif (et inversement en France).
Ensuite, rappelons que les politiques industrielle sont parfois difficilement comparables, en raison notamment de traditions d’intervention publique et de centralisation très différentes. Par exemple, de nombreux gouvernements, notamment dans les pays anglo-saxons, se sont saisis de sujets liés à l’industrie du futur sans pour autant y faire exclusivement ni même explicitement référence. Le plan américain National Network for Manufacturing Innovation touche ainsi à la fois à la fabrication additive, aux matériaux composites, aux énergies durables et à la digitalisation des relations avec la chaîne d’approvisionnement… sans parler d’Industrie 4.0 ! Les comparaisons entre pays doivent dès lors être considérées avec prudence12.
Cela étant posé, nous regroupons les pays étudiés en quatre ensembles.
2. L’Allemagne, pionnière soucieuse de préserver son avance
L’objectif du programme Industrie 4.0 est de développer au sein des industries allemandes des « systèmes de production cyber-physiques ». Ceux-ci reposent sur une modélisation numérique des processus de production et sur des échanges de données, en cours de fabrication, entre produits et machines d’une part et entre différents acteurs de la chaîne de production d’autre part.
Concrètement, ce programme consiste majoritairement à organiser et financer la recherche dans les domaines de la robotique industrielle, de l’automatisation, de la mise en réseau, etc., avec le souci de garantir l’avance de l’Allemagne dans ces technologies. On remarque dans ce choix que l’Allemagne joue sur ses atouts, à savoir les machines. Certes, les décideurs sont conscients de l’importance du numérique et des enjeux de cybersécurité que cela soulève mais les efforts sont concentrés sur les segments où le pays dispose déjà d’un avantage concurrentiel certain.
La deuxième étape du programme est de promouvoir ces technologies auprès de l’ensemble du tissu industriel allemand. La création de démonstrateurs vise ainsi à sensibiliser les entreprises. Dans ce cadre, l’État allemand s’est placé dès le départ dans un rôle de facilitateur plutôt que de stratège. Sur les recommandations d’un rapport publié en 2013, et afin de faciliter la mise en réseau des acteurs, il a créé la Plattform Industrie 4.0. En dépit d’une réorganisation en 2015, qui a vu le gouvernement fédéral s’impliquer davantage, les représentants académiques et économiques, notamment les constructeurs de machines ainsi que les fournisseurs d’automatismes, restent largement à la manœuvre.
Le projet Industrie 4.0 est donc résolument orienté vers le développement d’une offre de solutions. L’Allemagne montre de ce fait un vif intérêt pour la normalisation et la standardisation des procédés. C’est un des cinq grands thèmes de réflexion identifiés par le gouvernement, avec la recherche et l’innovation, la sécurité des systèmes et des réseaux, le cadre réglementaire et juridique, et la formation professionnelle. Les travaux de la Plattform Industrie 4.0 ont débouché sur un modèle d’architecture de référence, baptisé RAMI 4.0, qui couvre à la fois l’intégration horizontale et verticale des technologies de l’information ainsi que le cycle de vie du produit. Inquiète des initiatives prises par certains de ses concurrents, l’Allemagne a également accéléré ses efforts de rapprochement avec les instances américaines ou chinoises13.
3. Les outsiders : la Corée du Sud et la Chine
La Corée du Sud apparaît comme le pays asiatique le plus propice à la diffusion de l’industrie du futur. Le secteur industriel y représente près du tiers de la richesse nationale et 60 % de sa production est de milieu ou de haut-de-gamme, chiffre égalé uniquement par l’Allemagne14. Ses entreprises sont également en pointe en termes d’équipement : d’après l’International Federation of Robotics (IFR), la Corée du Sud dispose de l’industrie la plus robotisée au monde (437 robots pour 10 000 employés en 2013) loin devant le Japon (323), l’Allemagne (282) et la France (125). Elle bénéficie par ailleurs d’un haut niveau d’éducation et de qualification de sa main d’œuvre et d’une infrastructure numérique sans égale15. Enfin, son secteur de la robotique industrielle est l’un des plus performants au monde et elle bénéficie d’un positionnement privilégié sur les technologies numériques, grâce à la présence de grands conglomérats – les chaebols historiques – développant de nombreuses activités dans le secteur, à l’image de Samsung ou de LG.
La montée en puissance de son voisin chinois n’en constitue pas moins une menace sérieuse. L’entrée en vigueur en juin 2015 d’un premier traité de libre-échange entre les deux pays, avant peut-être la signature d’un accord trilatéral incluant le Japon, rend d’autant plus nécessaire le renforcement de la compétitivité de l’industrie sud-coréenne.
Le ministère du Commerce, de l’industrie et de l’énergie publiait ainsi en juillet 2014 un rapport dont les recommandations ont conduit à la mise en place de la Manufacturing Industry Innovation 3.0 Strategy. Comme en Allemagne, le gouvernement coréen s’est engagé dans un soutien massif à la recherche, centré sur dix technologies, avec un penchant fort pour le numérique, en particulier le big data et l’internet des objets. Pour ce qui est de la diffusion de ces technologies au sein des entreprises, la Corée s’est plutôt distinguée de l’Allemagne en se fixant un objectif précis – et ambitieux : faire passer le nombre d’usines « intelligentes » de 500 à 10 000 d’ici 2020. Il prévoit également d’accompagner 100 000 PME dans leur transformation numérique, en ciblant les entreprises exportatrices.
Si la Chine n’a pas encore atteint le niveau technologique de l’Allemagne et de la Corée du Sud, elle ne doit néanmoins pas être sous-estimée : sa volonté de faire monter en gamme son secteur industriel n’est plus un secret et elle apporte tous les jours les preuves d’une capacité à réaliser des progrès fulgurants. Elle s’est inscrite dans la course vers l’industrie du futur en juin 2015 avec le lancement du plan Made in China 2025. Initié par le ministère de l’Industrie et des technologies de l’information, il est le fruit d’une réflexion menée en coordination avec 150 experts de l’Académie d’ingénierie de Chine. Il est le premier d’une série de plans décennaux ayant pour ambition de faire du pays le leader de l’industrie mondiale à l’horizon 2049, date à laquelle la République populaire célèbrera son centenaire. Signe que ces annonces sont prises au sérieux, Jost Wübbecke, chercheur au Mercator Institute for China Studies de Berlin, va jusqu’à parler de « déclaration de guerre à l’Allemagne » pour désigner ce programme d’envergure16.
Encadré 2 – Le programme Manufacturing Industry Innovation 3.0 Strategy
Avec sa Manufacturing Industry Innovation 3.0 Strategy, la Corée du Sud vise la montée en gamme de l’ensemble de son industrie, condition nécessaire pour pérenniser la croissance de ce secteur qui représentait près de 29 % du PIB en 2012. Ce plan a pour objectif de dynamiser un secteur dont les principales forces demeurent centrées sur des activités traditionnelles. La notion d’industrial convergence constitue le cœur du projet coréen et peut être explicitée de deux manières. Elle traduit d’une part l’émergence d’un nouveau tissu industriel qui doit mêler production, digitalisation et TIC afin de proposer des produits à plus fort contenu technologique et davantage de services liés. À d’autres occasions, ce terme doit se comprendre comme la fusion de plusieurs technologies digitales (internet des objets, capteurs, etc.) dans une même entité, qu’il s’agisse d’un produit ou d’une chaîne de production. Le souci est ici d’améliorer l’efficacité de la production et de proposer des produits de meilleure qualité.
Le pilotage du programme a été confié à un Comité à l’innovation industrielle public-privé, dont les deux co-présidents sont le ministre en charge du programme et le président de la CCI de Corée. Il se structure autour de trois piliers.
Premièrement, la création d’une industrie de haute technologie dans des domaines d’avenir jusqu’alors peu développés (véhicules et vêtements intelligents, médecine du futur) est le principal pilier du plan. Il vise à développer l’offre technologique et à créer un noyau d’entreprises intelligentes : d’ici 2020, le gouvernement ambitionne ainsi de créer 10 000 sites de production automatisés, contre 50 en 2014.
La digitalisation des PMI et ETI est le deuxième volet du plan. Son objectif est d’améliorer l’efficacité productive des entreprises : 100 000 petites et moyennes entreprises exportatrices doivent être aidées d’ici 2017.
Le soutien au développement d’innovations plus fondamentales, déjà maîtrisées par l’industrie coréenne (logiciels, matériaux, robotique) constitue le troisième pilier. 775 millions d’euros sont notamment investis dans la recherche publique sur dix technologies, dont la fabrication additive et le big data. Ce volet inclut également la reconversion de complexes industriels obsolètes en centres innovants.
Le gouvernement chinois a en effet annoncé la mobilisation de moyens importants afin d’accompagner la transformation du secteur industriel. La première des priorités est de moderniser une industrie de main d’œuvre encore peu robotisée. Cet effort répond à une triple nécessité : améliorer la compétitivité sur des activités plus haut-de-gamme ; contourner le problème de la hausse des salaires des ouvriers chinois ; répondre au futur déficit de main d’œuvre lié à une démographie déclinante et aux aspirations nouvelles de la jeune génération17.
S’il est difficile d’établir un chiffrage précis au niveau national, plusieurs gouvernements locaux ont d’ores et déjà annoncé le déblocage de financements pour mettre en place cette stratégie. Par exemple, le gouvernement de la province du Guangdong, qui comprend notamment les villes de Canton et Shenzen, a annoncé qu’il investirait à lui seul 135 milliards d’euros pour la modernisation de son industrie au cours des trois prochaines années. Plusieurs observateurs tempèrent néanmoins l’enthousiasme que peuvent susciter ces initiatives en signalant que, en Chine, le décalage entre les annonces officielles et les traductions concrètes est parfois très important.
Encadré 3 – Le programme Made in China 2025
Le plan Made in China 2025 donne la priorité à dix « secteurs », très vastes : les nouvelles technologies de l’information, la robotique et les automates, l’aérospatial, l’ingénierie navale et ferroviaire, les véhicules basse consommation, les équipements électriques, l’équipement agricole, les nouveaux matériaux et les biotechnologies. Il subventionne la recherche des entreprises chinoises dans ces secteurs, avec des objectifs pour 2020. D’autres actions, plus larges, visent à soutenir l’innovation, la montée en gamme et la transition écologique18. La principale est la création de quinze centres d’innovation industrielle en 2020 et quarante en 2025, dont les travaux se centrent sur les TIC, les systèmes cyber-physiques, la fabrication additive et les produits biopharmaceutiques. Parallèlement, le plan soutient la recherche afin d’augmenter fortement le nombre de brevets en équipements industriels de pointe. Il avance également la création de 1 000 usines-pilotes vertes et de 100 zones industrielles écologiques.
L’Allemagne a été une source d’inspiration essentielle pour la définition du plan chinois. La très large palette de secteurs et de considérations qu’il englobe le distingue toutefois du plan allemand, focalisé sur des domaines pointus. De même, leurs objectifs diffèrent sensiblement dans la mesure où la Chine vise d’abord à un rattrapage technologique, là où le programme allemand a pour ambition de maintenir la place dominante occupée par les offreurs de solutions.
Malgré ces différences, les deux pays ont institutionnalisé des échanges notamment à travers l’Alliance germano-chinoise pour l’Industrie 4.0, qui mobilise des personnalités politiques des deux pays. Elle s’ouvre également à d’autres spécialistes, aux fédérations professionnelles et aux universités. Le gouvernement allemand a déclaré en octobre 2014 encourager la collaboration entre les entreprises et centres de recherche des deux pays, notamment sur des sujets de standardisation19.
Le deuxième volet de la stratégie chinoise consiste à développer le secteur des biens d’équipement industriels, afin de tirer parti du dynamisme de la demande mondiale mais surtout de répondre aux besoins croissants des entreprises chinoises. En effet, la Chine représente de loin le premier marché pour les robots industriels selon l’IFR, et sa demande devrait encore doubler d’ici 2018 pour s’établir à 150 000 unités par an. Or, seuls 20 % des robots installés en Chine sont pour l’instant produits par des entreprises locales. Comme en France, ce sont surtout les producteurs étrangers qui profitent de cet essor. Mais la réaction se prépare : plus de trente usines de robots étaient en cours de construction fin 201420 et plusieurs rachats de spécialistes de la robotique ou de l’intégration (Gimatic, KraussMaffei, Paslin) ont été menés au cours des derniers mois. L’émoi de la classe politique allemande a notamment été très vif lors du passage de la pépite Kuka sous pavillon chinois21.
Priorité a également été donnée au développement d’un langage chinois de communication inter-machines. Cette stratégie de guerre des standards est risquée. Elle a pour l’instant permis à plusieurs champions nationaux comme Shanghai Siansun Robot & Automation d’exploiter l’immense marché national en les protégeant de la concurrence étrangère. À terme, cela risque cependant de les handicaper lorsqu’ils voudront se développer à l’international.
D’autres obstacles risquent de ralentir la marche en avant de la Chine. De fortes tensions persistent entre l’organisation politique du pays, très rigide, et la souplesse attendue des chaînes de valeur. Le tissu industriel chinois reste dominé par de gros conglomérats publics dont la gestion n’est souvent pas à la hauteur des enjeux de l’industrie du futur. De même, le contrôle de l’accès à internet par les autorités chinoises entrave très fortement la communication des entreprises et ralentit l’intégration du numérique au sein des usines.
4. France, États-Unis, Royaume-Uni : l’industrie du futur comme levier du renouveau industriel ?
Ces pays occidentaux forment certainement la catégorie la plus hétérogène ; ils ont néanmoins en commun d’avoir vu leur industrie se déliter au cours des dernières décennies. L’industrie du futur représente pour eux une occasion de donner un souffle nouveau à un secteur en perte de vitesse face à la concurrence de pays plus compétitifs. C’est le cas de la France, engagée avec son initiative « Industrie du futur » dans un vaste programme de soutien à l’investissement, qui doit accélérer la modernisation de l’appareil productif. Celui-ci vise à combler le retard des entreprises en matière de robotisation et les incite à adopter les outils numériques pour s’adapter aux nouveaux usages des consommateurs et gagner en compétitivité (cf. Chapitre 3).
On retrouve également dans ce groupe les États-Unis et le Royaume-Uni. Ces deux pays ont, eux aussi, connu un effondrement de la part industrielle de leur produit intérieur brut depuis la fin des années 1970. Comme en France, la crise de 2008 a retenti comme un signal d’alerte et a fait prendre conscience de l’importance du secteur industriel pour la prospérité économique. Partant d’un constat similaire, leurs réponses n’en ont pas moins été radicalement différentes, en raison de leur tradition spécifique au sujet de l’intervention publique. Il ne s’agit pas, pour ces deux pays, de mettre en place un plan d’urgence pour l’industrie ni de soutenir les entreprises dans leurs projets d’investissement, comme dans la plupart des pays d’Europe continentale ; il est davantage question de promouvoir la recherche sur des technologies d’avenir, tout en améliorant l’interface entre les instituts de recherche et le monde économique. Ces recherches portent notamment sur les nouveaux matériaux et procédés : la numérisation n’est donc qu’une composante du smart manufacturing.
Aux États-Unis, c’est le President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) qui a sonné le tocsin en juin 2011, dans un rapport s’inquiétant de la concurrence croissante à laquelle était soumise l’industrie américaine, en particulier sur les activités de haute technologie. Dans la foulée de ce rapport, le gouvernement fédéral a acté la création de l’Advanced Manufacturing Partnership qui a lui-même débouché sur la création du National Network for Manufacturing Innovation (NNMI) en 2013. Doté d’un budget d’un milliard de dollars sur huit ans, il ambitionne la création de quinze Institutes for Manufacturing Innovation (et vise même un objectif de 45 d’ici 2025) ; neuf aujourd’hui sont référencés sur le site web du NNMI.
Imaginés suivant le modèle des Fraunhofer Institute allemands, ces IMIs rassemblent des chercheurs, conseillers du gouvernement et industriels. Ils développent chacun une spécialité technologique tout en se coordonnant de manière à offrir des compétences larges aux entreprises : aux technologies centrales de l’usine du futur (intégration et optimisation de la chaîne de production par échanges de données, fabrication additive), s’ajoutent des programmes dédiés aux semi-conducteurs et aux matériaux composites ou à faible densité. À terme, les instituts doivent théoriquement devenir financièrement indépendants, grâce notamment aux cotisations et autres financements des entreprises, aux ressources tirées des contrats de recherches, etc.
Au Royaume-Uni, les actions visant – plus ou moins directement – à soutenir l’industrie du futur sont regroupées au sein de l’Industrial strategy, l’outil politique en faveur de l’innovation et du développement industriels créé en 2013. Son action en direction de l’industrie du futur se concentre principalement sur le plan Catapult, dont un des axes est intitulé High Value Manufacturing Catapult. Il vise à mettre en réseau des centres de recherche existants, afin de faire bénéficier les entreprises industrielles de la recherche de pointe britannique (le terme Catapult cherche à exprimer l’idée d’un passage rapide des recherches avancées au marché). Les thèmes des projets Catapult sont retenus sur la base de plusieurs critères, parmi lesquels notamment l’existence de moyens de recherche de pointe ou la possibilité d’attirer des entreprises internationales sur le territoire britannique. Les technologies retenues ne se limitent pas à l’automatisation, la « production flexible » ou les systèmes numériques appliqués à l’industrie mais portent aussi sur les nouveaux matériaux, le traitement de surface, etc.
Encadré 4 – Le programme Advanced manufacturing partnership
Outre le NNMI, l’Advanced Manufacturing Partnership (AMP) comprend également onze initiatives, aux budgets sensiblement plus modestes. On peut notamment citer le programme Materials Genome Initiative qui a bénéficié de 2011 à 2014 de 250 millions de dollars d’investissement public dans la recherche de nouveaux matériaux. L’objectif principal de ce programme est de diviser par deux le temps de déploiement de nouveaux matériaux au sein des industries, qui peut atteindre à l’heure actuelle plus de vingt ans.
Le plan National Robotics Initiative lancé en septembre 2012 vise pour sa part à soutenir le développement et la diffusion de robots de nouvelle génération, en particulier les cobots. À l’issue d’appels à projets annuels, la National Science Foundation, en partenariat avec la NASA, les National Institutes of Health et le ministère de l’agriculture, a ainsi sélectionné 52 nouveaux projets pour un budget total de 31,5 millions de dollars en 2014.
Le Graduate Assistance in Areas of National Need date de 2002 et n’est donc pas issu des recommandations de l’AMP. Le rapport de 2011 a toutefois recommandé de le réorienter. Représentant 30 millions de dollars par an, ce programme alloue des bourses à des doctorants effectuant leurs recherches dans des domaines clés et faisant face à des contraintes financières. Il est piloté par le ministère de l’Éducation. Les secteurs-clés identifiés dépassent le cadre de l’industrie du futur : ils comprennent certes la robotique, l’ingénierie, l’informatique mais également la biologie, la physique, la statistique, etc.
On peut rappeler, pour comparaison, quelques ordres de grandeur français. Le pôle CEA Tech, par exemple, qui regroupe les trois grands laboratoires de recherche technologique du CEA, représente un budget annuel de plus de 650 millions d’euros. Le dispositif Cifre, qui soutient les thèses menées en entreprises mobilise une dotation publique de l’ordre de 19 millions d’euros.
Encadré 5 – Le programme High Value Manufacturing Catapult
Le programme High Value Manufacturing Catapult (HVMC) est ouvert depuis le 1er octobre 2011. Il vise à combler l’écart entre la recherche théorique, ses équipements et compétences de haut niveau d’une part et les applications industrielles d’autre part. Il affiche un objectif de long terme ambitieux, tellement ambitieux d’ailleurs qu’il ne semble pas crédible : doubler la part de l’industrie dans le PIB, qui était de 10,1 % en 2011 !
À travers le soutien à sept centres existants, le programme met à disposition des entreprises un réseau d’infrastructures d’équipements, et de compétences réparti sur l’ensemble du territoire britannique, pour favoriser leur développement. Ce réseau a bénéficié d’un investissement public initial de 200 millions d’euros puis de 90 millions d’euros par an de 2012 à 2018. Ce dispositif fait partie d’une stratégie d’amélioration de l’écosystème d’innovation. Couvrant l’ensemble du territoire le long d’un arc Bristol-Glasgow, le réseau vise également à renforcer l’attractivité du Royaume-Uni auprès des entreprises britanniques et internationales.
Les relations entre ces centres de recherche et les entreprises se font pour l’instant principalement sur le mode de l’adhésion, moyennant le paiement d’une cotisation annuelle variable suivant le centre, la taille de l’entreprise et le niveau d’utilisation des services disponibles. L’adhésion donne accès aux ressources et expertises du centre. Des cotisations plus importantes permettent de participer aux orientations des programmes de recherche.
Le programme HVMC paraît dynamique : sur l’année 2013-2014, il a respecté tous ses objectifs de revenus, de partenariats et d’investissements. Il est, de loin, le programme le plus important du plan Catapult, dont il concentrait 1 200 des 1 500 employés en août 2014. À cette date, il a soutenu 1 000 projets proposés par près de 1 500 entreprises, et généré un revenu total de plus de 138 millions d’euros par des contrats de recherche. Ce succès est aussi perceptible dans l’investissement des industriels qui s’élevait à 306 millions d’euros fin 2014, soit 40 % des revenus des centres. Le soutien tripartite (conservateur-libéral-travailliste) dont bénéficie le programme HVMC semble également lui garantir une certaine pérennité.
Pour mémoire, les instituts Carnot français, qui constituent une initiative similaire, regroupent 27 000 personnels de recherche, donnent lieu chaque année à 7 500 contrats avec des entreprises, lesquels drainent 970 millions d’euros de recettes partenariales, dont 458 millions d’euros de contrats de recherche avec les entreprises.
Grande absente de la plupart des autres initiatives, la question de l’adaptation des compétences face aux transformations induites par l’industrie du futur semble davantage être prise en compte aux États-Unis et au Royaume-Uni. D’abord, l’organisation autour de centres de recherche associant les universités est propice à cette réflexion et à la mise en œuvre de dispositifs concrets. Des formations sont ainsi proposées par les centres, en lien avec leurs thématiques de recherche22. En coordination avec le ministère de l’Éducation, le gouvernement britannique a également mis en place un fonds, l’Employer Ownership of Skills Pilot, qui offre la possibilité à un large groupe d’associations industrielles d’expliciter leurs besoins en compétences et de proposer des cursus adéquats.
5. L’Italie mise sur un soutien régional à ses clusters
L’Italie, enfin, offre au sein de ce tableau un double visage. Très robotisée, son industrie n’en reste pas moins positionnée sur des secteurs à faible croissance et sur des segments de milieu de gamme. Productrice importante de biens d’équipement industriels, elle n’a pas su s’orienter vers l’intégration numérique de l’usine, contrairement à ses concurrents allemands ou coréens réellement positionnés sur les « technologies 4.0 ».
La politique en direction de l’industrie du futur en Italie part explicitement de ce constat ; elle se décline aux échelles nationales et régionales. Historiquement, c’est même une initiative lombarde qui a vu le jour la première, dès 2006, sous le nom de Mind in Italy (cf. Encadré 6). Dotée d’un budget modeste de 40 millions d’euros, elle est longtemps restée une initiative isolée.
Encadré 6 – le Cluster « Fabbrica intelligente Lombardia »
Le cluster lombard dédié à l’usine du futur est, par le nombre d’entreprises et de centres de recherche qu’il mobilise, un acteur important de l’effort national. Une centaine d’entreprises, douze universités et centres de recherche et autant de fédérations industrielles prennent part à ce cluster régional.
Les éléments budgétaires dont nous disposons, en revanche, sont incroyablement faibles. La cotisation va de 500 à 1 000 euros par acteur ; et la région de Lombardie participe à hauteur d’un million d’euros pour 2014-2015. L’objectif du cluster est de créer un observatoire de veille technologique et de développer des projets de recherche précis avec l’aide des entreprises et centres impliqués. On peut donc le comparer à un pôle de compétitivité français de faible envergure.
Les programmes nationaux ont progressivement gagné en importance mais il demeure difficile d’identifier une stratégie forte. Lancé en janvier 2012 mais déjà clôturé, un premier plan intitulé Fabbrica del futuro devait rassembler organismes de recherche et universités autour de projets de recherche assez théoriques et pointus. Doté d’un budget dérisoire de 4 millions d’euros, son pilotage a été confié au Centre national de la recherche (CNR). Cette prise en charge se déployait jusque dans la constitution des projets, qui devaient tous intégrer un ou plusieurs instituts affiliés au CNR dans leurs équipes.
On ne peut donc pas à proprement parler de « plan italien », au mieux d’un projet de recherche sur des sujets susceptibles d’intéresser l’industrie. Assez logiquement, l’initiative Fabbrica del futuro n’a connu qu’un faible écho auprès des industriels.
Le programme Cluster Tecnologici Nazionali : Fabbrica Intelligente est venu ensuite. Doté en 2013 de 47 millions d’euros, il vise à obtenir des résultats appliqués, en lien avec les technologies de l’usine du futur, et à créer des espaces de coopération et de spécialisation régionales (par exemple, la production spécialisée pour la région de Modène, la production modulaire pour Bergame, la robotique pour Naples, etc.). La mobilisation des entreprises et des régions est donc plus forte sur ce dernier programme mais, au regard des exemples précédents, force est de constater que l’action du gouvernement italien est restée relativement limitée.
- 12 – Voir le tableau récapitulatif en annexe (page 77).
- 13 – Pour une étude approfondie du programme Industrie 4.0 , nous vous invitons à consulter l’ouvrage « Industrie 4.0. Les défis de la transformation du modèle industriel allemand », auquel La Fabrique de l’industrie s’est associée. Dorothée Kohler et Jean-Daniel Weisz y reviennent dans le détail sur les grandes étapes de la construction du programme allemand et sur le rôle joué par les principaux acteurs (industriels, syndicats, etc.).
- 14 – Source : UNIDO (base CIP).
- 15 – D’après le rapport « State of the internet » publié par Akamai technologies, la Corée du Sud disposait en 2013 du réseau le plus rapide au monde avec un débit de 21.0 Mbit/s, contre 12.9 Mbits/s pour le réseau japonais.
- 16 – Wübbeke (2015).
- 17 – Das, N’Diaye (2013).
- 18 – Markus, Marro (2015).
- 19 – Wübekke, op. cit.
- 20 – Vilars (2014).
- 21 – H+ Magazine (2016).
- 22 – C’est par exemple le cas de l’Advanced manufacturing research centre de Sheffield.
André Gauron – L’Industrie 4.0 : quelle vision pour la France ? – Commentaire
Ingénieur et économiste de formation, André Gauron est conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes. Il a travaillé à l’Insee et au Commissariat général au plan avant d’être conseiller de Pierre Bérégovoy aux affaires sociales et au ministère de l’Économie et des Finances. Il a été membre du CAE entre 1998 et 2002 et collabore depuis sa création à Lasaire, un laboratoire de recherche sur les questions sociales proche des organisations syndicales.
La révolution numérique est largement engagée. Comme les précédentes révolutions industrielles, elle va profondément renouveler notre façon de produire et de consommer. Comme elles, elle a une dimension technologique et impactera l’organisation du travail. Mais son ressort est différent des précédentes, elle est de nature communicationnelle et se développe d’entrée au plan mondial. Pour la première fois, il s’agit d’une révolution qui porte spécifiquement sur la communication entre les hommes et entre les hommes et les machines, où qu’ils soient. Cette révolution comporte encore de nombreuses inconnues. Si son importance ne fait plus débat, en revanche, sa mise en perspective diffère profondément d’un pays à l’autre. Or, la vision qu’un pays se fait de la révolution digitale impacte très directement la formation et l’évolution des compétences, et donc les politiques publiques à mettre en œuvre.
L’opposition entre la France et l’Allemagne est à cet égard symptomatique. De l’autre côté du Rhin, l’enjeu des débats en cours et des politiques à mettre en œuvre s’énonce simplement : maintenir le leadership industriel allemand dans la production de biens haut de gamme et défendre le « site allemand », position unanimement portée par l’ensemble des acteurs, patronat, syndicats, État et Länder23. De ce côté-ci, l’objectif est tout différent : si l’industrie du futur est présentée comme « un levier du renouveau industriel », c’est davantage à partir des usages et des enjeux de société qui mêlent à la fois transition écologique, transformation du travail, révolution managériale, reconquête des territoires ou encore économie du partage. Le « renouveau industriel » est vu comme une opportunité ouverte par la transformation sociale attendue plus que comme le cœur de l’enjeu. Quand la question de la compétitivité est omniprésente en Allemagne, elle est peu présente dans le débat français (et trop souvent réduite à un débat sur les coûts salariaux).
Il faut s’arrêter un instant sur cette opposition pour éviter de faux débats. Pour tout le monde, il est clair que la révolution digitale transforme en profondeur les rapports entre l’industrie et les services, que là où il y avait deux mondes distincts, il y a désormais continuum. Il n’y a plus production d’objets d’un côté et de services de l’autre, mais production de solutions qui incluent les deux. La relation client en est de ce fait révolutionnée. La question est de savoir, qui, dans cette relation, commande à l’autre : est-ce que les services vont prendre définitivement le pas sur l’industrie, comme on le professe en France, ou est-ce que l’industrie doit conserver son leadership sur les services comme le veut l’Allemagne ?24 Le numérique va-t-il réaliser le rêve de Serge Tchuruk, énoncé il y a vingt ans, d’« entreprises sans usines », vouées à créer des solutions avec des produits fabriqués ailleurs, un monde de services qui a renoncé à son industrie nationale ? Ou bien impose-t-il d’abord à l’industrie de transformer ses équipements en devenant plus communicationnelle, avant même de se prolonger par des services intégrés en offrant des solutions globales au client, complètement maîtrisées de l’amont (la production) à l’aval (le service) ? Deux visions radicalement différentes.
La façon de regarder le futur de l’automobile résume bien ce dilemme. De chaque côté du Rhin, on regarde l’avenir de l’automobile à travers son usage. Mais ici, l’usage s’inscrit dans une vision de transition écologique et d’économie solidaire qui met l’accent sur l’auto-partage et le covoiturage ; là-bas, on ne s’intéresse pas à la propriété du véhicule mais à sa conduite, à la voiture autonome. La France se demande comment contrôler les plateformes de mise en relation des usagers et éviter une captation par les GAFA25. Les constructeurs allemands se sont inquiétés de voir le cœur de la voiture autonome, le gestionnaire de navigation, leur échapper et se sont unis pour racheter l’application de cartographie numérique Here mise au point par Nokia avant que Google ne s’en empare. La France aura peut-être la voiture électrique avant les Allemands, mais elle aura laissé les Google26 et autres Uber s’installer au volant et en capter la valeur. Elle a une vision sociétale du numérique quand l’Allemagne garde une vision profondément industrielle. Cela risque de ne pas être suffisant pour assurer le « renouveau de l’industrie française », voire d’aggraver son déclin.
- 23 – La commission d’éthique mise en place par la chancelière allemande, Angela Merkel, sur les conséquences de la fin du nucléaire, affirmait ce même objectif.
- 24 – Voir : Conseil national du numérique, 2016, « Travail, emploi, numérique : les nouvelles trajectoires », Rapport au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, janvier ; Kotlicki M-J., 2015, « Les nouveaux rapports industrie/services à l’heure numérique », avis du Conseil économique, social et environnemental, octobre ; France stratégie, 2016, « Tirer parti de la révolution numérique », France Stratégie 2017-2027, mars ; Kohler D., Weisz J-D., 2016, « Industrie 4.0 . Les défis de la transformation numérique du modèle industriel allemand », La Documentation française, mars.
- 25 – GAFA : Google-Apple-Facebook-Amazon.
- 26 – Dans une note d’avril 2016 intitulée « La voiture sans chauffeur, bientôt une réalité », France Stratégie imagine deux scénarios de déploiement, l’un progressif d’ici à 2040 l’autre de rupture plus rapide à partir de 2025 avec en photo dans le mail d’envoi une voiture aux couleurs de Google. Comme si le géant américain de l’internet avait déjà gagné la bataille de la géolocalisation nécessaire au pilotage !
Pour une Industrie 4.0 à la française
Le panorama précédent met en exergue la diversité des politiques « Industrie du futur » à travers le monde. Il ne s’agit pas de classer les pays étudiés mais de mettre en exergue les défis spécifiques auxquels la France est confrontée, ainsi que ses atouts, pour qu’elle définisse des priorités pertinentes. L’enjeu principal pour l’industrie française est la modernisation de son appareil productif, afin d’accélérer sa montée en gamme et d’améliorer durablement sa compétitivité. En parallèle, la France doit aussi exploiter ses atouts dans les technologies clés de l’industrie du futur. Ses entreprises ne sont certes pas en capacité de rivaliser avec les leaders allemands ou coréens de la robotique industrielle généraliste mais comptent tout de même de nombreux talents dans les technologies du numérique. La mobilisation autour de l’industrie du futur peut être l’occasion de fédérer l’ensemble des acteurs autour de ces objectifs, afin de mettre la France sur la voie de la réindustrialisation.
1. Un impératif : la modernisation de l’appareil productif
La France affiche un retard important
La modernisation de l’appareil productif est un préalable indispensable pour soutenir la compétitivité de l’industrie française. En effet, un cercle vicieux s’est enclenché depuis au moins dix ans : les marges des entreprises sont trop faibles pour soutenir l’investissement, le vieillissement de l’outil de production s’accélère, la capacité à innover se réduit… Dès 2010, le rapport final des États généraux de l’industrie alertait sur le déficit d’investissement de la France, de l’ordre de 100 milliards d’euros, vis-à-vis de ses principaux concurrents. Alors que l’industrie française ne comptait que 32 233 robots en 2014, on en dénombrait 59 823 en Italie et 175 768 en Allemagne. Si l’on raisonne en termes de « densité », c’est-à-dire lorsque l’on rapporte le stock de robots en service au nombre de salariés, la France disposait en 2013 de 125 machines pour 10 000 salariés contre 282 pour l’Allemagne, bien loin des 437 du leader de ce classement : la Corée du Sud (cf. Graphiques 2 et 3).
Graphique 2 – Stock de robots industriels multi-tâches (2014)
Source : International Federation of Robotics
Graphique 3 – Nombre de robots pour 10 000 salariés (2013)
Source : International Federation of Robotics
Comme le constate l’économiste Robin Rivaton, « l’industrie française a tendance à adopter un comportement conservateur » en termes d’investissement27. Les entreprises cherchent à retarder au maximum le remplacement de leurs machines : elles n’étaient ainsi que 65 % à avoir déclassé des équipements en 2014, contre 80 % en 2000. Et c’est avant tout en raison de leur usure ou de leur vieillissement que les industriels choisissent de s’en séparer (60 % en 2014, soit 15 points de plus qu’en 2000), moins d’un tiers des machines étant mises au rebut pour être remplacées par du matériel plus performant (cf. Graphique 4).
Graphique 4 – Évolution des motivations pour les déclassements d’équipements
Source : Insee
Aux faibles performances en matière de robotisation s’ajoute un retard dans la numérisation de l’outil de production. Le cabinet de conseil Roland Berger révèle que les entreprises françaises affichent un retard important, à la fois quand on les compare aux usages des consommateurs et à ceux de leurs homologues étrangères. Leur utilisation du numérique se limite souvent à un socle basique (emails, site web vitrine, etc.) et les usages les plus avancés sont l’apanage d’un nombre restreint d’entreprises, parmi lesquelles on retrouve beaucoup de grands groupes. Ce constat est confirmé par les principaux indicateurs de maturité numérique publiés par le Forum économique mondial ou par l’International Telecommunication Union.
Le graphique 5 montre que les industriels français sont bien moins avancés dans leur utilisation des outils numériques que leurs voisins allemands. Ils se placent même à des niveaux inférieurs à la moyenne européenne sur la plupart des aspects. La diffusion du numérique s’est pour l’instant faite au profit de l’intégration des processus en interne, grâce à des logiciels de planification (ERP), ce qui donne le sentiment que ces entreprises restent pour l’essentiel des « donjons numériques », pour reprendre l’expression de Roland Berger28. Les entreprises manufacturières ont en effet négligé la gestion de la relation client ou les usages plus avancés permis par le cloud et l’internet des objets, par exemple. Enfin, il convient de souligner les écarts criants en termes de développement des compétences clés : les entreprises françaises étaient 17 % à avoir employé un spécialiste des TIC et 20 % à avoir organisé des formations dans ce domaine en 2014, soit respectivement 7 et 14 points de moins qu’en Allemagne.
Les pouvoirs publics mobilisés
Les pouvoirs publics semblent avoir pris la mesure des risques d’un tel déficit d’investissement productif. Les différentes mesures décidées par le gouvernement depuis 2012 (CICE, Pacte de responsabilité) ont permis aux entreprises de restaurer leurs marges et de recouvrer une capacité d’investissement. À travers son programme « Industrie du futur » (cf. Encadré 7), il s’est engagé plus directement encore dans le soutien à la modernisation de l’appareil productif et à la transition numérique des entreprises.
Encadré 7 – Le programme « Industrie du futur » en France
L’initiative française en faveur de l’industrie du futur s’inscrit dans le projet de la « Nouvelle France industrielle ». Lancé le 12 septembre 2013 par le président de la République et le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg, ce projet est le résultat d’un travail préparatoire d’un an mené par le Conseil national de l’industrie (CNI). La détermination des priorités a pour sa part été confiée à la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS)29 et au cabinet McKinsey, en lien avec les pôles de compétitivité et les comités stratégiques de filières au sein desquels les chefs d’entreprises, les partenaires sociaux, les administrations concernées et les fédérations professionnelles sont représentés.
Depuis le mois de mai 2015, la Nouvelle France industrielle est entrée dans sa deuxième phase afin de faire gagner le projet en lisibilité et de le mettre plus en phase avec les grands défis d’avenir. Concrètement, cela s’est traduit par une réorganisation des 34 plans initiaux30 en neuf « solutions »31 et un programme transversal intitulé « Industrie du futur ». L’ambition de ce dernier a été élargie : outre la modernisation de l’outil productif, son objectif est aujourd’hui d’accompagner la transformation numérique des entreprises.
Le pilotage du programme a été confié à différents représentants du monde économique, qui ont pour charge de définir la feuille de route. Aux côtés des groupes Fives et Dassault Systèmes, les deux co-pilotes de l’ancien plan « Usine du futur », on retrouve aujourd’hui des membres du CNI, des représentants des pouvoirs publics, des industriels ainsi que des représentants de l’Alliance Industrie du futur. Présidée par Philippe Darmayan, président d’ArcelorMittal France et du Groupe des fédérations industrielles, cette dernière a pour mission de mettre en œuvre et de coordonner les actions définies par la feuille de route. Elle associe de nombreux acteurs du monde industriel et du numérique (FIM, UIMM, UIC, Syntec Numérique, etc.), du monde de la recherche et de la formation (CEA, Cetim, Ensam, Institut Mines-Télécom, etc.) et est ouverte à l’ensemble des syndicats et fédérations professionnelles souhaitant s’impliquer dans le projet.
Alors que les aides publiques à l’intégration des technologies de l’industrie du futur sont quasiment absentes du côté allemand, de nombreux dispositifs ont vu le jour en France. Un soutien financier direct de l’ordre de 2,2 milliards d’euros est apporté par l’intermédiaire de Bpifrance, afin d’aider les PME et ETI dans le financement de leurs investissements dans le numérique, la robotique, l’efficacité énergétique, etc. À cela s’ajoute une mesure exceptionnelle de 2,5 milliards d’euros d’avantages fiscaux pour les entreprises investissant dans leur outil productif. Le programme « Robot Start PME » lancé en octobre 2013 vise quant à lui à inciter les plus petites entreprises à s’équiper d’un premier robot. Il a été reconduit jusqu’en 2017 dans le cadre du plan « Industrie du futur », après avoir épuisé son enveloppe initiale dès le mois de mars 2015. À terme, ce sont 250 entreprises qui bénéficieront de ce dispositif déployé par le Symop, le Cetim et le CEA List.
Graphique 5 – Pourcentage des entreprises manufacturières…
Données 2009, 2011 ou 2014
(*) RFID : Radio frequency identification ; (**) ERP : Enterprise resource planning ; (***) GRC : Gestion de la relation commerciale
Champ : Industrie manufacturière (entreprises de plus de 10 salariés)
Source : Eurostat / Traitement : La Fabrique de l’industrie
Pas de futur pour l’industrie sans montée en gamme
La modernisation de l’appareil productif est un prérequis pour l’amélioration de la compétitivité industrielle et l’ampleur de la mobilisation des acteurs publics et institutionnels est un premier motif de satisfaction. Il ne faudrait pas, toutefois, focaliser le débat sur la seule question technologique, comme le fit le plan « Usine du futur ». Avant mai 2015, celui-ci avait en effet pour seul objectif de financer des projets de modernisation d’entreprise et de faire émerger une offre nationale de technologies. Or, l’intégration de nouvelles technologies de production, l’automatisation et la numérisation des process doivent s’inscrire dans une démarche de montée en gamme, sans laquelle toute stratégie de reconquête industrielle serait vaine.
Ce constat n’est pas nouveau. De nombreuses études et rapports ont en effet mis en lumière, notamment depuis 2008, le problème de positionnement de gamme de l’industrie française et la nécessité de développer une offre différenciée, de qualité, à même de s’imposer sur les marchés mondiaux ou de mettre en œuvre des processus de production plus efficaces.
Deux objectifs sont donc visés : offrir des produits différenciés ou personnalisés que le client est prêt à payer plus chers que des commodités ou, grâce à une excellente maîtrise des processus de fabrication, maîtriser les coûts de production malgré le coût plus élevé de la main d’œuvre. Ces objectifs peuvent d’ailleurs se révéler complémentaires. Il faut ainsi garder à l’esprit que le modèle de l’industrie du futur repose non seulement sur des usines modernes, numérisées, capables de fabriquer des produits personnalisés, mais aussi sur de nouvelles organisations qui améliorent les conditions de travail en supprimant les tâches les plus pénibles, qui libèrent la créativité des salariés et la mettent au service de l’innovation et de l’amélioration continue. La modernisation de l’outil de production doit donc se faire au profit de l’amélioration de la compétitivité « coût » et « hors coût ». Celle-ci doit se concevoir au sens large : elle peut reposer sur la technologie, mais également sur le design, le marketing, etc.
Plusieurs entreprises encore implantées en France fournissent d’excellents exemples de ce type de positionnement. En misant sur le développement de produits innovants, à fort contenu technologique, des entreprises, comme Thuasne dans le textile technique ou Axon’ Cable, Eolane ou Actia dans les systèmes électroniques, sont parvenues à résister à l’effondrement de secteurs soumis à la concurrence sur les prix exercée par les pays émergents. Sur un autre plan, même s’ils sont peu nombreux, les récents cas de relocalisations opérées en Europe ou aux États-Unis montrent comment la proximité avec les marchés finaux peut être un des ressorts de la montée en gamme industrielle32. Dans le cas de Motorola par exemple, la relocalisation d’une partie des activités du groupe aux États-Unis a découlé du choix d’élargir la gamme des produits de la marque tout en proposant de nombreuses possibilités de personnalisation. Dans une configuration où les produits sont parfois fabriqués sur-mesure, à la demande du client, le lien direct avec le consommateur est essentiel car il permet de mieux connaître ses besoins, d’adapter les produits à ses envies, de développer des services associés, etc. Les problèmes de coordination avec un fabricant lointain, déjà sensibles pour des productions standardisées, deviennent quasiment insurmontables dès lors que le degré de personnalisation s’accentue.
Mais, comme le dit Stéphan Bourcieu, directeur général du groupe ESC Dijon-Bourgogne, « une telle stratégie de montée en gamme ne se décrète pas »33. Elle représente un défi important à l’échelle de l’entreprise et ne pourra se faire que sur la durée, car elle nécessite la mobilisation de ressources financières importantes et remet en question de nombreuses autres dimensions : innovation, qualité, services, organisation de la production, niveau de qualification des salariés, etc. Le défi est donc de taille. L’industrie du futur représente une opportunité unique de fédérer l’ensemble des acteurs autour de cet enjeu. Plutôt que d’insister sur le retard ou les handicaps de la France, nous avons choisi, dans la partie qui suit, de nous focaliser sur les atouts que compte notre pays et sur lesquels nous pouvons capitaliser pour réussir cette transition dans les meilleures conditions.
2. Les atouts de la France dans la transition vers l’industrie du futur
Identifier les atouts technologiques
Pour être mobilisatrice, la vision technologique de l’Industrie 4.0 a indubitablement un aspect prospectif, même aux yeux des grands groupes industriels allemands qui ont participé à la forger. Cette vision a installé dans le discours collectif l’image d’usines automatisées et digitalisées à l’extrême, où les lignes de production seraient rendues flexibles grâce aux machines-outils connectées haut de gamme… évidemment produites par les champions de l’industrie mécanique allemande. Les fournisseurs français peuvent donner l’impression d’être en retard par rapport à ces leaders et d’avoir raté le tournant des technologies 4.0. S’ils sont effectivement en retrait dans les domaines de la robotique industrielle ou des automatismes34, ils ont en revanche de nombreux atouts à faire valoir sur des technologies de pointe tels que les systèmes embarqués, la réalité augmentée, etc. qui investiront massivement les usines et les entreprises. C’est pourquoi le travail d’identification des atouts français est primordial. Il a été amorcé au sein de l’Alliance Industrie du futur ; un rapport de l’Académie des Technologies à paraître à l’automne 2016 présentera en outre certaines technologies clés sur lesquelles la France dispose d’un positionnement avantageux ou doit faire des efforts particuliers.
La cybersécurité est un exemple de ces nombreux domaines dans lesquels l’offre française excelle et dont les perspectives de croissance sont prometteuses. La diffusion des machines-outils pilotées en réseau et des objets connectés ou encore l’intégration de la chaîne de valeur grâce aux outils numériques accroissent en effet les volumes mais aussi le nombre des canaux d’échange de données, et donc les possibilités de s’introduire dans les systèmes. Le virus Stuxnet, conçu en 2008 dans le but d’endommager les installations nucléaires iraniennes, est l’exemple le plus connu d’attaque informatique ayant visé un site industriel mais il est loin d’être le seul. En 2014, l’industrie pétrolière norvégienne a subi à son tour une attaque massive : plus de cinquante entreprises ont vu leurs données de forage et de prospection piratées. En 2016, le directeur des affaires publiques d’Airbus Group faisait état de 300 attaques par jour pour sa seule entreprise. Le secteur de l’énergie constitue une cible privilégiée des hackers mais l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (Anssi) a déjà mis en garde l’ensemble des industriels face à la recrudescence de ces cyberattaques pouvant dans certains cas avoir des conséquences pour la survie même de l’entreprise35.
De grands groupes français comme Airbus ou Thales défendent aujourd’hui leur position de leader sur le marché de la cybersécurité. Tout l’enjeu pour eux est de transposer leurs technologies de pointe, développées pour des applications militaires ou sensibles, à un marché beaucoup plus large. À leurs côtés, des entreprises de services comme Atos ou Orange proposent également ce type de services dans des offres globales d’accompagnement à la transformation digitale des entreprises. On retrouve enfin de nombreuses PME et ETI spécialistes de l’édition et de l’intégration de solutions de cybersécurité en pointe, dont certaines se sont regroupées en 2013 au sein de l’association HexaTrust.
Plus largement, ces dernières années, la France a su développer un vivier de start-up et de PME spécialisées dans le numérique : internet des objets, big data, etc. La vivacité de ce nouvel écosystème se retrouve dans les résultats du baromètre établi par Capgemini Consulting et eCap Partner. Celui-ci a répertorié plus de 405 levées de fonds portant sur des start-up du numérique en 2015, contre 300 l’année précédente. Le montant cumulé de ces levées de fonds a dépassé le milliard d’euros, soit une progression de 140 % en un an. Parmi les pépites françaises, on peut citer Sigfox qui, début 2015, a réussi à lever 100 millions d’euros auprès d’investisseurs européens, américains et asiatiques afin d’accélérer son développement à l’international. Cette start-up toulousaine déploie un réseau bas débit dédié à l’internet des objets36 (« Ultra narrow band ») qui permet de couvrir des zones très larges avec une économie d’infrastructure.
L’enjeu central pour ces technologies numériques – et pour les technologies de l’industrie du futur de manière générale – est la normalisation des standards permettant l’interopérabilité des systèmes.
D’une part, cela soulève la question de la structuration de ces filières composées d’acteurs très différents, développant de plus des technologies qui n’en sont parfois qu’à leurs balbutiements. Les relations entre grands groupes et start-up restent encore ambiguës, alternant entre fascination et méfiance réciproques. Les mentalités et les pratiques tendent à évoluer et la multiplication des incubateurs au sein des grands groupes est un signe de cette volonté de tirer parti des avantages et qualités de chacun : la puissance économique et commerciale des grands groupes d’une part, l’agilité et la capacité d’innovation propres aux petites structures d’autre part. De la réussite de ces coopérations dépendra en grande partie la capacité de la France à imposer ses produits et standards, face à des concurrents américains qui se sont déjà mis en ordre de bataille. AT&T, Cisco, General Electric, IBM, et Intel ont par exemple créé au mois de mars 2014 l’Industrial Internet Consortium (IIC). Plus de 200 acteurs de l’internet des objets se sont regroupés aux côtés de ces cinq géants des télécommunications et du numérique afin d’accélérer le développement et l’adoption de leurs produits et donc de leurs normes.
D’autre part, cela met en évidence l’importance d’une coopération franco-allemande et plus largement européenne pour peser dans les négociations de cette future normalisation. L’IIC et la Plattform Industrie 4.0 ont annoncé leur rapprochement en mars 2016, reconnaissant ainsi la nature complémentaire de leurs travaux et notamment de leurs modèles architecturaux, baptisés respectivement IIRA (Industrial Internet Reference Architecture) et RAMI 4.0 (Reference Architecture Model for Industry 4.0). Pour leur part, la France et l’Allemagne ont présenté au mois d’avril 2016 un plan d’action commun qui prévoit notamment d’établir un cadre de référence unifié, dérivé de RAMI 4.0.
Capitaliser sur la qualité de la recherche publique pour soutenir l’innovation et la montée en gamme
La France bénéficie d’une bonne recherche publique grâce à des laboratoires de qualité (CNRS, Inria, etc.). La distinction du CEA comme l’organisme public de recherche le plus innovant au monde par l’édition 2016 du classement Reuters en est le signe. De manière globale, elle reste toutefois un pays « suiveur » en matière d’innovation et peine à transformer les résultats de sa recherche en applications commercialisables, créatrices de richesses37. Certes, ce constat est dressé dans de nombreux pays, y compris dans certains que nous jugeons plutôt performants en la matière (Suède, États-Unis…) mais il faut reconnaître qu’il prend une acuité toute particulière en France. L’exemple de la fabrication additive est symptomatique. En 1984, deux brevets décrivant la technique de stéréolithographie sont déposés par des Français puis quelques semaines plus tard par un universitaire américain, Charles Hull. Ce dernier créera moins de deux ans plus tard une start-up qui deviendra rapidement le leader mondial sur cette technologie centrale de l’industrie du futur38, alors que le brevet français ne sera jamais exploité. La filiale d’Alcatel qui en était propriétaire n’a pas jugé pertinent de le maintenir, bien qu’un laboratoire du CNRS ait montré la viabilité du procédé.
De nombreuses réformes ont cherché à améliorer l’interface entre les organismes de recherche et les entreprises, notamment la création des conventions Cifre au début des années 1980, la loi dite « Allègre » sur la recherche et l’innovation de 1999 (qui permet par exemple à un chercheur de créer ou de conseiller une entreprise pour valoriser ses travaux), l’extension et le déplafonnement du crédit d’impôt recherche, bénéficiant aux entreprises engageant des recherches et plus encore lorsqu’elles les confient à des laboratoires publics, le statut de « Jeune entreprise innovante », les pôles de compétitivité depuis 2005, les instituts Carnot, les instituts de recherche technologique (IRT), les sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT), etc.
Cette politique a eu des effets positifs. Alors que les dépenses publiques de recherche et développement, exprimées en points de PIB, sont restées stables, l’effort de recherche des entreprises s’est nettement relevé depuis le creux observé au milieu des années 2000 (cf. Graphique 6).
Graphique 6 – Dépenses intérieures de R&D des entreprises et des administrations (en % du PIB)
Source : MENESR-SIES Recherche et Insee
Les efforts doivent être poursuivis car la France reste en deçà de la moyenne des pays de l’OCDE en termes d’effort global (2,24 % contre 2,36 % du PIB en 2013). Après dix ans de création de nouveaux dispositifs et institutions, l’heure doit d’abord être à l’évaluation et à la mise en cohérence d’une architecture devenue complexe39. Les premiers travaux de la Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation, installée en juin 2014 suite aux recommandations du rapport Beylat-Tambourin, alertent sur les risques de saupoudrage et les effets d’aubaine que la multiplication des dispositifs entraîne. Ils révèlent qu’entre 2000 et 2015, le nombre de dispositifs nationaux de soutien à l’innovation est passé de 30 à 62 et que sur cette même période, les dotations par dispositif ont été divisées par trois.
La stratégie de transfert technologique doit ensuite se concevoir selon une approche plus globale. C’est ce que préconise Suzanne Berger dans son rapport remis au gouvernement en janvier 2016. Les réformes successives ont pour l’instant privilégié la création d’institutions permettant de faire le pont entre les organismes de recherche publique et les entreprises ; il faut aujourd’hui, selon elle, miser sur des connexions directes beaucoup plus denses et des interactions beaucoup plus nombreuses et diverses entre la recherche publique et les entreprises (contrat de recherche, conseil, co-encadrement de stages et thèses, échanges de toute nature, mobilité individuelle…).
Par ailleurs, les structures d’essaimage de certains organismes ont fait la preuve de leur efficacité (Inra, CEA). L’Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria) fait partie des pionniers dans ce domaine. Depuis une trentaine d’années, il a participé à la création et au développement de plus de 120 sociétés de technologies innovantes, proposant des produits et services dans des secteurs aussi divers que la défense, les transports, l’énergie, l’éducation, etc. Ce soutien consiste non seulement à apporter une aide financière afin de faciliter l’amorçage, mais aussi dans le conseil aux chercheurs pour la définition et la formalisation de leur projet entrepreneurial. Ce dispositif d’accompagnement permet de faire le lien entre les savoir-faire des chercheurs et les besoins du marché et concourt à leur faire acquérir une culture entrepreneuriale nécessaire dans ce type de démarche.
Mobiliser les écoles d’ingénieurs
Les ingénieurs joueront un rôle de pivot pour mener à bien la transition des entreprises vers l’industrie du futur. En effet, les différentes technologies concernées sont souvent disponibles et même, pour certaines, déjà présentes au sein des entreprises. Le véritable enjeu pour les industriels est de trouver les compétences qui leur permettront de les combiner de manière efficace et pertinente. De même, ces profils sont essentiels pour accompagner la montée en gamme de l’industrie. À ce titre, la qualité de la formation des ingénieurs en France constitue un atout précieux.
Selon Laurent Champaney, directeur général adjoint de l’école nationale supérieure des Arts et Métiers (Ensam) en charge de la formation, « un déficit important est à prévoir chez les ingénieurs de production et les ingénieurs en organisation industrielle car ils sont aux avant-postes de la modernisation et de la numérisation des entreprises. » Par ailleurs, la transformation en profondeur des fonctions tertiaires comme le marketing, la logistique ou la gestion commerciale par le numérique requerra de nombreux spécialistes du développement informatique, du big data mais également d’architectes de systèmes capables de mettre en réseau les équipements informatiques, les sites internet, les machines et les objets connectés. Ces profils concentrent déjà les plus fortes tensions sur le marché de l’emploi de niveau master, car les besoins n’ont pas toujours été correctement anticipés et les filières de formation n’en sont parfois qu’à la phase de conception. En conséquence, entre six et huit projets de recrutements sur dix sont jugés difficiles pour les chefs de projets informatiques ou les spécialistes de la maintenance40.
Plus globalement, les difficultés de recrutement sur les postes d’ingénieur sont en partie imputables à un déficit d’attractivité du secteur industriel41. Pour corser les choses, le profil-type de l’ingénieur dont l’industrie a besoin ressemble de plus en plus à la perle rare. Les entreprises attendent d’eux qu’ils combinent leur expertise technique avec des compétences managériales, qu’ils aient une vision globale de tous les aspects du business, les aptitudes pour travailler à l’international, les qualités pour s’intégrer à des structures et des méthodes de travail en constante évolution, etc. Comme le résume Laurent Champaney, « les métiers de l’ingénierie se complexifient et nécessitent la maîtrise d’une palette de compétences toujours plus large, en raison notamment de la diffusion du numérique. Ces disciplines exigeantes, où l’erreur n’est pas permise, peuvent rebuter certains étudiants. »
Les tensions dans le recrutement sont également le signe de la concurrence que se livrent les employeurs pour attirer les meilleurs profils. Elles soulignent en particulier le problème de la mainmise des grands groupes (industriels ou non), des cabinets de conseil ou encore des SSII sur le recrutement des étudiants sortant des écoles les plus prestigieuses. En définitive, ce sont les petites entreprises qui souffrent le plus de cette pénurie. Christian Lerminiaux, ancien président de la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI), confirme que « ce sont surtout les PME innovantes qui manquent d’ingénieurs. Placées sur des niches technologiques, elles ont besoin de matière grise pour se développer, et leur difficulté à attirer des diplômés limite leur croissance. »42
Face à ces difficultés, il est donc urgent que les écoles d’ingénieurs et les PME renforcent leurs liens. Le programme « Ingénieur, pensez PME », lancé en 2013 par trois écoles d’ingénieurs implantées entre Aix-en-Provence et Marseille, consiste par exemple à organiser tout au long de l’année des visites de sites, des conférences ainsi que des rencontres entre les étudiants et les PME de la région. Ces manifestations permettent aux entreprises d’insister sur les responsabilités plus élevées et la plus grande autonomie dans le travail qu’elles peuvent offrir à leurs collaborateurs. En trois ans, la part des élèves de ces écoles ayant effectué leur stage en PME est passé de 5 % à 20 %. Certains grands groupes commencent également à se saisir de ce problème d’accès aux compétences et jouent la carte de la coopération inter-entreprises avec les PME de leur filière. Les « Parcours partagés d’apprentissage » ont ainsi été créés en 2012 à l’initiative de la filière aéronautique. Ce dispositif permet à un jeune réalisant son apprentissage dans un grand groupe, d’effectuer une partie de son parcours chez un de ses fournisseurs, généralement une PME. Si son contrat ne débouche pas sur une embauche définitive dans le groupe, l’apprenti pourra alors se diriger vers la PME.
- 27 – Rivaton (2012).
- 28 – Roland Berger (2014a).
- 29 – Aujourd’hui rebaptisée « Direction générale des entreprises » (DGE).
- 30 – Plus d’informations sur la première phase de la Nouvelle France Industrielle et ses 34 plans sur : www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/nouvelle-france-industrielle-sept-2014.pdf
- 31 – Nouvelles ressources, ville durable, mobilité écologique, transports de demain, médecine du futur, économie des données, objets intelligents, confiance numérique, alimentation intelligente.
- 32 – Woody (2015). On notera cependant que certaines entreprises arrivent à coordonner un « front office » proche du client et un « back office » dans les pays où la production peut être réalisée à moindre coût.
- 33 – Bourcieu (2014).
- 34 – Voir le commentaire de Jean-Pierre Laumond (page 66) pour une analyse plus nuancée.
- 35 – Challenges (2016).
- 36 – L’internet des objets peut utiliser des infrastructures à bas débit, beaucoup moins coûteuses que celles utilisées par les ordinateurs et smartphones. Ces réseaux à bas débit permettent la communication de faibles volumes de données entre les appareils connectés, tout en étant peu énergivores.
- 37 – Berger (2016).
- 38 – Le marché de la fabrication additive représentait en 2015 plus de 5 milliards de dollars, en progression de plus de 25 % sur un an (source : Wohlers Associates).
- 39 – Beylat, Tambourin (2013).
- 40 – Source : enquête « Besoins en main d’œuvre » (Pôle emploi, données 2015).
- 41 – Apec (2008).
- 42 – Usine nouvelle (2013).
Jean-Paul Laumond – La robotique en France : une recherche de qualité – Commentaire
Jean-Paul Laumond est roboticien, directeur de recherche au LAAS-CNRS à Toulouse, membre de l’Académie des Technologies, IEEE Fellow. Professeur de mathématique au début de sa carrière, il soutient une thèse en robotique en 1984. Son activité de recherche porte sur la planification et le contrôle du mouvement en robotique. En 2000, il crée et dirige pendant deux ans la société Kineo Cam qui devient en 2012 Siemens PLM Software. En 2005, il oriente son activité sur les robots humanoïdes et co-dirige pendant trois ans le laboratoire franco-japonais JRL, commun au CNRS et à l’AIST. En 2012, il est le titulaire de la chaire Innovation Technologique Liliane Bettencourt au Collège de France. Depuis 2014, il conduit le projet de recherche Actanthrope soutenu par l’European Research Council. Il est le lauréat 2016 du prix IEEE Inaba Technical Award for Innovation Leading to Production.
La robotique industrielle nait au début des années 1960 avec l’introduction du premier manipulateur programmable sur les chaînes de montage de General Motors. A la même époque, en France, le Commissariat à l’énergie atomique étudie la possibilité de commander à distance un bras manipulateur chargé d’explorer les zones irradiées des centrales nucléaires. Dans le courant des années 1970, la Régie nationale des usines Renault (RNUR) s’engage, avec le soutien de l’État et la participation de laboratoires de recherche publique, dans la conception et la fabrication de robots au sein de sa branche machines-outils. Sa filiale ACMA produit une centaine de robots en 1980 et le nombre de robots à la RNUR passe de 31 à 220 en l’espace de cinq ans, de 1977 à 198243. Dans le même temps, le CNRS, s’appuyant sur cette dynamique, lance le programme « Automatique et robotique avancées » (ARA) basé sur un partenariat public-privé, et doté de plusieurs millions de francs. Ce programme donne une impulsion déterminante à l’origine de la structuration de la recherche fondamentale en robotique, alors même que la fin des années 1980 voit les industriels français se désengager de la production de robots (ACMA sera vendu au fabricant italien COMAU). Dans les années 1990, un groupement réunissant CEA, CNRS, INRIA et ONERA développe un robot d’exploration planétaire en collaboration avec le CNES. Seize années après ARA, toujours à l’initiative du CNRS, est créé le programme ROBEA auquel participent 250 équipes de recherche regroupées sur une centaine de laboratoires. 2007 marque la création du groupement de recherche en robotique, le GDR Robotique, qui regroupe aujourd’hui plus de 1 300 chercheurs. En 2012, Robotex, un réseau national de plates-formes expérimentales de robotique financé dans le cadre des investissements d’avenir, regroupe quinze laboratoires autour de cinq thématiques allant de la robotique industrielle à la robotique humanoïde en passant par la robotique terrestre et aérienne, la robotique médicale et la micro-robotique.
Les équipes du CNRS et d’INRIA développent une recherche généraliste en partenariat avec les universités et les grandes écoles. La recherche en robotique est également organisée par domaines avec les Arts et Métiers (robotique industrielle), le CEA (robotique d’intervention et exosquelettes), l’IFREMER (robotique marine et sous-marine), l’IFSTTAR (robotique agricole), l’INSERM (robotique médicale), l’IRSTEA (véhicules automatisés et transports), l’ONERA (robotique aérienne).
La France se trouve dans une situation paradoxale : absente de la production de robots industriels dominée principalement par le Japon, l’Allemagne et la Suède, et par ailleurs faiblement équipée (cinq fois moins que l’Allemagne), elle mène une recherche fondamentale de qualité, couvrant de larges spectres applicatifs. Lors du dernier congrès de robotique organisé par la société IEEE à Stockholm en mai dernier, la France occupe la troisième place en nombre d’articles présentés, ex aequo avec l’Italie et le Japon et derrière les États-Unis et l’Allemagne.
Un deuxième paradoxe tient à la difficulté de pérenniser sur le territoire les succès des partenariats public-privé. Nous avons vu comment Renault a abandonné la fabrication des robots industriels alors même qu’elle a contribué à la naissance des réseaux de recherche en robotique. Les raisons sont en grande partie technologiques : l’entreprise avait fait le pari de rester sur les actionneurs hydrauliques à commande analogique, faciles à programmer par apprentissage, quand les moteurs électriques, à l’époque plus coûteux, autorisaient la commande numérique, certes plus complexe car nécessitant le recours à des langages de programmation, mais qui sera in fine la clé du succès des grands constructeurs de robots industriels.
Plus près de nous, l’exemple d’Aldebaran Robotics, racheté par la société japonaise Softbank en 2012, est également emblématique du paradoxe. Même si l’on peut s’interroger sur l’évolution du marché de la robotique personnelle (en 2015, il représente 11 % du marché de la robotique), le succès des robots NAO et Pepper démontre la qualité du savoir-faire français en matière d’intégration robotique. Conçu par Aldebaran, le robot humanoïde ROMEO est une plateforme de recherche nationale fédérant une quinzaine de partenaires, laboratoires académiques et PME, autour de thématiques diversifiées incluant la conception mécanique, la mécatronique, la commande, la programmation, la vision artificielle, la perception multi-sensorielle, la communication verbale et non verbale, la planification de mouvement, l’intelligence artificielle. Si ROMEO est très loin de concurrencer le robot ATLAS de Boston Dynamics en terme de performance physique, il représente une plateforme de recherche unique dans son ambition d’intégrer les différentes composantes d’un robot humanoïde complet, capable d’actions et de communication, en interaction avec l’homme.
A défaut d’être présent sur le marché de la robotique industrielle, cette capacité d’intégration est un atout de la recherche française en robotique, atout qui fait le succès de plusieurs PME du domaine de la logistique, des transports, de la robotique médicale et para-médicale, de la robotique agricole, avec des spécialités telles que les drones, la robotique parallèle ou la robotique à câbles.
Quand on sait que le coût d’une cellule robotisée sur une ligne de production est très largement dominé par le coût d’intégration du robot, et non par le coût du robot lui-même, la recherche française, placée dans le contexte de l’industrie du futur, trouve sa place dans sa capacité à maîtriser le système robotique dans sa totalité, comme en témoigne sa participation active aux projets européens Euroc, Factory-in-a-Day ou Comanoid. Ce dernier est à l’origine de l’accord de partenariat signé au printemps 2016 entre Airbus Group, le CNRS et l’institut japonais AIST, et portant sur une étude des potentialités de la robotique humanoïde dans l’industrie aéronautique.
- 43 – Coriat B., 1983, « La robotique à la Régie Renault », Revue d’économie industrielle, n°24.
Pierre-Marie Gaillot et François Pellerin – L’action des régions en faveur de l’industrie du futur – Commentaire
Chef de projet « Industrie du futur » au Centre technique des industries mécaniques (Cetim), Pierre-Marie Gaillot est également pilote du projet « Déploiement régional auprès des entreprises » de l’Alliance Industrie du futur. François Pellerin est directeur du projet « Usine du Futur » de la région Nouvelle-Aquitaine. Ingénieur et docteur ès sciences, il a fait l’essentiel de sa carrière à Turbomeca (groupe Safran), dans la recherche et développement matériaux, puis à la direction de l’établissement de Bordes.
L’industrie du futur est une réponse à plusieurs transitions simultanées : énergétique, écologique, numérique, organisationnelle et sociétale. Elle constitue un défi important en termes de développement local. Les enjeux pour les territoires sont de conserver les savoir-faire, structurer la sous-traitance locale et, bien sûr, dynamiser la formation et l’emploi pour entretenir les bassins d’activité. L’industrie du futur est ainsi portée par une volonté politique forte de soutenir une industrie française confrontée à un besoin urgent de moderniser son outil de production vieillissant, avec un fort retard d’investissement.
Une attention particulière est portée par les régions au programme « Industrie du futur », en recherchant la mise en place de véritables accompagnements ciblés, de proximité et bien articulés, permettant aux entreprises de se placer en situation d’innover, de se financer, d’exporter et de recruter. Ces actions sont accompagnées par l’Alliance Industrie du futur, au sein d’un groupe piloté par le Cetim. L’Alliance apporte des supports à valeur ajoutée, en particulier avec l’appui de ses 35 correspondants régionaux et de ses 550 experts.
Chaque dispositif régional est spécifique :
- Diagnostics « Industrie du futur » ;
- Apport d’expertise pour accélérer les projets de développement au travers de parcours thématiques ciblés : stratégie, modèles économiques, performance industrielle, numérique, robotique, technologies avancées de production, formation aux nouveaux métiers ;
- Aide à l’investissement d’équipements productifs et de dispositifs numériques ;
- Mise en place de plateformes collaboratives pour favoriser l’appropriation de nouvelles technologies par les PME ;
- Mise en place de partenariats pour se développer à l’international ;
- Mise en œuvre de programmes de recherche collaborative.
Ces dispositifs sont financés par les régions, moyennant plus de 200 millions d’euros, et permettent l’accompagnement de plus de 2 000 entreprises engagées dans un parcours « industrie du futur ». Les entreprises sont encore essentiellement au stade du diagnostic, les projets industriels devraient donc suivre dans les semaines et mois à venir.
Après une première étape de consolidation des programmes existants, les régions ont engagé une refonte de leur programme « industrie du futur », le plus souvent en lien étroit avec l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) qui fixe les orientations régionales pour une durée de cinq ans.
Dans la nouvelle région Nouvelle- Aquitaine, par exemple, 280 entreprises ont été accompagnées par le programme « Usine du futur » en l’espace de deux ans. Les entreprises apprécient une approche terrain, graduelle, qui combine la technologie avec la performance organisationnelle et sociale. Les entreprises font un pré-diagnostic de trois jours, qui couvre l’outil de production, l’organisation industrielle, le développement durable (environnement, formation, conditions de travail et management), etc. Un plan d’action est ensuite établi. L’entreprise est alors accompagnée financièrement sur le conseil, la formation, l’investissement, l’aide à l’embauche. Depuis le lancement du programme en février 2014, 17 millions d’euros ont été engagés par la région sur ce plan.
Dans le domaine technologique, trois domaines prioritaires émergent : la robotique, la fabrication additive et les outils numériques pour la production (ERP, PLM, MES, outils de simulation). Des parcours seront montés sur ces thématiques. Puis, marche par marche, les entreprises seront accompagnées vers l’usine numérique et connectée.
En ce qui concerne l’organisation industrielle, les diagnostics montrent que des progrès importants peuvent être réalisés : deux tiers des entreprises peuvent gagner au moins 30 % de leur temps d’écoulement.
Enfin, l’enjeu est de transformer les pratiques de management pour que les opérateurs s’approprient le progrès continu avec le soutien actif de l’encadrement. Les salariés semblent aujourd’hui imprégnés de culture hiérarchique, modèle dans lequel c’est l’encadrant qui est censé détenir le savoir. Or les savoirs métier sont le plus souvent détenus par les opérateurs eux-mêmes. La transition numérique demandera donc de profonds changements culturels, pour les opérateurs comme pour les encadrants ; cela ne pourra se faire que par une action de longue durée. Les maîtres mots sont ici autonomie et responsabilité.
L’objectif est de prolonger ce mouvement sur l’ensemble de la grande région autour de la modernisation de l’outil industriel, de l’organisation et des méthodes de management. Il s’agit d’entrainer une masse critique d’ETI et de PME, en mettant à leur disposition des ressources (expertise, plateformes, programmes de recherche et de formation) leur permettant de monter en performance industrielle et en compétences. Au total, 600 entreprises seront accompagnées par le programme « Usine du futur » en région Nouvelle-Aquitaine d’ici la fin de la décennie.
Conclusion
Le concept d’industrie du futur a connu un succès retentissant ces dernières années, à la mesure des bouleversements que la révolution numérique impose au secteur industriel. Alors que l’Allemagne est très souvent désignée comme le champion incontesté de l’Industrie 4.0 et particulièrement des équipements, machines, logiciels et systèmes de production, beaucoup d’autres pays ont compris les enjeux et se mobilisent. Qu’il s’agisse de la Corée du Sud, des États-Unis ou de la Chine, ils cherchent à contester à leur manière la suprématie allemande. Si elle parvient à se mettre en ordre de marche, la France peut également tirer parti de l’expertise de ses grands groupes et de la vivacité de son tissu d’entreprises dans le numérique.
L’industrie du futur représente un enjeu de compétitivité pour l’ensemble des entreprises industrielles. Déjà en pointe en matière de robotisation, la Corée du Sud a lancé un programme d’envergure afin d’accélérer la digitalisation de ses usines, à l’aune duquel la mobilisation française semble encore timorée. En termes d’équipement comme d’investissement, les entreprises françaises sont largement en retrait de leurs concurrents et souffrent d’un sous-investissement chronique. Leur effort pour y remédier, soutenu par les pouvoirs publics, ne portera ses fruits que s’il est mené avec persévérance sur le long terme. La France peut s’appuyer sur la bonne qualité de sa recherche publique et de ses formations d’ingénieurs, surtout si l’une et les autres savent améliorer la qualité de leurs échanges avec les PME et les ETI industrielles. La dimension technologique doit être pensée en articulation avec d’autres volets de la compétitivité, et notamment la montée en compétences du capital humain à tous les échelons de l’entreprise.
Ce dernier aspect est souvent affiché comme une préoccupation centrale par les politiques publiques, mais rares sont les dispositifs concrets à avoir vu le jour. Certes, de nombreuses incertitudes sur l’évolution de l’industrie rendent difficile l’anticipation précise des besoins en compétences. Mais l’accompagnement efficace des salariés affectés par les changements sera la clé de la réussite de la transition vers l’industrie du futur. L’adaptation du système de formation pour accompagner la montée en qualification, gérer les reconversions et mettre en place les filières de formation en lien avec les nouveaux métiers doit être une priorité absolue44.
- 44 – La question de l’évolution des compétences face aux mutations industrielles fera l’objet d’une prochaine note de La Fabrique (à paraître en novembre 2016).
Annexe – Tableau récapitulatif des principaux programmes étudiés
La comparaison entre des programmes d’ambitions et de périmètres différents, mêlant dispositifs transversaux et actions plus ciblées, est difficile. Le tableau ci-après rappelle, pour chacune des initiatives étudiées, les principaux objectifs ainsi que les ordres de grandeur concernant leur financement. Dans le cas de la France, les montants alloués reprennent les deux enveloppes de prêts « Industrie du futur » gérées par Bpifrance ainsi que l’appel à projets du Programme des investissements d’avenir ; ils n’intègrent donc pas le dispositif de suramortissement pour l’investissement productif qui représente un effort budgétaire d’environ 2,5 milliards d’euros. De même pour l’Allemagne, les 200 millions d’euros dédiés au programme Industrie 4.0 ne correspondent qu’au financement de la part du gouvernement fédéral. Les nombreuses actions menées par les Länder ne sont pas prises en compte.
Pour une présentation détaillée des différents programmes, vous pouvez consulter les fiches-pays disponibles en téléchargement gratuit sur le site de La Fabrique de l’industrie : www.la-fabrique.fr/Ressource/industrie-du-futur
Bibliographie
Apec, 2008, « Pénurie d’ingénieurs dans les secteurs en tension ? ».
Berger S., 2016, « Reforms in the French Industrial Ecosystem », janvier.
Beylat J-L., Tambourin P., 2013, « L’innovation : un enjeu majeur pour la France – Dynamiser la croissance des entreprises innovantes », avril.
The Boston Consulting Group, 2015, « Industry 4.0. The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries », avril.
Bourcieu S., 2014, « Le long chemin vers la montée en gamme », La Tribune [en ligne], disponible sur www.latribune.fr/opinions/tribunes/20140217trib000815790/le-long-chemin-vers-la-montee-en-gamme-des-entreprises-francaises.html [consulté le 17/05/2016].
Challenges, 2016, « Cyberattaque : les groupes industriels dans le viseur en 2015 », disponible sur www.challenges.fr/high-tech/20160318.CHA6402/cyberattaque-les-groupes-industriels-dans-le-viseur-en-2015.html [consulté le 26/05/2016].
Commission nationale d’évaluation des politiques d’innovation – France Stratégie, 2016, « Quinze ans de politiques d’innovation en France », janvier.
Cour des Comptes, 2013, « Le financement public de la recherche, un enjeu national », Synthèse du rapport public thématique, juin.
Das M., N’Diaye P., 2013, « La fin du travail bon marché. La baisse de la population chinoise d’âge actif aura des conséquences importantes pour le pays et le reste du monde », Fonds monétaire international, Finances & Développement, vol. 50, n°2, juin.
Deloitte, 2015, « The future of manufacturing. Making things in a changing world », Deloitte University Press.
Direction générale des entreprises, 2013, « Relocalisations d’activités industrielles en France. Synthèse », décembre.
Direction générale des entreprises, 2016, « Technologies clés 2020. Préparer l’industrie du futur », mai.
Fédération des industries mécaniques, 2015, « Guide pratique de l’usine du futur. Enjeux et panorama de solutions », octobre.
Freyssenet M., 2013, « La “montée en gamme” : un consensus aveugle ? Confusions et méprises », Lasaire, La Tribune-Le Progrès : « Les voies de la réindustrialisation nationale et locale », Forum du Technopole, Saint-Etienne, 28 mars.
Gradeva M., 2014, « Quel avenir pour l’industrie française ? Objectifs et défis de la politique industrielle », Note du CEP, juillet.
H+ Magazine, 2016, « La Chine serait-elle le nouvel eldorado de la robotique ? », disponible sur www.humanoides.fr/chine-eldorado-robotique [consulté le 15/07/2016].
Kohler D., Weisz J-D., 2016, « Industrie 4.0. Les défis de la transformation du modèle industriel allemand », La Documentation française, mars.
Kotlicki M-J., 2015, « Les nouveaux rapports industrie/services à l’ère du numérique », Avis du Conseil économique, social et environnemental, octobre.
Markus D., Marro N., 2015, « ‘Made in China’ Now ‘Made by China’ », The US-China Business Concil [en ligne], disponible sur http://bit.ly/2ajhEgH [consulté le 15/07/2016].
Observatoire du financement des entreprises, 2014, « Rapport sur la situation économique et financière des PME », janvier.
Palier B., 2016, « Pour une stratégie inclusive de montée en qualité de l’économie et de la société française », Contribution au débat « Compétitivité, que reste-t-il à faire ? » de France Stratégie, avril.
Raynal J., 2015, « Tahar Melliti : “Un master Industrie du futur pourrait voir le jour dès la rentrée 2016” », Industrie & Technologies [en ligne], disponible sur : www.industrie-techno.com/tahar-melliti-un-master-industrie-du-futur-pourrait-voir-le-jour-des-la-rentree-2016.41013 [consulté le 29/11/2015].
Rivaton R., 2012, « Relancer notre industrie par les robots (1) : les enjeux », Fondapol, décembre.
Roland Berger, 2014a, « Du rattrapage à la transformation. L’aventure numérique, une chance pour la France », septembre.
Roland Berger, 2014b, « The new industrial revolution. How Europe will succeed », mars.
Syntec numérique, 2016, « Transformer l’industrie par le numérique », Livre blanc Industrie du futur, avril.
Usine nouvelle, 2013, « La vraie-fausse pénurie d’ingénieurs », disponible sur www.usinenouvelle.com/article/la-vraie-fausse-penurie-d-ingenieurs.N193116 [consulté le 17/05/2016].
Vilars T., 2014, « Quand les robots déferlent sur les usines chinoises », Les Echos [en ligne], disponible sur www.lesechos.fr/03/12/2014/lesechos.fr/0203987008318_quand-les-robots-deferlent-sur-les-usines-chinoises.htm [consulté le 28/01/2016].
Weil T., 2016, « L’imbrication croissante de l’industrie et des services », Les Synthèses de La Fabrique, n°8, juillet.
Wohlers Associates, 2016, « Wohlers Report 2016 Published », communiqué de presse [en ligne], disponible sur www.wohlersassociates.com/press71.html [consulté le 08/08/2016].
Woody M., 2015, « La renaissance de l’industrie sera portée par le raccourcissement des chaînes d’approvisionnement », in L’industrie américaine : simple rebond ou renaissance ?, La Fabrique de l’industrie, juin.
Wübbeke J., 2015, « Die Kampfansage an Deutschland », Die Zeit Online [en ligne], disponible sur www.zeit.de/wirtschaft/2015-05/chinaindustrie-technologie-innovation [consulté le 28/01/2016].
Thibaut Bidet-Mayer, L’industrie du futur : une compétition mondiale, Paris, Presses des Mines, 2016.
ISBN : 978-2-35671-423-7
© Presses des MINES – TRANSVALOR, 2016
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France
presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de lʼindustrie
81, boulevard Saint-Michel – 75005 Paris – France
info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr