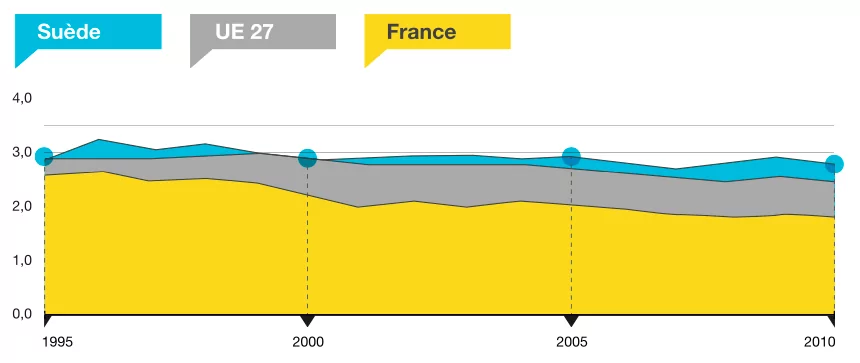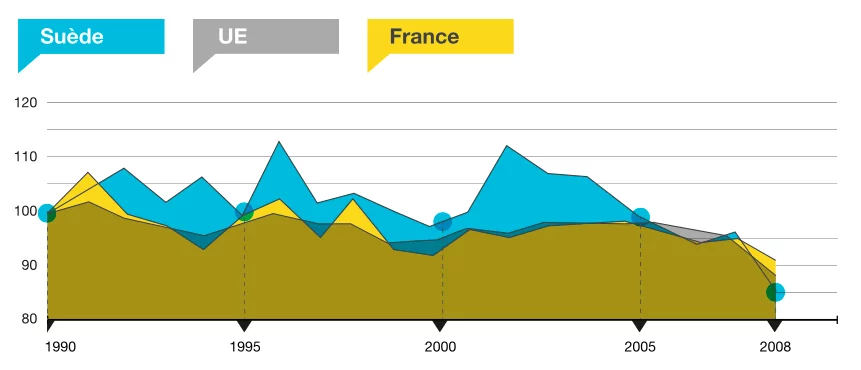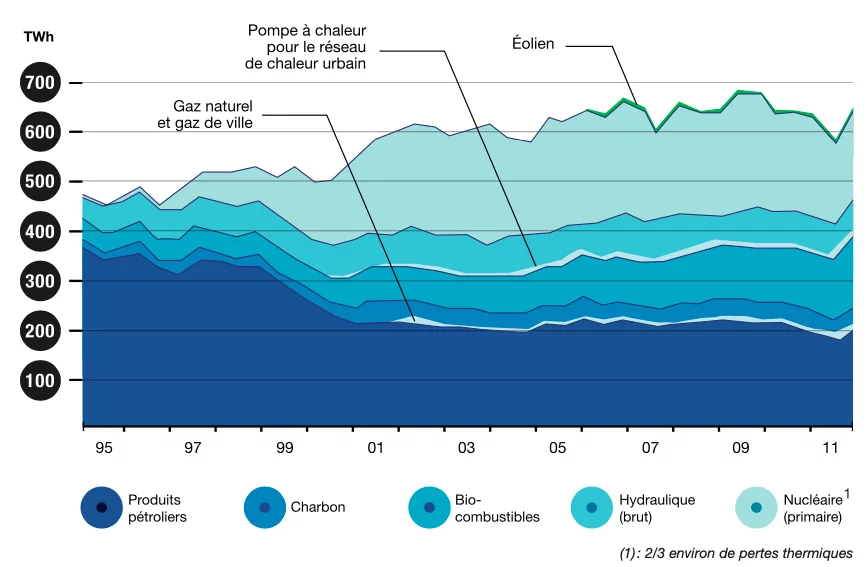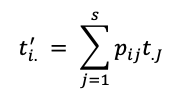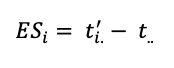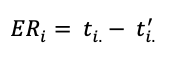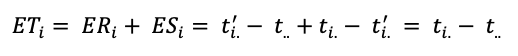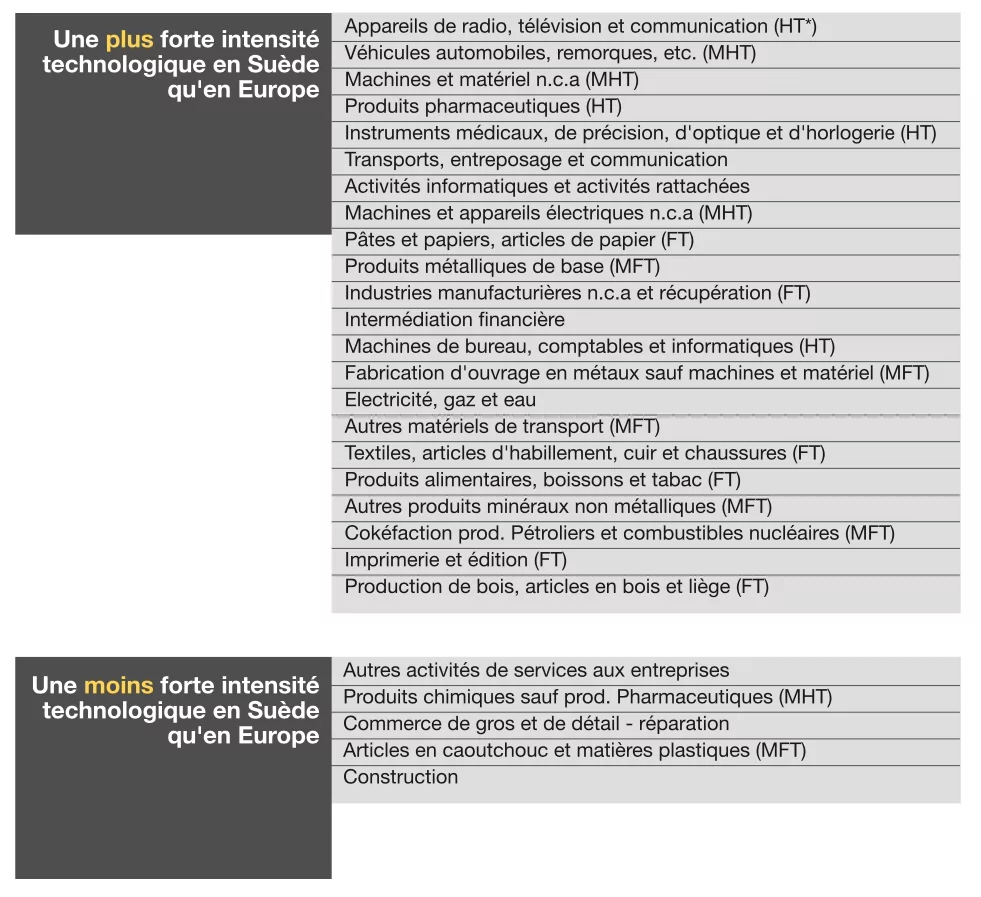Les transformations du modèle économique suédois

Delaunay Robert (1885-1941), Rythme. © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Jacqueline Hyde.
Préface
Le modèle suédois suscite curiosité et envie depuis plusieurs décennies, pour ses performances économiques, la qualité de son service public et son haut niveau de protection sociale. Confrontée au début des années 1990 à une grave crise, la Suède a su assainir ses finances publiques et réformer ses institutions en profondeur, tout en veillant au maintien des protections sociales et au libre fonctionnement du marché.
Cette note de La Fabrique de l’industrie explore les causes de cette performance suédoise, qu’elles soient économiques, sociales, politiques ou historiques. On trouve dans cet exemple, bien différent de l’Allemagne et moins connu, beaucoup d’idées utiles aux débats d’aujourd’hui sur les réformes économiques et la compétitivité industrielle. Malgré des aspirations analogues au maintien d’un État protecteur, d’un bon niveau de services publics et d’une économie prospère, la France et la Suède diffèrent par les moyens mis en œuvre, et surtout par la manière d’élaborer les choix collectifs. Au-delà des réformes structurelles adoptées, qui ne conviendraient peut-être pas toutes au contexte français, c’est l’expérience suédoise de la réforme qui me parait éclairante. La Suède est en effet capable d’organiser des réformes profondes sans blocage, préparées par un long processus d’expertise et de négociation démocratique qui favorise leur appropriation. Une telle méthodologie de la réforme ne se décrète pas ; elle est le fruit d’une longue histoire de collaboration entre les entreprises, l’État et les partenaires sociaux. La qualité du dialogue social est un des atouts déterminants de la Suède : des partenaires sociaux dont la légitimité est très forte mènent des négociations en veillant à ce que les salaires et les prestations restent compatibles avec la compétitivité d’une industrie dominée par de grands groupes exportateurs. Transparence et décentralisation permettent aux citoyens de s’assurer de la gestion efficace des deniers publics.
Cette note offre une illustration motivante de ce qu’il y a à réaliser dans notre pays et de l’importance de la mobilisation de tous pour susciter un choc de confiance. Le mouvement a été enclenché avec des accords tels que celui du 11 janvier 2013 au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels (ANI), qui complète le Pacte de compétitivité adopté le 6 novembre 2012. Il importe qu’il se poursuive pour permettre le redressement nécessaire de notre industrie.
Louis Gallois
Résumé
Alors que l’industrie s’essoufle dans la plupart des pays développés, l’Allemagne est le plus souvent prise en exemple pour ses excellentes performances (Hénard, 2012). Mais un autre pays, la Suède, semble faire mieux encore. Ces deux pays ont su, durant ces vingt dernières années, préserver davantage leur base industrielle que leurs voisins européens et conserver des balances commerciales très positives. La Suède a assaini ses finances publiques, aujourd’hui en excédent structurel, et a fortement réduit sa dette, tout en préservant un haut niveau de service public et de protection sociale. La Fabrique de l’industrie a donc souhaité mieux comprendre les raisons du succès du modèle suédois.
Une économie soutenue par la dynamique de grands groupes exportateurs
Aujourd’hui, la Suède présente des performances très enviables, en termes de compétitivité, de croissance, de PIB par habitant, d’innovation, d’excédents commerciaux et de maîtrise des finances publiques.
Le pays se place devant l’Allemagne sur tous ces critères, ne lui laissant de peu que le leadership sur le poids de l’industrie dans le PIB (22,4 % en Allemagne, contre 19,3 % en Suède et 12,5 % en France en 2009). Entre 1995 et 2007, l’accroissement de la valeur ajoutée en Suède était supérieur de huit points à ce qu’il était dans l’Union européenne. Notons cependant que la progression de l’emploi était inférieure de neuf points, rançon des importants gains de productivité que la Suède a réalisés dans tous les secteurs d’activités et notamment dans les services, marchands et non marchands.
Dans l’industrie, les gains de productivité ont notamment été rendus possibles grâce à l’investissement dans les TIC, dans la recherche et développement et plus largement dans le capital immatériel. La Suède présente l’un des plus gros efforts de R&D dans le monde (exprimé en % du PIB), du fait de l’investissement des acteurs privés. Dans quasiment l’ensemble des secteurs industriels – qu’ils soient low-tech ou high-tech – et les services marchands, l’intensité technologique1 est plus forte en Suède que dans le reste de l’Europe.
Le socle industriel suédois est dominé par des grands groupes, pour la plupart sous le contrôle de grandes familles qui ont formé des empires capitalistiques. Ces groupes participent largement au dynamisme des exportations. La structure de l’industrie suédoise, en termes de répartition des entreprises par taille, ressemble à celle de la France. La Suède n’est pas une terre plus propice que cette dernière au développement des startups ni même aux ETI ; cela démontre, si besoin était, qu’un développement économique enviable peut avoir des caractéristiques différentes des exemples germanique et américain.
Y a-t-il des coûts cachés à cette performance impressionnante ? Des arbitrages en tous cas. De 1950 à 1990, la croissance a été un peu moins élevée en Suède que dans le reste de l’OCDE. Très riche relativement à ses voisins ou à son propre passé dans les années 1950, le pays a privilégié la construction d’une société égalitaire mais a peu à peu perdu sa place de leader en termes de PIB par habitant.
Un progressisme coûteux mais durable et consensuel
Le succès suédois donne lieu à différents types d’explications. Certains estiment que le pays a exploré une troisième voie entre capitalisme libéral et communisme, conduisant au début des années 1970 à une société riche et égalitaire, cumulant un des plus hauts PIB par habitant de la planète avec un très haut niveau de protection sociale et de service public, tandis que le reste du monde croyait devoir choisir entre un enrichissement accompagné d’importantes inégalités (qui toutefois se résorbaient pendant les Trente glorieuses) et l’égalitarisme dans la pauvreté. Pour d’autres, le modèle suédois des années 1945-1975 a conduit à l’hypertrophie inefficace d’un État surprotecteur, la crise du début des années 1990 ayant rendu cette impasse manifeste et forcé le pays à engager des réformes d’inspiration libérale très poussées (déréglementations, libéralisations, décentralisations) grâce auxquelles il a retrouvé sa performance.
Ces deux explications contiennent une part de vérité. La trajectoire de la Suède a connu des impulsions contradictoires, des crises et des accidents. Une population très éduquée, de taille un peu plus réduite que celle de la région parisienne, a abordé ces difficultés, engagé des débats et cherché un consensus pour infléchir sa politique, parfois très substantiellement. Les Suédois sont très attachés, au moins depuis 1940, à un système de protection sociale et de services publics assurant la prise en charge du citoyen « du berceau à la tombe », à l’accès pour tous à l’éducation, aux soins et à des opportunités de promotion socio-professionnelle. Au risque de simplifier outrageusement, on pourrait dire que la Suède a d’abord mis en place, de 1940 au début des années 1980, un système de protection sociale et de service public efficace, généreux mais très coûteux, puis a travaillé depuis à en réduire le coût en conservant l’essentiel des acquis. Même si le système est aujourd’hui un peu moins généreux que dans les années 1970, il se maintient au niveau des meilleurs standards occidentaux et son coût transparent et maîtrisé est globalement accepté par la société.
Le dialogue social et la politique de l’emploi au service de la compétitivité et de la limitation des inégalités
En 1938, après une période de mouvements sociaux violents, les syndicats ouvriers et patronaux ont signé les accords de Saltsjöbaden. Des négociations centralisées, tirées par des syndicats très représentatifs, ont ensuite permis de fixer les salaires et d’assurer la paix sociale, en recherchant le meilleur compromis acceptable entre bien-être des individus et compétitivité des entreprises, sans grave accroc jusqu’à la fin des années 1960. La mise en application concrète du principe « à travail égal, salaire égal » conduisait à la faillite les entreprises les moins productives (qui devaient verser les mêmes salaires que leurs concurrentes les plus profitables) et favorisait la concentration des entreprises et la hausse de la productivité. Des politiques d’emploi actives, combinant formations, aides à la mobilité, aides à la création d’emplois dans les entreprises, travaux d’intérêt général et recrutements dans la fonction publique, permettaient de maintenir le taux de chômage aux environs de 2 %. C’est de cette période que date, en France notamment, l’idée que la Suède pouvait être considérée comme un pays « modèle ».
En 1969, une grève dure des mineurs a remis en cause la représentativité du syndicat
ouvrier unique et du parti social-démocrate qui lui était très lié. La revendication égalitariste s’est durcie, la hiérarchie des salaires s’est écrasée encore davantage ; la performance, les responsabilités ou le niveau de formation ne permettaient plus à un individu d’améliorer substantiellement sa rémunération. Tandis que l’emploi dans le secteur privé stagnait, la poursuite d’une politique de plein-emploi a conduit à multiplier les embauches dans le secteur public au détriment de la productivité de l’économie. Entre 1970 et 1985, le nombre de fonctionnaires est passé de 26 % à 38 % de l’emploi total.
Après plusieurs dévaluations de la couronne, l’État a entrepris dans les années 1980 le redressement des finances publiques. Il a pourtant fallu attendre la crise de 1991 pour que la Suède décide de privilégier la maîtrise de l’inflation sur l’objectif de plein-emploi, dix à quinze ans après la plupart des autres États membres de l’OCDE. Le taux de chômage est passé de 2 % à 10 % en deux ans ; il oscille aujourd’hui entre 6 % et 8 %. Le nouveau système d’assurance-chômage est moins généreux, avec une réduction des allocations en cas de refus d’emploi convenable. Le chômage des jeunes est important (entre 20 et 25 %, comme en France depuis 10 ans, selon Eurostat) mais la politique active de l’emploi limite le chômage de longue durée (moins de 20 % des chômeurs suédois, contre 40 % en France et dans le reste de l’Europe et même près de 50 % en Allemagne).
En dépit de ces réformes récentes, la Suède reste aujourd’hui un des pays les plus égalitaires de l’OCDE, avec le reste de la Scandinavie et les Pays-Bas. Même si les inégalités se sont accrues depuis 1970, le rapport entre les premier et dernier déciles est de 2,79 en Suède2, contre 3,39 en France, 4,21 au Royaume-Uni et 5,91 aux États-Unis (OCDE, 2009).
Une culture du consensus favorable aux réformes et une acceptation de l’impôt en contrepartie d’un haut niveau de service public
Si la Suède est capable d’engager des réformes profondes sans blocage, c’est que celles-ci sont à chaque fois préparées par un long processus d’expertise et de négociation.
Par exemple, le processus conduisant à la grande réforme fiscale de 1991 a été initié par des discussions et rapports d’experts dès 1984. La réforme a été annoncée en 1986. Après un sommet réunissant tous les chefs de parti et des représentants des groupes d’intérêt majeurs en octobre 1989, un consensus a été obtenu sur les grandes lignes de la réforme. Celle-ci a été mise en place comme prévu malgré deux changements de majorité gouvernementale. La réforme des retraites, elle aussi, a fait l’objet d’un travail préparatoire et d’un large consensus. Cette dernière a été adoptée en 1998, à une majorité de 75 % des membres du Parlement suédois, après quinze ans de réflexion concertée, et ce malgré les changements de gouvernement.
Toutes les études sur ce pays relèvent que les Suédois consentent à payer un impôt élevé, convaincus de bénéficier en contrepartie d’un service public performant grâce à une grande transparence de la procédure budgétaire et au contrôle des administrations. La très large décentralisation, entamée en 1975 et confirmée par étapes ensuite, confiant aux 290 communes la gestion des services sociaux et de l’éducation et aux 20 comtés celle de la santé et des infrastructures, a rapproché la décision d’engagement d’une dépense de ceux qui la financent.
Globalement, la fiscalité suédoise pèse moins sur les entreprises que sur les individus, et plus sur les revenus du travail que sur ceux du capital. Plus précisément, les revenus du capital sont taxés à un taux fixe de 30 %, tandis que ceux du travail sont soumis à un impôt progressif, de 30 % quasiment dès la première couronne à environ 55 % au-delà d’un seuil équivalent à 64 000€ €3. Contrairement à l’idée que l’on se fait parfois d’un système fortement redistributif, l’impôt suédois n’a donc pas pour objet de prélever les « rentiers » pour donner aux « travailleurs » : il assure une circulation solidaire et efficace de la valeur au sein de la population et en particulier de la classe moyenne. Il épargne largement les entreprises, ne taxant la richesse qu’elles produisent qu’à travers les revenus (du travail ou du capital) de ceux qui en bénéficient.
Récemment, pour favoriser la transition énergétique, la Suède a mis en place une fiscalité écologique qui ménage la compétitivité des entreprises mais pèse surtout sur le consommateur final. La taxe carbone, dont la croissance est programmée, représentait 114€ € par tonne de carbone émis, en 2011, pour les particuliers. Les entreprises paient 30 % de ce taux (mais 60 % à horizon 2015) et celles soumises au marché européen des quotas en sont exemptées4. En même temps, de nouveaux allégements des charges pesant encore sur le travail et des impôts sur les sociétés ont été décidés, pour préserver la compétitivité des entreprises.
En conclusion
Le cas suédois frappe par le nombre d’analogies avec le modèle économique français : prééminence des grands groupes exportateurs, rôle important de l’État, attachement de longue date à la redistribution des revenus et aux services publics. Mais il ne faut pas s’y tromper : les deux pays ne sont que des faux-jumeaux. Quand la France peine à se réformer, la Suède fait figure de social-démocratie décomplexée : elle maintient un État-providence très protecteur mais, lorsque le constat est établi que les recettes antérieures ne fonctionnent plus, elle sait rassembler au-delà des divergences idéologiques et des intérêts contradictoires pour concevoir et mettre en place des réformes structurelles pragmatiques. C’est notamment pourquoi une meilleure compréhension du fonctionnement suédois peut éclairer les débats sur les réformes économiques et la compétitivité industrielle en France.
- 1 – Taux des dépenses de R&D sur la valeur ajoutée
- 2 – C’est-à-dire que le revenu moyen du décile le plus riche de la population suédoise représente 2,79 fois celui du décile le plus pauvre.
- 3 – En France, ce revenu se situe dans la tranche à 30 %, soit 38 % avec la CSG.
- 4 – À l’exception des usines de cycle combine chaleur-électricité (CHP) qui bénéficient d’un taux réduit (8€ € par tonne CO2 en 2011).
LE MODÈLE SUÉDOIS : DE QUOI PARLE-T-ON ? – INTRODUCTION
Au regard de différents indicateurs de performance économique, la Suède fait figure de bon élève dans une Europe en crise ; et cette situation ravive les débats sur les vertus supposées du « modèle suédois ». En effet, déjà forte d’un tel succès durant les Trente glorieuses, et partageant avec la France une forme d’État-providence, la Suède suscite la curiosité depuis de nombreuses années. Dès 1970, Jean Parent, dans son ouvrage Le modèle suédois, analyse les facteurs de sa performance économique entre le début du XXe siècle et la fin des années 1960. À cette époque, la Suède est vue comme l’exemple typique d’une synthèse réussie entre capitalisme et socialisme, alliant efficacité économique et protection sociale des individus, image qui perdure aujourd’hui.
« Ce modèle a permis d’offrir à l’immense majorité de la population un niveau de vie élevé et de meilleures chances, tout en garantissant une plus grande efficacité et rentabilité des entreprises », déclarait Sture Nordh, président de TCO (confédération syndicale suédoise des « cols blancs ») de 1999 à 2011. La Suède fait donc partie de ces sociétés-modèles, idéales voire idéalisées, dont on tente de distinguer puis de répliquer les caractéristiques, dans le but d’obtenir des performances similaires. Mais ce « modèle » est-il aujourd’hui ce qu’il était hier ? Comment caractériser ses bonnes performances actuelles, notamment économiques et industrielles ? Et, finalement, qu’entend-on par « modèle suédois » ?
1. L’actuelle réussite suédoise
Le tableau 1 révèle les bonnes performances de la Suède en 2011, en matière de croissance, de commerce extérieur, de maîtrise des finances publiques et d’innovation.
Tableau 1 – Les performances suédoises en 2011
Sources : OCDE, Usherbrooke, Banque mondiale, Eurostat.
A. Croissance et commerce extérieur
La Suède semble s’être déjà relevée de la crise de 2008, à la différence de la plupart des pays européens. En 2011, la croissance suédoise (3,9 %) est plus de deux fois supérieure à celle de la France (1,7 %) et de 0,9 point supérieure à celle de l’Allemagne (3 %). La même année, le FMI classe la Suède au 8e rang mondial en termes de PIB par habitant, devant l’Allemagne et la France qui sont respectivement aux 19e et 20e rangs. Toujours en 2011, le classement des compétitivités nationales du World Economic Forum (WEF)5, qui évalue le potentiel des économies à atteindre une croissance soutenue à moyen et long termes, place la Suède en 3e position derrière Singapour et la Suisse. Elle perd une place par rapport à 2010 mais reste dans le trio de tête, loin devant la France au 15e rang. L’Allemagne, quant à elle, est au 5e rang.
Alors que l’Allemagne demeure une référence en matière d’industrie en Europe, la Suède a elle aussi su préserver son tissu industriel. D’après le tableau précédent, la valeur ajoutée industrielle en 2009 y représente 19,3 % du PIB, seulement 3 points de moins qu’en Allemagne (avec laquelle l’écart s’est fortement réduit) et 7 points de plus qu’en France. La part de l’industrie suédoise dans le PIB est également supérieure à la moyenne européenne (18 %).
Forte de sa tradition exportatrice, la Suède affiche en 2011 une balance commerciale positive de 24 milliards de dollars, soit 5,7 % du PIB (contre 4,8 % en Allemagne). La même année, la France accuse un déficit de plus de 56 milliards de dollars (2,3 % du PIB).
B. Finances publiques
« Celui qui est endetté n’est pas libre », a affirmé Göran Persson, Premier ministre social-démocrate de 1996 à 2006. La dette suédoise est restée constante durant la récession mondiale (40,2 % du PIB en 2007, 39,5 % fin 2010), contrairement à celle de ses homologues de l’UE 15. Fin 2011, les plus bas niveaux européens d’endettement ont été relevés, en dehors des pays d’Europe centrale et orientale6, au Luxembourg (18,2 % du PIB), en Suède (38,4 %) et au Danemark (46,5 %)7.
En 2011, le déficit budgétaire était d’environ 100 milliards d’euros en France, de plus de 560 milliards d’euros dans l’Union européenne et de 390 milliards d’euros dans la Zone euro (Eurostat, 2011). L’Allemagne affichait elle aussi, cette année-là, un déficit budgétaire modéré d’environ 26 milliards d’euros. Seuls trois pays européens présentaient un budget 2011 excédentaire : l’Estonie, la Hongrie et la Suède. Le solde budgétaire suédois s’élève à un peu plus d’un milliard d’euros. Cet excédent s’explique en grande partie par la règle d’or budgétaire mise en place dans le pays dès la fin des années 1980.
La Suède, contrairement à la France et à l’Allemagne, respecte plusieurs critères de convergence établis par l’UE pour intégrer la zone euro : un déficit annuel en-deçà de 3 % du PIB et une dette publique inférieure à 60 % du PIB. Elle a cependant refusé jusqu’à présent d’abandonner sa monnaie nationale8.
C. Innovation et nouvelles technologies
La Suède est reconnue pour l’effort de ses entreprises en matière de R&D et plus largement pour leur investissement en innovation. Il est souvent tentant de lier cela à un autre trait distinctif : son volontarisme en matière d’efficacité énergétique et ses efforts en matière d’innovation environnementale.
Depuis mars 2002, dans le cadre de la stratégie de Lisbonne puis de la stratégie de croissance Europe 2020, les États-membre de l’UE se sont fixés un objectif de dépenses de R&D de 3 % du PIB. Au sein de l’UE, seuls le Danemark, la Suède et la Finlande dépassent actuellement ce seuil. En 2011, la dépense intérieure de R&D en Suède représentait 3,4 % du PIB, largement au-dessus des taux allemand (2,8 %) et français (2,3 %) et au-dessous de celui de la Finlande (3,9 %). Ces écarts tiennent essentiellement aux efforts de R&D des acteurs privés.
En parallèle de cet effort d’investissement et de renouvellement technologique, la Suède s’est caractérisée, notamment dans la décennie 2000-2010, par une forte prévalence des TIC, tant du côté de l’activité marchande que des usages. Le Forum économique mondial publie ainsi le Network Readiness Index (NRI), un indice qui définit la place qu’occupent les TIC dans la vie d’un pays, l’usage et le bénéfice qu’il en tire ainsi que les interactions dans tous les domaines liés de près ou de loin à la connectivité. Depuis 2010, la Suède se situe au 1er rang selon cet indice. En 2011, l’Allemagne était 13e du classement, la France 23e.
En toute logique, la Suède se retrouve également très bien située dans les palmarès internationaux portant sur l’innovation, qui agrègent bien souvent un volet sur la R&D et un autre sur la diffusion des TIC. L’Insead (2012) classe ainsi 125 pays en fonction de la capacité de leurs infrastructures à favoriser la créativité et l’innovation. Pour 2011, la Suisse est première du classement, suivie par la Suède et Singapour, tandis que l’Allemagne et la France se situent respectivement aux 15e et 24e places. La Suède était déjà en 2e position en 2010. Dans l’ensemble, les pays nordiques sont bien positionnés dans ce domaine : Finlande (5e), Danemark (6e), Islande (11e) et Norvège (18e).
2. Aux origines du « modèle suédois »
A. La découverte du cas suédois dans les années 1970
Les indicateurs précédents se concentrent volontairement sur les toutes dernières années. Toutefois, la notion de « modèle suédois » renvoie principalement, dans la littérature, à l’organisation politique, économique et sociale des années 1945 à 1975.
Si l’on remonte un peu dans le temps, la croissance économique suédoise a bénéficié de la neutralité du pays dans les différents conflits mondiaux, notamment la Seconde Guerre mondiale. Son industrie s’est développée au début du XXe siècle, dans les industries du bois et des métaux ferreux principalement, et a trouvé des débouchés importants lors de la reconstruction en Europe.
Le système néo-corporatiste9, reposant sur l’équilibre des forces politiques et syndicales (ouvriers et patronat), a également eu un fort impact sur la dynamique de croissance du pays. Dès 1938, la Suède est sortie d’une période de violents mouvements sociaux, de grèves et de lock-out grâce à l’accord de Saltsjöbaden signé entre le syndicat national ouvrier LO (Landorganisationem Sverige) et le syndicat d’employeurs SAF (Svenska Arbetsgivare Foreninger). Le syndicat LO entretenait déjà à l’époque une forte proximité avec le parti social-démocrate, alors dominant au niveau de l’État. Ces forces politiques et syndicales ont maintenu une relative paix sociale jusqu’à la fin des années 1960. Leurs décisions centralisées en matière de négociation sur les salaires visaient à la modération et à l’égalitarisme. C’est ainsi que la compétitivité de l’industrie suédoise a été améliorée par la règle « à travail égal, salaire égal » grâce à un double effet : d’une part celui de contenir les salaires dans l’économie, garantissant ainsi la compétitivité-prix des entreprises exportatrices, et d’autre part celui d’éliminer les entreprises les moins productives, qui devaient payer les mêmes salaires que les plus performantes, ce qui a encouragé la rationalisation et la concentration de l’outil industriel et provoqué une hausse des gains de productivité.
Plus généralement, cette politique d’égalité salariale a participé d’une politique macroéconomique donnant priorité au plein-emploi, passant par la promotion de politiques actives sur le marché du travail mais aussi, si cela ne suffisait pas, par la création de postes dans les services publics, surtout à partir des années 1970. Le taux de chômage en Suède était d’environ 2 % dans les années 1970 et est resté très bas jusqu’au début des années 1990. Enfin, la Suède s’est distinguée entre 1945 et 1975 par la générosité de la protection offerte à tous ses citoyens dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la sécurité sociale et de la vieillesse. En contrepartie, la pression fiscale exercée sur les individus était élevée et le niveau des dépenses publiques important.
C’est de cette période que date la perception d’un « modèle suédois », fondé sur un régime de croissance social-démocrate (Vidal, 2010). Dans les années 1970 en effet, de nombreux scientifiques, politologues et experts ont tenté de décrypter ce modèle, qualifié par Chabot (1972) de « socialisme civilisé ou capitalisme assagi ». Son succès en matière de croissance économique au début du XXe siècle, le haut niveau de protection des individus assuré par l’État, la capacité des syndicats d’ouvriers et d’employeurs à prendre des décisions dans un cadre négocié et, enfin, la permanence d’un gouvernement social-démocrate donnant la priorité au plein-emploi ont fait de la Suède un modèle d’observation privilégié pour des pays comme la France.
B. Evolutions et ruptures à partir des années 1980
Si la notion de « modèle suédois » a pu se justifier il y a quarante ans et qu’elle apparaît également valide aujourd’hui, il ne faut pas perdre de vue que de nombreux événements ont poussé les Suédois à débattre des mérites et limites de ce cadre et à le faire évoluer profondément. En particulier, la Suède a traversé une grave crise économique au début des années 1990, suite à laquelle elle a revu ses objectifs et ses instruments de politique économique (fiscalité, assurance-chômage et politique de l’emploi, politique monétaire, etc.). Certains traits ressortent toutefois comme des constantes, à travers les décennies : elle n’a par exemple pas substantiellement entamé l’État-providence, pas plus que son système de protection sociale financé par un fort taux d’imposition.
À l’heure actuelle, la croissance a retrouvé un niveau élevé et les comptes publics sont en excédent, même si le taux du chômage a bondi depuis les années 1990, à près de 8 % aujourd’hui. Avec des objectifs et des contraintes similaires à ceux du système français, la Suède semble avoir réussi l’exploit de maîtriser ses finances publiques tout en fournissant un haut niveau de service public à ses citoyens et en conservant sa base industrielle. C’est à cet effet que cette note interroge les caractéristiques du succès suédois actuel, les fondements de son modèle et plus généralement les liens et les régularités entre la Suède d’hier et celle d’aujourd’hui. Elle analyse différentes facettes de l’écosystème suédois, des années 1945 à nos jours, telles que le dialogue social, la croissance économique, l’industrie, l’innovation… qui ont toutes eu des effets directs ou indirects sur sa compétitivité.
- 5 – Ce classement mesure le degré de compétitivité de 142 pays à travers le monde, sur la base d’une centaine d’indicateurs. Il tient compte du fait que les pays ne se trouvent pas tous au même niveau de développement économique, et donc que l’importance relative des différents facteurs de compétitivité est fonction des conditions de départ. Les composantes de la compétitivité sont regroupées en 12 piliers tels que les institutions, l’éducation et la santé, les infrastructures, l’environnement macro-économique, l’efficacité du marché financier et du marché du travail, l’ouverture technologique, l’innovation…
- 6 – Voir Rugraff (2009).
- 7 – Source Eurostat (2012).
- 8 – A contrario , la Suède ne respecte pas le critère de convergence sur le taux de change – la SEK varie beaucoup vis-à-vis de l’euro – et ne remplit pas non plus un critère technique sur l’indépendance de la Banque centrale de Suède.
- 9 – Alain Suppiot (1987) donne du néo-coporatisme la définition suivante : « (…) le néo-corporatisme sert à désigner l’émergence d’associations regroupant, sous les auspices ou avec l’aval de l’État, des représentants de groupes d’intérêts antagonistes, et assurant la conciliation de ces intérêts grâce au pouvoir normatif qui leur est reconnu ».
VOLET 1 – CROISSANCE, INDUSTRIE ET INNOVATION
Durant les Trente glorieuses, la Suède était incontestablement un pays prospère ; mais sa croissance s’est révélée de plus en plus lente, y compris au moment où le « modèle suédois » était admiré à l’étranger. Après une phase d’instabilité et de remise en question suite aux chocs pétroliers, le pays a connu une grave crise en 1992, qu’il a gérée avec un certain succès.
Depuis 1993, la Suède a renoué avec une croissance vigoureuse, tout en parvenant à maintenir une base industrielle à peu près aussi stable qu’en Allemagne. Le socle industriel suédois est dominé par des grands groupes, eux-mêmes largement aux mains de grandes familles possédantes. La Suède n’est pas plus que la France une terre propice aux startups ni même aux ETI ; cela démontre, si besoin était, qu’un développement économique enviable peut se concevoir dans de telles conditions, qui s’écartent d’archétypes allemand ou américain.
Cela étant, tournées vers l’international depuis longtemps et par nécessité, les entreprises suédoises doivent notamment leur force actuelle aux gains de productivité réalisés depuis 1992, en partie grâce à des investissements volontaristes dans les TIC et le capital immatériel.
Une croissance économique retrouvée, après deux décennies atones et une grave crise bancaire
Parler de « modèle suédois » renvoie intuitivement à l’idée d’une performance distinctive, à la fois en termes de prospérité (niveau du PIB) et de dynamisme économique (croissance du PIB). Cela s’est globalement vérifié durant les Trente glorieuses, du moins au début, et au cours des deux dernières décennies. Mais entre 1970 et 1993, la croissance du pays a été marquée par de longs essoufflements et de profondes discontinuités. Il est important de les retracer pour comprendre ce qu’il reste aujourd’hui du modèle encensé hier.
1. Une croissance soutenue avant 1970, malmenée puis restaurée après 1992
Comme tous les pays occidentaux, la Suède a connu une croissance ininterrompue de l’après-guerre jusqu’au milieu des années 1970. Elle a profité de cette prospérité pour mettre en place un certain nombre de cadres institutionnels économiques et sociaux, qui laisseront de cette période le souvenir de l’âge d’or du « modèle suédois ». L’objectif prioritaire de plein-emploi, en particulier, était alors au cœur de la politique économique et la croissance légèrement inférieure à celle des autres pays de l’OCDE.
Puis la Suède a subi comme ses voisins le contrecoup des chocs pétroliers, dès le début des années 1970. Toutefois, le ralentissement y a été particulièrement marqué et durable. Le déficit de croissance suédois au regard de la moyenne des pays de l’OCDE s’est amplifié dans les années 1970 et 1980, jusqu’à la crise bancaire du début des années 1990 (cf. graphique 1). Le pays est alors entré en récession pendant trois ans (cf. encadré 1).
Les causes et la chronologie de cette crise font l’objet de vifs débats (Vidal, 2010). Certains pensent qu’elle traduit l’essoufflement ou une dérive progressive du modèle : le poids de l’État-providence et la perte de compétitivité extérieure auraient entrainé sa chute. D’autres parlent d’un choc plus brutal, qui serait la conséquence de la libéralisation financière enclenchée dans les années 1980. D’autres enfin estiment que le modèle suédois d’après-guerre a toujours été sous-performant parce que défavorable à la croissance, précisément à cause de ses caractéristiques qui faisaient pourtant sa popularité à l’étranger (Krantz, 2004).
Suite à la récession de 1991-1993, la lutte contre l’inflation est devenue prioritaire et l’assainissement des finances publiques, engagé au début des années 1980, s’est accéléré. Plus généralement, la Suède avait enclenché avant la crise une série de réformes dans les domaines de l’emploi, des régimes de retraite, de la fiscalité… qui expliquent du moins en partie le dynamisme retrouvé de l’économie suédoise. Car en effet, la croissance est redevenue positive en 1994 et s’est accélérée à la fin des années 1990, dépassant alors celle de l’OCDE. En 2010, le PIB suédois semble là encore s’être mieux relevé de la crise de 2008-2009 que celui du reste de l’OCDE (cf. graphique 1).
Ramené par habitant, le PIB suédois a vivement augmenté sur la première partie du XXe siècle mais, dans la seconde moitié, a crû moins vite que le PIB per capita moyen de l’OCDE, au point de voir la Suède décrocher régulièrement dans le classement de tête. C’est l’élément le plus évoqué dans la littérature par ceux qui entendent démontrer la contre-performance du modèle : à partir de 1970 pour les auteurs qui soulignent les dérives d’un système antérieurement performant, ou dès 1950 pour ceux qui récusent toute performance économique du « modèle », tels Krantz (op.cit.) ou Henrekson (2001).
Le tableau 2 permet de prendre la mesure de ce phénomène. En 1970, le PIB par habitant en Suède était supérieur de 13 % à la moyenne des 25 pays les plus riches de l’OCDE. Le pays occupait alors la 4e place du classement. À partir de 1970, il a décliné jusqu’à passer en dessous de la moyenne OCDE. En 1998, il occupait la 18e place. Il a repris ensuite une croissance supérieure à la moyenne. En 2010, il était de nouveau au-dessus de la moyenne OCDE (10e place du classement). Le classement du FMI de 2011 situe la Suède au 8e rang, devant l’Allemagne et la France qui sont respectivement aux 19e et 20e rangs.
Graphique 1 – Croissance du PIB en Suède et dans l’OCDE
Source : OCDE.
Encadré 1 – LA CRISE FINANCIÈRE ET IMMOBILIÈRE DE 1991-1992
Avant les années 1980, la Suède avait un système d’accès au crédit très réglementé relativement aux autres pays européens. Parallèlement, le pays était enserré dans une spirale inflationniste, caractérisée par une succession de dévaluations de la couronne et d’exigences d’augmentation des salaires. La dérégulation financière et du crédit faisait partie des mesures prises par le Gouvernement pour sortir de cette situation. Vidal (2010) fournit une description synthétique de la crise et de ses effets d’entrainement10: « Au cours des années 1980, le système financier suédois a été déréglementé, ce qui a favorisé la croissance du crédit et l’endettement des ménages, et l’émergence d’un cycle financier. Les agents privés ont utilisé des crédits qui croissaient rapidement pour financer l’investissement en logements, et aussi la consommation : le taux d’endettement des ménages a beaucoup augmenté de 1985 à 1989, et le taux d’épargne a chuté. » Les banques suédoises finançaient ces crédits en empruntant massivement à l’étranger où les taux étaient plus avantageux, s’exposant graduellement à un risque de change, et la bulle immobilière a gonflé : les prix ont augmenté en moyenne de 38 % entre 1989 et 2002 mais ont été multipliés par 9 en 10 ans pour les baux commerciaux au centre de Stockholm. L’éclatement de la bulle est venu du choc de la réunification allemande (que l’Allemagne a principalement financée par l’emprunt et donc via une augmentation de son taux d’intérêt). La Suède a été contrainte d’augmenter son taux d’intérêt à son tour, pour maintenir la parité de sa monnaie, mettant un coup d’arrêt à la progression des prix de l’immobilier. Les taux de défaut sur prêts sont passés de 0,5 % à 5 % en 1992, puis à 11 % en 1993 lorsque la banque centrale a été contrainte de laisser flotter – et donc chuter – la couronne. Les banques, dont les emprunteurs étaient insolvables, et qui avaient elles-mêmes emprunté en devises étrangères, ont fait progressivement faillite. Pour assainir les bilans bancaires, l’État a mis en place un plan de sauvetage des banques, accroissant sa dette publique11. Les nombreux licenciements, d’abord dans la construction, ont entraîné un bond du chômage de 2 à 10 % de la population active, tandis que les ménages ont dû restreindre leur consommation pour se désendetter. La crise bancaire s’est donc propagée à l’économie dans son ensemble. Cette crise n’est pas identique à celle des subprimes aux États-Unis, bien qu’elle soit le résultat de l’éclatement d’une bulle immobilière : en Suède, il ne s’agissait pas de prêts accordés à des ménages pauvres et les pertes sur les prêts hypothécaires des ménages sont restées finalement assez faibles.
Tableau 2 – PIB/habitant ajusté en parité de pouvoir d’achat dans les 25 pays les plus riches de l’OCDE (moyenne OCDE = 100)
Sources : OCDE, National Accounts Main Aggregates 1960-1997, vol.1, 1999. OCDE, Main Economic Indicators (janvier 1999). OCDE Stat 2010.
2. Une croissance tirée par le développement spectaculaire des exportations
La santé de l’économie suédoise repose très largement sur les exportations (Chabert et Clavel, 2012), qui représentent 50 % du PIB en 2010. Comme le montre le graphique 2, la part des exportations dans le PIB suédois a continuellement augmenté depuis 1970 et jusqu’à la crise de 2008, en dehors d’une période de repli dans les années 1980, et a toujours été supérieure à ce que l’on observe en Allemagne.
Graphique 2 – Exportations de biens et services (en % du PIB)
Source : Perspective Usherbrooke.
La culture de l’export en Suède est en partie liée à la taille réduite du pays (marché de 9,5 millions de consommateurs), qui favorise son ouverture vers l’extérieur. Elle s’explique également par l’abondance de ses ressources naturelles (bois et minerai de fer notamment) dont on a vu plus haut qu’elles avaient été massivement importées après-guerre par l’Europe en pleine reconstruction (Vidal, op.cit.). Par la suite, cette ouverture a été à la fois confirmée et facilitée sur différents volets réglementaires, fiscaux et douaniers notamment. Gwartney et al. (2001) comparent ainsi plus d’une centaine de pays sur la base d’un indice composite d’ouverture commerciale. En 1998, la Suède figurait au 14e rang, quand les États-Unis et la France se plaçaient respectivement aux 31e et 38e rangs12.
Quelques années plus tard, le 1er janvier 2005, la Suède devenait membre de l’Union européenne. Bandick (2011) montre que, même si les réformes et libéralisations antérieures avaient déjà fait de la Suède « l’une des économies les plus globalisées au monde », l’entrée dans l’UE a marqué le coup d’envoi d’un accroissement rapide des investissements directs (entrants) de l’étranger, principalement sous la forme de fusions-acquisitions, qui sont un catalyseur des échanges internationaux. Au début des années 2000, la Suède présentait ainsi l’une des proportions les plus élevées de l’OCDE d’emplois nationaux « détenus » par des filiales de groupes étrangers. Symétriquement, la Suède était en 1990 l’un des quatre seuls pays de l’OCDE dont le stock des IDE sortants représentait plus de 20 % du PIB (Andersson et al., 1996). Enfin, un autre élément d’explication de cette forte ouverture aux marchés extérieurs est la maîtrise de langue anglaise par la population : « Les Suédois n’ont pas nécessairement un anglais académiquement parfait mais la connaissance pratique de l’anglais est très largement répandue (90,6 % de la population en 2007, contre 44,7 % en France ; source Eurostat), avec une grande aisance à l’oral. Ceci est un atout pour partir à la conquête des marchés internationaux. L’apprentissage de la langue commence très jeune et passe beaucoup par l’expression orale. Dans l’environnement des Suédois et au-delà de l’enseignement, certains éléments facilitent peut-être cet apprentissage, comme le fait que les films soient sous-titrés mais jamais doublés ou encore le très fort taux de connexion à Internet de la population, et ce dès le plus jeune âge. » (Service économique régional de Stockholm, DG Trésor).
Dans l’absolu, l’export concerne la plupart des entreprises, à savoir 80 % des entreprises de plus de 50 salariés dans le cas des secteurs manufacturiers13. En valeur cependant, les exportations sont très concentrées. De grandes entreprises telles que Saab, Volvo, Ericsson, AstraZeneca, ABB ou Atlas Copco participent activement au dynamisme des exportations. En 2010, les 10 premiers groupes suédois représentaient près de 33 % des exportations de biens14. En France, selon le service des douanes (2011), les 10 premiers exportateurs assuraient 16 % des exportations en 2007 et les 100 premiers exportateurs environ 38 % des exportations en 201115.
Le deuxième trait caractéristique de la Suède en matière d’ouverture internationale, c’est que ses exportations excèdent ses importations. Alors que l’OCDE dans son ensemble n’a jamais cessé d’accroître son déficit commercial de biens avec le reste du monde, la Suède est parvenue à maintenir ses exportations nettes (cf. graphique 3).
Graphique 3 – Evolution de la balance commerciale des biens en Suède et dans l’OCDE
Source : OCDE.
Plusieurs périodes méritent d’être distinguées. Des années 1960 à la fin des années 1980, la balance commerciale de biens suédoise peinait à s’équilibrer de manière durable. La part de marché mondiale de la Suède dans les exportations de biens et services diminuait alors que l’OCDE dans son ensemble se maintenait (cf. graphique 4). Vidal (op.cit.) explique que « la spécialisation internationale traditionnelle de la Suède la rendait très vulnérable aux chocs et aux mutations des années 1970 et 1980. Parmi ses principales spécialisations, il y avait les produits en bois et la sidérurgie qui correspondent à ses principales ressources naturelles. Ces branches sont de fortes consommatrices d’énergie, et la croissance mondiale de ces produits a été très ralentie à partir des années 1970. » (p.13)
Graphique 4 – Parts de marché mondiales de la Suède et de l’OCDE dans les exportations de biens et services
Source : OCDE.
Face à la détérioration de la compétitivité extérieure de ses entreprises, le gouvernement a procédé à une série de dévaluations de la couronne suédoise. La première vague de dévaluations, entre 1977 et 1982, a permis d’améliorer la compétitivité et la rentabilité des entreprises exportatrices sur une courte durée. Dès la fin des années 1980 en effet, la compétitivité-coût des entreprises s’était une nouvelle fois dégradée, du fait de l’augmentation des salaires et d’une poussée de l’inflation en résultant (Vidal, op.cit.). Oh et al. (2009) soulignent ainsi que « la Suède a perdu 1/5e de sa part de marché mondiale entre 1977 et 1992, en dépit d’une dépréciation de 50 % de la couronne face aux autres monnaies » ; ils attribuent cette contre-performance à une croissance insuffisante de la productivité des entreprises.
La dernière dévaluation a eu lieu en 1992-1993, pendant la crise immobilière et bancaire, au moment de l’abandon du taux de change fixe. Le solde commercial a alors nettement décollé (cf. graphique 3) et la part de marché de la Suède dans les exportations mondiales s’est redressée sensiblement. La balance commerciale a toutefois subi deux périodes de repli, entre 1996 et 2001 puis à partir de 2004, principalement en raison de la dégradation de la position de deux secteurs clés : les fabricants d’équipements électriques d’abord et l’industrie automobile ensuite. Les principaux secteurs contribuant aujourd’hui à l’excédent commercial suédois sont, comme les deux précédents, des industries mures voire anciennes : par importance décroissante, l’industrie du papier, l’industrie pharmaceutique, l’équipement pour centrales nucléaires, les équipements électriques et le bois (cf. graphique 5).
Graphique 5 – Solde commercial des huit premiers secteurs exportateurs nets et de l’automobile (en milliards USD)
Source : OCDE.
Conclusion
Si la Suède peut prétendre au statut de modèle, c’est soit du fait de son dynamisme économique depuis l’après-guerre jusqu’en 1970, soit du fait de la vitalité qu’elle a retrouvée depuis 1993. Entre-temps, le pays a connu deux décennies de moindre croissance et, en 1992, une crise brutale. Le gouvernement a non seulement réussi son plan de sauvetage des banques mais il a surtout engagé une série de réformes structurelles déterminantes pour la reprise de l’économie et le maintien de l’industrie, dont les effets se ressentent encore aujourd’hui. La dépréciation de la couronne fin 1992, l’essor du commerce international, les mesures adoptées par l’État… sont autant de facteurs ayant facilité la sortie de crise. Chabert et Clavel (2012) estiment que la dépréciation de la couronne en novembre 1992 a permis de gagner 5 points de croissance des exportations, soit une contribution d’1,4 point à la croissance du PIB en 1993.
- 10 – Pour des éléments précis sur les mécanismes de la crise suédoise et les solutions apportées par l’État, voir également Schoeffler (1993), Ecopublix (2008), Letondu (2009) ou Chabert et Clavel (2012).
- 11 – Selon le Service économique régional de Stockholm, le sauvetage des banques a coûté 4 % du PIB à lʼÉtat au moment des mesures dʼurgence, ramené à 1,5 % dès 1997 et à environ 0 quinze ans plus tard (Chabert et Clavel, 2012). Sʼajoutant au sauvetage des banques, les effets de trois ans de récession et de mesures budgétaires contra-cycliques ont creusé le déficit public à 9 % en 1992 puis à 11 % en 1993. Le solde budgétaire est redevenu positif en 1998 (Letondu, op.cit. ).
- 12 – La Suède affiche 82 % de la note maximale, détenue par Hong-Kong et Singapour. Les États-Unis 77 % et la France 72 %.
- 13 – Eliasson et al. , 2012.
- 14 – Voir Clavel et Chabert (2012).
- 15 – Comparer le taux d’ouverture de deux pays de tailles très différentes pose toutefois un problème méthodologique. Toutes choses égales par ailleurs, un petit pays est plus ouvert qu’un grand. Le marché intérieur suédois est de taille un peu plus réduite que celui de l’Ile-de-France ; or le commerce de l’Ile-de-France avec le reste des régions françaises n’est pas comptabilisé comme une exportation.
Une culture de l’innovation et de l’investissement, facteur de productivité
« Une forte culture de l’innovation a propulsé la Suède à la pointe du développement technologique » peut-on lire dans un livre publié par l’Institut suédois pour vanter le dynamisme du pays16. Cette image de la Suède championne de la R&D et de l’innovation est fortement ancrée dans les esprits, constamment relayée par un nombre croissant de rapports et classements internationaux17181920.
On peut toutefois reprocher à ces articles et rankings une tendance à l’amalgame : le comportement des entreprises est une chose (par exemple le niveau de dépense de R&D), celui des usagers présents sur le même territoire en est une autre (par exemple l’usage des TIC parmi les séniors). Lier ces deux aspects, parmi d’autres variables hétérogènes, pour en conclure à la vitalité d’une « culture de l’innovation » peut sembler précipité. D’où l’importance d’y regarder de plus près.
1. Une grande partie des entreprises suédoises investissent plus en R&D que leurs homologues européennes
Avec une dépense représentant 3,4 % du PIB en 2010, la Suède est un des pays au monde qui investissent le plus en R&D, ce qui lui vaut chaque année l’attention, les compliments et l’envie de nombreux observateurs, notamment européens. La part publique de cette dépense étant minoritaire21, c’est à ses entreprises et notamment aux plus grandes d’entre elles22 que la Suède doit d’avoir dépassé l’objectif des 3 % que se sont assigné les pays membres de l’UE dans le cadre de la stratégie de croissance UE 2020, contrairement, entre autres, à la France et à l’Allemagne (cf. graphique 6).
Graphique 6 – Dépense intérieure de R&D (en % du PIB)
Source : OCDE.
L’hypothèse d’un biais méthodologique ou fiscal peut être rapidement écartée : d’une part les données sont harmonisées par Eurostat, d’autre part il n’existe pas de crédit impôt recherche ni de mesure équivalente en Suède. Dès lors, une question importante pour comprendre ce particularisme – et pour apprécier la probabilité que les entreprises françaises suivent un jour la même voie – est de savoir à quel point il est structurel, c’est-à-dire mécaniquement déterminé par la spécialisation économique du pays, ou au contraire « culturel » ou « géographique ». Une analyse structurelle-résiduelle (cf. annexe 1) a été menée à cette fin, pour l’année 200723, concernant les entreprises industrielles (y.c. énergie), la construction et les services marchands, et en se donnant un ensemble de pays européens comme territoire de référence24 (cf. encadré 2 page suivante).
Encadré 2 – COMMENT EXPLIQUER LES ÉCARTS D’EFFORT DE R&D D’UN PAYS À L’AUTRE ?
L’effort de R&D privé, c’est-à-dire le ratio entre la dépense de R&D et la valeur ajoutée des entreprises, varie sensiblement d’un pays à l’autre. Ces écarts ont deux origines. Premièrement, un pays peut détenir un positionnement favorable dans des secteurs qui, par nature, sont intensifs en R&D : produits pharmaceutiques, instruments médicaux, aérospatial… On appelle « effet structurel » cet impact mécanique de la spécialisation sectorielle du pays étudié. Deuxièmement, la part complémentaire de cet écart, qui dépend par construction de facteurs propres au territoire (particularismes institutionnels, culturels, micro et macro-économiques…) est appelée « effet géographique » ou encore parfois « effet résiduel ». C’est ce dernier effet qui permet de voir, le cas échéant, si des secteurs même peu intensifs en R&D contribuent au bon positionnement du pays en matière d’effort de R&D. L’analyse structurelle-résiduelle (ASR) est une façon d’examiner ces écarts et de les commenter ( cf. annexe 1).
Il en ressort que la Suède bénéficie d’une double dynamique. Sa spécialisation sectorielle, favorable aux activités intensives en R&D, est un premier avantage induisant un supplément d’effort de 0,7 point de PIB par rapport au territoire européen pris comme référence (cf. graphique 7). Mais surtout, les entreprises suédoises investissent bien plus en R&D que leurs partenaires européens des mêmes secteurs, expliquant un deuxième surcroît d’effort de 1,3 point de PIB. La somme des deux représente les 2 points de PIB qui séparent la Suède de l’ensemble des pays européens en matière d’effort de R&D.
Graphique 7 – Ecart des efforts de R&D des entreprises en Suède et dans l’UE en 2007 (en % de la valeur ajoutée des entreprises)
Source : OCDE. Calculs La Fabrique de l’industrie.
Secteurs considérés : industrie (y.c. énergie), construction et services marchands. L’écart structurel mesure l’effet de la spécialisation sectorielle ; l’écart résiduel reflète le comportement propre aux acteurs suédois.
Pour mémoire, les entreprises françaises, elles aussi, investissent plus en R&D que la moyenne de leurs concurrentes européennes. Mais cela vient compenser les effets d’une spécialisation sectorielle peu favorable. Si chacun des secteurs français investissait au niveau de ses homologues européens, leur effort de R&D ne représenterait en effet que 1,46 % de leur valeur ajoutée (effort de R&D théorique), sensiblement au-dessous de la moyenne européenne (1,83 %), alors qu’il est de 1,89 % en réalité (cf. graphique 8).
Graphique 8 – Décomposition de l’effort de R&D privé en 2007(en % de la valeur ajoutée des entreprises)
Source : OCDE. Calculs La Fabrique de l’industrie.
Secteurs considérés : industrie manufacturière (y.c. énergie), construction et services marchands.
N.B. : Données 2007 pour la Suède et l’Allemagne, 2006 pour la France. * L’effort en R&D privé théorique est l’effort de R&D privé du pays si chacun des secteurs, en fonction de son poids dans le PIB, avait investi au même niveau que la moyenne des pays européens.
Dans le cas allemand, c’est le contraire : les entreprises allemandes investissent plutôt moins en R&D que leurs partenaires européens, ce qui « prive » l’Allemagne d’environ 0,1 point d’effort de R&D, mais leur spécialisation sectorielle très favorable induit in fine un supplément de 0,73 point par rapport à la moyenne européenne (2,56 % versus 1,83 %).
Le volontarisme des entreprises suédoises en matière de R&D est donc avéré et important. On mesure combien ce comportement est répandu en détaillant, secteur par secteur, les écarts d’intensité technologique avec la moyenne européenne (cf. annexe 2).
Mesurer le particularisme suédois en matière d’investissement privé dans la R&D est une chose ; l’expliquer en est une autre. En l’absence de cause évidente, le Service économique régional de Stockholm (DG Trésor) évoque plusieurs hypothèses (cf. encadré 3).
Encadré 3 – Hypothèses pour expliquer l’ampleur de l’effort des entreprises en matière de R&D25
L’effet taille
La Suède est un petit pays. Son PIB de 2011 est environ 5 fois moins élevé que le PIB français. La structure économique de la Suède étant caractérisée par la présence de grands groupes, lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux fournissent un effort élevé d’investissement en R&D, cela pèse fortement sur l’effort total du pays. Pour rappel, les 10 premiers groupes suédois assurent 53 % de la R&D privée en 2009.
Les stratégies de certaines entreprises
Dans les années 2000, Ericsson a fait le choix de s’orienter davantage vers la gestion des réseaux de télécommunication que vers les équipements. Ce choix a été bénéfique – en termes de type de clients et de contrats, de rentrées financières… – et a poussé l’entreprise vers une activité plus intensive en recherche et développement. Dans un autre domaine, les groupes Volvo et Saab se sont désengagés de leurs activités de construction automobile (vendues respectivement à Ford en 1999 et à GM en 2000) pour se concentrer sur celle des poids lourds (respectivement Volvo AB, qui possède notamment Renault VI et Scania). Ces derniers contiennent plus de technologies et là encore, sont au cœur d’un marché dynamique, avec des clients beaucoup moins sensibles aux prix que ceux de la construction automobile. Naturellement, rien ne garantit que ces entreprises fassent toujours des choix stratégiques profitables. Cette explication est donc purement conjoncturelle.
Patriotisme industriel, protectionnisme capitalistique et politique d’attractivité
Le capitalisme suédois a été marqué par l’essor, à la fin du XIX e et au début du XX e siècle, de quelques puissantes familles d’industriels (dont les Wallenberg), rejointes plus récemment par d’autres familles misant davantage sur le commerce (Ikea), la sécurité (Securitas et ses spin-offs , tels que Loomis), les médias. Le pouvoir de ces familles, qui affichent un certain patriotisme industriel, est notamment lié à une forme de protectionnisme capitalistique qui permet de garder le contrôle des grands groupes mondialisés.
De plus, dans un objectif affiché d’attractivité, la Suède réduit le taux de l’impôt sur les sociétés, qui est ainsi passé de 26,3 % à 22 % le 1 er janvier 2013, avec l’objectif d’atteindre 15 % « à moyen terme ». Or, les entreprises suédoises tendent à maintenir leurs centres de recherche et développement à proximité de leur siège. De plus, les fondations privées sont une tradition suédoise ; les plus grosses d’entre elles, comme les trois principales fondations Wallenberg par exemple, financent largement les activités de R&D. Elles bénéficient en échange de certaines exonérations fiscales.
L’exception du professeur
Les professeurs et chercheurs, dans les universités et les grandes écoles, sont détenteurs de la propriété intellectuelle de leurs recherches, par exception à la loi LAU de 1949. Cela permet une exploitation facile des résultats et un passage plus simple de l’idée à l’entreprise, d’autant plus que de nombreuses universités se sont dotées d’incubateurs destinés à soutenir le transfert de technologie et la création de start-up .
2. Les entreprises suédoises tirent-elles profit de cet investissement en R&D ?
Dans la plupart des pays européens, ainsi qu’au niveau de la Commission européenne elle-même, de nombreux observateurs déplorent que l’effort de R&D ne débouche pas suffisamment sur des activités innovantes et solvables : dépôts de brevets avec octroi de licences, lancement de nouveaux produits, création de nouvelles entreprises… Les métriques utilisées sont diverses mais la frustration est la même : la dépense de R&D, soigneusement mesurée et ardemment encouragée, ne s’accompagnerait pas d’une « destruction créatrice » comparable à ce que l’on croit observer aux États-Unis. Ceci alimente de longue date le sentiment d’un « paradoxe », posé noir sur blanc par la Commission en 1995.
La Suède n’échappe pas à ce débat : le « paradoxe suédois » mobilise ainsi beaucoup d’attention dans la littérature économique. À quoi sert d’avoir un niveau record de dépense de R&D si les activités innovantes tangibles, ou surtout statistiquement traçables, ne s’en trouvent pas augmentées d’autant ?
Dès 1987, Ohlsson et Vinell affirment que les productions et exportations suédoises ne sont pas suffisamment alimentées par l’effort de R&D. Edquist et McKelvey (1996) s’étonnent à leur tour de la faible part des productions high-tech en Suède, malgré les budgets de R&D très conséquents qui sont investis par les entreprises ; ils baptisent « paradoxe suédois » ce syndrome qui sera confirmé ensuite à de multiples reprises. Les auteurs les plus sceptiques, tels Ejermo et Kander (2011), ne manquent pas d’ailleurs de souligner qu’il a été tellement confirmé, dans à peu près tous les pays européens et jusqu’aux États-Unis eux-mêmes (Jones, 1995), qu’il n’y a peut-être plus lieu de parler de paradoxe. Le débat est cependant toujours actif, d’une part parce que le constat est régulièrement affiné et réaffirmé26, d’autre part parce que cette préoccupation reste totalement prégnante chez les décideurs politiques (OCDE, 2005).
Pour leur part, Ejermo et Kander (op.cit.) n’adhèrent pas à la thèse d’un paradoxe spécifiquement suédois : ils attribuent à de probables biais statistiques la différence de productivité de la R&D (exprimée en nombre de brevets déposés par dollar de R&D dépensé) qu’ils mesurent entre la Suède et les États-Unis. En revanche, ils soulignent que cette productivité de la R&D s’est accrue en Suède de 40 % entre 1985 et 1998, y compris dans des secteurs manufacturiers moyennement ou faiblement intensifs en technologie. Ils rapprochent en outre ce sursaut, consécutif à la sortie de crise de 1993 en Suède, d’un mouvement analogue observable aux États-Unis quelque dix ans plus tôt. Ainsi, le phénomène fondamental selon eux n’a rien d’un paradoxe national mais relève de l’alternance entre des phases de transformation (de 20 à 25 ans) au cours desquelles la productivité de la R&D est modérée et des phases de rationalisation (10 à 15 ans) où elle augmente significativement. On retrouve là l’idée que les économies nationales parviennent, plus ou moins bien et plus ou moins vite, à se saisir de nouveaux paradigmes technologiques ou « régimes technologiques » (Malerba, 2004).
3. L’effort d’innovation est-il à l’origine des gains de productivité observés en Suède ?
C’est établi, il est irréaliste de rechercher un lien mécanique et linéaire entre l’investissement en R&D et la croissance économique (Aghion et Howitt, 1998). Dans le cas suédois, il est en revanche très instructif de rapprocher l’effort de R&D des entreprises avec l’accroissement de leur productivité.
Comme le note Edquist (2011), les gains de productivité se sont accélérés en Suède à la sortie de la crise, en 1993. Nombre d’économistes attribuaient ce rebond à un phénomène de rattrapage et pensaient qu’il s’essoufflerait en quelques années. Or, la progression de la productivité est non seulement restée élevée entre 1995 et 2005, mais elle a même atteint l’un des niveaux les plus élevés au monde27.
Deux explications de ce phénomène sont fréquemment invoquées. La première porte sur les effets bénéfiques des libéralisations des années 1980, via le renforcement de la pression concurrentielle sur les entreprises (Nickell, 1996). La seconde relève l’effet de la diffusion des TIC dans l’économie, démontré à diverses reprises dans le cas suédois, à partir du milieu des années 1990.
Edquist en ajoute une troisième. Il souligne en effet l’importance, en Suède, des investissements dans le capital immatériel (ou « intangible »), notion qui recouvre l’information numérisée, la propriété intellectuelle (R&D, licences, design…) et les compétences (les qualifications, le capital organisationnel et la marque). En rassemblant des sources hétérogènes, il montre que l’investissement privé dans le capital immatériel a représenté 11 % du PIB en 2004, un effort similaire à ce qu’il observe au Royaume-Uni et légèrement inférieur au cas nord-américain (13 %). Cet investissement est pour lui à l’origine de la moitié des gains de productivité enregistrés en Suède, part justement non expliquée par les seuls apports des biens tangibles, le capital et le travail.
Conclusion
Dans quasiment tous les secteurs industriels, qu’ils soient low-tech ou high-tech , et les services marchands, l’intensité technologique des entreprises est plus forte en Suède que dans le reste de l’Europe. De sorte que l’effort de R&D du pays est bien plus élevé que ce qu’induit sa spécialisation sectorielle. Ce comportement, avéré, n’a pas d’explication évidente ; on peut douter que les politiques publiques d’innovation en soient seules à l’origine.
Pourquoi les entreprises suédoises consentent-elles davantage que leurs homologues à dépenser pour de la R&D, risquée par nature ? Notons que ce comportement n’est ni universel – les Allemands tirent très bien leur épingle du jeu en investissant moins – ni consensuel : le débat autour du rendement de cette dépense, en termes de brevets ou de produits nouveaux, n’est pas tranché. Il semble incontestable, en revanche, que les investissements en R&D et le développement des TIC sont deux sources majeures de gains de productivité enregistrés par l’économie suédoise depuis le début des années 1990.
- 16 – Lagerberg et Randecker, 2010.
- 17 – Dray, 2010.
- 18 – Le Tableau de bord de l’innovation publié par la Commission européenne (2011) classe ainsi la Suède au premier rang de l’innovation, en 2010, parmi les pays membres de l’UE.
- 19 – La Harvard Business School (Porter Michael E., Stern Scott, 2010), de son côté, effectue une étude du « potentiel d’innovation » de 173 pays pour établir un « indice de capacité d’innovation nationale ». En 2010, la Suède est classée huitième, derrière l’Allemagne (3e ) mais devant la France (9e ). La Suède est 2e concernant le nombre d’ingénieurs qualifiés par habitant, mais seulement 21e concernant les politiques d’innovation.
- 20 – Selon l’Insead (2012) enfin, et comme indiqué en introduction, la Suède figure au 2e rang mondial en 2011 concernant la capacité de son infrastructure à favoriser la créativité et l’innovation.
- 21 – Les dépenses publiques de R&D représentent 1 % du PIB.
- 22 – Selon le Service économique régional de Stockholm, les 10 premiers groupes suédois assurent 53 % de la R&D privée en 2009.
- 23 – L’année 2007 a été choisie compte tenu des données disponibles – valeur ajoutée, dépenses de R&D – sur les bases de données de l’OCDE. Lorsque la donnée 2007 était manquante, nous avons utilisé les chiffres de 2006.
- 24 – L’ASR nécessite la construction d’un territoire de référence. Dans notre cas, la zone de référence européenne comprend les pays suivants : Autriche (2007), Belgique (2007), Finlande (2007), France (2006), Allemagne (2007), Grèce (2007), Italie (2007), Pays-Bas (2007), Portugal (2006), Espagne (2007), Suède (2007).
- 25 – Service économique régional de Stockholm (DG Trésor).
- 26 – Ainsi, Bitard et al. (2008) maintiennent qu’il existe un paradoxe suédois quand on compare la Suède aux autres « petits » pays.
- 27 – Voir aussi Oh et al. (2009).
La résilience enviable de l’industrie suédoise
L’économie suédoise a réalisé d’importants gains de productivité depuis 1993 et semble être parvenue à maintenir sa base industrielle. Le poids de l’industrie dans le PIB est en effet de 19,3 % en 2009, bien au-dessus de ce que l’on observe en France (12,5 %) ou au Royaume-Uni (14,5 %). Certes, sur longue période, il tend à diminuer en Suède comme dans l’ensemble des pays industrialisés, mais plus lentement. Cette base industrielle, loin d’être exclusivement tournée vers des secteurs high-tech, repose également sur des secteurs assez traditionnels encore compétitifs.
1. Le regain du secteur manufacturier entre 1993 et 2007
En 2009, l’industrie manufacturière suédoise représentait un peu plus de 14 % de l’emploi total et 19,3 % du PIB. Le graphique 9 montre plusieurs choses. Premièrement, si l’on raisonne en prix courants, le PIB industriel suédois a crû à une allure régulière de 1970 jusqu’en 2007, à la notable exception de la crise 1991-1993.
Mais, deuxièmement, si l’on compare cette fois les courbes en volume et en valeur, on voit apparaître deux périodes bien distinctes. Entre 1970 et 1990, le niveau d’inflation est tel que la croissance réelle est 3,5 fois plus faible que la croissance nominale (1,8 % par an en moyenne, contre 6,7 % en apparence). Entre 1993 et 2007, au contraire, la maîtrise de l’inflation amène à constater une croissance réelle plus forte que la croissance en valeur (6,3 % par an en moyenne, contre 5,6 %).
Autrement dit encore, abstraction faite de l’inflation, le PIB manufacturier en Suède a progressé 3,5 fois plus vite entre 1993 et 2007 qu’entre 1970 et 1990. Incontestablement, c’est là un signe de la vigueur et de la compétitivité de l’industrie suédoise dans les deux dernières décennies. Cette croissance s’explique, dans un premier temps, par un effet de sortie de crise et par la dévaluation de la couronne en 1992. Sur plus longue période, l’essor des exportations ainsi que les gains de productivité, tous deux mentionnés précédemment, ont joué un rôle essentiel. On doit ici souligner que les gains de productivité ne se sont pas limités aux seules grandes entreprises exportatrices, souvent plus productives que les autres, ni aux seules entreprises high-tech. Oh et al. (op.cit.) avancent au contraire qu’ils ont rejailli sur l’ensemble du tissu des entreprises, manufacturières ou non, indépendamment de leur taille et de leur intensité technologique.
Entre 2007 et 2009, le PIB manufacturier suédois a naturellement décru sous l’effet de la crise mondiale. En 2011, il n’avait toujours pas retrouvé son niveau de 2008, même en valeur.
Graphique 9 – PIB manufacturier suédois (secteur énergie compris)
Source : OCDE.
2. Une désindustrialisation plus lente que dans les autres pays développés
Bien que la Suède connaisse une croissance de son PIB industriel depuis les années 1970, la part de l’industrie dans le PIB n’a cessé de diminuer comme le montre le graphique 10 (page suivante).
Graphique 10 – Part du PIB industriel dans le PIB total (en %)
Source : OCDE.
Ce mouvement de désindustrialisation (-0,19 point de PIB par an entre 1970 et 2010) est une tendance commune aux pays développés, comme le montre le tableau 3. Toutefois, la Suède se désindustrialise presque deux fois moins vite que l’Allemagne ou la France (-0,35 et -0,31 point respectivement chaque année). Entre 1970 et 2010, les industries danoise et finlandaise n’ont perdu quant à elles que respectivement 0,11 et 0,16 point de PIB par an.
S’agissant de la part des effectifs industriels dans l’emploi, la Suède suit là encore la tendance générale à la baisse, observable dans les pays développés. Le graphique 11 montre que la baisse en Suède est moins rapide qu’en France et en Allemagne.
Graphique 11 – Part dans l’emploi total de l’industrie manufacturière (en %)
Source : OCDE.
Deux explications du phénomène de désindustrialisation des pays développés méritent d’être relevées. D’abord, certaines tâches qui relevaient auparavant du secteur industriel sont aujourd’hui externalisées à des sociétés de services (nettoyage, restauration, gestion des ressources humaines, comptabilité, infogérance…). Un ensemble d’emplois ont donc basculé statistiquement dans la catégorie tertiaire sans aucun changement sur le terrain. Ensuite, les gains de productivité, jusqu’à aujourd’hui plus élevés dans l’industrie que dans les services, font que le poids relatif des services augmente, d’une part parce que les prix des produits manufacturés diminuent relativement à ceux des services, d’autre part parce que la richesse supplémentaire créée par ces gains de productivité est davantage utilisée pour acheter des services que des produits industriels (selon une hypothèse assez établie d’élasticité de la demande de services au revenu). La demande de produits croît moins vite que la productivité et le besoin de main d’œuvre industrielle diminue. Ces deux phénomènes, observables dans toutes les économies développées, sont souvent assimilés au versant le moins inquiétant du phénomène de désindustrialisation.
Dans le cas français, il est à peu près certain que ces deux phénomènes ne suffisent pas à expliquer le recul de l’industrie dans le PIB, autrement dit que la compétitivité de l’industrie française a peu à peu fléchi au point de lui faire perdre réellement ses marges et ses parts de marché, ce qui est autrement préoccupant pour les parties concernées. Dans le cas suédois, la situation est plus ambiguë. Le Bureau national du commerce suédois (2010) expose la discussion à peu près exactement en ces termes mais se garde de trancher sur le diagnostic. D’une part, il confronte à parité les points de vue de Djerf (2005), selon lequel l’emploi industriel suédois s’est maintenu si on lui ajoute la part des services externalisés, et de Nickell (2008) qui maintient qu’une désindustrialisation « réelle » opère en Suède. D’autre part, il évoque l’idée que, notamment grâce à la révolution numérique, les services pourraient être en train de rattraper leur retard sur l’industrie en matière d’accroissement de la productivité. Quoi qu’il en soit, le Bureau national du commerce déplore moins le recul du secteur manufacturier en Suède qu’il ne se félicite de son aptitude à se diversifier en intégrant des offres de services.
Tableau 3 – Evolution de la part du PIB industriel dans le PIB entre 1970 et 2010
Source : OCDE.
3. Une structure industrielle dominée par les grands groupes
Une des caractéristiques de l’industrie suédoise est la prégnance de grands groupes tels que Saab, Volvo ou Ericsson… qui sont pour la majorité d’entre eux détenus par de grandes familles suédoises, comme la célèbre famille Wallenberg. Un consensus règne dans le pays pour protéger le contrôle de ces groupes familiaux, dans l’espoir que cela limitera les délocalisations28, les acquisitions de firmes suédoises par des groupes étrangers étant à la fois nombreuses et matière à controverse. Lemaître (2012) note que ces grandes familles ont constitué de véritables sphères d’influence, qui contrôlent de façon directe ou indirecte (par des holdings) un ensemble d’entreprises dans les secteurs de l’industrie, du commerce ou des services (Ericsson, Securitas, Electrolux, Ikea, AtlasCopco…). Davis et Henrekson (1997) rappellent qu’en 1985, les cinq plus gros actionnaires détenaient 44 % de tous les droits de vote des entreprises de plus de 500 salariés en Suède.
Compte tenu du niveau d’ouverture internationale de l’économie suédoise aujourd’hui, il est difficile d’apprécier si cette conception du capitalisme, à la fois patrimoniale et patriotique, protège effectivement des prises de contrôle étrangères et, surtout, du risque d’accélération de la désindustrialisation. En revanche, il ne fait guère de doute qu’elle incarne un « capitalisme patient », où le souci de la profitabilité à court terme peut être mis en balance avec l’intérêt de l’investissement à long terme. Dans la même perspective, on a pu également se demander si l’existence de fonds de pension fortement dotés en Suède29 ne contribuait pas, elle aussi, à promouvoir des stratégies d’investissement de long terme, favorables au maintien de la base industrielle. La réponse est incertaine, tant les règles prudentielles qui s’imposent à ces derniers sont contraignantes. Les cinq fonds publics suédois ont, entre autres, interdiction d’intervenir en dehors des marchés de capitaux, de placer plus de 5 % de leurs avoirs dans des entreprises non cotées, de détenir plus de 10 % des droits de vote d’une même entreprise, de placer plus de 2 % de leurs avoirs dans des entreprises suédoises cotées…
Si l’on fait abstraction de cet édifice capitalistique particulier, la structure industrielle suédoise est très similaire à celle de la France (cf. tableau 4). Les grands groupes et ETI industriels représentent à peine 1 % des entreprises en Suède (soit 309 entreprises) mais concentrent presque 50 % de la main d’œuvre industrielle et un peu plus de 60 % du chiffre d’affaires total. Aucun des grands groupes suédois n’a été fondé après la Seconde Guerre mondiale à une exception près, Tetra Pak, en 196930.
Cette concentration de l’industrie suédoise est ancienne31 et ne dois pas être attribuée par exemple à la récente vague de fusions-acquisitions. Elle est également matière à débat. Un peu comme en France, où l’on vante la puissance à l’export des « champions nationaux » tout en déplorant que les startups ou les ETI ne prospèrent pas suffisamment, les économistes suédois affichent leur perplexité voire leurs désaccords sur les avantages et inconvénients d’une telle organisation.
Davis et Henrekson (op.cit.), en particulier, livrent un réquisitoire sans complaisance sur la multitude des biais règlementaires, fiscaux et culturels qui, tout en étant très favorables aux grands groupes établis, dynamiques, exportateurs et capitalistiques, entravent la création puis l’essor de nouvelles générations d’entreprises. Braunerhjelm et Henrekson (2012) présentent un point de vue complémentaire et plus récent. Tout en concédant que la contrainte réglementaire et fiscale sur l’entrepreneuriat s’est un peu desserrée (permettant par exemple l’essor d’un marché du capital-risque au milieu des années 1990), ils jugent dans l’ensemble l’écosystème suédois exigeant voire décourageant pour l’entrepreneuriat. Ainsi par exemple, les quelque 1 % de chercheurs qui fondent une startup, en flux annuel, n’ont aucune chance d’en tirer un bénéfice financier ; l’espérance de gain serait plutôt négative par rapport à leur situation antérieure. Soixante pour cent de ces chercheurs-entrepreneurs abandonnent dans les deux ans, dont les deux tiers reviennent à leur poste d’origine. Autre exemple, les auteurs jugent compliquée la réglementation fiscale qui s’applique aux PME, le législateur mettant un soin particulier à ce qu’un revenu du travail (fortement taxé) ne puisse pas être présenté comme un revenu du capital (faiblement taxé).
Dans l’ensemble, le statut fiscal de l’entrepreneur ou de celui qui investit dans une jeune entreprise semble défavorable. Entre autres conséquences observables, Zaring et Eriksson (2009) relèvent que les acteurs étant entrés sur le marché florissant des TIC dans les années 1990 relèvent de deux catégories très contrastées : des startups à l’espérance de vie relativement courte d’une part et, d’autre part, les filiales de groupes existants cherchant là une voie de diversification, qui ont joué un rôle structurant et stabilisant.
Pour ce qui est des ETI, que l’institut statistique suédois ne différencie pas des grands groupes, de premières approximations permettent d’avancer qu’elles ont à peu près le même poids qu’en France. Sur 1 millier d’entreprises de plus de 250 salariés en Suède, 90 % sont des ETI (chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros).
En résumé, la structure industrielle suédoise est dominée, comme en France, par de grands groupes exportateurs puissants, avec moins de startups qu’aux États-Unis ou au Royaume-Uni et moins d’ETI qu’en Allemagne. On peut trouver là la preuve qu’une base industrielle peut être performante sans se conformer à un modèle anglo-saxon ou germanique.
Tableau 4 – Nomenclature des industries suédoise et française en 2010 (en %)
Source : Statistiques structurelles d’entreprises (OCDE), Insee.
TPE : Très petites entreprises.
PME : Petites et moyennes entreprises.
ETI-GG : Entreprises de taille intermédiaire et grands groupes.
4. Une économie mêlant activités traditionnelles, industries plus intensives en technologie et services
Présentée comme une championne de la R&D et des TIC, la Suède a l’image d’un pays dont l’industrie serait tournée vers les secteurs de haute technologie. Une analyse de l’activité économique montre une réalité plus nuancée. L’économie suédoise a développé des industries en lien avec les ressources naturelles de son territoire (bois, papier, métallurgie), d’autres tournées vers la maîtrise de technologies spécialisées (automobile, téléphonie) mais elle s’appuie également sur des services marchands et non marchands (Touzé, 2007) qui ont réalisé des gains de productivité importants depuis la fin des années 1990.
Les graphiques 12a et 12b (voir ci-après) confirment ce positionnement sectoriel. Ils divisent l’activité économique en 44 secteurs (industrie, énergie, construction, services marchands et non marchands) et présentent leurs poids relatifs dans l’emploi et la valeur ajoutée par rapport à un territoire de référence européen32, en 2007. Lorsque cet indice, nommé indice de spécificité, est supérieur à 1, le secteur est surreprésenté en Suède, et inversement.
La Suède détient une forte spécialisation, en termes d’emploi et de valeur ajoutée, dans les industries du papier et du bois. Le poids de l’industrie papetière dans l’emploi est 2,2 fois supérieur à ce qu’il représente dans l’Union européenne, et 2,6 fois plus élevé en termes de valeur ajoutée. Des activités industrielles middle-tech voire high-tech ressortent également, telles que l’automobile, les produits pharmaceutiques, les équipement électroniques. Dans l’ensemble, la Suède apparaît spécialisée dans des secteurs dominés par de grands établissements33 ; la croissance dans ces secteurs est étroitement liée au dynamisme des groupes suédois. Les industries textile et agroalimentaire sont quant à elles sous-représentées en Suède, que ce soit dans l’emploi ou la valeur ajoutée en 2007.
5. Des gains de productivité importants, notamment dans les services
Entre 1995 et 200734, l’emploi a progressé de 9,6 % en Suède et de 15,9 % en Europe, soit un écart défavorable de 6,3 points. Pourtant, une analyse structurelle-résiduelle, analogue à celle qui a été présentée précédemment au sujet de l’effort de R&D, montre que la Suède bénéficiait d’un positionnement sectoriel théoriquement favorable au développement de l’emploi. C’est donc uniquement à des dynamiques propres au pays (cadre politique, décisions d’entreprises…) qu’il faut attribuer cette moindre progression par rapport à l’Europe.
A contrario, la valeur ajoutée a augmenté plus vite en Suède qu’en Europe: 83,1% contre 73,6%, soit un écart de 9,6 points en faveur de la Suède. Même si la Suède tire, cette fois encore, un avantage modeste de son positionnement sectoriel, l’essentiel de cette sur-performance relève de facteurs propres.
Ce contraste entre les évolutions de l’emploi et de la valeur ajoutée traduit la vigueur des gains de productivité enregistrés en Suède, déjà mentionnés plus haut.Le tableau 5, qui repose sur la décomposition précédente en 44 secteurs, montre que la moitié d’entre eux ont enregistré à la fois une croissance de la valeur ajoutée et une progression de l’emploi. Ces 22 secteurs expliquent à eux seuls l’essentiel de l’accroissement de valeur ajoutée (71,4 % sur les 83,1 %) et la totalité de la progression de l’emploi. Dix-neuf autres secteurs, soit une petite moitié, ont connu une hausse de la valeur ajoutée et une baisse de l’emploi ; ils contribuent nettement moins que les précédents à la croissance de la valeur ajoutée. Seuls trois secteurs ont décru sur les deux tableaux.
Tableau 5 – Répartition des secteurs en fonction des contributions à la croissance de l’emploi et de la valeur ajoutée entre 1995 et 2007
Source : OCDE. Calculs La Fabrique de l’industrie.
Des calculs complémentaires révèlent que la totalité des secteurs ont connu une hausse de la productivité en Suède entre 1995 et 2007. Le tableau 6 (voir page suivante) établit un parallèle entre les hausses de gains de productivité constatés en Suède et en Europe.
Tableau 6 – Comparaison des taux de croissance de la productivité (par personne employée) en Suède et en Europe (1995-2007)
Source : OCDE. Calculs La Fabrique de l’industrie.
On note que les secteurs ayant le plus contribué à la croissance de la valeur ajoutée et à celle de l’emploi sont dans le domaine tertiaire, marchand ou non. L’industrie a contribué dans une moindre mesure à la croissance de la valeur ajoutée et dans le même temps à la décroissance de l’emploi.
Les gains de productivité réalisés en Suède dans le secteur (marchand) « Autres activités de services aux entreprises » sont plus de 3 fois supérieurs à ceux réalisés en Europe. Dans le secteur (non marchand) « Autres activités de services collectifs, sociaux et personnels », ils sont 2,7 fois plus forts. La réorganisation de l’État (décentralisation, diminution du nombre de fonctionnaires…) et les vagues de libéralisation des années 1990 apportent des éléments d’explication aux gains de productivité observés dans les services non marchands. La santé est une compétence centrale des comtés depuis les années 1970, ces derniers ayant réorganisé l’accès aux soins médicaux (cf. chapitre 6). De plus, entre 1991 et 1992, les maisons de retraite, les subventions aux centres de garde d’enfants à but lucratif, les écoles maternelles, les agences pour l’emploi et les subventions aux écoles privées ont été libéralisées (Trésor-Eco, 2012).
Dans l’industrie, le secteur « appareils de radio, télévision et communication » a réalisé la plus forte croissance de productivité par personne employée en Suède (+215 %). Ce taux est 2 fois supérieur à celui constaté en Europe. D’autres secteurs industriels se détachent comme celui de la « production de bois, articles en bois et liège », secteur dans lequel la Suède est spécialisée (voir graphiques 12a-12b), ou textile dans lequel elle est, au contraire, non spécialisée. Enfin, un grand secteur exportateur tel que « pâtes et papiers, articles en papier » a vu sa productivité augmenter entre 1995 et 2007 en Suède (+25,5 %) mais beaucoup plus lentement qu’en Europe (+270 %).
Graphique 12a – Spécialisations relatives de la Suède en termes d’emploi (2007)
Source : OCDE. Calculs La Fabrique de l’industrie.
Graphique 12b – Spécialisations relatives de la Suède en termes de valeur ajoutée (2007)
Source : OCDE. Calculs La Fabrique de l’industrie.
6. L’industrie suédoise se protège de la concurrence sur les prix par un haut niveau de gamme
Selon le gouvernement suédois, la santé économique future du pays et le maintien de son système social très développé dépendent largement de la capacité des entreprises à rester compétitives sur les marchés mondiaux35. Les exportations apparaissent donc comme une des clés de la croissance suédoise. Or, Natixis (2012) montre que le niveau de gamme des produits proposés par la Suède est élevé, les acheteurs étrangers s’avérant très peu sensibles au prix. En effet, l’élasticité des exportations en volume au taux de change effectif réel est très faible en Suède (0,08) comparativement à l’Espagne (0,84), la France (0,82), l’Italie (0,56) ou l’Allemagne (0,42) (Natixis, 2012).
Cette forte inélasticité est indubitablement une arme de l’industrie suédoise dans la compétition internationale, alors qu’elle doit composer avec des coûts élevés, notamment en termes de main d’œuvre (cf. graphiques 13 et 14).
Il reste que, en dépit de cet ancrage avantageux sur le haut de gamme, les industries suédoises voient leurs marges s’éroder, comme en France et au contraire de l’Allemagne (Natixis, op.cit.).
Graphique 13 – Coût unitaire du travail (base 100 en 1979)
Source : OCDE.
Graphique 14 – Coût horaire de la main d’œuvre dans l’industrie, charges comprises, en €
Source : Natixis, 2012.
Conclusion
La Suède dispose d’une base industrielle forte, structurée autour de grands groupes exportateurs et de grands empires capitalistiques détenant in fine une fraction importante des entreprises. Elle se désindustrialise, comme tous les pays développés, mais elle le fait moins vite que d’autres pays, de sorte que son socle industriel, où les secteurs dits traditionnels demeurent importants, bénéficie aujourd’hui d’une importance comparable à ce que l’on trouve en Allemagne. A contrario, le système suédois ne semble pas particulièrement propice à l’émergence en grand nombre de startups résilientes, ni d’ailleurs favorable aux ETI.
En plus d’un positionnement sectoriel légèrement favorable à la croissance, l’analyse structurelle-résiduelle montre une sur-performance spécifiquement suédoise en termes d’accroissement de la valeur ajoutée durant les deux dernières décennies relativement à l’Europe. L’exercice équivalent sur les emplois, qui montre une moindre croissance qu’en Europe, illustre l’ampleur des gains de productivité réalisés. Entre 1995 et 2007, l’industrie a contribué à la croissance de la valeur ajoutée à hauteur de 13,7 points tout en perdant des effectifs (-1,4 point). Sur cette même période, les gains de productivité réalisés dans les services marchands et non marchands ont été massifs. Sur les 83,1 % de croissance de valeur ajoutée et les 9,6 % de croissance de l’emploi observés en Suède sur la période étudiée, le secteur tertiaire a contribué respectivement à hauteur de 62,4 points et 10,6 points.
Grâce à ses gains de productivité, à son ouverture sur l’international et au maintien d’un niveau de gamme élevé, le secteur manufacturier suédois a connu une vive croissance entre 1993 et 2007, allant bien au-delà d’un simple phénomène de sortie de crise. Malgré tous ces succès, on peine à trouver une trace écrite de ce qu’est la politique industrielle suédoise aujourd’hui, de ce que sont ses stratégies et ses objectifs pour l’avenir. Gustav Fridolin, porte-parole du parti des Verts, estimait en juin 2011 que « la Suède était une nation industrielle sans politique industrielle ».
- 28 – La Suède s’est ainsi opposée aux différentes tentatives de la Commission européenne d’imposer une proportionnalité des droits de vote au montant du capital détenu. En l’état actuel, il existe deux types d’actions dans le pays comme le souligne Lemaitre (2012) : « (…) les actions A qui donnent des droits de vote supérieurs, et les actions B. À l’origine, le rapport pouvait aller de 1 à 1000. Il est aujourd’hui limité à 1 à 10 pour les nouvelles actions émises. Près de 60 % des entreprises cotées à la Bourse de Stockholm sont concernées par ce double système d’actions, qui permet aux investisseurs de long terme de contrôler l’entreprise sans pour autant posséder une part trop importante du capital financier ».
- 29 – Les avoirs des fonds de pension publics représentaient 27 % du PIB en 2010 (Severinson et Stewart, 2012).
- 30 – Huteau et Larraufie, 2009.
- 31 – En 1986, les entreprises ayant au moins 500 salariés représentaient 60,4 % de lʼemploi total, contre 30,4 % au sein de la Communauté européenne. Les entreprises de moins de dix salariés regroupaient quant à elle 9,5 % lʼemploi en Suède, soit moins de la moitié de la part de lʼemploi représentée par les TPE dans la Communauté européenne. (Davis et Henrekson, 1997).
- 32 – Ce territoire européen comprend l’Autriche, la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suède. Son périmètre a été contraint par la disponibilité des données sur l’emploi total (nombre de salariés et travailleurs indépendants) et la valeur ajoutée (en dollars courants) dans les bases de l’OCDE.
- 33 – Ericsson pour les télécommunications, Tetra Pak pour la papeterie ou encore Volvo pour les véhicules motorisés, Saab pour l’aéronautique et la défense, Vattenfall et ABB pour l’énergie, Electrolux pour la machinerie et l’équipement.
- 34 – Cette période d’entre deux crises se caractérise par une relative stabilité de la conjoncture.
- 35 – Jacob et Guillon, 2012.
VOLET 2 – EMPLOI ET COHÉSION SOCIALE
La compétitivité de l’industrie suédoise a reposé, au moins durant les Trente glorieuses, sur un socle original composé de trois éléments dont on ne comprend les mérites que si on les appréhende globalement : (i) le cadre néo-corporatiste du dialogue social et en particulier de la négociation salariale, (ii) la prééminence des politiques actives de l’emploi et (iii), plus largement, la culture suédoise attachée à l’égalité sociale et à la redistribution.
Cet héritage est suffisamment vivant pour que le lecteur français puisse en tirer les enseignements utiles aux débats d’aujourd’hui. Les deux chapitres suivants reviennent donc sur la pratique suédoise du dialogue social et sur les politiques de l’emploi, très spécifiques.
Le rôle déterminant du dialogue social dans la compétitivité
Dans les années 1920, la société suédoise a été marquée par de violents mouvements sociaux, de fortes grèves et des lock-out. Ces mouvements ont pris fin grâce à la signature de l’accord de Saltsjöbaden (1938) entre les deux forces syndicales majoritaires, le syndicat des ouvriers LO (Landorganisationem Sverige) et celui des employeurs SAF (Svenska Arbetsgivare Foreninger36). Depuis cet accord, la régulation des relations professionnelles, et plus largement du marché du travail, est fortement marquée par la présence syndicale (cf. encadré 4).
La politique d’égalité salariale proposée par deux économistes de LO, Rehn et Meidner est un exemple caractéristique du poids des partenaires sociaux dans la prise de décision politique et économique. En 1950, le gouvernement social-démocrate a craint le risque d’une montée des salaires et des prix dans l’économie. Rehn et Meidner ont alors proposé une politique macroéconomique social-démocrate se démarquant du modèle keynésien, jugé trop inflationniste37. L’objectif de plein-emploi restait au cœur de cette politique macroéconomique mais les moyens pour y parvenir étaient différents, car reposant sur le principe de l’égalité salariale.
Vu de France, on peut s’étonner qu’un seul syndicat ait été une source d’inspiration aussi déterminante pour un élément central de la politique économique. En réalité, LO a toujours entretenu un rapport privilégié avec le parti social-démocrate ; il fut à l’origine de sa création en 1889. Jusqu’à la fin des années 1970, les salariés membres de LO, c’est-à-dire 80 % des salariés suédois, adhéraient de façon automatique au parti social-démocrate (Boujnah, 2002), parti qui a gouverné de manière quasi ininterrompue depuis 1932. Le projet des deux économistes a été présenté en 1951, lors du Congrès de la confédération LO, et adopté en 1955.
En un peu plus de 60 ans, malgré des modifications dans les rapports de force entre acteurs syndicaux, la décentralisation progressive de la négociation ou encore les effets ambivalents de la politique d’égalité salariale, le pouvoir et la légitimité des partenaires sociaux dans le système de négociation collective n’ont pas été démentis, ce qui a contribué à la compétitivité de l’économie.
Encadré 4 – LA CONSTRUCTION D’UN CADRE NÉO-CORPORATISTE
Dans les années 1930, les relations entre LO, la SAF et le parti social-démocrate ont façonné un cadre néo-corporatiste. L’accord de Saltsjöbaden , en 1938, a mis en place les institutions et les acteurs qui ont permis le développement du modèle suédois (Simoulin, 2005). Cet accord consacre le principe d’autonomie des partenaires sociaux, ainsi que celui de leur reconnaissance mutuelle, qui sont à la base du système de négociation collective. Il prévoit que le marché du travail doit être règlementé par des conventions collectives, plutôt que par la Loi. L’État ne peut s’immiscer dans les négociations des partenaires sociaux. Les conventions collectives permettent d’assurer la paix sociale car les grèves et lock-out ne sont autorisés que lorsque celles-ci arrivent à échéance.
1. Les effets ambivalents de l’égalité salariale
A. Des effets globalement positifs jusqu’à la fin des années 1960
Dans les années 1950, la solidarité salariale consistait à réduire les différences de revenus entre salariés ayant un même niveau d’éducation et d’expérience, quel que soit leur secteur d’activité. Autrement dit : « à travail égal, salaire égal ». Cet égalitarisme s’accompagnait d’une modération, en moyenne, des revendications salariales pour protéger la compétitivité des entreprises exportatrices. Les revenus étant homogènes d’une entreprise à l’autre, le sentiment d’injustice était relativement absent38. La demande d’augmentation salariale était faible et les entreprises prospères, celles-ci pouvant donc dégager des marges confortables. Dans le même temps, l’absence de modulation fragilisait les entreprises les moins rentables. La loi du marché éliminait ainsi les entreprises les moins compétitives et accélérait la migration du capital et du travail vers les activités à forte productivité. Concrètement, cela s’est traduit par la concentration des parts de marché autour des grandes entreprises familiales.
Les effets bénéfiques de ce régime ont été constatés à de multiples reprises (cf. Hibbs et Locking, 2000). Des années 1950 à 1960, cette politique centralisée de modération a offert à la Suède un taux d’inflation inférieur à la moyenne des pays développés, lui permettant de préserver sa compétitivité par rapport à ses voisins39. Elle a en outre participé à la construction d’une société peu clivée40 (cf. encadré 5). Encore aujourd’hui, l’écart entre les plus hauts et les plus bas revenus est bien moindre en Suède qu’aux États-Unis ou dans d’autres pays européens, comme le montre le tableau 7.
Selon le Parlement européen (1997), au début des années 1980, l’écart entre le premier et le dernier déciles des salaires industriels était de 34 % en Suède, contre 210 % au Royaume-Uni et 490 % aux États-Unis. Selon Freeman et al. (1997), la Suède a réussi à cette époque à combiner un des plus hauts niveaux de vie du monde avec un des niveaux d’inégalité salariale les plus bas parmi les pays développés. Incidemment, ce fonctionnement particulier a immortalisé pour beaucoup d’observateurs étrangers l’attrayant succès du capitalisme suédois.
Encadré 5 – LA SUÈDE ET L’ÉGALITARISME
La société suédoise est attachée à un égalitarisme entre les sexes, entre les revenus et entre les différentes classes sociales. La politique d’égalité salariale a participé à sa traduction dans les faits ; mais d’autres facteurs y ont également contribué, comme la diffusion de la « Loi de Jante » ( Jantelagen ). Il s’agit d’une formulation, restée célèbre, de valeurs anciennes souvent associées à l’éthique protestante. La loi de Jante est issue d’un roman du Dano-Norvégien Aksel Sandemose (1933), caricaturant les règles culturelles de son village du Jutland, caractéristiques de la culture scandinave. Cet ensemble de règles de conduite impose à l’individu de ne pas se mettre en avant, de ne pas se croire meilleur que le collectif, de contribuer au bien commun. Le fait qu’un individu affirme sa supériorité par rapport aux autres est interprété comme un rejet du groupe. L’attitude correcte consiste au contraire à minimiser son importance individuelle. L’égalitarisme très poussé en Suède se retrouve au travers de nombreux exemples, allant de l’humilité de la famille royale ou des personnalités politiques à l’absence du vouvoiement dans les entreprises.
Tableau 7 – Evolution du degré d’inégalité dans différents pays des années 1970 aux années 2000 (indice de Gini* après impôts et transferts)
Source : OCDE.
* L’indice de Gini mesure le degré d’inégalité de la distribution des revenus dans une société donnée. Son résultat varie de 0 à 1 où 0 signifie l’égalité parfaite (même revenu pour tous) et 1 signifie l’inégalité totale (une personne détient tout le revenu).
B. La radicalisation de la politique de solidarité salariale et son essoufflement
À la fin des années 1960, la politique de solidarité salariale s’est radicalisée. Le principe directeur n’était plus « à travail égal, salaire égal » mais « même salaire pour tous ». Autrement dit, il ne s’agissait plus seulement de rapprocher les salaires entre entreprises mais également au sein des entreprises, toutes fonctions et qualifications confondues. Cette mutation s’est faite sous la pression du syndicat LO, qui a réussi à imposer son point de vue dans les négociations centralisées avec les employeurs.
Pour les avocats de cette approche, un système où les écarts de rémunération entre « cols blancs » et « cols bleus » sont comprimés crée un sentiment de justice pour les ouvriers, une cohésion de la main d’œuvre tous statuts confondus, et finalement une meilleure productivité de l’entreprise. En réalité, c’est l’effet contraire qui a été obtenu : cette tendance a induit une démotivation des salariés, dont les perspectives de revenu étaient de plus en plus indépendantes du statut et de l’efficacité au travail. Salaire et productivité se sont peu à peu déconnectés. De plus, la hausse des salaires des ouvriers a entrainé l’augmentation des coûts de production pour les entreprises, donc une détérioration de la rentabilité et de la compétitivité et, à plus long-terme, une fragilisation de l’économie. Face à l’augmentation des coûts de production, le gouvernement a procédé à une série de dévaluations dans les années 1970-1980, dont les effets bénéfiques n’étaient que temporaires.
Ce resserrement des revenus dans les années 1970 a par ailleurs contribué à dissuader les jeunes de poursuivre des études longues, celles-ci ne représentant plus la promesse d’un avantage économique. Il en a résulté une certaine détérioration de la qualité de la main d’œuvre dans les années 1980 et 199041. Ce système a également favorisé le chômage ou l’inactivité des populations les moins productives (les personnes âgées, les travailleurs handicapés et les jeunes les moins expérimentés42) puisque, à salaire égal, les entreprises préfèreraient recruter les personnes au potentiel de productivité le plus fort.
Graphique 15 – Croissance globale de la production industrielle et de la productivité du travail* entre 1961 et 1993
In Hibbs et Locking, 2000.
* Représentée par le log de la production industrielle et de la productivité du travail.
In fine, sur toute la période allant de 1950 à 1980, Hibbs et Locking (op.cit.) jugent que cette politique de négociation centralisée aura eu un bilan global neutre sur la productivité, au regard des économies étrangères. Ils montrent en effet que la production et la productivité ont d’abord été impactées positivement par le nivellement salarial dans les années 1950-1960 (plus précisément, que les effets positifs l’emportaient alors sur les effets négatifs) puis négativement dans les années 1970 (les effets négatifs devenant dominants) (cf. graphique 15).
C. La remise en cause des négociations centralisées dans les années 1970
En 1969, une série de grèves sauvages massives dans les mines de fer du nord de la Suède (Kirunavont) ont marqué l’entrée en crise du système de régulation centralisée des salaires. Ces grèves exceptionnelles constituaient une grave remise en cause du syndicat ouvrier LO et du parti social-démocrate par une partie de la classe ouvrière. En 1970, les syndicats ouvriers ont commencé à exiger des salaires plus élevés dans les négociations nationales, des dépenses publiques plus importantes et des mesures fiscales plus redistributives, ces exigences ne s’accordant plus avec la vision du patronat (SAF). Surtout, une proposition de créer des fonds salariaux a violemment opposé les parties en présence. Les organisations syndicales ont en effet proposé qu’une partie des bénéfices des entreprises soit versée à des fonds centraux gérés par les syndicats, afin que les salariés puissent détenir collectivement des parts de leur capital. Ces fonds ont été perçus par le patronat comme une nationalisation masquée et donc comme une violation des accords de Saltsjöbaden. De cette période est restée une certaine méfiance entre les parties prenantes, les syndicats ayant perdu une partie de la confiance des ouvriers et du patronat.
En outre, la forte augmentation des emplois publics, à cette époque, a contribué à déséquilibrer une structure syndicale auparavant unifiée et disciplinée. À la fin des années 1970, une ligne de fracture nouvelle opposait, d’une part, les syndicats de salariés des industries exportatrices, toujours sensibles à l’enjeu de compétitivité à l’export et donc enclins à la modération salariale et, d’autre part, les syndicats des employés du secteur public aspirant plus ouvertement à des augmentations de salaires. L’absence de consensus entre les syndicats d’employés a abouti à l’effondrement du cadre centralisé des négociations salariales interprofessionnelles. À partir de 1982, les accords nationaux ont progressivement perdu tout pouvoir normatif, devenant de simples recommandations ; en 1990, la SAF a formellement dissout sa cellule de négociation.
2. Le dialogue social aujourd’hui : décentralisation et consensus autour du maintien de la compétitivité de l’industrie
Comme on l’a vu, le conflit et les tensions entre acteurs économiques, politiques et sociaux ne sont pas absents de la vie économique suédoise. Ce qui frappe, en revanche, c’est le pouvoir et la légitimité des partenaires sociaux en Suède, leur aptitude à traduire le résultat des négociations en normes et règles.
A. La décentralisation de la négociation collective
Le pouvoir des syndicats dans le système de relations professionnelles est une constante de la société suédoise. Stable depuis les années 1970, le taux de syndicalisation est de 83 %, l’un des plus hauts d’Europe. La force des syndicats repose sur l’engagement et la confiance de leurs membres43.
Il existe trois confédérations syndicales, chacune représentant une catégorie socio-professionnelle : Landsorganisationen i Sverige (LO, ouvrier), Tjanstemannens Centralorganisation (TCO, employés et cadres) et Sveriges Akademiker Centralorganisation (SACO, diplômés) ce qui présente l’avantage d’éviter la concurrence intersyndicale44.
Selon l’Inspection générale des affaires sociales (2004)45, le pouvoir accordé aux syndicats renforce leur attractivité et leur légitimité. Il s’exerce en matière de représentation des salariés au sein de l’entreprise (il n’existe pas de comités d’entreprises), en matière de décisions individuelles (leur avis est déterminant sur des questions telles que le recrutement ou le licenciement46), en matière de négociation sur les salaires ou encore de gestion des caisses d’allocations chômage47.
Après les accords de 1938, la loi de 1976 sur la codétermination a affirmé la place de la négociation collective sur tous les sujets importants liés à la sphère du travail, notamment les conditions et le temps de travail et les rémunérations. La Suède ne dispose pas de salaire minimum fixé au niveau de l’État. Au contraire, la politique salariale est du ressort des partenaires sociaux, qui négocient les niveaux de salaires et un éventuel salaire minimum (IGAS, op.cit.). Les grèves ne sont pas autorisées avant que les conventions collectives ne soient arrivées à échéance.
À partir de 1970, les négociations ont basculé sur un mode décentralisé qui est la règle aujourd’hui, à la fois au niveau des branches et des entreprises, ce qui permet aux parties prenantes de s’adapter aux besoins et contraintes de chacune d’elles, jusqu’à l’adaptation des rémunérations en fonction des résultats des salariés (IGAS, op.cit.).
B. L’Industriavtalet de 1997, un accord des partenaires sociaux autour du maintien de la compétitivité de l’industrie
L’accord Industriavtalet a été signé en 1997 par 17 fédérations syndicales et patronales représentant les différentes branches de l’industrie (secteurs manufacturier, minier, sylvicole et agricole). Il est le résultat d’un appel du gouvernement suédois aux partenaires sociaux, lancé en 1995, à maîtriser les salaires pour maintenir la compétitivité de l’économie. En 1996, les syndicats de l’industrie affiliés à LO se sont emparés du sujet et ont réclamé une négociation avec le patronat48.
L’Industriavtalet porte sur la limitation des grèves et des lock-out et le maintien d’un niveau de salaires compatible avec la compétitivité des entreprises exportatrices. Il introduit une règle interprofessionnelle sur la négociation salariale : les négociations doivent d’abord avoir lieu dans les branches des industries les plus exposées à la compétition internationale, servant ainsi de référence aux branches non exposées. Il ne prévoit pas d’objectifs en termes d’augmentation salariale (on a d’ailleurs vu au chapitre précédent que ni le niveau ni la progression des salaires n’avaient fléchi dans l’industrie), mais établit des procédures acceptées de tous (cf. encadré 6). Il introduit aussi des règles de procédure en matière de négociation collective. Les négociations des nouvelles conventions collectives doivent intervenir trois mois avant l’échéance de celles en vigueur, un médiateur impartial intervenant si aucun accord n’a été trouvé un mois avant cette échéance.
Encadré 6 – Un consensus entre partenaires sociaux pour protéger les entreprises exportatrices
« À mesure que la Suède a évolué progressivement vers un dispositif plus décentralisé de détermination des salaires, ce nouveau cadre (l’ Industriavtalet ) a conforté le consensus entre les partenaires sociaux à propos des conditions et de la discipline nécessaires pour instaurer à la fois une inflation modérée et une croissance durable des salaires réels. Cet accord commence par souligner que la compétitivité internationale des entreprises du secteur manufacturier est une condition importante pour assurer une amélioration constante du niveau de vie et de l’emploi. »
In OCDE, 2007.
Conclusion
Les cadres institutionnels de négociation collective, à la fois nécessaires à l’émergence d’un modèle suédois et ayant largement contribué à sa popularité voire à son idéalisation à l’étranger, ont été formalisés au XXe siècle, grâce à des accords fondateurs tels que celui de 1938.
Le pouvoir et la légitimité des partenaires sociaux n’ont pas été démentis depuis lors, bien que des réajustements aient eu lieu en fonction des modifications du rapport de force entre acteurs et de la situation économique du pays. Leur rôle s’est même renforcé au fil du temps, avec des lois comme celle portant sur la codétermination (1976).
La chronologie du dialogue social en Suède montre à quel point les syndicats ont joué un rôle-clé dans la compétitivité de l’économie. La politique d’égalité salariale proposée par Rehn et Meidner a d’abord permis un accroissement de la compétitivité des entreprises, avant que sa radicalisation ne produise des effets contre-productifs. Néanmoins, presque quarante ans plus tard, et malgré une décentralisation très aboutie de la négociation collective, l’accord Industriavtalet (1997) a institutionnalisé le consensus des partenaires sociaux autour de cet impératif de maintien d’un niveau de salaire compatible avec la compétitivité des entreprises. La Suède demeure un pays où les disparités des revenus sont les moins fortes, relativement aux États-Unis, à la France ou à l’Allemagne.
Les bons résultats de la Suède en matière de taux de chômage, de taux d’emploi ou encore de taux de chômage de longue durée sont trois des principales raisons pour lesquelles les observateurs internationaux accordent à sa politique de l’emploi une efficacité supérieure à celle de beaucoup d’autres pays. D’ailleurs, ces performances sont à rapprocher de celles de ses voisins danois et finlandais, au point que certains évoquent l’existence d’un modèle nordique d’organisation du marché du travail (Lefebvre et Méda, 2008). Ces trois pays ont en commun de mettre un accent prioritaire sur les politiques actives de l’emploi, c’est-à-dire les programmes et services qui assurent le retour à l’emploi (formation, accompagnement personnalisé, aide à la création d’entreprise, contrats aidés…), qui complètent, tout en s’en distinguant, les politiques dites passives, désignant les aides financières versées aux demandeurs d’emploi.
En Suède, la logique d’activation du marché de l’emploi est la plus ancienne : elle a traversé les décennies depuis le début du XXe siècle et était un des piliers du modèle Rehn-Meidner. Elle fait d’ailleurs système avec une stratégie globale d’investissement dans le capital humain, avec des partenaires sociaux puissants qui veillent à sécuriser les trajectoires professionnelles des individus tout en assurant la flexibilité nécessaire aux entreprises.
Jusqu’en 1990, le taux de chômage s’est maintenu aux environs de 2 %, quand celui de la moyenne des pays industrialisés était de l’ordre de 6 %. Dans les années 1990, la crise économique et le renversement des priorités macroéconomiques (quand la maîtrise de l’inflation a pris l’ascendant sur celle du chômage) ont mis fin à cette longue période de plein-emploi. Les finalités et les instruments de la politique de l’emploi ont donc été revus, sans remettre en question son objectif principal d’activation. Aujourd’hui, les logiques de responsabilisation des chômeurs et d’individualisation de l’accompagnement ont gagné en importance.
- 36 – La confédération patronale SAF a fusionné avec la fédération de l’industrie en 2001 donnant ainsi naissance à une nouvelle confédération nommée Svenskt Näringliv (SN).
- 37 – Le modèle de plein-emploi inspiré de la théorie keynésienne génère un risque inflationniste du fait de l’augmentation de la consommation des agents économiques, qui excède les capacités de production des entreprises, tandis que la hausse des taux d’intérêt liée aux anticipations d’inflation limite l’investissement, donc l’ajustement de leurs capacités à la demande.
- 38 – Vidal, op.cit.
- 39 – Vidal, op.cit.
- 40 – Simoulin, op.cit.
- 41 – Grjebjne, 1999.
- 42 – Groulx, 1989.
- 43 – Sture Nordh, « den Svenska Modellen » (Le modèle suédois), note du TCO.
- 44 – TCO et SACO ne sont liés à aucun parti politique contrairement à LO.
- 45 – Ce rapport propose un point détaillé sur les principales caractéristiques du système suédois de relations professionnelles et sur son financement.
- 46 – Les entreprises peuvent licencier pour motif économique sans plan social. La négociation avec les syndicats est en revanche obligatoire, notamment pour choisir les employés à licencier. La règle qui s’applique par défaut en Suède est que le dernier arrivé est le premier à quitter l’entreprise (Huteau et Larraufie, 2009).
- 47 – Les caisses d’allocations chômage sont rattachées aux organisations syndicales. L’affiliation n’est pas obligatoire.
- 48 – Ahlberg et Bruun, 2005.
Une logique d’activation de la politique de l’emploi à l’efficacité reconnue
Les bons résultats de la Suède en matière de taux de chômage, de taux d’emploi ou encore de taux de chômage de longue durée sont trois des principales raisons pour lesquelles les observateurs internationaux accordent à sa politique de l’emploi une efficacité supérieure à celle de beaucoup d’autres pays. D’ailleurs, ces performances sont à rapprocher de celles de ses voisins danois et finlandais, au point que certains évoquent l’existence d’un modèle nordique d’organisation du marché du travail (Lefebvre et Méda, 2008). Ces trois pays ont en commun de mettre un accent prioritaire sur les politiques actives de l’emploi, c’est-à-dire les programmes et services qui assurent le retour à l’emploi (formation, accompagnement personnalisé, aide à la création d’entreprise, contrats aidés…), qui complètent, tout en s’en distinguant, les politiques dites passives, désignant les aides financières versées aux demandeurs d’emploi.
En Suède, la logique d’activation du marché de l’emploi est la plus ancienne : elle a traversé les décennies depuis le début du XXe siècle et était un des piliers du modèle Rehn-Meidner. Elle fait d’ailleurs système avec une stratégie globale d’investissement dans le capital humain, avec des partenaires sociaux puissants qui veillent à sécuriser les trajectoires professionnelles des individus tout en assurant la flexibilité nécessaire aux entreprises.
Jusqu’en 1990, le taux de chômage s’est maintenu aux environs de 2 %, quand celui de la moyenne des pays industrialisés était de l’ordre de 6 %. Dans les années 1990, la crise économique et le renversement des priorités macroéconomiques (quand la maîtrise de l’inflation a pris l’ascendant sur celle du chômage) ont mis fin à cette longue période de plein-emploi. Les finalités et les instruments de la politique de l’emploi ont donc été revus, sans remettre en question son objectif principal d’activation. Aujourd’hui, les logiques de responsabilisation des chômeurs et d’individualisation de l’accompagnement ont gagné en importance.
1. La politique active de l’emploi, pilier du modèle Rehn-Meidner
Le modèle Rehn-Meidner reposait, on l’a vu, sur un accompagnement à marche forcée de toute l’économie productive vers les segments et les entreprises à forte compétitivité. Si la faillite des firmes les moins productives était explicitement prévue, cette approche « darwinienne » était accompagnée d’une politique active de l’emploi, afin d’accompagner les mutations de l’économie suédoise : il s’agissait de procurer de la main d’œuvre aux entreprises dynamiques qui recrutaient et de reclasser les salariés licenciés des entreprises les moins performantes. En conséquence, entre 1950 et 1970, la politique de l’emploi était tournée vers des actions stimulant l’offre de travail. Plus précisément, les politiques actives mises en œuvre à l’époque alliaient « (…) formations, aides à la mobilité, aides à la création d’emplois dans les entreprises, travaux d’intérêt général, recrutements dans la fonction publique » (Vidal, 2010, p.6).
En 1970, les politiques actives représentaient, en termes de dépenses, 90 % de l’ensemble des politiques de l’emploi49. Les personnes qui perdaient leur emploi étaient prises en charge par une agence locale. Les mesures d’accompagnement à la mobilité, professionnelle et géographique, étaient au cœur de l’action des agences.
Qui plus est, l’État était employeur en dernier ressort, ce qui explique que le nombre de fonctionnaires ait très largement augmenté entre 1960 et 1990, notamment dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Rosen (1997) signale même que, entre 1963 et 1992, la quasi-totalité de l’augmentation de l’emploi en Suède a concerné l’emploi des femmes dans les services publics territoriaux. Davis et Henrekson (op.cit.) relèvent a contrario que l’emploi privé n’a pas augmenté entre 1950 et 1990. Par voie de conséquence, le nombre de fonctionnaires est passé de 25,8 % à 38,2 % de l’emploi total entre 1970 et 1985 (Coulet, 2007), augmentation dont on a dit plus tard qu’elle avait joué dans la perte de compétitivité globale de l’économie (Vidal, 2010, p.9).
Au tournant des années 1970, la santé de l’économie s’est détériorée et les entreprises suédoises ont subi des pertes de parts de marché à l’international. La politique de l’emploi, sans renoncer à son objectif prioritaire de plein-emploi, s’est alors tournée vers la demande de travail. Ont ainsi été développées à cette époque des incitations financières, sous forme de subventions, encourageant les employeurs à produire, même au-delà de la demande, et à prendre en charge le perfectionnement ou le reclassement des salariés à l’intérieur de l’entreprise. Jusqu’en 1980, le chômage est resté quasiment inexistant. Entre 1974 et 1976 une série de mesures de protection de l’emploi ont été votées par le Parlement, sous la pression des syndicats, telles que la loi de 1974 visant à promouvoir l’embauche des travailleurs désavantagés (personnes handicapées, jeunes et personnes âgées), la loi de 1976 sur la représentation des syndicats aux conseils d’administration des entreprises et la loi, également de 1976, sur la codétermination. Cette dernière reconnait au syndicat local le droit à l’information et à la négociation sur la détermination des conditions de travail, allant jusqu’à un droit de véto sur les changements introduits par la direction50. Le législateur a également imposé des conditions plus strictes aux employeurs en cas de réduction du personnel ou de fermeture d’usines (période de notification, primes de dédommagement et priorité au réengagement des employés mis à pied).
Une nouvelle réorientation de la politique de l’emploi a été engagée au début des années 1980, basculant de nouveau vers une stratégie de l’offre de travail : diminution du recours aux subventions aux employeurs, développement des programmes orientés vers des populations cibles, augmentation du personnel et de l’équipement des agences locales de l’emploi. Trois mesures spéciales ont ainsi été adoptées dans la décennie 1980 concernant l’éducation et la formation des jeunes.
« Opportunités jeunesse », introduite en 1982, vise à réduire le chômage des jeunes de 16 et 17 ans. Elle leur ouvre de places réservées dans les secteurs privé et public et renforce les dispositifs d’éducation et de formation s’adressant à cette tranche d’âge. « Équipes de jeunes » a été introduite en janvier 1984. Cette loi, qui entend remplacer le droit à des indemnités de chômage par le droit à l’emploi, oblige les municipalités à procurer aux jeunes de 18 et 19 ans un emploi d’utilité collective de quatre heures par jour. La troisième mesure, instituée en 1984, porte sur les aides au recrutement. S’adressant principalement aux jeunes et aux chômeurs de longue durée, elle prévoit le versement de subventions à l’emploi totalisant la moitié des salaires durant six mois.
Toutes ces politiques actives de l’emploi ont entrainé une croissance importante des dépenses publiques dans les années 1970 et 1980, compte tenu du nombre élevé de programmes et de l’augmentation du nombre d’emplois publics. Au cours des années 1980, il était de plus en plus difficile de contenir la hausse des salaires et des prix dans l’économie. En 1991, la Suède s’est engagée à ne plus dévaluer sa monnaie et a décidé de lier la couronne suédoise au Système monétaire européen (SME). Cette décision a fait passer l’objectif de plein-emploi au second plan, derrière la lutte contre l’inflation (cf.encadré 7), concordant avec la fin du quasi plein-emploi en Suède. Pour autant, la composante active de la politique de l’emploi est demeurée importante.
Encadré 7 – Le changement de cap de la politique macroéconomique
Dès le milieu des années 1980, le gouvernement avait déjà tenté de réduire ses dépenses en diminuant les effectifs du secteur public. Il avait également entamé une libéralisation des services publics, en premier lieu du transport ferroviaire. En 1991, il a réorienté sa politique macroéconomique et a relégué au second rang l’objectif de plein-emploi. À cette date en effet, la Suède a pris la résolution de ne plus dévaluer sa monnaie et de lier la couronne suédoise au SME. Par cet acte, le gouvernement a fait de la lutte contre l’inflation son principal objectif de politique économique, dix à quinze ans après la plupart des autres pays développés (Lindvall, 2006). Cette réorientation est survenue alors que la récession débutait dans le pays. Par ailleurs, le Système monétaire européen est entré en crise en 199251 . La Suède est alors revenue sur sa décision : elle a dévalué la couronne suédoise une dernière fois en 1992, rétablissant ses performances à l’exportation. Depuis, elle a laissé flotter sa monnaie et, selon une politique dite de ciblage d’inflation, s’est fixé un objectif de hausse des prix (+ 2 %) en fonction duquel la Banque centrale adapte son taux d’intérêt.
2. Vers une responsabilisation des chômeurs, ou « l’activation des dépenses passives »
Entre 1990 et 1994, le taux de chômage est passé de 1,7 % à 9,4 % (cf. graphique 16), conséquence de la propagation à l’économie réelle de la crise bancaire et de la réduction des emplois publics, déjà amorcée, pour réduire le poids des dépenses publiques.
Des programmes ciblés vers les populations connaissant des difficultés pour s’insérer sur le marché du travail ont continué à être mis en place. Le gouvernement a incité les communes à s’impliquer dans la lutte contre le chômage de longue durée et à rapprocher l’aide sociale, dont elles avaient la charge, de la politique de l’emploi. Cette décision a entériné le principe d’une décentralisation des politiques de l’emploi vers le niveau communal. Le réseau d’agences locales de l’emploi n’a cessé de se développer ; Huteau et Larraufie (2009) en dénombrent aujourd’hui au moins une par commune (325). Elles dépendaient auparavant d’agences régionales qui ont fusionné au 1er janvier 2008, pour laisser place à une agence nationale de l’emploi. Celle-ci fournit aux agences locales une dotation pour le personnel et les locaux et finance les programmes de la politique de l’emploi. Son offre de services, outre les agences locales, passe également par les centres d’appels et par Internet.
Le nombre important de chômeurs dans les années 1990 a également entraîné une réorientation de la politique passive de l’emploi, en vue d’une plus grande responsabilisation du demandeur d’emploi. On parle « d’activation des dépenses passives ». Les conditions d’accès aux allocations chômages se sont durcies (allongement de 6 à 12 mois de la période de cotisation ouvrant droit à l’allocation) et leur montant s’est réduit (de 90 % à 80 % du salaire brut en 1993, puis à 75 % en 1997). Un accent prioritaire a alors été porté sur la nécessité d’élever le taux d’activité, pour financer les politiques sociales sans compromettre la situation des finances publiques (Coulet, 2007).
Dans les années 2000, la politique passive est entièrement devenue un outil de responsabilisation du demandeur d’emploi. En 2000, a été instauré un plan d’action individuel, définissant la trajectoire de retour à l’emploi du chômeur et cernant le secteur d’activité et la zone géographique concernés par sa recherche. Celui-ci énumère les droits et obligations du demandeur d’emploi et instaure une relation contractuelle avec le service public de l’emploi, individualisant le suivi des chômeurs. En 2001, la dégressivité des allocations, en cas de refus d’un « emploi convenable » ou de participer à un programme de formation, est venue renforcer cette logique de responsabilisation. Les allocations sont réduites de 25 % en cas de premier refus, de 50 % en cas de deuxième refus et supprimées en cas de troisième refus. L’allocation-chômage n’est donc plus seulement un moyen d’assurer un revenu de remplacement au cours de la période d’inactivité mais elle devient un élément à part entière de la politique d’activation (Coulet, op.cit.). En 2000, le programme « garantie d’activité » a été instauré, à destination des chômeurs inscrits depuis plus de 24 mois : ceux-ci bénéficient, sans limite de durée, de contacts plus réguliers avec un agent et sont dans l’obligation de construire un projet professionnel ouvrant l’accès à des formations.
En 2006, est arrivé au pouvoir un gouvernement de centre-droit, désireux de mener une politique de « retour au travail ». Laurent Clavel (2010) indique que celle-ci a porté sur une réduction d’impôts et des charges sur les salaires, sur la réduction de l’indemnisation du chômage et sur la lutte contre les fraudes et la passivité dans la recherche d’emploi. Le programme « garantie d’activité » a été remplacé par le programme « garantie emploi et développement », ouvert dès 12 mois de chômage consécutifs. Les allocations chômage sont devenus dégressives : elles s’élèvent à 80 % du salaire moyen de référence sur les douze derniers mois pendant 200 jours, à 70 % jusqu’au 300e jour et à 65 % à partir du 301e jour. La durée totale de l’indemnisation est fixée à 630 jours (Coulet, op.cit.).
Graphique 16 – Evolution du chômage en Suède et dans l’OCDE
Source : OCDE.
3. Une politique de l’emploi coûteuse mais performante aux yeux de l’OCDE, notamment grâce à l’investissement dans la formation
L’OCDE (2006) distingue deux modèles performants de politique de l’emploi : le modèle libéral, à l’image du système britannique, et le modèle nordique. « Il y a eu deux types de politiques réussies ces dernières années. L’une repose sur la concurrence sur le marché des produits, de faibles niveaux d’allocations, une faible protection de l’emploi. Le résultat est un haut taux d’emploi, un faible coût public, un haut taux de travailleurs pauvres. L’autre repose sur la négociation et un dialogue social forts, des allocations généreuses, des politiques actives et un strict contrôle de la recherche d’emploi. Elle produit de hauts taux d’emploi, de faibles taux de travailleurs pauvres, et a un coût budgétaire élevé. [Le] modèle nordique apparaît comme celui qui est à la fois efficace et équitable. »
En Suède, le taux d’emploi dépasse nettement la barre des 70 % depuis plus de 10 ans. C’était l’un des objectifs de la stratégie de Lisbonne, atteint également par le Danemark et, depuis peu, l’Allemagne (cf.tableau 8). Lefebvre et Méda (2008) notent que ce taux d’emploi s’observe « malgré des mesures de protection de l’emploi très rigoureuses en Suède, et une législation sur les licenciements économiques plus contraignante qu’en France » (p.134).
Tableau 8 – Taux d’emploi (en % de la population en âge de travailler de 15 à 64 ans)
Source : Eurostat.
En termes de taux de chômage, la Suède suit quasiment la même tendance que l’OCDE depuis le début des années 2000. En revanche, elle reste au-dessous de la moyenne de l’UE 17 (cf. tableau 9).
Tableau 9 – Taux de chômage (en %, moyenne annuelle)
Source : Eurostat.
La Suède est aujourd’hui confrontée au problème du chômage des jeunes, à peu près dans les mêmes proportions que la France (environ 20 à 25 %). Toutefois, il y est de plus courte durée : seulement 10 % des jeunes connaissent une période de chômage de plus d’un an en Suède, contre 28 % en France. De manière générale, le taux de chômage de longue durée est plus faible qu’en France ou que dans la moyenne des pays de l’OCDE (cf.graphique 17). Il est très probable que l’activation des dépenses pour l’emploi et les conditions associées au versement des allocations chômage produisent des effets sur la rapidité avec laquelle les personnes sortent du chômage.
Graphique 17 – Chômage longue durée (en % du chômage total)
Source : Eurostat. Rupture de série en 2005 et 2006 pour la Suède.
Depuis les années 2000, le primat est donné à la sortie rapide vers l’emploi, au détriment de la formation, ce que révèle l’évolution des dépenses consacrées aux différentes « politiques en faveur du marché du travail »52. Avant cette période, la formation des demandeurs d’emploi représentait 1,3 % du PIB suédois en 1999, contre 0,7 % au Danemark, 0,5 % en Allemagne, 0,4 % en France et 0,3 % dans l’UE 15. En 2009, ces mêmes dépenses de formation professionnelle pèsent seulement 0,06 % du PIB en Suède, contre 0,2 % au Danemark, 0,3 % en Allemagne, 0,4 % en France et 0,2 % dans l’UE 15 (Eurostat).
Ce désinvestissement en matière de formation résulte de la priorité donnée aux incitations à la reprise rapide d’emploi (aide à la mobilité géographique, contrôle des chômeurs, suivi individualisé), notamment depuis le changement de majorité gouvernementale en 2006, ainsi qu’aux politiques de défiscalisation visant à créer des emplois peu qualifiés, en particulier dans le secteur des services à la personne.
Il n’en reste pas moins, selon Lefebvre et Méda (op.cit.), que l’importance accordée par tous les acteurs économiques suédois à l’investissement dans le capital humain, c’est-à-dire dans l’éducation et dans la formation, est un facteur décisif, à la fois du fonctionnement du marché du travail, de l’efficacité des politiques de l’emploi et de la compétitivité des entreprises (cf. encadré 8).
Encadré 8 – L’investissement en capital humain au cœur de la compétitivité des entreprises et de l’économie
« Les différentes formes de flexibilité mobilisées dans le système productif nordique, liées à des institutions et des politiques qui assurent une recherche d’emploi sereine et incitent au retour rapide à l’emploi grâce à un accompagnement individualisé ne suffisent pas, selon nous, à rendre compte des performances nordiques en matière d’emploi. Nous formons l’hypothèse que ces différentes politiques ne peuvent pleinement développer leurs effets que dans un contexte qui valorise en permanence la qualification de la main-d’œuvre parce que seule celle-ci est susceptible d’accompagner le processus de montée en gamme permettant aux entreprises de conserver une avance technologique et de développer des produits à forte valeur ajoutée, moins sensibles à la concurrence des pays à bas salaires. L’investissement dans la qualification de la main-d’œuvre à toutes les étapes du cycle de vie permet non seulement aux entreprises de s’adapter aux évolutions de la division internationale du travail mais aussi aux salariés de trouver ou retrouver rapidement un emploi, d’autant qu’un grand soin est également apporté à la qualité des appariements grâce à l’intervention des partenaires sociaux dans les différentes institutions concernées par les transitions. Dans un monde où le risque principal est devenu celui de ne pas disposer d’un niveau minimal de qualification, la stratégie consistant à faire en sorte que le plus de personnes possible accèdent à ce niveau constitue un facteur essentiel de réussite. »
In Lefebvre et Méda, 2008, p. 136.
L’importance de la formation tout au long de la vie en est un témoignage. Celle-ci se déroule de façon formelle, informelle ou non formelle à chaque étape de la vie : périodes d’études, d’inactivité, d’activité productive ou encore de chômage. En 2010, 25 % des Suédois de 25 à 64 ans ont indiqué avoir suivi un enseignement ou une formation au cours des 4 semaines précédentes, proportion très largement supérieure aux 9 % observés dans la moyenne des pays européens et aux 5 % relevés en France (enquête communautaire sur les forces de travail, cf. tableau 10).
Tableau 10 – Formation permanente (en % de la population totale âgée de 25 à 64 ans)*
Source : Eurostat.
* La formation permanente fait référence aux personnes âgées de 25 à 64 ans qui ont répondu avoir suivi un enseignement ou une formation au cours des quatre semaines précédant l’enquête. Les informations collectées concernent toutes les formes d’enseignement ou de formation, qu’elles soient ou non pertinentes pour l’emploi actuel ou futur du répondant.
En 2011, 24 % de la population suédoise en âge de travailler s’était arrêtée à la fin de la scolarité obligatoire, contre 30 % en Europe53. Symétriquement, 30 % avait réalisé des études supérieures, contre 24 % en Europe. La Suède dépasse ainsi l’UE 27, la France et l’Allemagne concernant la proportion de population ayant accompli des études supérieures (cf.tableau 11).
Tableau 11 – Population âgée de 25 à 64 ans par niveau d’éducation (en %)
Source : Eurostat.
Le système d’éducation et de formation suédois repose sur la scolarité obligatoire de 7 à 16 ans, le second cycle du secondaire, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle initiale pour les jeunes jusqu’à 19 ans et la formation pour adultes. Ce système est organisé différemment du cadre français (cf. schéma 1 et Cedefop, 2009). La formation pour adultes, dont l’offre est développée et diversifiée, s’appuie sur une longue tradition remontant au XIXe siècle, avec les mouvements d’éducation populaire. L’enseignement et la formation sont financés par les communes, les entreprises et l’État.
Schéma 1 – Fonctionnement du système éducatif et de formation suédois
In Cedefop, 2009, p. 27.
Conclusion
Depuis les années 1950, la Suède a adapté les finalités et les instruments de sa politique de l’emploi aux changements de rythme économiques et politiques, tout en conservant un attachement prioritaire aux politiques actives. Partie d’un dispositif adapté à un objectif de plein-emploi, elle a accentué depuis les années 1990 l’individualisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi, leur responsabilisation, l’incitation au retour à l’emploi, la décentralisation des agences pour l’emploi, tout en maintenant un taux de remplacement net sur la première année de chômage assez proche de la médiane de l’UE 15 (61 % en Suède contre 65 % pour l’UE 1554).
L’organisation du marché du travail suédois répond aux réflexions en cours en Europe sur la « flexicurité », principe qui cherche à concilier le besoin de flexibilité des entreprises et la demande de sécurité des salariés. De façon plus générale, les pays d’Europe du nord et en particulier le Danemark sont souvent pris pour exemples en la matière. En réalité, il n’existe pas un mais plusieurs modèles de flexicurité, qui combinent des pratiques dans différents domaines : le régime d’assurance-chômage, la négociation collective, la protection de l’emploi, le système de formation initiale et continue, les possibilités de concilier vie personnelle et professionnelle, l’accompagnement des demandeurs d’emploi, l’utilisation des dépenses pour l’emploi55… Ainsi par exemple, le régime suédois reste pour le moment sensiblement moins flexible que le système danois (Lefebvre et Méda, op.cit.).
Au-delà de ces distinctions, il convient de retenir que l’efficacité des mesures adoptées en Suède est indissociable de l’importance de l’investissement dans le capital humain, à toutes les étapes de la vie. Cette logique d’éducation permanente s’avère bénéfique à la compétitivité des entreprises comme à la construction des trajectoires professionnelles des individus.
- 49 – Les politiques actives en 2011 représentent 48 % du total des dépenses pour l’emploi en Suède et 32 %, en France (Eurostat).
- 50 – Ce droit de véto peut toutefois être contesté par l’employeur devant les tribunaux.
- 51 – Le taux d’intérêt de la banque centrale d’Allemagne a été relevé suite à la réunification du pays, entraînant la crise du SME (Vidal, op.cit. , p.18).
- 52 – Eurostat définit les « politiques en faveur du marché du travail » comme « les interventions publiques sur le marché du travail visant à permettre un fonctionnement efficace de celui-ci et à corriger des déséquilibres, et qui peuvent être distinguées d’autres interventions plus générales de la politique de l’emploi dans la mesure où elles agissent de façon sélective en favorisant des groupes particuliers sur le marché du travail ».
- 53 – Soit le niveau CITE 0-2. L’Unesco a créé la CITE (Classification internationale type de l’éducation) pour procéder à des comparaisons internationales sur les statistiques de l’éducation. Le niveau CITE 0-2 regroupe l’enseignement primaire, le premier cycle de l’enseignement secondaire, y compris le niveau 3C court (enseignement préprofessionnel et professionnel de moins de deux ans). Le niveau CITE 3-4 comprend le second cycle de l’enseignement secondaire et l’enseignement postsecondaire non supérieur. Le niveau CITE 5-6, enfin, représente l’enseignement supérieur.
- 54 – Cour des comptes, 2013.
- 55 – Besson, 2008.
VOLET 3 – Politiques macroéconomiques et grands arbitrages
“ Welfare policy and wages structure must always consider the realities of business economics e.g. the level of cost and competition in the surrounding world. ”
Manifeste What is Social democracy ?du Parti social-démocrate suédois56.
- 56 – In Huteau et Larraufie, 2009, p.67.
Des réformes structurelles à l’origine d’un nouveau modèle de croissance économique
Au pouvoir pendant près de quarante ans sans interruption (1930-1970), les sociaux-démocrates ont modelé un système caractéristique de protection sociale, reposant sur les principes d’égalitarisme et d’universalité. Ces institutions ont été mises en place pendant la période du boom économique mais, dès les années 1980, le poids des dépenses publiques a acculé le gouvernement à une série de coupes budgétaires.
Une vague de réformes structurelles de grande ampleur a alors été mise en œuvre, donnant lieu un nouveau modèle de croissance soutenable. On ne peut pas parler pour autant de remise en cause du modèle social-démocrate d’État-providence, toujours bien vivant. Les réformes des années 1990 correspondent plutôt à une nouvelle organisation de ce modèle, avec en ligne de mire ce qui pourrait être considéré en France comme un paradoxe : le maintien des protections sociales et l’attachement à une logique de marché.
1. Un modèle social-démocrate d’État-providence maintenu dans la durée
Les bases de l’État-providence suédois ont été posées jusque dans les années 1975. L’institutionnalisation généralisée de la protection sociale – reconnaissance des droits sociaux et priorité de ces droits face aux mécanismes du marché – prenant en charge les individus « du berceau à la tombe » s’est faite progressivement : création d’un régime d’assurance-chômage en 1903, création des allocations familiales en 1948, de l’assurance-maladie universelle en 1955, des régimes de pension complémentaire universelle en 1960, de l’assurance parentale en 1974… Le secteur public en est ainsi venu à assurer une grande partie de la sécurité matérielle des individus, les droits sociaux étant universels et liés à la citoyenneté. Dans certains domaines, la Suède a développé des politiques en avance sur ses voisins européens, comme en matière d’égalité entre hommes et femmes (cf. encadré 9).
Encadré 9 – L’ Égalité des hommes et des femmes
Le droit de vote a été accordé aux femmes suédoises dès 1919, ce qui place la Suède parmi les premiers pays en Europe. Depuis 1960, l’égalité professionnelle des hommes et des femmes est devenue un objectif majeur des politiques sociales suédoises. De nombreuses mesures ont été prises pour faire appliquer cet objectif, notamment une règle qui impose aux entreprises de plus de dix salariés de se doter d’un plan pour l’amélioration de l’égalité des sexes, des politiques visant à garantir des places au sein des crèches, des mesures en matière de congé parental (les congés parentaux suédois atteignent jusqu’à quinze mois pour le couple marié ou en concubinage, à prendre avant les huit ans de l’enfant, dont cinq mois réservés au père)… Aujourd’hui, le taux d’activité des femmes est quasiment égal à celui des hommes. Il existe une quasi-parité à l’Assemblée et dans le gouvernement. Les résultats de la Suède en matière d’égalité homme-femme sont, après la Norvège, parmi les meilleurs d’Europe (World Economic Forum, 2012).
Ces protections sociales ont impliqué un haut niveau de dépenses publiques. Les dépenses de l’État suédois, en proportion du PIB, ont été supérieures à celles de la France entre 1970 et 2005 (cf. graphique 18). Plus précisément, malgré une première décrue entre 1983 et 1988, elles ont tendanciellement augmenté jusqu’à culminer à 71 % du PIB au plus fort du plan de sauvetage ayant fait suite à la crise de 1991. Après 1993, ces dépenses publiques ont diminué continûment pour rejoindre, en 2005, le niveau français de 54 %.
Graphique 18 – Dépenses des administrations publiques (en % du PIB)
Source : OCDE.
Ramenées par habitant, en 2010, les dépenses des administrations publiques sont encore légèrement supérieures en Suède à ce qu’elles sont en France : le tableau 12 détaille leur structure.
Tableau 12 – Dépenses des administrations publiques par habitant en 2010 (USD courants en parité de pouvoir d’achat)
Source : OCDE. Calculs La Fabrique de l’industrie.
Pour financer un tel système, les prélèvements obligatoires étaient nécessairement élevés. Ils ont progressé d’environ 30 % à 50 % de la richesse nationale entre la fin des années 1960 et le début des années 1980 : la Suède comptait alors la plus forte pression fiscale d’Europe et de l’OCDE (cf. graphique 19). En 2008, la charge fiscale globale représentait 39,3 % du PIB dans l’Union européenne contre 46,4 % en Suède.
Graphique 19 – Charge fiscale suédoise (en % du PIB)
Source : ekonomifakta.se.
Haut niveau de dépense publique, charge fiscale élevée, principe d’accès universel et fort attachement à l’égalité : telles sont les caractéristiques d’un État-providence qualifié de « social-démocrate » par Esping-Andersen dans les Trois Mondes de l’État-providence (2007). Dans la typologie de l’auteur, la France est au contraire caractérisée par un État-providence de type « conservateur et corporatiste », car « il cultive les distinctions de statut et la hiérarchie entre individus » (Algan et Cahuc, 2007, p.44), les droits sociaux étant conditionnés à l’appartenance à tel ou tel de groupe de métiers, de revenus, etc.
Pour mesurer la notion d’universalité de l’accès aux protections sociales, Algan et Cahuc (op.cit.) observent la part de la population en âge de travailler éligible aux allocations de maladie, de chômage et de retraite dans différents pays en 1990. Cette part s’élève à 90 % en Suède, 75 % au Royaume-Uni, 72 % en Allemagne, 70 % en France et 54 % aux États-Unis (p.49). L’égalitarisme du modèle est quant à lui mesuré par le rapport entre les allocations sociales de base et les allocations maximales. En 2002, la Suède arrive en deuxième position (0,82) derrière le Danemark (0,99). Elle se place loin devant le Royaume-Uni (0,64), l’Allemagne (0,56), la France (0,55) et les États-Unis (0,23).
Calendrier des réformes (1981-1996)
2. Les décennies 1980-1990 ou le temps des réformes
A. Cinq réformes structurelles et deux vagues de libéralisations menées par nécessité
À l’aube des années 1980, suite aux deux chocs pétroliers, l’économie suédoise s’était détériorée et son positionnement sur le marché mondial s’était dégradé. Parallèlement, le gouvernement était confronté à la croissance non maitrisée des dépenses publiques.
Dès 1980, la Suède a mis en place une nouvelle gestion publique, afin d’en améliorer la productivité par l’intégration de critères économiques de marché. L’organisation de l’administration suédoise repose sur une séparation très nette entre des ministères, chargés de concevoir les politiques, et des agences, qui les mettent en œuvre. Une agence est une entité publique autonome, chargée de la réalisation d’une mission d’intérêt général ; elle dispose d’une grande liberté de choix quant aux méthodes de réalisation des missions qui lui sont confiées. Dans les années 1980, dans une logique de décentralisation, le contrôle de l’État sur les agences s’est allégé et un grand nombre d’entre elles ont été restructurées. On a assisté également à une première vague de libéralisations : dérégulation de l’accès aux crédits et ouverture à la concurrence dans les transports ferroviaires. L’objectif était de garder un État-providence généralisé et complet tout en réduisant les dépenses publiques.
Lorsque la Suède est entrée en récession, au début des années 1990, elle a été contrainte d’approfondir certaines réformes en cours et d’en engager de nouvelles. À partir de 1991, une seconde vague de réformes structurelles a été entamée et le processus de libéralisation des services publics a gagné en ampleur : télécommunications, postes, électricité, transport aérien, maisons de retraite, écoles maternelles, taxis.
Au total, durant ces deux décennies 1980 et 1990, cinq réformes structurelles ont été adoptées (cf. calendrier des réformes) : une réforme de l’organisation de l’État correspondant à un approfondissement de la décentralisation et consacrée dans la loi sur les collectivités de 1991, une réforme fiscale inscrite dans la loi de 1991, une réforme budgétaire consacrée par la modification constitutionnelle de 1994, une réforme de l’emploi engagée à partir de 1990 et une réforme des retraites.
Calendrier des réformes (1997-2012)
B. Un processus de décentralisation très abouti
La Suède était un État unitaire fortement centralisé avant les années 1970. Le principe de la décentralisation a été inscrit dans la Constitution de 1974. Les articles 1 et 7 garantissent l’autonomie locale des deux niveaux de collectivités que sont les comtés et les municipalités (cf. tableau 13). En pratique cependant, la Suède est restée fortement centralisée (moyennant un contrôle a priori des agences et un faible transfert de compétences aux collectivités) jusqu’à la loi de 1991 sur les collectivités locales – “Local Government Act”. Cette loi a transféré de nombreuses compétences nationales au niveau local dans le but de réduire les déficits et la dette publique.
Tableau 13 – L’organisation administrative de la Suède en 2011
In Rapport de l’inspection générale des finances, 2011.
Le transfert de compétences s’est accompagné systématiquement de dotations financières et d’une véritable autonomie budgétaire. La nouvelle organisation décentralisée a en effet impliqué un remaniement du système fiscal et l’apparition d’impôts locaux. Selon la constitution suédoise, les collectivités ont le pouvoir de créer une taxe afin de mettre en œuvre leurs missions : cela correspond à un impôt sur le revenu local, payé aux communes et aux comtés. Cette taxe représente leur principale recette (respectivement 67 % et 69 % de leur budget). Un système de péréquation vient corriger les déséquilibres entre collectivités, dus à leurs situations géographique, démographique ou économique. Dans le cas des communes, cette péréquation s’élève à 2 % du PIB (Service économique régional de Stockholm).
Dans cette organisation décentralisée, les autorités locales disposent d’un degré exceptionnellement élevé d’autonomie politique, fonctionnelle et financière. Les comtés ont pour compétence principale la santé et les soins médicaux. Ils sont propriétaires de tous les hôpitaux, fixent les honoraires des médecins de ville et ont la charge, depuis janvier 1998, du remboursement des médicaments hors ticket modérateur. Ils s’occupent également du tourisme et de l’agriculture, des transports urbains, de la culture et de l’enseignement (compétences partagées avec les communes).
Les municipalités ont des compétences très larges en matière de foncier et d’urbanisme, d’eau et d’assainissement, de déchets ménagers, de voirie, de services sociaux, de sports et loisirs, d’incendie, d’enseignement, de logement, de salubrité, d’énergie, de planification et de construction, ainsi que certaines tâches en matière d’environnement. L’éducation constitue la tâche la plus importante transférée aux communes (30 % de leur budget) ; elles sont responsables de l’enseignement de la maternelle jusqu’à l’entrée à l’université, de la construction et de l’entretien des locaux, de la rémunération des enseignants, des manuels scolaires et des repas qui sont gratuits. Elles recrutent les chefs d’établissements et les enseignants, construisent les programmes scolaires en fonction des orientations données par les ministères (la formation professionnelle revient aux comtés). Elles gèrent également des entreprises publiques : chaque commune possède ainsi entre deux et quatre entreprises qui peuvent intervenir dans tous les secteurs relevant de leurs compétences, à l’exception de l’éducation et des services de secours.
Malgré une diminution de 12,5 % du nombre d’emplois dans les administrations publiques (centrales, territoriales et sécurité sociale) entre 1993 et 2008, la Suède fait encore partie des pays connaissant le plus fort taux d’administration, avec 140 emplois publics pour 1 000 habitants en 2008 (cf. graphique 20).
Graphique 20 – Nombre d’emplois dans les administrations publiques pour 1 000 habitants (2008)
In Barbier-Gauchard, Guilloux, Le Guilly, 2010.
La fonction publique d’État a perdu des emplois depuis les années 1990 du fait de la privatisation de certains services publics et de la rationalisation de l’administration. Ce mouvement a été contrebalancé par l’élévation du nombre d’employés dans les collectivités locales suite au Local Government Act. Aujourd’hui, ce sont elles qui concentrent la majeure partie de l’emploi public en Suède : la fonction publique d’État ne représentait plus que 25 % à peine des effectifs totaux en 2008 (cf. graphique 21).
Graphique 21 – Centralisation de l’emploi public et taux d’administration (2008)
In Barbier-Gauchard, Guilloux, Le Guilly (op.cit.). (1) : 2007
C. La réforme de la procédure budgétaire : un cadre plus strict, un fonctionnement de l’administration par objectifs et résultats
Le gouvernement suédois avait entamé une réflexion sur la réforme de la procédure budgétaire en 1990 en mettant en place une commission gouvernementale sur la Loi de finances. La crise économique ayant entrainé une grave détérioration des finances publiques, cette réforme est devenue une priorité politique. Deux études très critiques sur le fonctionnement des institutions et de la procédure budgétaire, jugée complexe, peu efficace et peu transparente, publiées coup sur coup par un fonctionnaire du ministère des Finances en 1992 et par la Commission européenne en juin 199357 ont fortement inspiré les travaux de la commission gouvernementale. Une fois les nécessaires modifications constitutionnelles adoptées, un premier projet de loi budgétaire a été présenté selon la nouvelle procédure en avril 1996.
L’attribution des crédits est passée d’une logique bottom-up, où chaque service demandait pour l’exercice un montant précis que lui accordait le ministre des Finances, à une logique top-down, où le ministre des Finances répartit aujourd’hui le budget selon les priorités politiques du gouvernement. Cela a permis une meilleure maîtrise de la dépense publique. En outre, ce ne sont plus les recettes qui s’adaptent aux dépenses mais l’inverse. Le plafonnement des dépenses est réalisé d’abord de façon globale puis selon 27 « secteurs » (défense, éducation, justice, culture…). La nouvelle loi a également mis en place, dans la procédure, des principes tels que la transparence budgétaire et des exigences minimales relatives à la périodicité et au contenu des rapports comptables et de performances (cf. schéma 2).
Schéma 2 – Processus budgétaire suédois
In Huteau et Larraufie, 2009, p.143.
De plus, des règles strictes en matière de déficit budgétaire ont été instaurées. Le gouvernement s’est engagé à obtenir un excédent moyen de 2 % du PIB sur un cycle économique58 entre 2000 et 2007 (moyenne glissante de 7 ans), ce chiffre a été ramené à 1 % ensuite et le principe a été inscrit dans la Loi en 2010. En 2003, une loi a créé la Cour suprême d’audit qui donne au Parlement les moyens de contrôler l’utilisation des fonds publics.
Selon cette nouvelle organisation top-down, le rôle du ministre des Finances suédois s’est considérablement accru. Lorsque le Premier ministre suédois prend une décision contraire à l’avis du ministre des Finances, ce dernier démissionne. Ce cas s’est produit deux fois : en 1990 et en 1999.
Dans l’ensemble, ces nouvelles pratiques budgétaires ont visé à instaurer une culture du résultat au sein des administrations. Au niveau central comme au niveau local, celles-ci fonctionnent par objectifs et résultats, et bénéficient d’une autonomie de gestion. Cette autonomie se traduit notamment par la libre gestion du personnel (recrutements, négociations sur les salaires et les conditions de travail, licenciements). Le statut des fonctionnaires ayant été supprimé au début des années 1990, les droits et obligations des employés de l’administration centrale et des collectivités locales relèvent depuis des conventions collectives.
L’administration suédoise se caractérise aussi par une culture de la transparence et de l’évaluation. Les citoyens disposent d’un droit universel d’accès aux documents officiels et peuvent lire tous les documents administratifs qui ne sont pas classés secret (Carpentier et Lemaître, 2005). Des indicateurs de gestion ont été mis en place pour mesurer l’efficacité de la dépense publique et l’Agence nationale pour la gestion publique est chargée de l’évaluation de l’administration.
D. La réforme des retraites
Conscient que ses finances ne lui permettaient pas de faire face au problème du vieillissement de la population, le gouvernement suédois a également engagé une réforme du système de retraite. Une commission a été constituée en 1991 pour y réfléchir. Elle comprenait des députés, le ministre de la Sécurité sociale et des experts mais excluait les partenaires sociaux.
Cette commission a publié, en 1992, un rapport présentant les grandes orientations de la future réforme. La décision de réformer le système n’a été approuvée par le Parlement qu’en juin 1994, par 90 % des députés et cinq des six partis politiques. Le projet final a obtenu un vote favorable en 1998 et la première pension calculée selon les règles du nouveau système a été versée le 1er janvier 2001. Le processus de mise en place a donc été long ; le résultat final est néanmoins assez proche de la première ébauche du processus.
L’ancien système de retraite suédois consistait en une pension de base, dont le taux de cotisation était de 20 % du revenu. Basée sur un système de points, elle correspondait à 60 % du salaire de base multiplié par le nombre moyen de points des 15 meilleures années, auquel s’ajoutait une retraite complémentaire que souscrivaient 90 % des employés et une assurance-vie.
Le nouveau régime de retraite obligatoire repose sur deux piliers. Le premier pilier est le compte personnel, appelé « compte notionnel », dont dispose chaque assuré ; il représente 86 % des cotisations. Tous les ans, le cotisant acquiert un droit à la pension qui sera versé à la retraite. La cotisation est de 16 % (7 % du salaire brut pour l’employé et 9 % pour l’employeur). Les montants cotisés sont transférés mensuellement au fonds de réserve géré par l’Agence des retraites qui assure le versement des pensions. Les comptes notionnels sont majorés chaque année, les gains étant estimés sur la base de la mortalité observée parmi la même génération. Plus une génération a une durée de vie longue, plus les représentants de cette génération devront travailler pour pouvoir augmenter la valeur de leur compte notionnel.
Le second pilier est le régime par capitalisation à cotisations définies, qui fait partie du régime obligatoire. Le taux de cotisation est fixé à 2,5 % et les sommes sont versées par les cotisants sur un compte d’épargne individuel. L’Agence des retraites collecte les cotisations et les distribue à des fonds privés suédois ou étrangers choisis par les assurés. Lorsque les assurés n’en choisissent pas, ce qui est le cas le plus fréquent, les montants des cotisations sont versés automatiquement à un fonds par défaut, appelé aussi septième fonds, dont les investissements se font à 90 % en actions et 10 % en obligations.
Chaque assuré crée son propre capital avec les cotisations annuelles et le rendement des investissements. Une fois à la retraite, les Suédois peuvent convertir la pension en rente fixe ou opter pour une rente variable afin de continuer à alimenter les fonds. Dans le second cas, la pension mensuelle peut changer en fonction de l’évolution des fonds choisis par les individus et aussi des modifications de l’espérance de vie.
Enfin, près de 90 % des salariés suédois bénéficient d’une ou plusieurs complémentaires, organisées sur une base socio-professionnelle. Elles représentent environ 15 % des prestations vieillesse perçues par les Suédois. Il existe quatre grands régimes complémentaires : pour les fonctionnaires d’État, les cadres du privé, les non-cadres du privé et les employés des collectivités locales. Les complémentaires peuvent être à cotisations ou à prestations définies et fonctionnent sur la base de la capitalisation. La complémentaire est versée à l’âge normal de la retraite sous forme d’une rente indexée sur les prix.
3. Des résultats convaincants mais des marges de progression dans l’éducation et la santé
A. L’assainissement des finances publiques et la grande confiance des citoyens dans l’État-providence
La rationalisation de l’administration suédoise à partir des années 1980 avait pour objectif d’assainir les finances publiques. Avant la crise de 1991, la Suède était déjà parvenue à une situation excédentaire. Après la crise et la vague de réformes structurelles des années 1990, des périodes de déficits et d’excédents se sont succédées (cf. graphique 22 page suivante).
Graphique 22 – Solde budgétaire entre 1981 et 2010 (en % du PIB)
Source : OCDE.
Le budget suédois a connu trois périodes de déficit, entre 1978 et 1986, entre 1991 et 1997 et entre 2009 et 2010. À titre de comparaison, la France a été constamment déficitaire depuis 1980 et l’Allemagne a connu seulement deux budgets excédentaires (2000 et 2007) et un budget à l’équilibre (2008). Le coût important des mesures de sauvetage adoptées pour faire face à la crise bancaire en 2008 a rendu le budget suédois à peine déficitaire pendant que, à l’issue d’un mouvement d’ampleur équivalente, il a fait descendre le déficit public français à près de 8 % du PIB en 2010. En 2011, le solde budgétaire suédois était déjà de nouveau excédentaire d’un peu plus d’un milliard d’euros (Eurostat).
Les excédents budgétaires ont permis à la Suède d’effacer progressivement sa dette depuis 1995 alors que celles de l’Allemagne, de la France et de l’UE ont tendance à augmenter depuis le début des années 2000 (cf. graphique 23). Selon Willem Adema, spécialiste des questions sociales à l’OCDE, cette maîtrise budgétaire donne à la Suède « les moyens de soutenir son économie et de préserver son modèle social ».
Graphique 23 – Dette publique entre 1995 et 2011 (en % du PIB)
Source : Eurostat.
Enfin, la Suède, comme l’ensemble des pays nordiques, se caractérise par un degré élevé de confiance à l’égard des institutions nationales. Ce résultat est loin d’être anecdotique. Malgré l’ampleur et l’orientation franchement libérale des réformes (dérégulation des services publics, rationalisation de l’administration, suppression du statut de fonctionnaire, etc.), les garanties associées à l’État-providence ont été conservées. La confiance des individus envers les institutions, qui est restée élevée en Suède, a permis de maintenir un niveau élevé de prélèvements pour en assurer le financement (cf. graphique 24).
Graphique 24 – Indice de confiance dans les institutions nationales (2010)59
In OCDE, 2011.
Il convient à ce sujet de noter que près de 70 % des Suédois jugent que, en règle générale, « il est possible de faire confiance aux autres », contre 20 % des Français (cf. graphique 25).
Graphique 25 – Confiance envers les autres citoyens (en %)
In Algan et Cahuc, 2007. Chiffres issus de l’enquête du World Values Survey 1990 et 2000.
B. Des fonds publics mieux maitrisés mais un service rendu parfois critiqué
Carpentier et Lemaître (2005) jugent que les dérégulations des services publics ont eu des effets positifs d’un point de vue financier mais que les effets sur les usagers ont été contrastés, en particulier dans les cas de la Poste et du secteur ferroviaire. Dans le domaine de l’électricité, secteur ouvert à la concurrence depuis 1996, Huteau et Larraufie (2009, p.71) notent que l’électricité suédoise est la moins chère d’Europe, mais que son prix est sujet à de très fortes variations. En dix ans, elle a augmenté de 65 % pour les particuliers alors que le service rendu est discutable : en 2005, 1 million de personnes ont été privées d’électricité suite à une violente tempête, la compagnie concernée ayant été critiquée pour ne pas avoir réalisé les investissements nécessaires à l’enfouissement des lignes.
Dans le domaine de l’éducation, les performances des élèves mesurées par leurs résultats aux tests PISA60 sont assez moyennes si on les compare au niveau de dépense publique per capita correspondant. La Suède consacre 6,74 % de son PIB à l’éducation en 2011, contre 5,07 % dans l’UE27, 5,58 % en France ou encore 4,55 % en Allemagne (Insee). Tous les pays dont les résultats au test PISA sont supérieurs à celui de la Suède dépensent moins par élève, hormis l’Autriche. Ce constat reste vrai si l’on corrige des écarts de PIB par habitant (cf. tableau 14).
Tableau 14 – Performances des élèves et coût de l’éducation en 2001
In Roseveare, 2002 (OCDE).
Plumelle (2005) précise que les résultats aux tests PISA varient selon que les élèves sont suédois ou étrangers (qu’ils soient nés en Suède ou non). Elle relève également des différences en matière d’échec scolaire entre communes, ainsi que des écarts de performances entre écoles privées et écoles communales. Aghion a confirmé cet accroissement des inégalités au sein du système éducatif suédois dans une intervention récente aux Rencontres économiques d’Aix-en-Provence (2012).
Dans le domaine de la santé, depuis la loi de décentralisation, les comtés assurent le financement et la gestion des soins. Selon Desjourdy (2009), la réforme a permis de stabiliser les dépenses de santé (8,3 % du PIB en 2004 contre 9,1 % en 1980). Du fait de l’essor des centres de soins primaires et des soins à domicile, 45 % des lits d’hôpitaux ont été supprimés et le système emploie 20 % de personnel en moins qu’en 1990. Selon les différents classements de l’OCDE et de l’Organisation mondiale de la santé, le système de santé suédois serait parmi les plus performants au monde. La maîtrise des dépenses est assurée, les Suédois sont en bonne santé mais le système a tendance à s’engorger. Les files d’attente sont longues pour avoir accès à un médecin généraliste, pour consulter un médecin spécialiste ou organiser une opération. Cette situation entraîne le développement des cliniques privées fixant des prix élevés et l’insatisfaction des usages des services publics de santé (Huteau et Larraufie, 2009).
Conclusion
Les réformes engagées dans les années 1980 et 1990, importantes et nombreuses (libéralisation de nombreux secteurs, refonte du système de retraite, réorganisation et décentralisation de l’administration, réforme des politiques budgétaire et monétaire, suppression du statut de fonctionnaire…), sont à l’origine d’un nouveau modèle de croissance économique en Suède. « L’ensemble a permis de mettre fin à la période précédente marquée par une inflation élevée, une dépense publique en expansion et des dévaluations chroniques et de laisser la place à un tout autre modèle mettant l’accent sur l’exportation, la maîtrise de l’inflation, la recherche d’excédents budgétaires » (Trésor-Eco n°105, 2012, p.6). Ces réformes n’ont pas remis en cause le modèle social-démocrate d’État-providence et, surtout, n’ont pas généré de tension majeure dans la société suédoise. Carpentier et Lemaître (2005) indiquent que « la modification complète de l’administration suédoise s’est faite sans heurts sociaux. Les suédois sont syndiqués à 80 % et les syndicats, riches, forts et bien organisés, comptent sur leur capacité de négociations et sur la collégialité pour obtenir des avancées globales (salaire…). » (p.5)
Plus que le contenu des réformes, c’est la méthode de conception des politiques publiques en Suède qui est riche d’enseignements. Bergh et Erlingsson (2008) rappellent que, comparée aux autres pays, la méthode suédoise d’élaboration des politiques est connue pour être particulièrement rationnelle, pragmatique et consensuelle. En outre, les décisions sont d’autant moins prises dans la précipitation que les commissions et les groupes d’intérêts, très nombreux, jouent un rôle important (p.81).
Chabert et Clavel concluent que « d’une certaine manière, en acceptant de ’mettre sur la place publique’ les projets de réforme très tôt dans le processus, l’administration et la classe politique suédoises ont pris le pari d’accepter un point d’arrivée des réformes potentiellement différent de celui souhaité initialement, mais dans le même temps, plus stable car mieux ’approprié’ par les acteurs61 ».
- 57 – La Commission européenne établissait une comparaison de 13 États en Europe et démontrait que la Suède était le pire pays, avec l’Italie, pour la qualité de ses institutions budgétaires.
- 58 – Le fait que le budget soit constitué d’un cycle de trois ans, permet d’avoir une meilleure visibilité sur les décisions à moyen terme. La pluri-annualité budgétaire permet de mettre en perspective les politiques publiques. Cette technique est notamment utilisée pour le budget européen, où certaines mesures impliquent un engagement de crédits sur plusieurs années.
- 59 – « Les données relatives à la confiance envers les institutions sociales sont issues de l’enquête Gallup World Poll, menée dans plus de 140 pays. (…) (L)’indice de confiance dans les institutions nationales s’appuie sur les questions visant la confiance à l’égard du pouvoir militaire, du pouvoir judiciaire et de l’administration nationale » (OCDE, 2011).
- 60 – PISA (Programme for International Student Assessment) est une enquête menée tous les trois ans auprès de jeunes de 15 ans dans les 34 pays membres de l’OCDE et dans de nombreux pays partenaires. Elle évalue l’acquisition de savoirs et savoir-faire essentiels à la vie quotidienne au terme de la scolarité obligatoire.
- 61 – Trésor Eco n°105, 2012, p.7.
Une fiscalité favorable aux entreprises
La pression fiscale suédoise est parmi les plus élevées de la planète (cf. tableau 15). En 2010, les recettes fiscales représentaient 45,8 % du PIB en Suède, contre 38,4 % dans l’UE 27, 38,1 % en Allemagne et 42,5 % en France (Eurostat, 2012).
Le système fiscal suédois de la fin du XIXe se caractérisait par une forte pression fiscale sur les contribuables et les entreprises62. Conscients des effets négatifs que cela pouvait engendrer, les décideurs ont progressivement fait évoluer ce système. En 1938, le ministre des Finances Wigforss a octroyé des niches fiscales aux grandes entreprises très productives, au détriment des petites et moyennes entreprises63. Cette stratégie a participé à la concentration du capital, de la production et de la main d’œuvre dans les grandes entreprises. En 1947, une réforme est venue augmenter l’impôt sur le revenu ainsi que les taxations sociales et de santé. Dans les années 1970 et 1980, les coûts de production en Suède se sont élevés et la fiscalité a été critiquée comme étant trop lourde pour les PME. En 1991, une réforme fiscale a été envisagée, en cohérence avec la stratégie de diminution des dépenses publiques menée parallèlement.
Tableau 15 – Total des recettes fiscales (en % du PIB)
Source : OCDE.
1. La réforme fiscale de 1991 s’est basée sur un système dual de taxation des revenus et du capital
La fiscalité suédoise se distingue par un taux de taxation des entreprises en nette diminution depuis le milieu du XXe siècle et, depuis la réforme de 1991, par un système dual de taxation des revenus et du capital.
La réforme fiscale a été amorcée par un long processus, enclenché en 1984. Dans un premier temps, il s’agissait uniquement de discuter de la pertinence d’une telle réforme, jusqu’à ce que le Premier ministre annonce, en 1986, sa décision d’engager l’État dans une réforme globale de sa fiscalité. Trois commissions ont alors été missionnées pour étudier la question. Entre la mise en place de ces commissions et la présentation de leur rapport en juin 1989, de nombreuses tractations ont eu lieu au sein des partis et entre les partis et les syndicats. En octobre 1989, le Premier ministre Carlsson a invité tous les chefs de partis et les représentants des principales organisations à une réunion au sommet à Haga, afin d’arriver à un consensus qui a abouti à un accord unanime sur la réforme64.
La réforme a installé un système de taxation dual : les revenus du travail sont aujourd’hui soumis à un taux d’imposition progressif tandis que les revenus du capital sont assujettis à un taux forfaitaire de 30 %. Le taux d’imposition marginal sur le revenu a été largement diminué dans ce nouveau système, ramené de 87 % à 57 % (Aghion et Berner, 2013). De plus, l’impôt sur les sociétés est passé de 58 % à 30 %, les niches fiscales ont été quasiment supprimées, l’assiette fiscale de la TVA a été élargie et, enfin, de nouvelles écotaxes sur le carbone, le soufre et les oxydes d’azote ont été instaurées pour compenser la baisse de l’impôt sur le revenu.
Cette nouvelle politique a eu plusieurs conséquences. D’abord, la diminution de la taxation sur les revenus du travail combinée à l’augmentation de l’assiette de la TVA a fait basculer la pression fiscale du travail sur la consommation, stimulant l’offre de travail. Ensuite, l’instauration d’un taux forfaitaire sur le capital a encouragé l’épargne. Aghion et Berner (op.cit.) estiment que le taux d’épargne brut a augmenté de quatre points en vingt ans. Selon eux, cette progression de l’épargne a été bénéfique à l’économie suédoise car elle lui a offert un stock de capital productif de long terme et a limité la fuite de capitaux. Ce stock de capital a notamment été utilisé pour investir dans l’innovation. Enfin, la suppression des niches fiscales a limité les montages permettant l’évasion fiscale. C’est donc un système fiscal plus simple et plus incitatif qui a émergé au début des années 1990. La charge fiscale a diminué de 6 points entre 1990 et aujourd’hui, restant tout de même à un niveau élevé.
2. Une taxation des entreprises en constante diminution, les revenus et la consommation largement taxés
Lorsque l’on observe le système fiscal suédois relativement à d’autres pays européens (cf. tableau 16) ou de façon indépendante (cf. tableau 17), on constate qu’il pèse plus lourdement sur les travailleurs et consommateurs que sur les entreprises.
Le taux de l’impôt sur les sociétés, qui était de 52 % à la fin des années 1980, a été réduit progressivement pour atteindre 28 % au milieu des années 199065. Ce taux est resté stable jusqu’en 2008 puis a été abaissé à 26,3 % jusqu’en 2012. Depuis le 1er janvier 2013, il est de 22 %, c’est-à-dire inférieur au taux d’imposition moyen des sociétés constaté en 2012 en Europe (23,93 % selon Ernst&Young)66. Le gouvernement de centre-droit a indiqué son souhait de ramener ce taux à 15 % « à terme ».
Si la Suède et la France ont des niveaux similaires de prélèvements totaux, d’environ 46 % du PIB en 2011, les structures de leurs recettes fiscales sont différentes (graphiques 26a et 26b). La Suède taxe en effet les ménages à hauteur de 14,8 % du PIB en 2011, tandis que la France les taxe à 7,9 %. En France, les cotisations sociales représentent 16,9 % du PIB contre 7,4 % en Suède. Au total, ces deux taxes sommées représentent 24,8 % du PIB en France et 22,2 % en Suède. De plus, les recettes provenant des taxes indirectes, constituées en majeure partie de la TVA, sont de trois points plus élevées en Suède qu’en France. La Suède taxe donc davantage que la France le revenu et la consommation des ménages pour financer son État-providence, tandis que la France se repose plutôt sur les charges sociales.
Enfin, on remarque que les recettes liées à la fiscalité sur les entreprises sont moitié plus élevées en Suède (3,4 % du PIB contre 2,3 % en France), alors que le taux d’imposition sur les bénéfices y est plus faible. Cette différence s’explique par une meilleure profitabilité des entreprises suédoises ces dernières années et par l’absence de niches fiscales.
Tableau 16 – Taux d’imposition marginaux sur les revenus et taux standard de TVA (en %)
In Eurostat, 2012.
Tableau 17 – Le système fiscal suédois en 2012
Graphique 26a – Structure des recettes fiscales (taxes et contributions sociales) en 2011 (en % du PIB)
Source : Eurostat.
Graphique 26b – Répartition des recettes fiscales en 2011 (en % du
PIB)
Source : Eurostat.
3. La recherche d’une fiscalité écologique compatible avec la compétitivité des entreprises
A. L’introduction d’une fiscalité verte avec la réforme de 1991
La Suède a depuis longtemps mis en place une taxation énergétique (taxes sur le fuel en 1929 et sur l’électricité en 1951). L’objectif de ces taxes était alors purement financier. Ce n’est qu’après les deux chocs pétroliers que la taxation énergétique a été mise en place pour inciter à réduire la consommation d’énergie fossile. Dans les années 1980, les préoccupations environnementales ont été plus vives encore dans le débat gouvernemental. En 1986, une commission de la fiscalité environnementale a été mise en place afin de réfléchir à une réforme de la taxation carbone.
Après l’échec européen du projet de taxe carbone sur les émissions industrielles, et suite aux propositions de la commission sur la fiscalité environnementale de 1986, le gouvernement a créé une « écotaxe » sur les émissions de CO2 en 1991. La Suède couple une taxe carbone, qui incite à l’utilisation d’énergies non carbonées, avec une taxe sur l’énergie, qui incite à réduire la consommation d’énergie.
Cette réforme s’est intégrée à la réforme fiscale de 1991. Les taxes sur le carbone, le souffre et les oxydes d’azote ont été instaurées pour compenser en partie la baisse du taux d’imposition marginal sur les revenus. La fiscalité verte s’est donc faite à pression fiscale constante.
De plus, la fiscalité environnementale prévoyait d’emblée deux niveaux de taxation afin de ne pas nuire à la compétitivité économique du pays : un premier niveau élevé, concernant les ménages et les services, et un deuxième niveau plus faible, pour les secteurs sujets à la compétition internationale.
Une deuxième commission a été réunie en 1995 afin d’améliorer le fonctionnement du marché du travail, compte-tenu de la forte hausse du chômage dans les dernières années, et d’envisager le transfert de la taxation du travail vers la fiscalité verte. En 2001, le programme « Green tax shift » a donc cherché à mettre en œuvre une fiscalité verte plus incitative tout en maintenant constante la pression fiscale globale. Il s’est traduit par une réduction de l’impôt sur les revenus faibles et moyens et par une baisse des charges patronales, compensées par une augmentation des recettes de la taxe carbone et des taxes sur l’énergie. Fixé à 27 euros la tonne de CO2 en 1990, le premier niveau de taxation carbone (celui qui concerne les ménages et les services) a atteint 114 euros en 2011 (cf. graphique 27).
Graphique 27 – Evolution du taux standard de la taxe carbone en Suède entre 1991 et 2010
Source : OCDE.
Graphique 28 – Part des taxes environnementales dans le PIB (en %)
Source : Eurostat.
Le deuxième niveau, dédié aux entreprises, fixé à 7 euros la tonne de CO2 en 1991, est aujourd’hui de 34 euros pour les entreprises non soumises au marché des quotas européens ; ce taux sera doublé entre 2011 et 2015. Les autres entreprises sont exemptées de taxe carbone, à l’exception des usines de cycle combiné chaleur-électricité (CHP) qui bénéficient d’un taux réduit (8 euros la tonne de CO2 en 2011). Par ailleurs, les industries électro-intensives sont dispensées de payer la taxe sur l’énergie.
Au total, les taxes environnementales en Suède représentent 2,8 % du PIB en 2010, ce qui est proche de la moyenne européenne (2,5%, cf. graphique 28). En France, ce chiffre est de 1,9 % : seules l’Islande et l’Espagne présentent des taux plus faibles en Europe.
B. Une réduction importante de l’empreinte carbone
La Suède a diminué d’environ 15 % ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2009 (cf. graphique 29). La contraction des émissions est identique en Europe, mais moins importante en France (-9 %). Il est toutefois difficile de faire la part des choses entre la baisse structurelle, indéniable, et l’effet conjoncturel lié à la crise économique de 2008-2009.
En 2009, la Suède avait l’empreinte carbone par habitant la plus faible de l’UE : 7,0 tonnes en 2010 et 6,4 tonnes en 2009 (Grosjean et Debroux, 2012, p.5). La France se situait à un niveau proche de la Suède en 2009 ; l’Allemagne, en revanche, avoisinait le seuil des 10 tonnes par habitant (OCDE).
Graphique 29 – Emissions de CO, en kt (base 100 en 1990) 2
Source : OCDE.
La taxe carbone a par ailleurs favorisé le développement des énergies renouvelables, perceptible entre 1970 et 2010 (cf. graphique 30). Sur cette période, Grosjean et Debroux (2012) précisent en effet que « le recours aux produits pétroliers s’est contracté de 47 % alors que l’utilisation des biocombustibles (déchets et tourbe inclus) a augmenté de 230 %. Grâce au développement du nucléaire et de l’hydroélectricité, la production électrique a augmenté de 131 % sur cette même période » (p.14).
Graphique 30 – Bouquet énergétique primaire suédois (hors exports d’électricité) entre 1970 et 2010
In Grosjean et Debroux, 2012, p 14.
Conclusion
La fiscalité suédoise est au service d’un État qui a voulu réduire ses dépenses pour assainir ses comptes et a souhaité préserver un niveau élevé de prestations sociales. Ces dernières sont largement financées par l’impôt des citoyens et les impôts indirects (TVA). Les contributions sociales et la fiscalité des entreprises, au contraire, demeurent plus faibles en Suède qu’en France et qu’en Allemagne.
La réforme fiscale a en effet permis de diminuer la charge fiscale de six points de PIB depuis 1990 tout en préservant la compétitivité des entreprises. La taxe sur les sociétés a diminué tout au long du XXe siècle pour atteindre 22 % le 1er janvier 2013 et les taxes environnementales pèsent plus lourdement sur les particuliers que sur les entreprises. Même l’instauration d’une taxe carbone a favorisé une baisse des émissions de CO2 sans freiner a priori la croissance économique.
- 62 – Du rietz et al ., 2010.
- 63 – Op.cit.
- 64 – Morinao Iju, 2007.
- 65 – HEC et le Cercle des européens, 2010.
- 66 – Certains observateurs relèvent que cette fiscalité suédoise des entreprises, moins lourde qu’en France par exemple, n’empêche pas pour autant les délocalisations d’entreprises à des fins d’optimisation (Jacob et Guillon, 2012). Des holdings ont ainsi quitté le pays dans les années 2000, en raison de l’entrée dans l’Union européenne des PECO à la fiscalité plus favorable (HEC et le Cercle des européens, op.cit. ).
Conclusion
Les performances économiques de la Suède ravivent aujourd’hui l’intérêt des observateurs étrangers pour le « modèle suédois ». La Suède aurait-elle trouvé un modèle de développement idéal, alliant croissance économique, cohésion sociale, maîtrise des finances publiques et même, depuis peu, proactivité écologique ? Peut-on identifier les ingrédients de ce succès ?
Quel modèle suédois ? Quelles performances ?
La Suède avait déjà été érigée au rang de « modèle » dans les années 1950-1970. Pour ses admirateurs, elle avait su à cette époque construire une société démocratique et consensuelle, troisième voie enviable entre le capitalisme et le communisme, alliant dynamisme économique et haut niveau de protection des individus et de redistribution. Plus récemment, du milieu des années 1990 jusqu’à aujourd’hui, elle a de nouveau suscité l’intérêt du fait de sa vitalité économique, de la résilience de sa base industrielle et de l’assainissement de ses comptes publics. Entre ces deux périodes, le pays a connu deux décennies de moindre croissance et, en 1991-1993, une crise brutale.
Le débat n’est pas clos sur les origines de cette crise économique. Pour certains, la Suède aurait poussé trop loin le souci d’égalitarisme et de redistribution, ce qui aurait pénalisé la croissance du pays et affaibli sa résistance aux chocs exogènes. C’est ainsi que, selon quelques auteurs, le « modèle suédois » était intrinsèquement contre-performant dès 1950 ; d’autres parlent d’un dévoiement progressif et d’une entrée en crise au début des années 1970. Quoiqu’il en soit, pour les premiers comme pour les seconds, la Suède n’aurait finalement fait que payer en 1992 le prix de ce modèle économique et social insoutenable. Pour d’autres, ce sont les réformes d’inspiration libérale adoptées dans les années 1980, en particulier une dérégulation de l’accès au crédit aux effets mal anticipés, qui auraient précipité la Suède dans la tourmente.
Cette note n’a pas vocation à trancher ce débat. En revanche, elle met l’accent sur un point important. Si le modèle suédois présente des visages distincts selon la période à laquelle on le considère, certains traits caractéristiques demeurent. L’attachement à un modèle d’État-providence social-démocrate en est un, reposant sur une double préoccupation d’égalitarisme et d’universalité. Mais, si l’objectif de maintenir un niveau élevé de protection sociale n’a jamais été démenti, les moyens concrets pour y parvenir ont largement varié dans le temps : fiscalité, arbitrages macroéconomiques, équilibre entre État et territoires, entre interventionnisme et dérégulations, rôle des syndicats… Ce pragmatisme est un autre trait distinctif du « modèle » : les Suédois ont adapté leur État-providence au cadre changeant d’une économie de marché, en confiant par exemple les missions de service public spécifiées par le Gouvernement à des agences gérées selon les normes du privé.
Forces et faiblesses du modèle économique suédois actuel
Selon les analyses structurelles-résiduelles détaillées dans cette note, l’accroissement de la valeur ajoutée entre 1995 et 2007 en Suède s’explique marginalement par une structure économique favorable (c’est-à-dire un positionnement sur des secteurs en croissance au niveau européen) et relève principalement d’une surperformance suédoise, relativement à l’Europe. L’exercice équivalent sur les emplois illustre l’ampleur des gains de productivité réalisés. Sur cette période, la valeur ajoutée suédoise a augmenté de 83,1 % quand l’emploi a progressé de 9,6 %. L’industrie a contribué à la croissance de la valeur ajoutée à hauteur de 13,7 points. Elle a, dans le même temps, réduit ses effectifs (-1,4 point). Les gains de productivité dans les services marchands et non marchands ont été massifs : ils sont à l’origine d’une hausse de 62,4 points de la valeur ajoutée et de 10,6 points de l’emploi. Ces résultats confirment les effets positifs de la rationalisation des services publics et des deux vagues de libéralisation.
Les facteurs à l’origine de la compétitivité industrielle sont nombreux et relèvent pour la plupart d’une dimension « hors-prix » : un capitalisme patrimonial et paternaliste, de grands groupes exportateurs, un positionnement de gamme élevé, des gains de productivité, l’investissement dans la recherche et développement, dans les TIC et dans le capital immatériel, la maîtrise de la langue anglaise par la population, l’investissement en capital humain, un dialogue social permettant des négociations compatibles avec la compétitivité de l’industrie… À quoi il ne faut pas oublier d’ajouter une fiscalité clémente pour les entreprises.
En particulier, la Suède domine ses partenaires par le niveau de financement de R&D privée. Cette note montre que les entreprises suédoises investissent plus que la moyenne européenne dans ce domaine à secteur donné (comme aux États-Unis, au Japon et en France), alors que la Suède bénéficie déjà d’un positionnement sectoriel favorable dans les secteurs intensifs en R&D (comme la Corée, l’Allemagne ou le Japon, mais contrairement à la France ou aux États-Unis). Sur 31 secteurs offrant des biens et services marchands, 22 présentent en 2007 une intensité technologique plus forte que la moyenne européenne. Le débat autour du rendement de cette dépense, en termes de nombre de brevets ou de produits nouveaux par euro dépensé, n’est pas tranché. En revanche, on sait que cet effort a contribué au moins en partie aux gains de productivité observés depuis 1990.
Malgré les aménagements des années 1990 et un accroissement des inégalités depuis le milieu des années 1980, la Suède conserve un niveau très avancé de prestations publiques et de protection sociale. Le système éducatif et le système universitaire restent bien dotés. Les dépenses publiques d’éducation représentent plus de 7 % du PIB en 2009, contre 6 % en France et 5 % en Allemagne (Eurostat). Certes, les tenants du modèle social-démocrate suédois originel ont dû faire des concessions face à la nouvelle donne économique mondiale et à la nécessité pour le pays de se désendetter. Les retraites versées sont aujourd’hui calculées en fonction des montants disponibles, pour la part en répartition comme pour la part en capitalisation. Certes encore, une assurance-chômage moins généreuse qu’auparavant pousse les demandeurs d’emplois à chercher activement une activité, mais les allocations restent plus élevées que dans les pays anglo-saxons et l’efficacité des politiques de l’emploi les place toujours parmi les meilleurs standards mondiaux. Le taux de chômage, qui se limitait à 2 % de la population active jusqu’au début des années 1990 du fait de politiques de « droit à l’emploi » dont le coût était devenu prohibitif, se maintient depuis lors entre 6 et 8 %. Il touche plus particulièrement les jeunes (23 % en 2011 contre 21 % dans l’Union européenne) mais les politiques actives de l’emploi – qui ont toujours été privilégiées par les Suédois – limitent efficacement le chômage de longue durée (1 % en 2011 contre 4 % dans l’UE).
Pourtant, c’est peut-être dans le domaine social que résident les principaux défis auxquels la Suède fait face aujourd’hui. D’une part, la Suède est devenue depuis trente ans l’un des pays d’Europe accueillant le plus fort flux d’immigrants légaux ; certains craignent que sa politique d’intégration ne soit plus à la hauteur du défi (Fondation Robert Schuman, 2012 ; Boujnah, 2002). D’autre part, malgré des résultats remarquables en termes de croissance économique et la priorité donnée aux politiques actives de l’emploi, la Suède n’a pas retrouvé le plein-emploi qui dominait avant le début des années 1990. Tout cela pourrait remettre en cause l’homogénéité qui caractérisait jusqu’ici la société suédoise et, en particulier, l’acceptation sociale du coût fiscal d’un système encore très généreux.
L’élaboration du consensus démocratique
Un autre trait distinctif aura caractérisé le « modèle suédois » à travers les différentes périodes considérées : la capacité du pays à organiser un débat démocratique fécond, puis à appliquer les décisions prises. Dès 1938, les partenaires sociaux ont mis en place un système de négociation collective centralisé sur les conditions de travail, le temps de travail et les rémunérations. Le marché du travail est réglementé par les conventions collectives et non par la loi, ce qui donne la mesure de l’autonomie et de la légitimité des syndicats. Plus récemment, on peut prendre en exemple la réforme du financement des retraites. Cette dernière a été adoptée en 1998, à une majorité de 75 % des membres du Parlement suédois, après quinze ans de réflexion concertée, et malgré les changements de gouvernement. Ce processus a permis à la Suède de passer d’un système de prestations définies à un régime de cotisations définies qui fait l’objet d’un large consensus national.
Plusieurs traits culturels sont évoqués dans la littérature pour expliquer cette capacité : une éducation qui valorise la communauté et sa cohésion au détriment des aspirations individualistes, une éthique protestante réprouvant les comportements opportunistes et la triche, un niveau d’éducation élevé permettant une participation informée aux débats.
Cette participation et cette adhésion se traduisent aujourd’hui dans une décentralisation des décisions et une très grande transparence des administrations. La décentralisation fait que les choix d’action publique sont débattus au niveau local. Au niveau national, une grande partie de la dépense publique passe par des agences ou fait l’objet de délégations de service public. Dans les deux cas, il semble que l’administration ait mis au point des systèmes de contrôle de gestion efficaces, du moins par rapport à la situation qui prévalait au début des années 1980. Tout cela conduit à ce que la pression fiscale, élevée, soit bien acceptée : si les citoyens ont le sentiment de payer beaucoup d’impôt et aimeraient en payer moins, ils remettent peu en cause les services publics proposés, si ce n’est dans le domaine de la santé ou de l’énergie.
Qu’apprendre de la Suède ?
Comme toute démarche de benchmarking, l’étude du modèle suédois illustre la difficulté à transposer des mesures d’un système à un autre. Elle montre comment les cadres institutionnels se transforment, guidés par des choix passés et par des priorités données à l’action publique, par des évènements exogènes ou par les rapports de forces qu’entretiennent les parties prenantes. La complémentarité et les interactions entre les institutions régissant le marché du travail, la démarche d’innovation, la conduite du budget de l’État ou encore l’organisation du système fiscal font que la réplication isolée de mesures efficaces aurait, dans un autre environnement, des effets incertains. Il n’en reste pas moins que l’observation de modèles étrangers peut être source d’inspiration, modifier des représentations des acteurs et, in fine, faciliter le changement.
La France a, comme la Suède, la volonté de rester une économie prospère mais aussi de maintenir un État protecteur, d’éviter la fracture sociale et d’offrir des chances égales à ses citoyens. La Suède constitue donc pour elle une source d’inspiration intéressante, qui peut paraître assez naturelle. Or, ces objectifs communs masquent des divergences dans la perception des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre, qui relèvent de choix politiques et de société. Les deux pays ont donc en réalité des approches sensiblement différentes, qui sont matière à réflexion.
En Suède, le financement de l’État-providence repose sur une pression fiscale parmi les plus élevées au monde, s’exerçant principalement sur les individus. Des années 1980 aux années 2000, un ensemble de secteurs ont été libéralisés et ouverts à la concurrence. L’administration publique a progressivement changé de culture, avec l’apparition du new public management. Par exemple, les agences ont leur propre budget, alimenté par les contributions des usagers, et sont totalement responsables de leurs ressources. Dans le même temps, la décentralisation s’est affirmée de sorte qu’elle est aujourd’hui beaucoup plus poussée qu’en France et qu’on pourrait peut-être parler de « système-providence » plutôt que d’État-providence. L’éducation a été transférée aux communes, la santé en grande partie aux comtés. Ces choix ont contribué à la maîtrise des finances publiques, tout en maintenant le niveau des services publics. Dès 1980, la Suède a mis en place une règle d’or et fixé à 2 % du PIB son objectif d’excédent budgétaire (abaissé à 1 % en 2007).
La social-démocratie suédoise apparaît comme décomplexée : on y trouve un État protecteur, certes, mais attaché au fonctionnement du marché. Les réformes structurelles ambitieuses et cohérentes de la politique budgétaire, de la fiscalité, des retraites et du marché du travail ont été rendues possibles par une forte préparation impliquant les « forces vives de la nation ». C’est cette capacité de la Suède à organiser une concertation démocratique pour discuter des objectifs des politiques, élaborer un nouveau consensus, adapter lois et réglementations avec pragmatisme et veiller à la mise en place des décisions prises qui pourrait être source d’inspiration pour la France.
Bibliographie
Articles de revues, ouvrages et communications
Aghion Philippe, Howitt Peter, 1998, Endogenous Growth Theory, MIT Press: Cambridge, MA.
Aghion Philippe, 2012, « Investir mieux dans l’école primaire », Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence « Et si le soleil se levait aussi à l’Ouest… La nouvelle dynamique mondiale », 6-8 juillet.
Ahlberg Kerstin, Bruun Niklas, “Sweden: Transition through collective bargaining”, In: T. Blanke and E. Rose (guest eds), “Collective Bargaining and Wages in Comparative Perspective. Germany, France, The Netherlands, Sweden and the United Kingdom”, Bulletin of Comparative Labour Relations, Vol. 56, Kluwer Law International, The Hague 2005, pp. 117-143.
Algan Yann, Cahuc Pierre, 2007, La société de défiance, Éditions Rue d’Ulm/Presses de l’Ecole Normale Supérieure, 100 p.
Algan Yann, Cahuc Pierre, Zylberberg André, 2012, La fabrique de la défiance… et comment s’en sortir, Albin Michel, 192 p.
Andersson Thomas, Fredriksson Torbjörn, Svensson Roger, 1996, “Multinational Restructuring, Internationalization and Small Economies: The Swedish Case”, Psychology Press.
Auger Jacques, 1998, « Réforme de l’administration publique : Suède », Coup d’œil, vol. 4, n°2, Observatoire de l’administration publique, ENAP.
Auluck Randhir, Chemla-lafay Annie, Chol Céline, Coué Brigitte, Deleplace Marie-Thérèse, Dengler Brigitte, Maréchal Michel, 2006, « 25 ans de réforme de la gestion publique dans les pays de l’OCDE : convergence et systémique », Institut de la gestion publique et du développement économique, mai.
Bandick Roger, 2011, “Foreign Acquisition, Wages and Productivity”, The World Economy, Wiley Blackwell, vol. 34(6), pp. 931-951.
Barbier-Gauchard Amélie, Guilloux Annick, Le Guilly Marie-Françoise, 2010, « Tableau de bord de l’emploi public – Situation de la France et comparaisons internationales », Synthèse du Centre d’Analyse Stratégique, décembre.
Bengtsson Håkan A., 2006, « Le modèle suédois à l’épreuve des réformes libérales », La Vie des idées, septembre.
Bergh Andreas, Erlingsson O. Gissur, 2009, “Liberalization without Rentrenchment : Understanding the Consensus on Swedish Welfare State Reforms”, Scandinavian Political Studies, Vol. 32, n°1, pp. 71-93.
Besson Eric, 2008, « Flexicurité en Europe, éléments d’analyse », Rapport remis au Premier ministre, La documentation française, février.
Bitard Pierre, Edquist Charles, Hommen Leif, Rickne Annika, 2008, “Reconsidering the paradox of high R&D input and low innovation : Sweden” in C. Edquist and L. Hommen (eds), Small Country Innovation Systems : Globalization, Change and Policy in Asia and Europe. Edward Elgar : Cheltenham.
Bouckaert Geert, Veerle Conings, 2006, “Are state structure and form of political executive indicators for content and functions of budget reform?”, Conclusions from the Belgian, Dutch and Swedish cases, Conférence “The Second TransAtlantic Dialogue”, 1-3 juin, Leuven (Belgique).
Boujnah Stéphane, 2002, « L’inoxydable modèle suédois, du modèle de société au modèle de gouvernement ». En temps réel. Disponible sous :
http://entempsreel.com/sites/default/files/EnTempsReel-Cahier6.pdf
Braunerhjelm Pontus, Henrekson Magnus, 2012, “Entrepreneurship, Institutions and Economic Dynamism : Lessons from a Comparison of the United States and Sweden”, Research Institute of Industrial Economics.
Bureau national du commerce, 2010, “Servicification of Swedish manufacturing”, mars. Disponible sous http://www.kommers.se/Documents/dokumentarkiv/publikationer/2010/skriftserien/report-2010-1-servicification-of-swedish-manufacturing.pdf
Centre d’Analyse sur les Différends et leurs Modes de Solution (CADMOS), « Gestion de crise dans l’Euromed : DOSSIER SUEDE », Faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud 11.
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), 2009, « Formation professionnelle en Suède : une brève description ».
Chabot Georges, 1972, « Le modèle suédois, de Jean Parent », Annales de géographie, Vol. 81, n° 445, pp. 356-357.
CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale), 2008, « Suède : Réforme de l’assurance chômage ».
CLEISS, 2011, « Le régime suédois de sécurité sociale ».
Commission européenne, 1995, Green Paper on Innovation. Disponible sous http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf
Commission européenne, 2011, “Innovation Union Scoreboard, 2011”. Disponible sous
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis
innovation-scoreboard/index_en.htm
Coulet Cyril, 2007, « Les dispositifs d’activation de la politique suédoise de l’emploi dans une perspective historique », Travail et Emploi, n°112, octobre-décembre, pp. 63-74.
Coulet Cyril, 2008, « La réforme de la politique de l’emploi suédoise », article de blog du 16 janvier.
Cour des comptes, 2013, « Marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques », janvier.
Davis Steven J., Magnus Henrekson, 1997, “Industrial Policy, Employer Size, and Economic Performance in Sweden”, in The Welfare State in Transition: Reforming the Swedish Model (University of Chicago Press, 1997), pp. 353-398.
Desjourdy Alain, 2009, « Les réformes de santé en Suède : quelles leçons pour le Québec ? », Cahiers de recherché en politique appliquée, Vol.II, n°3, automne 2009.
Djerf Olle, Frisén Hâkan, Ohlsson Henry, 2005, ”Svensk industri i globaliseringens tid – Nya behov av investeringar och kompetensutveckling”, Report, Industrins Ekonomiska Råd. (en suédois).
Du rietz Gunnar, Johansson Dan, Stenkula Mikael, 2010, “The marginal Tax Wedge of Labor in Sweden from 1861 to 2009”, avril.
Ecopublix (blog), 2008, « La crise financière, version suédoise », 23 octobre :
www.ecopublix.eu
Edquist Charles, Mckelvey Maureen, 1996, “High R&D Intensity, Without High Tech Products: A Swedish Paradox ?” Working Paper Linköping, Department of Technology and Social Change, Linköping University.
Edquist Harald, 2011, “Can Investment in Intangibles Explain the Swedish Productivity Boom in the 1990s?”, Review of Income and Wealth, 57.
Ejermo Olof, Kander Astrid, 2011, “Swedish business research productivity. Industrial & Corporate Change”, Vol. 20 Issue 4, mai, pp. 1081-1118
Eliasson Kent, Hansson Pär, Lindvert Markus, 2012, “Do Firms Learn by Exporting or Learn to Export? Evidence from Small and Medium-sized Enterprises”, Small Business Economics, 39 (2012), pp. 453-472.
Esping-Andersen Gosta, 2007, Les trois mondes de l’État-providence. Essai sur le capitalisme moderne, Broché, 310 p.
Eurostat, Communiqué de presse du 23 avril 2012, Euro indicateurs.
Eurostat, Communiqué de presse du 21 mai 2012, « Evolution de la fiscalité dans l’Union Européenne : nouvelle hausse des taux de TVA en 2012 ».
Fondation Robert Schuman, 2012, « Equilibre budgétaire et compétitivité : l’exemple suédois », Question d’Europe, n°258, 12 novembre.
Freeman Richard B., Topel Robert, Swedenborg Birgitta, 1997, The Welfare State in transition : Reforming the Swedish Model, University of Chicago Press, National Bureau Of Economic Research, 356 p.
Grjebjne André, 1999, « Suède : le modèle banalisé ? », Les études du CERI, n°50, mars.
Groulx Lionel, 1989, « La politique de l’emploi en Suède », Nouvelles pratiques sociales, Vol. 2, n° 2, pp. 23-36.
Gwartney James, Skipton Charles, Lawson Robert, 2001, “Trade Openness, Income Levels, and Economic Growth, 1980-1998”, Economic Freedow of the World, Annual Report, pp. 71-90.
HEC et le Cercle des européens, 2010, « L’imposition des groupes de sociétés en Europe, un nouveau pas vers la convergence fiscale », Fiche pays.
Hénard Jacqueline, 2012, L’Allemagne : un modèle, mais pour qui ?, Note de La Fabrique de l’industrie, n°1, Presse des Mines, Paris.
Henrekson Magnus, 2001, “Swedish Economic Growth ; A Favorable View of Reform”, Challenge, vol. 44, n°4, Juillet-Août, pp. 38-58.
Hibbs Douglas A. Jr, Locking Hâkan, 2000, “Wage Dispersion and Productive Efficiency: Evidence for Sweden”, Journal of Labor Economics.
Huteau Benjamin, Larraufie Jean-Yves, 2009, Le malentendu suédois, Presse des Mines, 197 p.
Insead, 2012, « Global Innovation Index 2012 Édition ». Disponible sous :
http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html
Inspection générale des affaires sociales (IGAS), 2004, « Le financement des syndicats : étude d’administration comparée – Le cas de la Suède », rapport n°2004 159 présenté par de Saintignon Pierre, Guedj Jérôme, Saintoyant Valérie et Osterrieder Holger, octobre.
Inspection générale des finances, 2011, « Étude des stratégies de réforme de l’État à l’étranger », n°2010-M-098-02, avril.
Isaksson Anders, 2006, « Trygghetens förvandlingar » (Transformations de la sécurité sociale), publié dans « Bo Den problematiska tryggheten. Välfärdsstaten under tre decennier » (La sécurité sociale en question. Trente ans de l’État-providence), Södersten (éd.), SNS, Stockholm.
Jacob Yvon, Guillon Serge, 2012, « En finir avec la mondialisation déloyale ? », Rapport publié à la Documentation Française, 303 p.
Jolivet Annie, Mantz Timothée, 2009, « Pas de consensus face à la crise », Chronique internationale de l’IRES, n°121, novembre, pp. 136-147.
Jones Charles I., 1995, “R&D-based models of economic growth”, Journal of Political Economy, 103, pp. 759-784.
Krantz Olle, 2004, “Economic Growth and Economic Policy in Sweden in the 20th Century: A Comparative Perspective”, (working paper).
Lagerberg Rikard, Randecker Emma, 2010, Sweden, Up North, Down to Earth, Swedish Institut, 72 p.
Lecaussin Nicolas, 2010, « La réforme du système de retraite suédois », article sur le site de l’Institut de recherches économiques et fiscales (IREF).
Lefebvre Alain, Méda Dominique, 2008, « Performances nordiques et flexicurité : quelles relations ? », Travail et Emploi, n°113, Janvier-mars, pp. 133-143.
Letondu François, 2009, « La crise suédoise des années 1990 : des leçons à réutiliser », Focus de la Société générale, février.
Lindberg Ingemar, Ryner Magnus, 2010, « Crises financières et syndicats : Suède 1990-1994 », Journal international de recherche syndicale, vol.2, n°1, Bureau International du Travail, Genève.
Lindvall Johannes, 2006, “The Politics of Purpose: Swedish Economic Policy After the Golden Age”, Comparative Politics, 38 (2006), pp. 253-272.
Magnusson Lars, Friedrich Ebert Stiftung, 2007, “The Swedish labour market model in a globalized world”.
Malerba Franco (Ed.), 2004, Sectoral systems of innovation, Cambridge University Press, Cambridge.
Mantz Timothée, 2007, « Suède ̔Le travail doit payer̕ : la réforme de l’assurance chômage », Chronique internationale de l’IRES, n° 105, 12 p.
Miroshnyk Olga, 2009, “Institute of local self-government in Sweden”, Razumkov centre, n°1.
Morinao Iju, 2007, “Tax policy in globalization-the Swedish Experience”, Conférence “International Forum on the Comparative Political Economy of Globalization”, 31 août – 2 septembre 2007, Mushashi University, Tokyo (Japon).
Natixis, 2012, « Il ne faut pas regarder le coût du travail seul mais le couple coût du travail – niveau de gamme », Flash économie, n°37, 16 janvier.
Nickell Stephen J., 1996, “Competition and Corporate Performance,” Journal of Political Economy, 104, pp. 724-46.
Nickell Stephen J., Redding Stephen, Swaffield Joanna, 2008, “The Uneven Pace of Deindustrialisation in the OECD”, The World Economy, 31 (2008), pp. 1154-1184.
Nordh Sture, « Den Svenska Modellen » (Le modèle suédois), note du TCO.
OCDE, 2005, “Main Science and Technology Indicators”, Paris.
OCDE, 2006, “Boosting Jobs and Incomes. Policy lessons from reassessing the OECD jobs strategy”. Disponible sous : www.oecd.org/els/emp/36889821.pdf
OCDE, 2007, « Chapitre 1. Principaux défis de l’économie suédoise », Études économiques de l’OCDE, 2007/4 n° 4, pp. 21-57.
OCDE, 2008, « Étude économique de la Suède, 2008 », Synthèses, décembre.
OCDE, 2011, « Confiance à l’égard des institutions sociales », dans Panorama de la société 2011 : Les indicateurs sociaux de l’OCDE, Éditions OCDE.
Oh Donghyun, Heshmati Almas, Lööf Hans, 2009, “Technical Change and Total Factor Productivity Growth for Swedish Manufacturing and Service Industries (Royal Institute of Technology, CESIS – Centre of Excellence for Science and Innovation Studies, 2009).
Ohlsson Lennart, Vinell Lars, 1987, « Tillväxtens drivkrafter. Industriförbundets förlag »: Stockholm.
Ouellet Aubert, 1995, « Les finances publiques en Suède », Télescope, 1995, Vol. 2, n°4, novembre.
Parent Jean, 1970, Le modèle suédois, Calman-Lévy, Paris, 303 p.
Parlement européen, 1997, « La politique sociale et la politique du marché du travail en suède », Direction générale des études, Série Affaires sociales.
Plumelle Bernadette, 2005, « L’éducation en Suède », Revue internationale d’éducation de Sèvres, n°39, pp. 139-146.
Porter Michael E., Stern Scott, 2010, “National Innovation Capacity”, Harvard Business School. Disponible sous : http://www.isc.hbs.edu/Innov_9211.pdf
Rosen Sherwin, 1997, “Public Employment, Taxes, and the Welfare State in Sweden”, in The Welfare State in Transition : Reforming the Swedish Model, University of Chicago Press.
Roseveare Deborah, 2012, “Enhancing the Effectiveness of Public Expenditure in Sweden”, OCDE.
Rugraff Eric, 2009, « Pourquoi les nouveaux pays membres de l’UE sont-ils durement touchés par la crise financière ? », Bulletin de l’observatoire des politiques économiques en Europe, n°20.
Sandberg Nils Eric, 1997, What went wrong in Sweden ?, Timbro.
Sandemose Aksel, 1933, En flyktning krysser sitt spor.
Schoeffler Pierre, 1993, « La crise de l’immobilier en Suède. Revue d’économie financière », Numéro hors-série : La crise financière de l’immobilier : réflexions sur un phénomène mondial, pp. 301-309.
Sejersted Francis, 2011, The Age of Social Democracy : Norway and Sweden in the Twentieth Century, Princeton University Press, 560 p.
Service des douanes, 2011, « Les opérateurs du commerce extérieur de la France », Données et tableaux – résultats révisés.
Service économique régional de Stockholm (réseau international de la DG Trésor), « L’administration suédoise. Structure et fonctionnement » (Nil Carpentier et Frédéric Lemaître), juin 2005.
Service économique régional de Stockholm (réseau international de la DG Trésor), « Elections 2010 en Suède : programme des deux coalitions : emploi, questions sociales » (Laurent Clavel), 2010.
Service économique régional de Stockholm (réseau international de la DG Trésor), « Reforme fiscales en Suède ̔pour favoriser la compétitivité̕ », avril 2011.
Service économique régional de Stockholm (réseau international de la DG Trésor), « Le commerce extérieur de la Suède en 2011 » (Laurent Clavel), 9 mars 2012.
Service économique régional de Stockholm (réseau international de la DG Trésor), Séminaire sur le modèle nordique face aux crises du 13 avril 2012
(http://www.tresor.economie.gouv.fr/5336_seminaire-sur-le-modele-nordique-face-aux-crises).
Service économique régional de Stockholm (réseau international de la DG Trésor), « Quelles leçons tirer aujourd’hui de la crise des années 1990 en Suède ? » (Laurent Clavel et Guillaume Chabert), Trésor-Eco, septembre 2012,
https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/375918
Service économique régional de Stockholm (réseau international de la DG Trésor), « Structure du capitalisme suédois et enjeux pour les relations économiques entre la France et la Suède (Frédéric Lemaître), septembre 2012.
Service économique régional de Stockholm (réseau international de la DG Trésor), « Rapport Environnement 2012 » (Julien Grosjean et Lucie Debroux),
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/375090, notamment pp. 12-13.
Severinson Clara, Stewart Fiona, 2012, “Review of the Swedish National Pension Fund”, OECD Working papers on Finance, Insurance and Private Pension n° 17.
Simoulin Vincent, 2005, « Le « modèle suédois » : succès persistant, recompositions actorielles et reconfigurations intellectuelles, Cahiers internationaux de sociologie, 2005/2, n°119, pp. 289-309.
Steinmo Sven, 1988, “Social democracy vs. socialism : Goal Adaptation in social democratic Sweden”, Politics and Society.
Suppiot Alain, 1987, « Actualité de Durkheim. Notes sur le néo-corporatisme en France », Droit&Société, numéro 6/1987.
The Swedish Trade Union Confederation (LO), 2006, “How the swedish model is working”.
The Swedish Trade Union Confederation (LO), “The Swedish Social Democratic Party – An introduction », Disponible sous : http://www.socialdemokraterna.se/upload/Internationellt/Other%20Languages/TheSwedishSocialDemocraticParty.pdf
Touzé Vincent, 2007, « Les performances économiques de la Suède. Quelques éléments d’évaluation. », Revue de l’OFCE, n°100.
Vidal Jean-François, 2010, « Crises et transformations du modèle social-démocrate suédois », Revue de la régulation, 2e semestre/Automne 2010 : Varia.
Wehner Joachim, 2007, “Budget reform and legislative control in Sweden”, Journal of European public policy, pp. 313-332.
World Economic Forum, 2011, “The global Competitiveness Report 2011-2012”.
World Economic Forum, 2012, “The global gender gap report 2012”.
Zaring Olof, Eriksson C. Magnus, 2009, “The Dynamics of Rapid Industrial Growth : Evidence from Sweden’s Information Technology Industry, 1990-2004”, Industrial and Corporate Change, pp. 507-528.
Articles de presse
Libération, 1999, « La Suède perd un ministre des finances europhile », article du 13 avril.
Le Francofil, Dray Daniel, 2010, « Comment la Suède est devenue le pays de l’innovation ? », article du 8 juin.
Le Figaro, 2010, « Suède : prévisions de croissance à 4,5% », article du 20 août.
The Economist, 2012 “Decline and small: Small firms are a big problem for Europe’s periphery”, article du 3 mars.
The Economist, 2012, “Small is not beautiful: Why small firms are less wonderful than you think”, article du 3 mars.
Le Monde, 2013, « Vive le modèle suédois », Aghion Philippe et Berner Bénédicte, article du 10 janvier.
Sources statistiques
La grande majorité des données proviennent des bases de l’OCDE.
Annexes
Annexe 1. L’analyse structurelle-résiduelle
A. Intérêt de la méthode
Lʼidée générale sous-jacente à lʼanalyse structurelle-résiduelle (ASR) consiste à reconnaître que la croissance d’un territoire est imputable pour partie aux dynamiques sectorielles globales : toutes choses égales par ailleurs, le taux de croissance du territoire considéré sera dʼautant plus fort que ce territoire est spécialisé dans des secteurs globalement en croissance et/ou peu spécialisé dans des secteurs globalement en déclin.
Néanmoins, la structure des activités nʼexplique pas nécessairement lʼensemble de la dynamique du territoire : on peut observer, dans certains territoires, une évolution favorable de secteurs globalement en déclin, ou inversement. Autrement dit, la dynamique du territoire sʼexpliquerait en partie également par des facteurs régionaux spécifiques.
Lʼobjet même de lʼASR est de décomposer statistiquement la croissance du territoire en une composante structurelle (effet de la structure industrielle) et une composante résiduelle ou géographique (croissance non expliquée par la première composante).
Elle peut être réalisée sur différentes variables telles que la valeur ajoutée, le chiffre d’affaires ou l’emploi.
B. Méthode de l’analyse structurelle-résiduelle
On définit ETi qui est lʼécart total du territoire i, différence entre le taux de croissance du territoire (ti) et le taux de croissance de lʼensemble des territoires (t..),i.e. un agrégat : une région, un pays, un groupe de pays.
On définit également le taux de croissance théorique ti c’est-à-dire le taux que lʼon observerait pour le territoire i si chacun de ses secteurs évoluait au rythme observé pour lʼensemble des territoires.
où Pij est le poids du secteur j dans le territoire i
Pour calculer ce taux, il convient de remplacer, dans le calcul du taux de croissance, les taux observés dans le territoire i par les taux observés dans le territoire de référence.
Lʼécart structurel est la différence entre le taux de croissance théorique et le taux de croissance du territoire de référence (t..) du territoire de référence. Il s’écrit :
Si ESi > 0 (respectivement ESi < 0), la région est plus (moins) spécialisée que la moyenne dans des secteurs en croissance et/ou moins (plus) spécialisée que la moyenne dans des secteurs en déclin.
Lʼécart résiduel résume lʼensemble de la croissance non expliquée par la structure sectorielle. Il se déduit de la différence entre le taux de croissance du territoire et son taux de croissance théorique.
Il capte l’ensemble des facteurs présents sur le territoire qui vont venir influencer positivement ou négativement le développement des unités locales (par exemple, les prises de décisions des équipes managériales, les choix en termes de politiques publiques…). Sans enquêtes de terrain, sans analyses qualitatives, il n’est pas possible de préciser la nature exacte de cet effet résiduel.
Logiquement, on retrouve :
Enfin, chacun des secteurs contribue positivement ou négativement à l’écart structurel et à l’écart résiduel.
Annexe 2. Contribution par secteur à l’effort de R&D suédois
Source : OCDE. Calculs la Fabrique de l’industrie.
* HT : secteur de haute technologie.
MHT : secteur de moyenne haute technologie.
MFT : secteur de moyenne faible technologie.
FT : secteur de faible technologie. Cette classification est fonction de l’intensité technologique. Elle fait référence à la typologie des activités fixée par la CITI révision 3.
Emilie Bourdu, Les transformations du modèle économique suédois, Paris, Presses des MINES, 2013.
ISBN : 978-2-35671-048-2
© Presses des MINES – TRANSVALOR, 2013
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de lʼindustrie
81, boulevard Saint-Michel -75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr


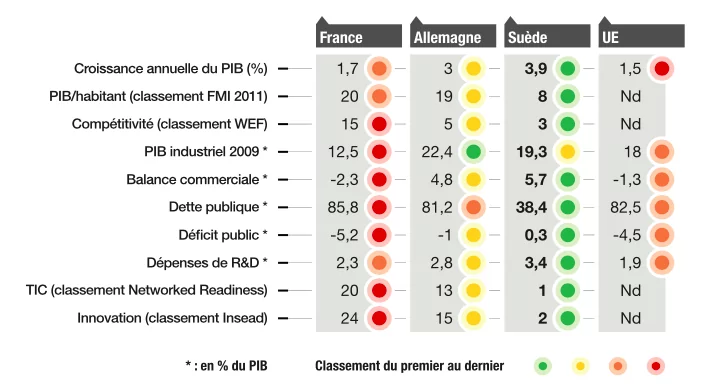
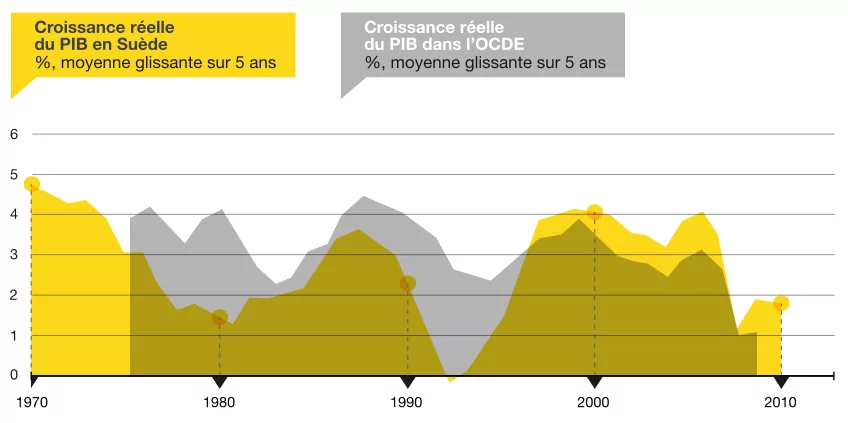
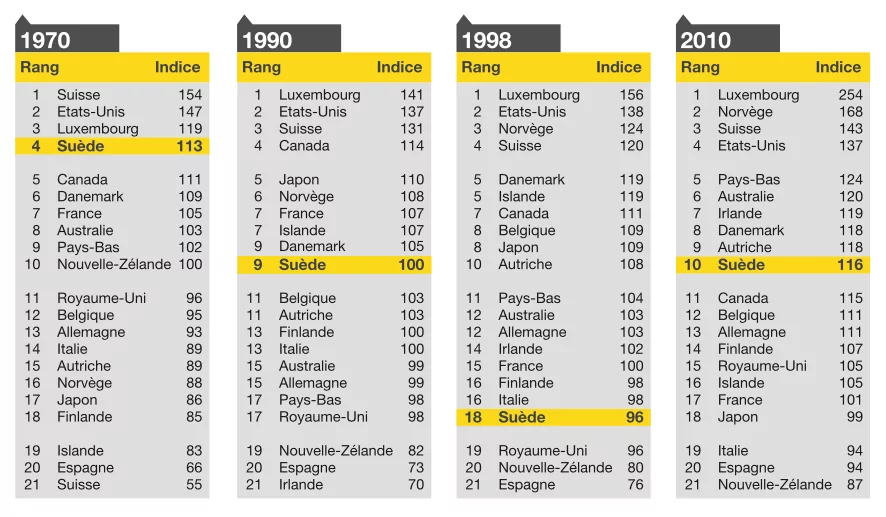
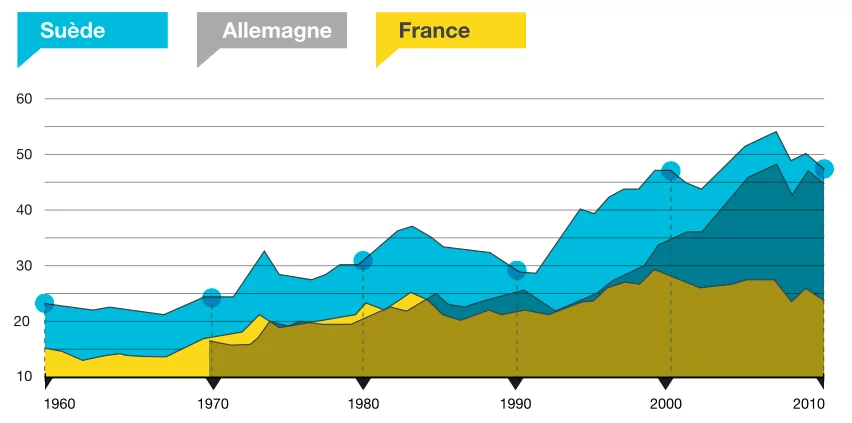
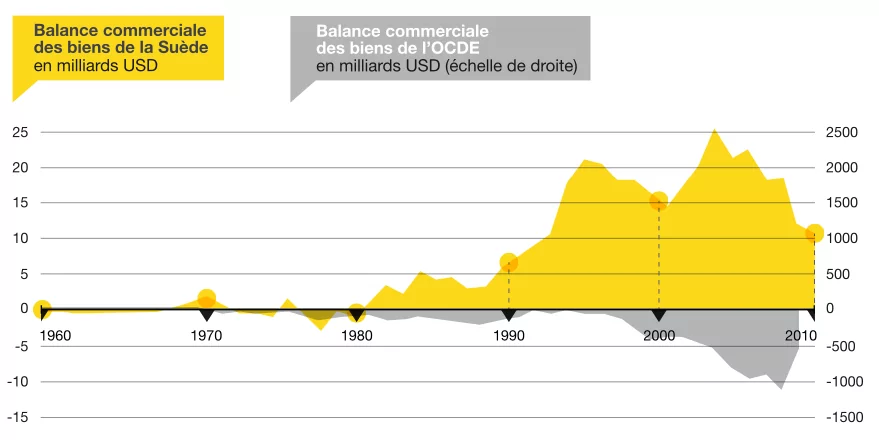
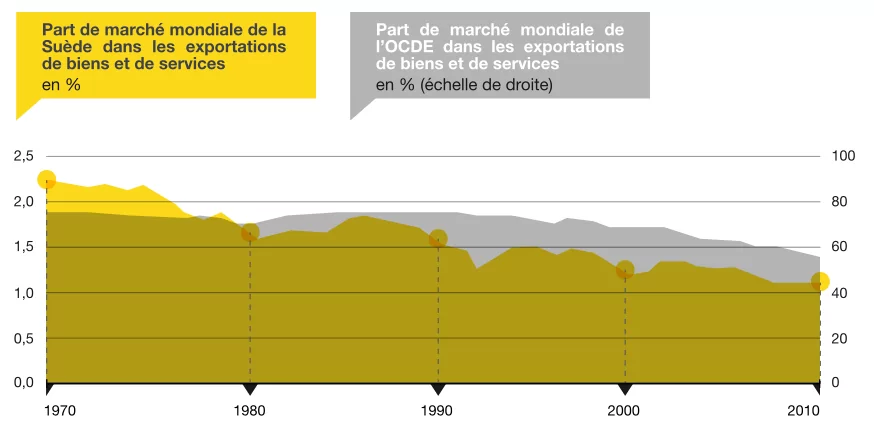
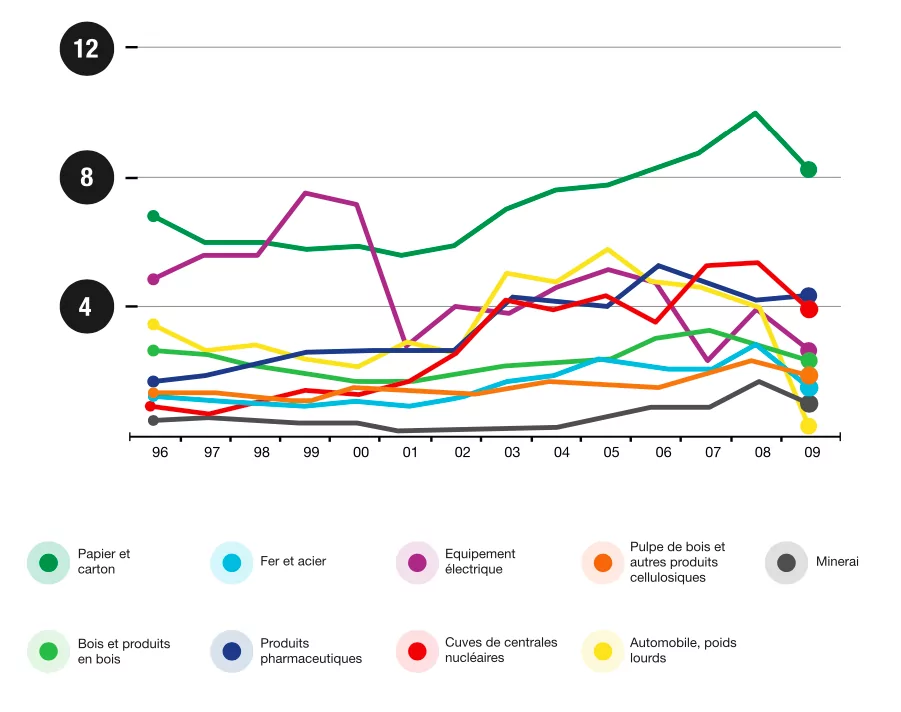
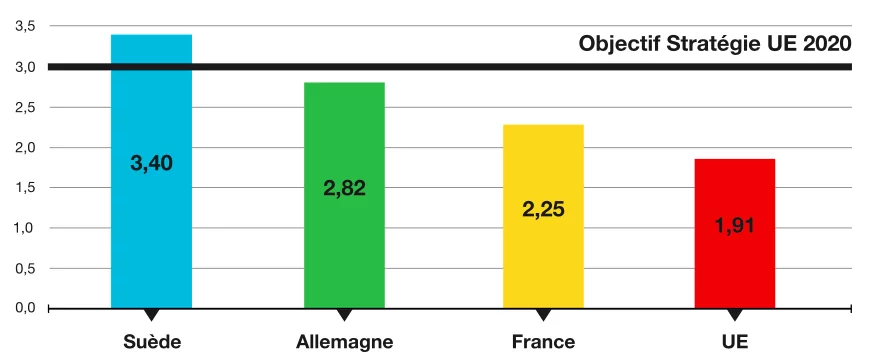
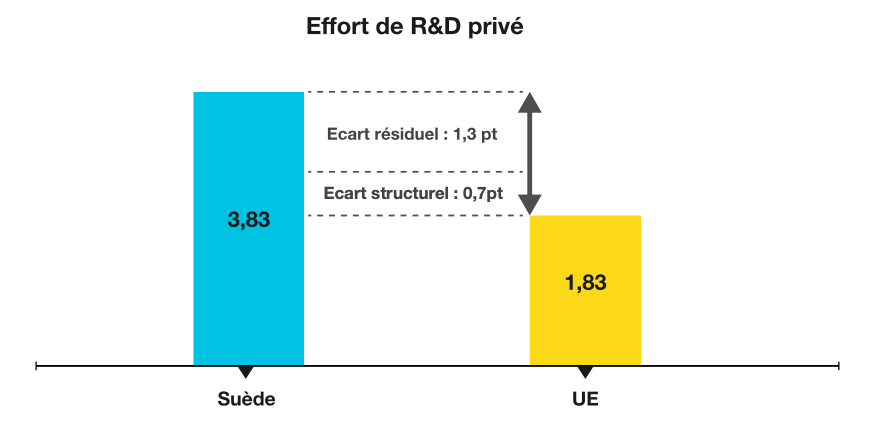
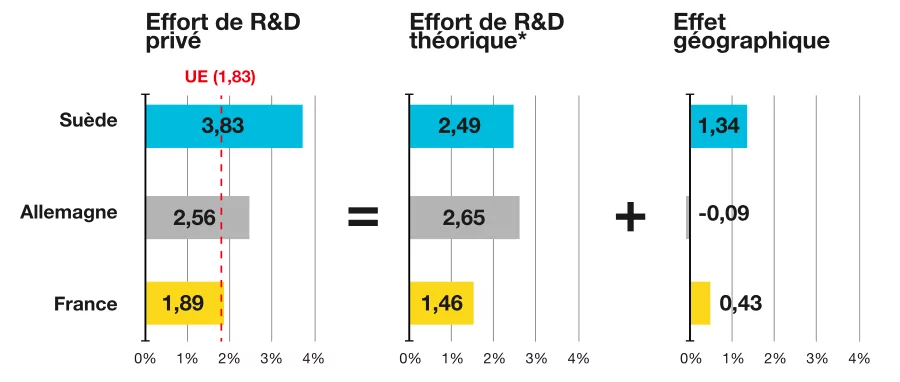
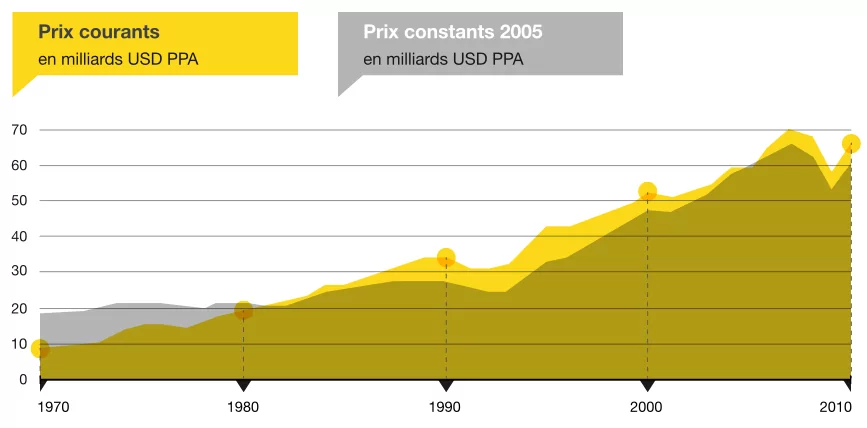
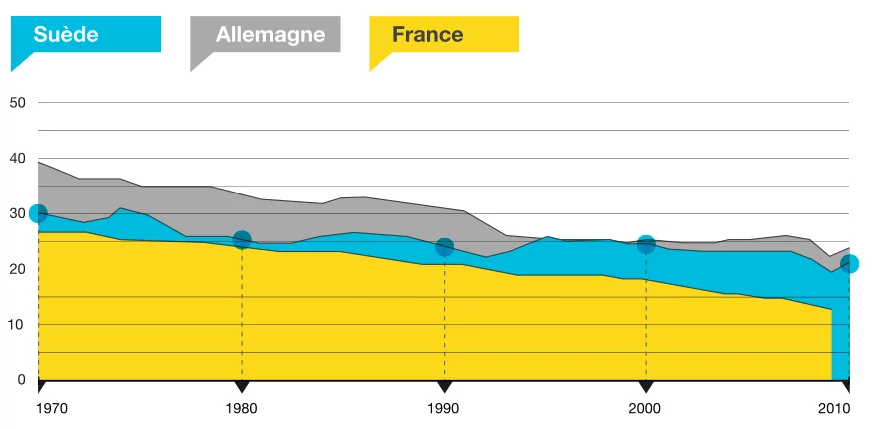
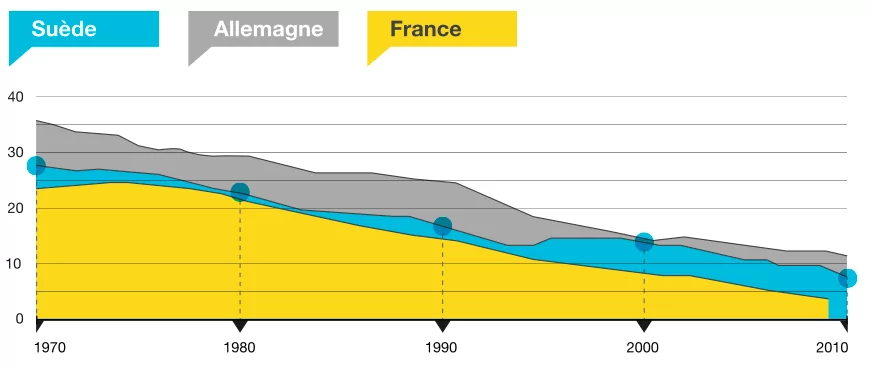
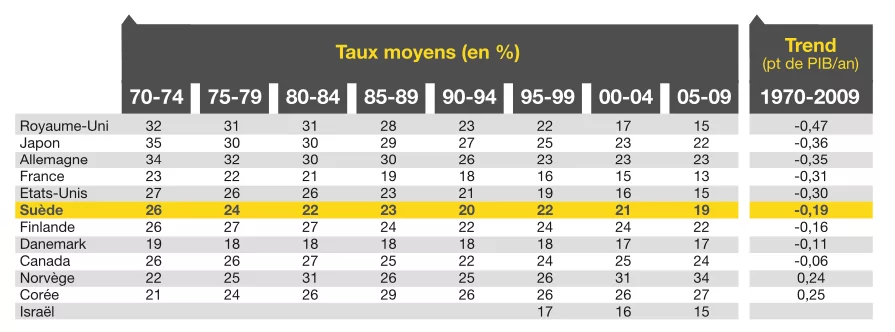
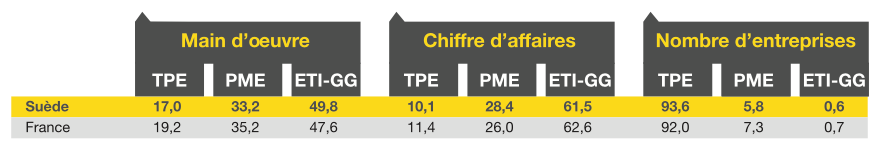
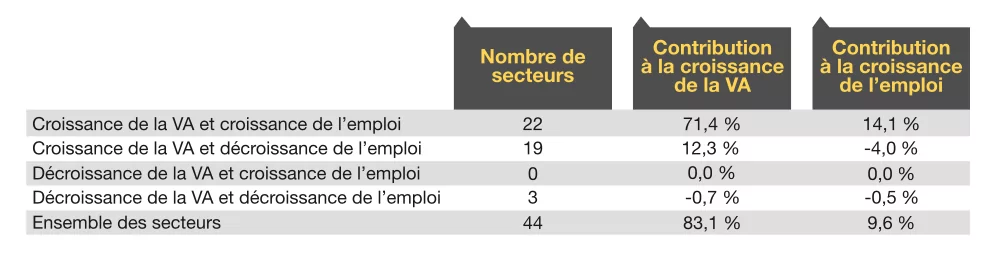
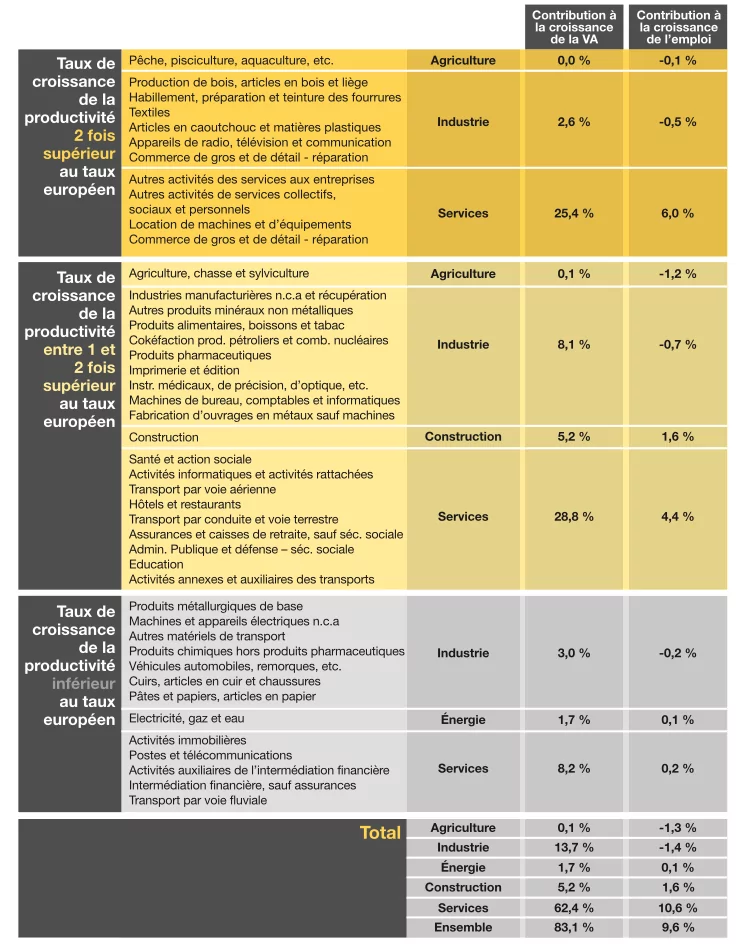
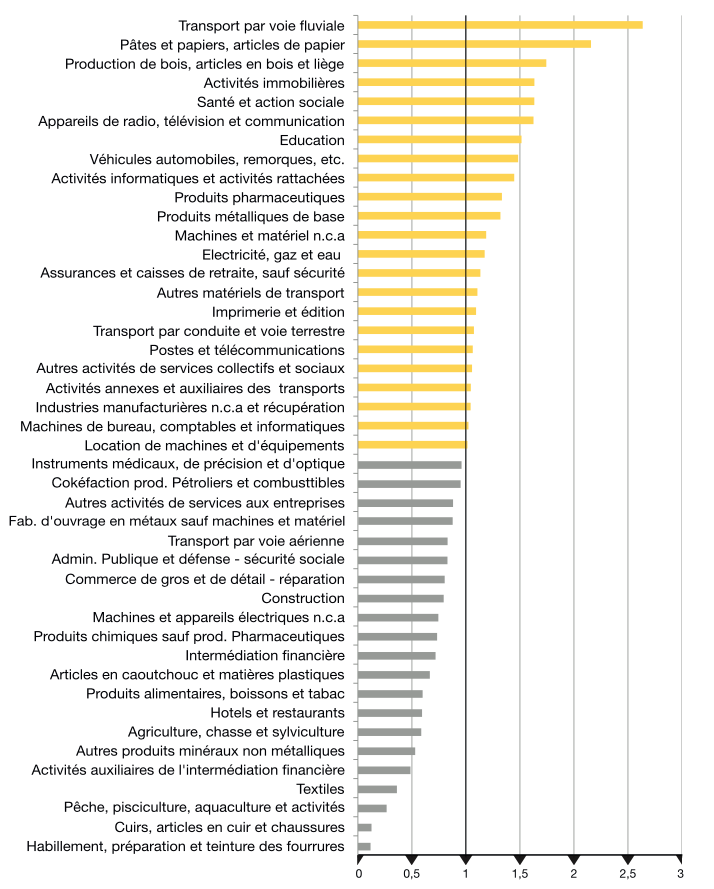
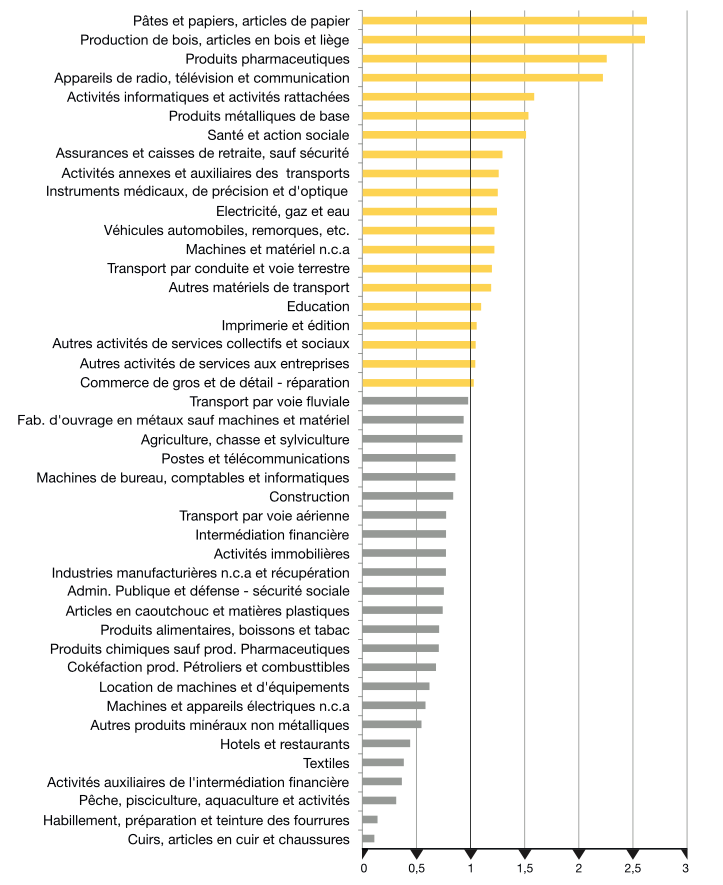
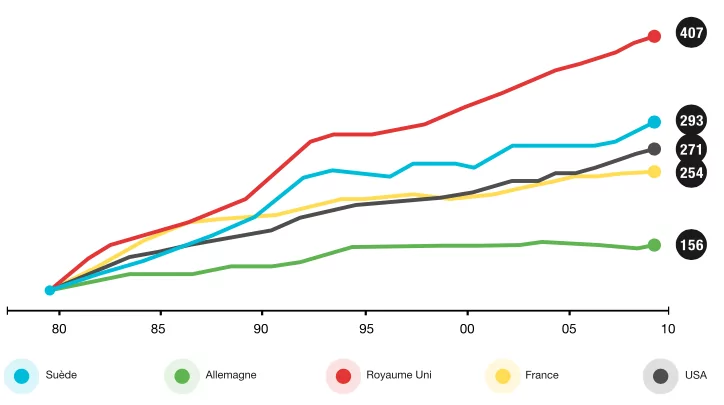
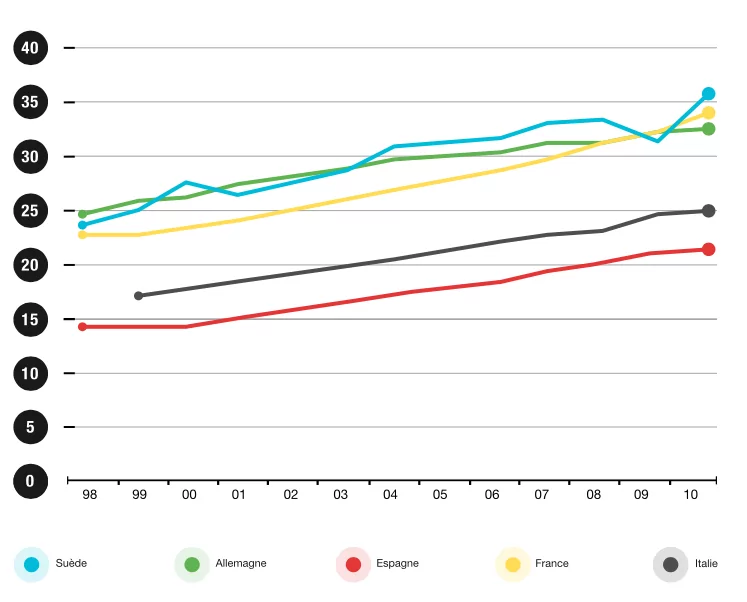
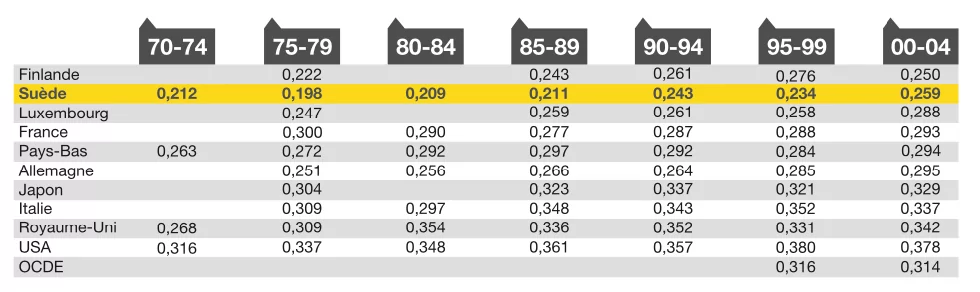
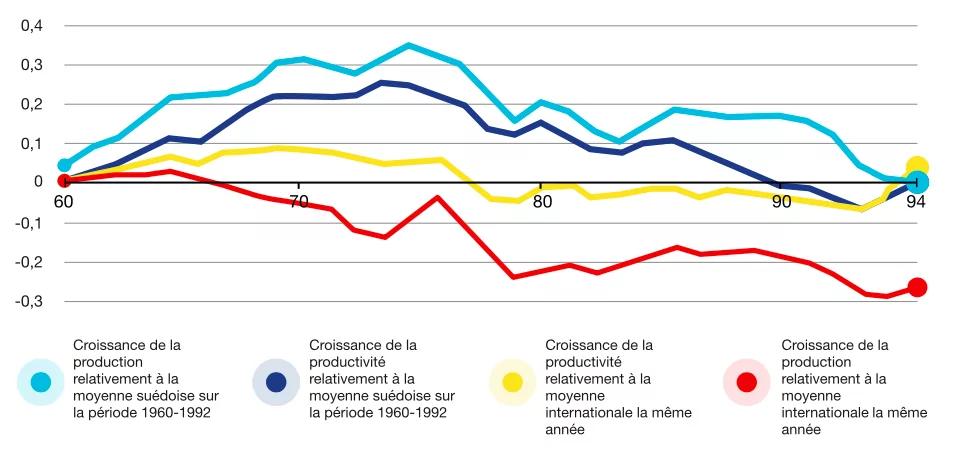
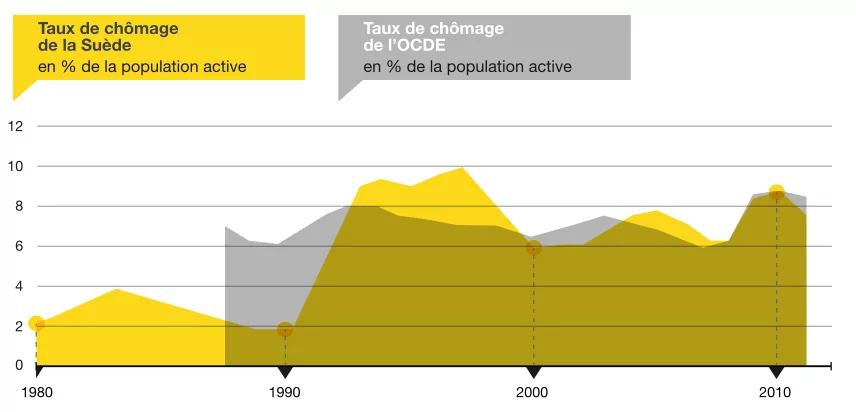
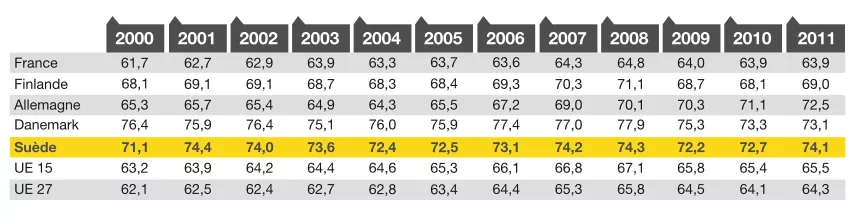

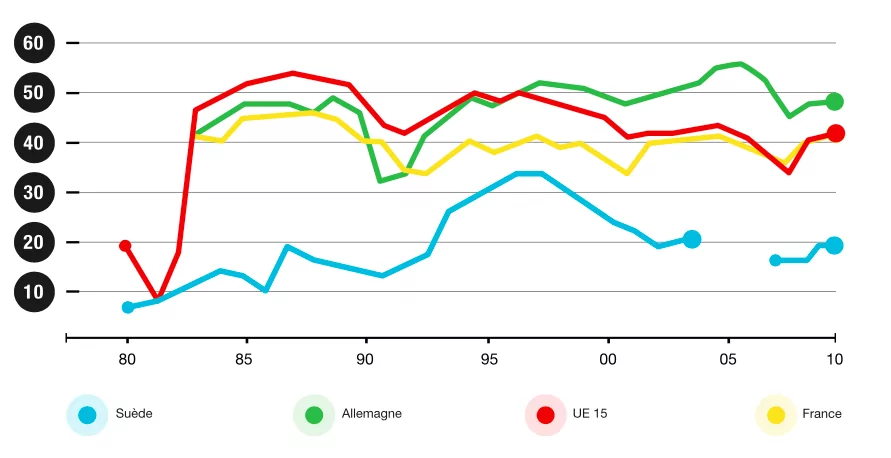

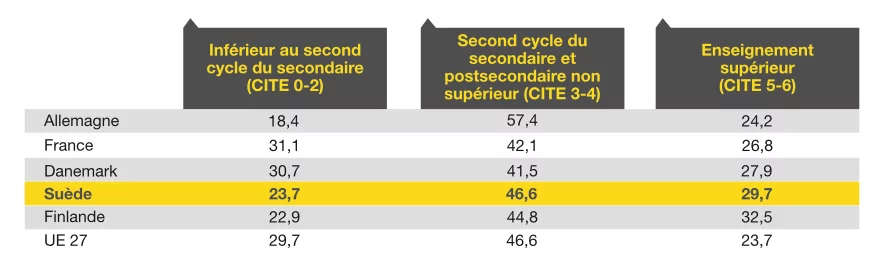
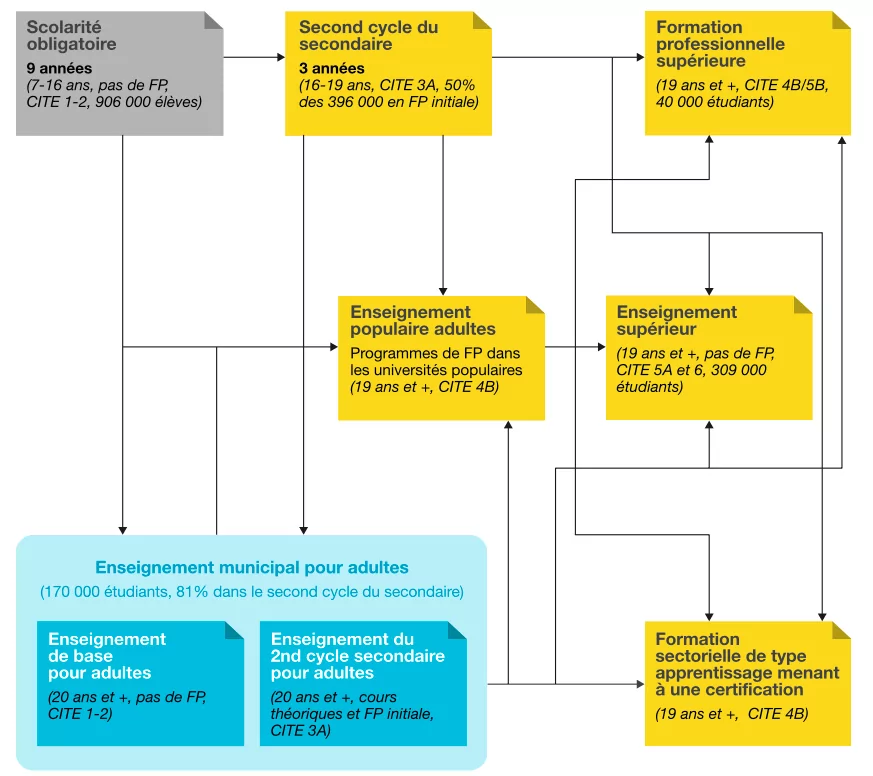
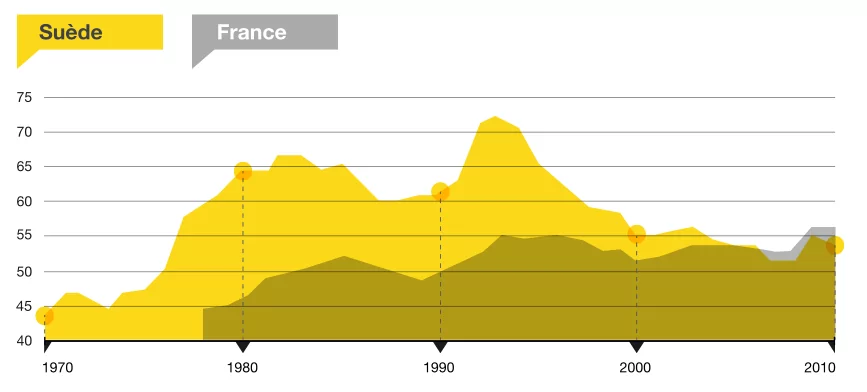
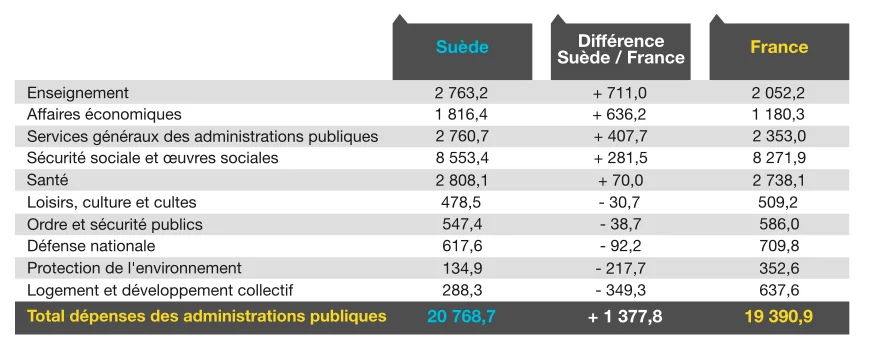
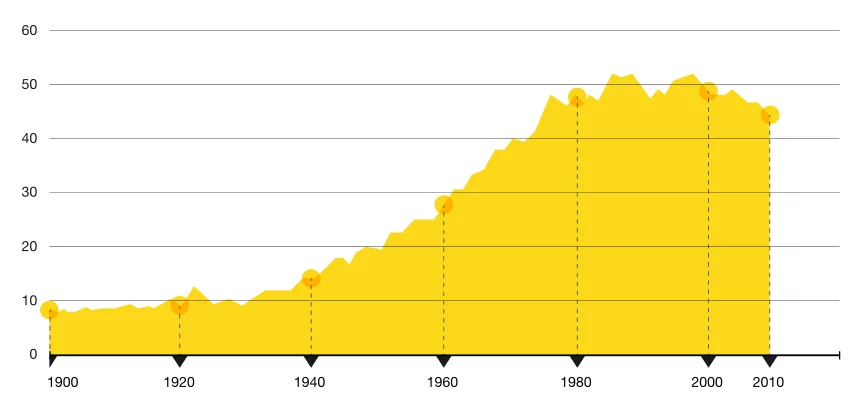
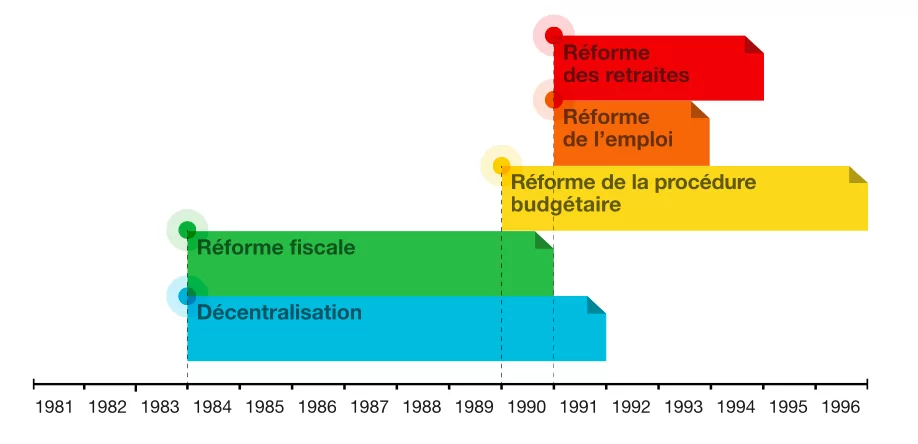
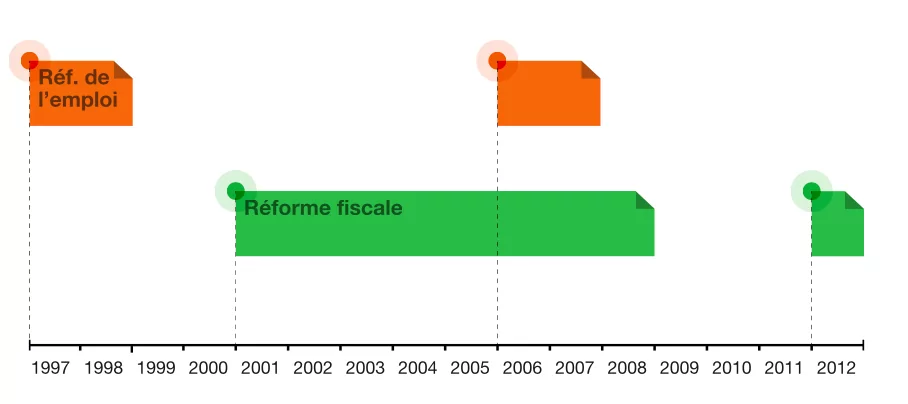
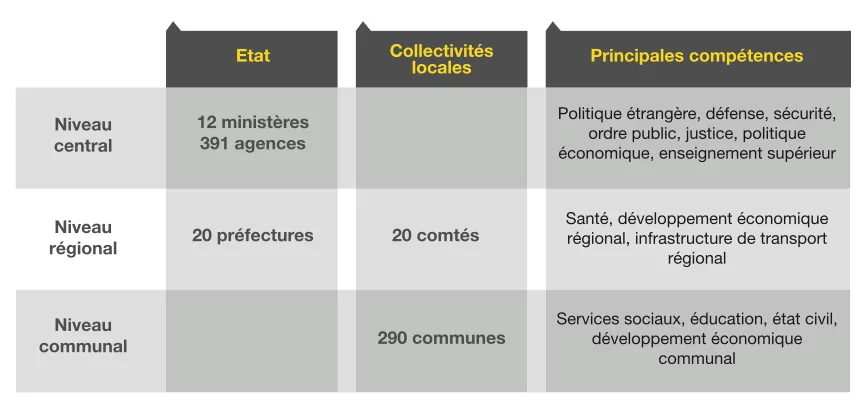
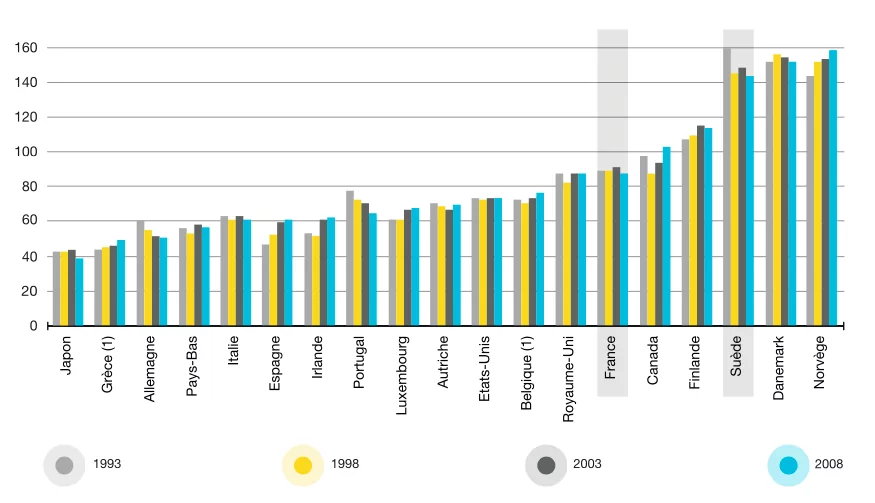
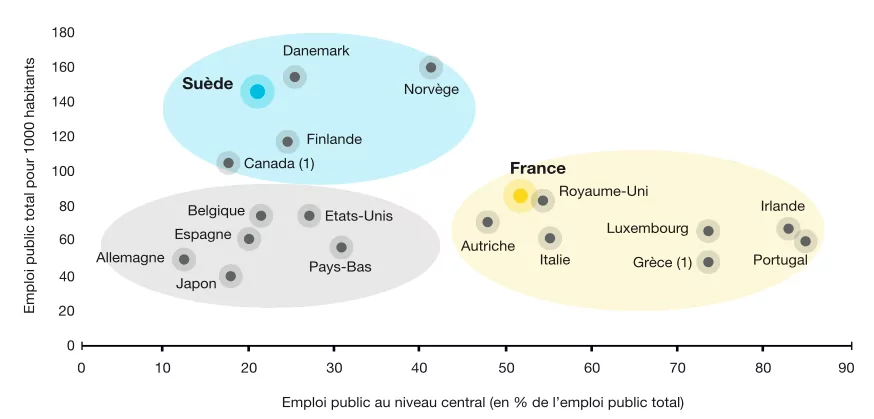
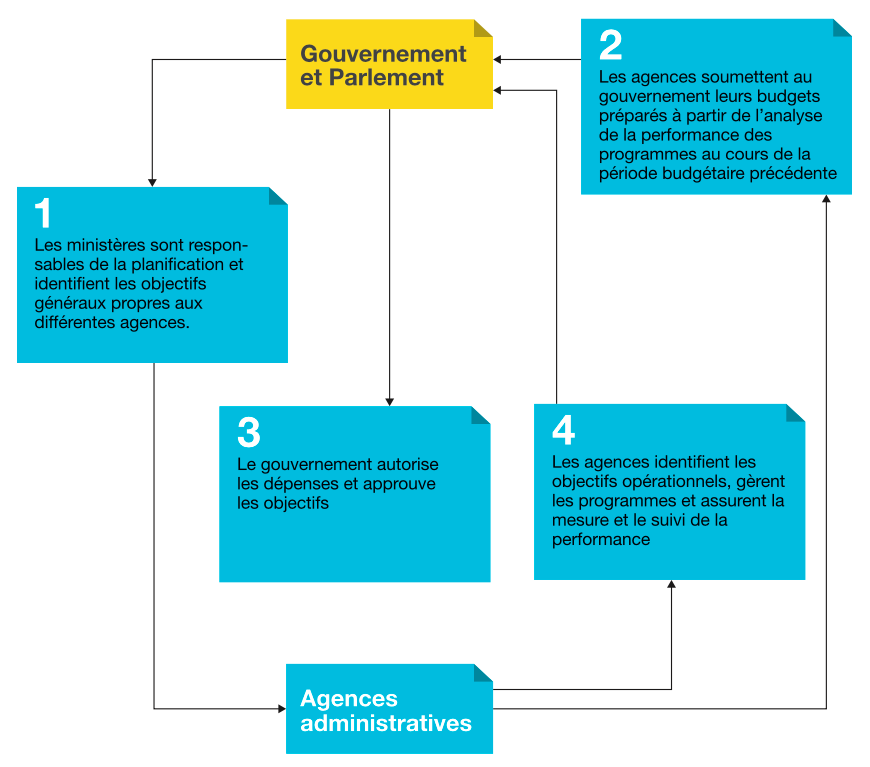
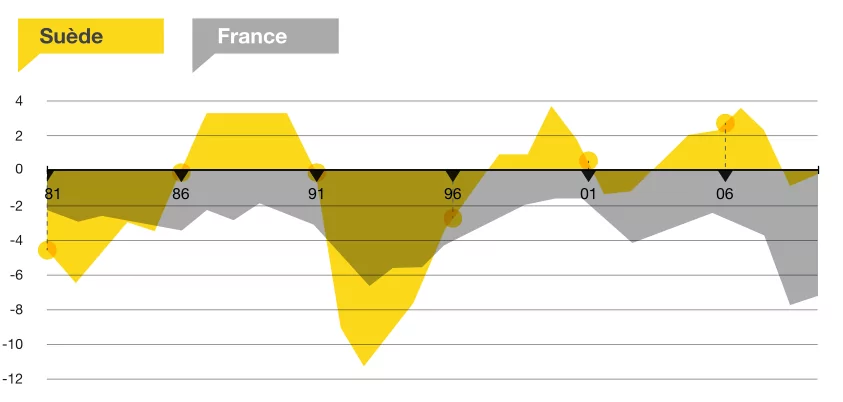
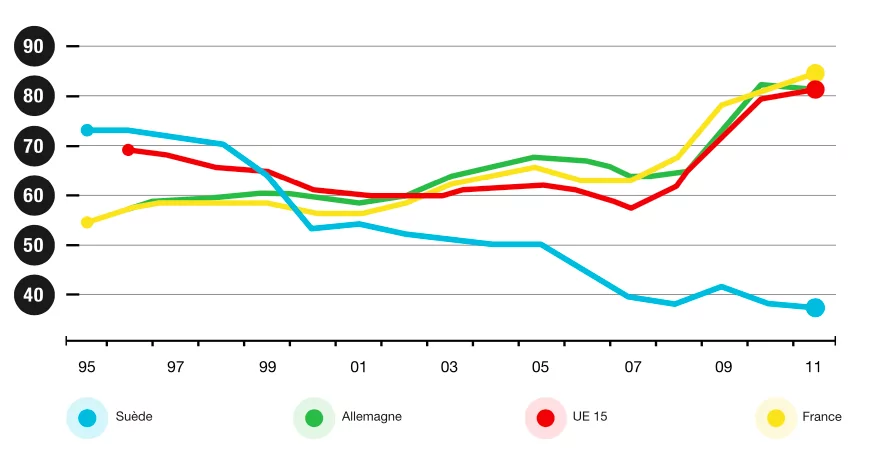
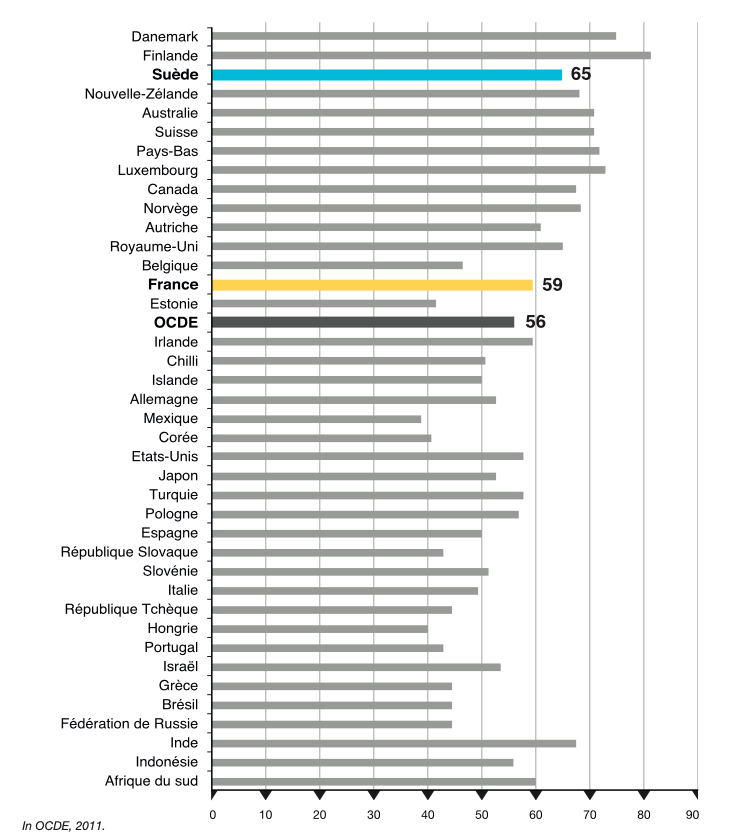
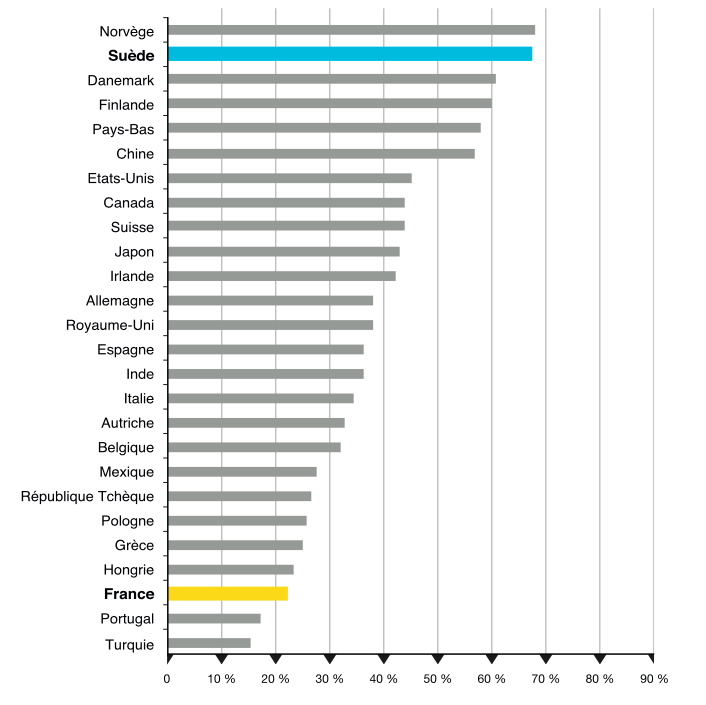
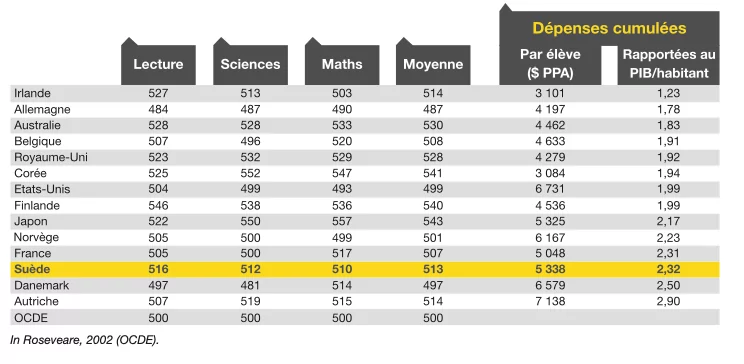
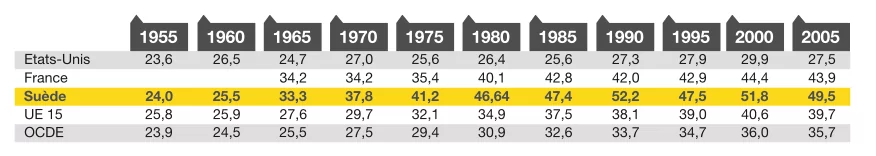
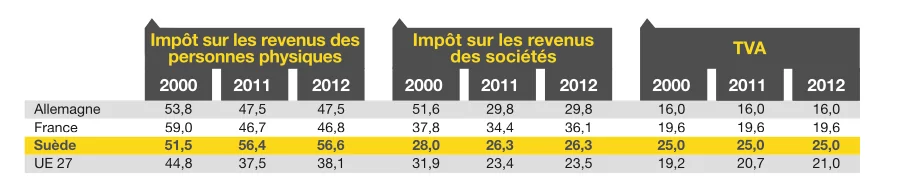

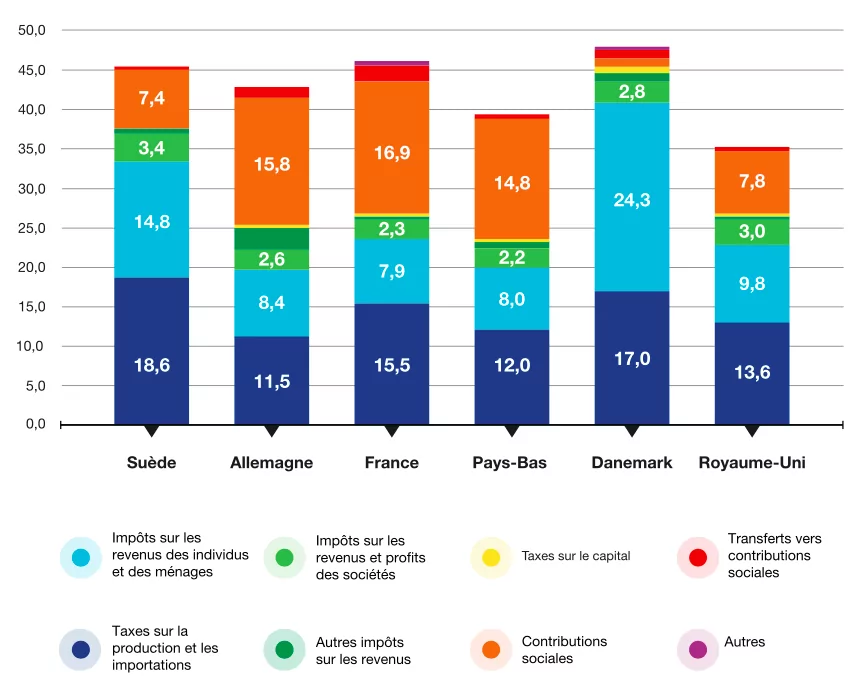
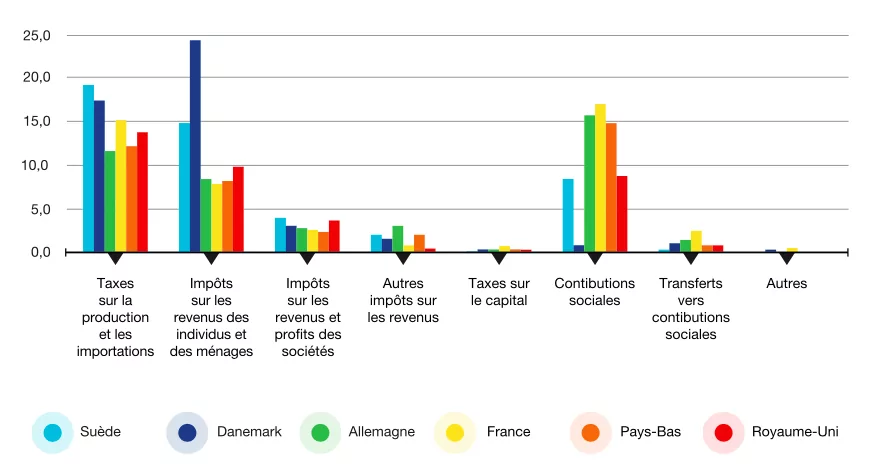
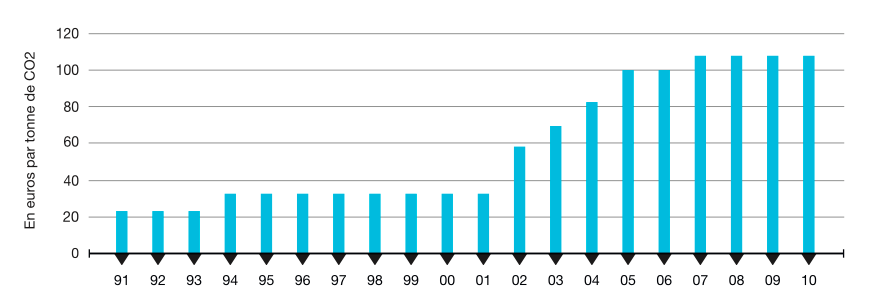
.png)