Les jeunes élites face au travail – Regards croisés entre Polytechnique et Harvard

© Hurca/shutterstock.com
Avant-propos
En écho sans doute à l’attention croissante portée aux causes et aux effets de la souffrance au travail, nous traversons une période de profonde interrogation concernant la place du travail dans nos vies et les attentes que nous pouvons nourrir à son égard. Cette réflexion traverse toutes les générations, des étudiants aux retraités, et toutes les parties prenantes, actifs et employeurs.
Les entreprises, au-delà de leurs particularités sectorielles et géographiques, partagent très largement cette inquiétude d’avoir de plus en plus de mal à recruter et à conserver leurs talents. Leur questionnement aigu se mue même en inquiétude lorsqu’il s’agit de s’adresser aux plus jeunes générations : comme si les employeurs manquaient des codes ou des repères pour comprendre leurs attentes et proposer une offre d’emploi à même de les satisfaire.
Cette question importante est très largement débattue dans la presse, à tel point que les opinions plus ou moins savantes exprimées à ce propos sont loin d’être convergentes. Il importe donc d’aborder ce sujet éminent avec humilité et discernement.
C’est tout l’objet de cet ouvrage que d’apporter une contribution à l’édifice : en donnant la parole à des jeunes alumni de deux écoles prestigieuses, l’École polytechnique et l’université de Harvard, nous cherchons à comprendre dans leurs récits comment se construisent leurs attentes et leurs décisions, et sur quels points les jeunes élites françaises se distinguent ou au contraire se rapprochent de leurs pairs américains.
Nous espérons que ce document offrira aux entreprises et aux acteurs de l’emploi une source de réflexion sur cet enjeu contemporain.
La collection des « Docs de La Fabrique » rassemble des textes qui n’ont pas été élaborés à la demande ni sous le contrôle de son conseil d’orientation, mais qui apportent des éléments de réflexion stimulants pour le débat et la prospective sur les enjeux de l’industrie.
L’équipe de La Fabrique
Résumé
La génération qui entre ou vient d’entrer dans le monde du travail suscite nombre d’interrogations. Est-elle encore intéressée par le travail lui-même ? Renâcle-t-elle à intégrer les grandes entreprises au motif qu’elles ne sont pas assez axées vers la survie de la planète ? Ne supporte-t-elle plus que le télétravail et entend-elle surtout se protéger des incursions professionnelles dans sa vie personnelle ?
Nombre d’études ont été lancées pour essayer de comprendre si une « rupture » générationnelle était en train de s’opérer ou du moins, une « quête de sens » au travail qui serait d’autant plus marquée chez les jeunes générations. Elles procèdent généralement par questionnaires sur de grands échantillons. La littérature faisant état de différences marquées liées à l’appartenance sociale et au niveau d’éducation, ce Doc propose d’apporter une première pièce au puzzle, en se focalisant sur les attentes des jeunes élites françaises et américaines. Plus précisément, il s’appuie sur une étude qualitative comparative, qui croise les regards d’une vingtaine d’ alumni issus respectivement de l’École polytechnique et de l’université de Harvard, pour identifier d’autant mieux ce qui fait ou non la singularité des diplômés de grandes écoles françaises dans leur rapport au travail.
Ce Doc met en avant au moins une différence majeure dans le rapport au travail des deux populations étudiées avec, d’un côté, les alumni de Harvard qui tendent à aborder le travail plutôt comme une transaction, c’est-à-dire un investissement de soi contre de l’argent, alors que les diplômés de Polytechnique insistent davantage sur la nature relationnelle du travail. Ces derniers se montrent en effet globalement plus exigeants quant à l’ambiance au travail et à la qualité des interactions avec leurs collègues. Ils se distinguent également par leurs attentes élevées concernant l’engagement de l’entreprise en matière environnementale, sujet rarement évoqué par les alumni de Harvard qui, dans l’ensemble, tiennent des propos plus assumés sur la fonction instrumentale du travail.
Signe d’une globalisation croissante des élites, les réponses récoltées de part et d’autre de l’Atlantique s’avèrent toutefois concordantes sur un certain nombre de points : la volonté de se dépasser constamment et de sortir de sa zone de confort, la conscience de ses privilèges éducatifs et sociaux, le profil attendu du manager qui doit savoir alterner entre implication et lâcher-prise, le souhait d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle ou encore, l’aversion à l’égard des lourdeurs bureaucratiques.
Autre similitude phare : la propension des jeunes interrogés à raisonner par « arbitrage » entre les dimensions constitutives du sens au travail. Ce résultat s’avère d’autant plus questionnant qu’il inclut souvent la mission de leur organisation dans la « balance » : de fait, les jeunes alumni interrogés ont tendance à relativiser l’importance de cette dimension par rapport à d’autres préoccupations. Dit autrement, les récits collectés ne viennent pas corroborer l’idée d’une nouvelle « radicalité » des jeunes élites au sujet de l’utilité sociale de leur activité, pas même du côté français où l’on entend pourtant fréquemment retransmis des discours protestataires tenus par les étudiants de grandes écoles. Sans pour autant se départir des grandes tendances culturelles précitées, les jeunes diplômés laissent néanmoins transparaître leur subjectivité dans pareil raisonnement par arbitrage puisque chacun définit la ou les variables « pivots », c’est-à-dire les préoccupations qui pèsent le plus dans la balance, en fonction de sa sensibilité.
D’un point de vue organisationnel, il ne ressort donc des entretiens aucun critère clé à privilégier de la part des employeurs pour attirer et retenir les jeunes diplômés. Aussi prosaïque que cela puisse paraître, c’est au contraire la mise en place d’un patchwork de mesures qui semble particulièrement adaptée. Ainsi, des réformes concernant la mission des organisations, en déjouant notamment le piège du greenwashing , doivent être menées en tandem avec d’autres pratiques organisationnelles « plus tangibles », comme l’offre d’un salaire compétitif, un contenu du travail polyvalent et stimulant intellectuellement, un accompagnement managérial qui dose savamment « lâcher prise » et soutien dans la montée en compétences et responsabilisation ou encore, la possibilité de travailler à distance et la garantie d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Remerciements
Nous remercions tout d’abord chaleureusement Elie Saad et Adib Alhachem, étudiants à l’École polytechnique (X20), pour leur apport empirique à cette étude. Ceux-ci ont conduit, parfois en binôme, parfois avec l’aide d’Anne-Sophie Dubey, les dix entretiens côté français.
Nous remercions également Florence Charue-Duboc, professeure à l’École polytechnique et présidente du département Management de l’Innovation et Entrepreneuriat au sein de ce même institut, pour la confiance qu’elle nous a accordée en nous donnant l’opportunité de travailler avec ces deux étudiants.
Nous tenons pareillement à remercier Nien-hê Hsieh, professeur à la Harvard Business School, d’avoir accueilli Anne-Sophie Dubey en séjour de recherche aux États-Unis et rendu ainsi possible la comparaison entre les deux populations étudiées.
Nous sommes bien sûr redevables envers les dix-neuf participants à l’étude qui ont grandement contribué à la richesse de cette étude par leur ouverture d’esprit et la sincérité de leur témoignage.
Enfin, nous sommes dûment reconnaissantes envers Hervé Dumez, professeur à l’École polytechnique et directeur de l’Institut Interdisciplinaire de l’Innovation (i 3 ) et Vincent Charlet, délégué général de La Fabrique de l’industrie, pour leur regard critique à différentes étapes de rédaction de cet ouvrage.


Introduction
Big Quit ou Great Resignation aux États-Unis1, difficultés de recrutement accentuées en France2, protestations des diplômés des grandes écoles françaises (HEC, AgroParisTech…) contre le capitalisme contemporain…3 : tous ces phénomènes sont aujourd’hui invoqués pour décrire une « tendance » qui serait à l’œuvre parmi les jeunes diplômés, celle d’un rapport au travail significativement différent de celui des cohortes qui les ont précédées. Depuis quelques années, de nombreux médias se font ainsi le relai d’une « quête de sens » au travail, en particulier chez les jeunes diplômés, qui se traduirait notamment par des exigences d’engagement sociétal et environnemental envers leur employeur et par la recherche d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
De nombreuses enquêtes se sont donc attachées à étudier les préoccupations des nouvelles générations, à commencer par la sauvegarde de l’environnement, l’utilité sociale du travail, l’égalité entre les femmes et les hommes ou encore la lutte contre les discriminations. Mais il n’est pas aisé de conclure à la réalité même du phénomène, tant les résultats diffèrent d’une étude à l’autre. Certaines enquêtes s’accordent sur l’idée que les jeunes, au premier rang desquels les plus diplômés, seraient particulièrement exigeants à l’égard du travail et seraient prêts à prendre des emplois moins rémunérateurs mais porteurs de sens (Apec, 2022). En revanche, d’autres travaux n’identifient pas d’effet de génération en la matière et concluent que le phénomène s’étend au contraire à une large fraction de la population, tous âges confondus (e.g., Coutrot et Perez, 2021).
De l’aveu même des employeurs, cette question des attentes et des frustrations propres aux jeunes générations face au travail mérite donc d’être approfondie. Si l’âge est un critère possible, le rapport au travail pourrait aussi et même surtout être déterminé par l’origine socio-économique et le niveau d’éducation (Loriol, 2017), lesquels jouent éminemment sur la capacité individuelle à naviguer dans l’espace social en adaptant ses préférences à sa situation socioéconomique. Il n’est alors pas surprenant que ceux nés dans un milieu défavorisé soient confrontés à un champ d’exploration moins ouvert que leurs homologues privilégiés4. Les « jeunes » ne sont pas un groupe homogène ayant les mêmes attentes ni les mêmes préoccupations.
Ces éléments nous invitent à considérer la jeunesse comme plurielle dans son rapport au travail plutôt qu’en comparaison aux générations plus anciennes5. Dans cette optique, nous proposons ici d’apporter une première pièce au puzzle, en nous focalisant sur les attentes des jeunes issus de CSP supérieures. Plus précisément, cette étude porte sur la population très spécifique des jeunes alumni issus respectivement de deux écoles prestigieuses française et américaine : l’École polytechnique et l’université de Harvard. L’originalité de ce travail repose sur la confrontation des résultats de 19 entretiens qui, par un jeu de contraste, mettent en lumière ce qui fait ou non la singularité des jeunes diplômés français dans leur rapport au travail – d’autant qu’il est souvent fait l’hypothèse d’une certaine homogénéisation au niveau des élites managériales, liée à la mondialisation (e.g., Wagner, 2020).
L’objet de cette étude est ainsi de brosser un portrait global du rapport au travail des jeunes français et américains respectivement issus de Polytechnique et de Harvard. Cinq grands thèmes, donnant lieu à cinq chapitres, sont ici étudiés. Dans un premier temps, il s’agira de mettre en évidence un syndrome du « bon élève » commun aux deux populations, se traduisant notamment par un sens de l’exigence élevé et un besoin constant de progresser. Ensuite, nous noterons que l’accompagnement managérial se révèle être une source d’engagement au travail de part et d’autre de l’Atlantique, en venant jouer un rôle important dans cette quête de réalisation de soi et de montée en autonomie. Nous verrons toutefois que les alumni de l’École polytechnique ont tendance à accorder un poids plus important à la bonne entente avec leurs collègues que ceux de Harvard. Dans un troisième temps, nous nous pencherons sur la recherche d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, qui apparaît comme une préoccupation de plus en plus répandue et commune aux deux populations. Ensuite, nous verrons que l’utilité sociale du travail, de même que les engagements des entreprises en matière environnementale, sont des éléments plus ou moins considérés par les deux populations étudiées. Il semble parfois que la question de l’impact individuel prime sur celle de la mission de l’organisation. Ce quatrième chapitre sera aussi l’occasion de discuter des considérations pécuniaires qui restent importantes chez les jeunes diplômés. Finalement, le cinquième chapitre présentera la propension des jeunes interrogés à raisonner par « arbitrage » entre les dimensions constitutives du sens au travail. En dépit des tendances culturelles retracées dans les chapitres précédents (notamment sur la qualité des relations ou le rapport à l’argent), la quête de sens au travail conserve un caractère subjectif dans son exécution en tant que telle chez les jeunes diplômés.
- 1 ‒ Selon un rapport du Bureau des statistiques du travail américain (Bureau of Labor Statistics), plus de 4,5 millions de personnes ont quitté leur emploi aux États-Unis en novembre 2021, un chiffre jamais atteint auparavant. Notons toutefois que les démissions enregistrées concernent majoritairement les emplois non-qualifiés : lire l’article “More quit jobs than ever, but most turnover is in low-wage work”, New York Times, du 4 janvier 2022.
- 2 ‒ Selon une étude de la Dares (août 2022), les difficultés de recrutement se sont accentuées dans le contexte de la reprise économique post-Covid. Selon l’institution, le contexte économique « reflète le dynamisme du marché du travail et une situation dans laquelle le pouvoir de négociation se modifie en faveur des salariés ».
- 3 ‒ Lire l’article « HEC, AgroParisTech… Comment les cérémonies de diplômes des grandes écoles sont devenues politiques », Les Echos Start, du 17 juin 2022.
- 4 ‒ Voir par exemple : Appadurai, A. 2004. “The Capacity to Aspire: Culture and the Terms of Recognition”, in V. Rao and M. Walton (eds): Culture and Public Action (Stanford, CA, Stanford University Press) ; ou Ray, D. 2006. “Aspirations, Poverty and Economic Change”, in A.V. Banerjee, R. Bénabou and D. Mookherjee (eds): Understanding Poverty (Oxford, Oxford University Press).
- 5 ‒ Cette étude ne dit donc rien des cohortes précédentes et ne permet pas, en cela, de confirmer ni d’infirmer l’hypothèse d’une rupture des jeunes par rapport à leurs aînés en matière d’aspirations professionnelles.
Méthode et limites de l’étude
Cette étude comparative repose sur des entretiens qualitatifs menés avec dix alumni de l’École polytechnique et neuf alumni de l’université de Harvard (figure I). En 2022, l’une des co-autrices de cet ouvrage, Anne-Sophie Dubey, doctorante à l’École polytechnique en parallèle de son activité de chargée d’études à La Fabrique de l’industrie, a encadré deux étudiants de Polytechnique – que nous nommerons parfois X – , Elie Saad et Adib Alhachem, sur la question des attentes au travail des jeunes salariés. Anne-Sophie Dubey a ensuite eu l’occasion de mettre à profit son séjour de recherche à la Harvard Business School durant l’été 2022 pour répliquer cette étude auprès d’une population similaire. De fait, à l’aune de sa réputation liée au taux d’acceptation, Harvard peut être perçue comme l’un des pendants américains de Polytechnique, à la différence majeure qu’elle ne forme pas uniquement des ingénieurs mais comprend plus de facultés universitaires (les profils interrogés côté américain vont de l’ingénierie à l’économie en passant par les sciences humaines et la littérature).
L’échantillon a été constitué sur la base de trois critères majeurs : primo , des individus proches en âge de la génération Z (25 ans au maximum) dont il est souvent fait l’hypothèse qu’elle se situe en rupture par rapport aux générations précédentes dans ses attentes à l’égard du marché du travail6; secundo , des personnes dotées d’un minimum d’expérience en ayant notamment commencé à travailler avant le début de la crise Covid, largement admise comme déstabilisante ; tertio , et symétriquement, des personnes qui ne soient pas actives depuis trop longtemps, pour éviter les souvenirs flous ou partiels de leur insertion professionnelle – l’idée ici étant justement d’observer leurs éventuelles surprises, bonnes comme mauvaises. Ainsi, les alumni sélectionnés ont obtenu leur diplôme entre 2017 et 2019 ; ils avaient donc entre trois et cinq ans d’expérience professionnelle au moment de l’enquête.
Pour ce qui est des secteurs d’activité, deux autres critères ont été appliqués : une diversité qui reflète les débouchés traditionnels de ces élèves (recherche, conseil, industrie, entrepreneuriat et fonction publique)7; un mélange entre des profils dont le début de carrière s’est inscrit en continuité des stages menés dans le cadre de la scolarité et d’autres qui semblent avoir connu des remises en question (par exemple en étant passés du privé au public).
Les entretiens avec les 19 sujets de l’étude étaient semi-ouverts, d’une durée d’environ 45 minutes à une heure chacun, en visio-conférence. Des comptes-rendus d’entretien détaillés ont été rédigés pour chaque interview. En outre, à l’exception d’une personne, toutes ont donné leur consentement pour être enregistrées, ce qui a permis aux autrices de rester fidèles à leurs propos et de retranscrire les verbatim . Les données ont ensuite été anonymisées. Les entretiens ont été menés avec l’aide d’un guide rédigé sur la base d’une revue de la littérature grise et académique. Ce guide a été construit autour de quatre grandes thématiques :
• Socialisations scolaires et antérieures : la première partie de l’entretien a trait aux origines socio-économiques et aux socialisations scolaires, à l’université et avant (avec des questions sur les motivations pour rejoindre l’X ou Harvard, le parcours scolaire avant d’y entrer, les choix de cours d’approfondissement, le métier des parents, les activités extracurriculaires…) ;
• Entrée dans le monde du travail et changements notables au niveau des représentations et attentes au travail (i.e. bonnes et mauvaises surprises) : la deuxième partie de l’entretien a été conçue pour identifier les événements sources de questionnement pour les personnes interviewées, avec un premier ensemble de questions sur les éventuelles attentes déçues et les agréables surprises lors des premières expériences professionnelles (y compris les stages), et un second volet sur les effets ressentis de la crise Covid ;
• Les éléments constitutifs du sens du travail : la troisième partie s’inspire des travaux menés par Coutrot et Perez (2021) pour identifier les sources du sens du travail8. Ont donc été posées ici des questions ayant trait à des variables hautement subjectives, en lien avec les trois dimensions constitutives du sens du travail d’après Coutrot et Perez (2021), à savoir :
– le sentiment d’utilité sociale, qui renvoie à la finalité du travail au sens d’impact positif sur le monde extérieur, assimilable à des notions comme la vocation (e.g., Steger et Dik, 2009) ou la mission (e.g., Bénabou et Tirole, 2003) ;
– la cohérence éthique, qui a trait à deux types de jugements dans le monde social : les valeurs morales (faire ce qui semble juste d’après ses convictions personnelles) et les normes professionnelles (sentiment de bien effectuer son travail d’après les critères communément admis dans son métier) ;
– la capacité de développement de soi, qui concerne tant le savoir- faire que le savoir-être mobilisés dans son travail, c’est-à-dire «le niveau de compétence requis pour le poste, les différentes capacités qui doivent y être exercées, le potentiel de développement de ces capacités et l’acquisition de nouvelles compétences par le travail, la possibilité de développement personnel, d’expression de soi, et l’exercice de son pouvoir de jugement. Tous ces éléments contribuent à la qualité du travail d’une manière qui le rend plus ou moins signifiant (meaningful) ou épanouissant pour le travailleur » (Dejours et al., 2018).
– une quatrième dimension a été intégrée à cette partie du guide de l’entretien, l’unité avec les autres, dont le statut semble faire débat dans la littérature. De fait, Coutrot et Perez classent la coopération comme un facteur nécessaire du contexte organisationnel venant soutenir les trois dimensions ci-dessus, plutôt que comme une composante intrinsèque du sens du travail. Au contraire, dans leur échelle de mesure résultant d’un important travail d’entretiens (la Comprehensive Meaningful Work Scale), Lips-Wiersma et Wright (2012) mettent l’unité avec les autres (entendue comme soutien social, sociabilité au travail) sur le même plan que ces trois autres variables. Dans cette partie dédiée à l’intérêt intrinsèque du travail, nous avons jugé opportun d’inclure des questions en lien avec la qualité des relations à ses collègues et à ses managers car le travail est par nature collaboratif, une organisation se définissant comme une entité qui vise à coordonner l’action de différents individus pour atteindre un but commun (i.e., la production d’un bien ou d’un service, cf. Parsons, 1964 ; Schein, 1970 ; Mintzberg, 1990).
• Autres facteurs organisationnels de la qualité de vie au travail (QVT) : cette dernière partie a pour objectif de donner l’opportunité aux personnes interrogées de partager leurs impressions sur l’importance à leurs yeux d’autres variables « plus objectivables » car plus étroitement liées au contexte organisationnel. Cela recouvre les dimensions généralement couvertes par des sondages d’opinion, telles que la rémunération, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les marges de manœuvre accordées aux salariés, le recours au numérique, etc.
L’analyse des résultats a été organisée autour de ces quatre grandes thématiques, en s’attardant sur les ressemblances et les différences entre les deux populations étudiées. Cette étude offre ainsi des pistes de réflexion sur un sujet d’actualité, mais n’en couvre pas tous les aspects. Tout d’abord, rappelons qu’il s’agit ici de saisir les attentes à l’égard du travail de ce qu’on pourrait appeler « l’élite scolaire », et non de l’ensemble de la jeunesse. Il n’est même pas évident que les anciens élèves de l’X soient représentatifs des jeunes diplômés issus d’autres écoles prestigieuses, puisque leur socialisation s’en démarque, avec notamment le passage obligatoire par l’armée. On aura compris que cette étude ne permet pas non plus de tester l’hypothèse selon laquelle la génération Z se distinguerait des cohortes précédentes par une façon particulière de se représenter le travail. Pour ce faire, il aurait en effet fallu mener des entretiens auprès d’anciens élèves ayant obtenu leur diplôme bien avant ceux interrogés9. Enfin, certains choix ont dû être opérés de manière pragmatique, au vu des contraintes imposées par le calendrier de l’étude et la disponibilité des personnes sollicitées. Côté Polytechnique, certains sujets ont été contactés en fonction des recommandations d’ alumni déjà interviewés, ce qui peut avoir introduit un biais de sélection (sachant que les personnes qui s’entendent bien ont souvent tendance à penser d’une manière similaire). Côté Harvard, deux alumni peuvent être considérés comme des outliers (cas singuliers) puisqu’ils ont suivi un parcours légèrement différent des sept autres : ils ont étudié à Harvard pour leur Master, après avoir obtenu leur licence ailleurs. Il s’agit d’un polytechnicien ayant également travaillé en France, qui a justement été sélectionné pour tirer parti de son double regard franco-américain, et d’une personne désormais active en Chine. Si leurs témoignages ont pu apporter des « éléments de contraste » intéressants entre le marché du travail américain et, respectivement, les marchés français et chinois, leur parole doit néanmoins être nuancée pour cette même raison.
Figure I – Présentation des personnes interviewées

- 6 ‒ Lire l’article « Si tu n’aimes pas ton job, tu as raté ta vie ! », Les Echos Start, du 24 septembre 2021. N. B. : la génération Z englobe les individus nés entre 1997 et 2010, qui présentent notamment la particularité d’avoir toujours vécu avec les technologies de l’information.
- 7 ‒ Selon l’enquête sur le premier emploi des diplômés de l’X datant de 2018 et disponible sur le site de l’École polytechnique : « Au terme de leurs études, 47 % des étudiants choisissent de mener une carrière dans le secteur des affaires, 29 % poursuivent des études de doctorat, 15 % choisissent le secteur public et 3 % créent une start-up ».
- 8 ‒ Plutôt que de chercher à passer en revue toutes les dimensions de l’expérience professionnelle susceptibles d’aider le salarié à trouver un sens à son travail, Coutrot et Perez mettent l’accent sur « l’intérêt intrinsèque de l’activité concrète de travail en elle-même»; autrement dit, ils suggèrent de se focaliser sur qui fait «la spécificité de l’activité du travail », entendue comme « une expérience humaine de confrontation à et de transformation du réel […] organisée socialement en vue de la production d’un bien ou d’un service » (pp. 8-9). « Ce qui peut donner un sens intrinsèque à son travail concret aux yeux du travailleur, c’est donc l’impact de son activité sur le monde extérieur (le bien ou service produit) et sur lui-même (sa capacité de développement). Pris dans cette acception, le « sens du travail » se distingue du « sens au travail », apporté par les gratifications matérielles (salaire, carrière) ou psychologiques (reconnaissance, sociabilité) attachées à l’occupation d’un emploi. C’est l’explicitation de cette spécificité du sens de l’activité de travail qui nous semble manquer dans les définitions jusqu’ici proposées [en économie] » (Coutrot & Perez, 2021, p. 9).
- 9 ‒ Un complément à cette étude est envisagé en ce sens et pourrait voir le jour en 2024.
Sens de l’exigence et volonté de se dépasser
Dans cette partie, nous allons voir à quel point les deux populations étudiées ont en commun un sens aigu de l’exigence envers eux-mêmes mais également à l’égard de leur poste, avec comme corollaire une recherche permanente de validation extérieure et un risque de désillusion lors des premières expériences professionnelles. Cette quête de l’excellence nous conduira ensuite à souligner comment les alumni de l’X et de Harvard présentent un besoin constant de progresser, bien qu’il puisse se manifester selon des modalités différentes entre les deux populations.
Les « héros du futur » ou des « moutons en quête d’excellence » ?
L’exigence et ses revers
Tout comme les polytechniciens, les alumni de Harvard reconnaissent quasiment de manière unanime avoir aiguisé leur sens de l’exigence envers eux-mêmes lors de leur passage sur les bancs de l’école. Il est bien connu que ces instituts extrêmement compétitifs inculquent à leurs étudiants une capacité de travail importante, un goût marqué pour la stimulation intellectuelle et un besoin constant de « briller », de se dépasser pour atteindre les meilleurs résultats – même si, du côté des polytechniciens, certains semblent dire que c’est surtout en classe préparatoire qu’ils ont développé leurs méthodes de travail. Sans surprise donc, notre étude fait ressortir que ces alumni ont tendance à s’épanouir dans des postes à forte valeur ajoutée, où ils peuvent exercer leur sens aigu de l’analyse et faire preuve de polyvalence.
Ce sens de l’exigence se retrouve logiquement dans les attentes formulées à leur égard en entreprise. Patrick, par exemple, explique que l’un de ses chefs, X-Mines10, se montre plus exigeant envers les ingénieurs, tout particulièrement envers les polytechniciens : « Ça donne l’impression que vous êtes mauvais, alors que vous ne l’êtes pas. Vous n’êtes peut-être pas aussi brillant qu’espéré » . Patrick parle ainsi d’une double pression pesant sur les épaules des polytechniciens : celle auto-induite et celle exercée par le management puisque son chef leur accorde plus facilement des responsabilités en faisant le présupposé qu’ils progresseront d’autant plus rapidement. Certains voient cette pression plutôt d’un bon œil en l’interprétant comme une source d’« adrénaline » et non pas de stress, voire comme une marque d’« appréciation » : « J’avais l’impression que je faisais un travail normal alors que les autres étaient surpris positivement par la qualité de mon travail », raconte Pierre, passé manager à 25 ans, avec le soutien de son responsable qui a cru en lui en l’embauchant après son stage. De fait, les X sont souvent perçus, par la population française, comme « les héros du futur auxquels il faut adresser les problèmes sérieux comme le changement climatique, la transition numérique, toutes ces révolutions : il y a cette attente que les gens comptent sur nous pour faire les bonnes choses »,11 explique Marc. À l’instar des diplômés de Harvard dont le mantra célèbre, rappelé par Claire, est : « Nous formons les leaders du futur » ( “ We’re building the next generation of leaders ” en anglais).
Ce perfectionnisme commun aux deux institutions vient toutefois avec son lot de difficultés. Tout d’abord, cette quête de l’excellence se traduirait davantage par une recherche constante de validation extérieure que par une volonté de mieux se connaître, de développer son sens de l’auto-détermination. Signes les plus marquants de ce phénomène : le choix d’entrer à l’X ou à Harvard avant tout parce que « c’est la meilleure école » et la fréquente absence de projet professionnel clair à l’issue des études. Sur ce premier revers de la médaille, le témoignage de Leah s’avère particulièrement saisissant puisqu’elle va jusqu’à se qualifier, elle et ses camarades, de « moutons excellents » : « C ’est une sorte de syndrome […] Vous atterrissez dans un endroit avec toutes ces autres personnes qui sont devenues, d’une certaine manière, des âmes en peine qui cherchent quelqu’un qui leur dise quelle est la meilleure chose à faire, pour qu’elles puissent essayer de l’atteindre. Parce que pendant la majeure partie de vos 18 années d’existence jusqu’ici, la meilleure chose à faire était une étoile polaire très claire, c’était Harvard ou Stanford ou Oxford. […] Quand vous êtes ce genre d’enfant, vous n’avez aucun sens de l’autodétermination. Il y a un super livre à ce sujet, Les Moutons Excellents [Excellent Sheep] de William Deresiewicz12. […] Nous sommes tous des moutons excellents qui attendent que le berger nous dise où nous allons et ce que nous sommes censés vouloir, ce qu’il y a de mieux à faire. Le défi c’est, qu’une fois à l’université, la meilleure chose à faire n’est plus aussi claire, n’est-ce pas ? Quelqu’un ne pourrait-il pas simplement me dire quelle est la meilleure chose à faire ? Mais personne ne le fait. […] Il y a toujours cette même pression en moi d’identifier ce qu’il y a de mieux dans mon environnement de travail et de chercher à l’atteindre. »
Un risque de désillusion à l’entrée sur le marché du travail
Dans le prolongement de cette difficulté, il n’est pas rare de percevoir une certaine désillusion chez les alumni de Harvard et de Polytechnique après leurs premières expériences professionnelles. Par exemple, Laura voit son premier stage dans le conseil comme une « expérience à ne plus jamais répéter » notamment à la suite d’interactions déplaisantes avec un entourage qu’elle qualifie de « malveillant » et une charge de travail élevée, qui plus est, pour mener des tâches « dénuées de sens » à ses yeux (en l’occurrence, la création de fichiers Excel avec comme seul objectif d’accroître le chiffre d’affaires des clients de ١٠ %). Sam, lui, fait part du sentiment de « désenchantement » qu’il a connu lorsqu’il a rejoint une organisation internationale et dû revoir à la baisse son pouvoir d’action individuelle, du fait d’un fonctionnement hautement bureaucratique : « Où je dirais que j’ai dû me faire à l’idée, que ma vision a changé [c’était] en sortant de l’université, [d’autant que j’avais monté une start-up pendant mes études]. Dans une start-up, le monde vous appartient. Vous pouvez vraiment tout essayer. Tandis qu’en rejoignant une institution bureaucratique comme l’ONU […], vous êtes très vite limité dans ce que vous pouvez faire. Tu réalises alors qu’il y a des institutions avec lesquelles composer et que tu dois revoir à la baisse ton ambition de changer le monde. Tu te dis : “ Oh, je veux changer le monde mais je dois travailler au sein des structures existantes, avec tous leurs problèmes et imperfections. ” Si vous voulez faire avancer les choses, ça change juste votre réalité de ce que signifie avoir un impact. [ …] Je viens de connaître cet ajustement. Il a eu lieu et a rendu ma vision des objectifs et possibilités de changer les choses plus réalistes, je pense. Mais je l’ai vraiment vécu comme un désenchantement. » Ou encore, pensons à Claire, qui a fait le choix de quitter son emploi au sein d’une célèbre entreprise du numérique, « idéal sur papier » , pour créer sa propre structure : « J’ ai vraiment connu ce genre de moment où je vivais cette vie très confortable à San Francisco, gagnant plus d’argent que ce que je pensais mériter. […] J’ai eu ce moment où j’ai réalisé : “ Cela pourrait être le reste de ma vie. ” Si je ne voulais plus jamais faire quelque chose de spectaculairement difficile, je pourrais simplement rester dans [cette même entreprise] encore longtemps, puis peut-être être recrutée chez Google, ou alors rejoindre Facebook. Je pourrais me construire une vie très confortable et une famille et je serais juste qui je suis, ce que j’ai fait. Et pour une raison quelconque, même si j’avais tout sur le papier, j’ étais absolument misérable. Et je n ’ arrivais pas à mettre le doigt sur la raison. »
Se conformer au modèle dominant
Ce climat d’ambition exacerbée entretenu au sein des deux écoles finit par poser les bases d’une culture dominante, à en croire les alumni , à laquelle il n’est pas évident de se conformer et qu’ils vont pourtant retrouver en environnement professionnel. Sam parle ainsi d’une « quête absurde de la perfection partagée par tous » à Harvard, tandis que Jade déplore l’effet négatif induit sur les relations humaines ou l’épanouissement personnel d’un tel esprit de compétition : « [Il y avait] cette ambition acharnée et inutile, cette volonté de se surpasser, d’être prêt à se battre, à faire n’importe quoi pour arriver au sommet… À Harvard, tout le monde disait : “ N’est-ce pas super compétitif ? ” Et les gens s ’enthousiasmaient, d’une manière presqu’un peu perverse : “ Vive la compétition, j’ai hâte ! ” Moi, je veux juste apprendre, j’aurais préféré qu’on n’ait pas de notes du tout. Ça crée et renforce un environnement et une culture où il faut en faire plus, toujours en faire plus pour y arriver, d’une manière préjudiciable pour votre vie privée, pour vos relations et pour vos pairs. »
Ce qui n’est qu’un inconfort pour les uns irait pour d’autres jusqu’au développement d’un « syndrome de l’imposteur ». Patrice évoque ainsi, en des termes particulièrement frappants, son sentiment d’avoir choisi sa vocation professionnelle parce qu’il renonçait à se conformer à un monde qui, selon ses propres termes, n’était pas le sien : « Je me suis aperçu un peu après coup qu’il y avait peut-être un peu [chez moi] un syndrome de l’imposteur. […] Je suis universitaire, mes parents n’ont pas le bac, etc. Du coup, je me posais forcément des questions : comment est-ce que j’ai atterri ici ? […] Je pense que certains étrangers, étrangères, les provinciaux, les milieux sociaux particuliers, comme moi, pouvaient se sentir un peu en décalage. Je me disais : “Je ne suis pas du même monde qu’eux.” Ce qui était vrai, en fait. Je crois aux classes différentes. Et peut-être que [mon choix d’entrer dans] la gendarmerie – je ne me le suis pas dit explicitement sur le moment – était un moyen de retourner à ma classe. OK, je suis officier, mais dans l’imaginaire des gens, quand je dis “gendarmerie”, ce n’est pas pareil que “ ingénieur polytechnicien chez Airbus ” . Je pense vraiment que j’ai cherché à retourner à ma classe ; et le corollaire de ça, c’est que j’ai voulu fuir la classe de l’X que j’ai connue. Je ne me suis pas identifié à elle. Je n’avais pas les codes. […] Mais à l’inverse, sociologiquement, on les reconnaît. J’ai un ami avec qui je m’entends très bien. C’est littéralement l’archétype de l’X : maman prof, papa fonctionnaire A+, lycée à Louis-le-Grand, prépa à Louis-le-Grand, Parisien… Quand il est entré, lui n’a pas senti le décalage . »
Les statistiques nationales vont d’ailleurs toujours dans ce sens : si la population globale comprend 19,2 % d’ouvriers contre 20,4 % de cadres (INSEE, 2021), seuls 1,1 % des élèves reçus à l’X figurent parmi les enfants d’ouvriers contre 81,3 % pour les enfants de cadres (figure 1.1)13. Ce que le témoignage de Patrice apporte en supplément, c’est que ceci peut opérer comme un filtre y compris au moment où les alumni se choisissent une carrière.
Figure 1.1 – Origine sociale des étudiants et des admis à l’X
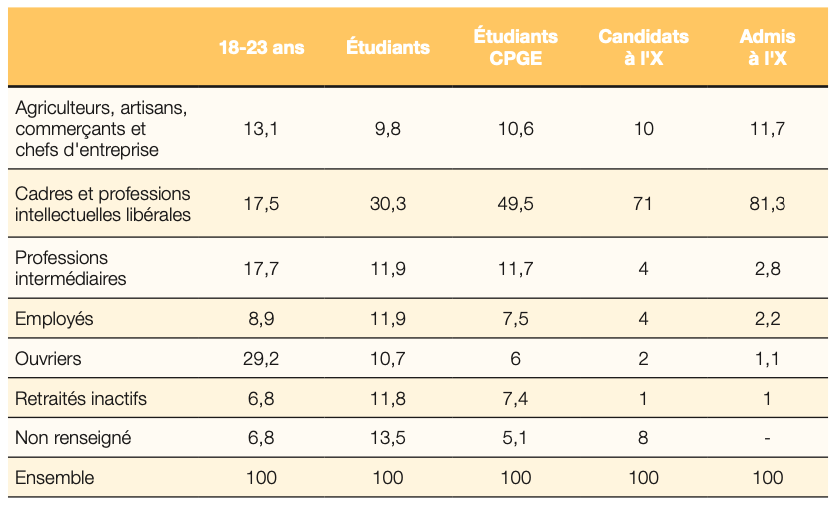
Colonne 1 : Répartition de tous les étudiants du secondaire dans les différentes académies pour l’année scolaire 2013-2014.
Colonnes 2 et 3 : Répartition des origines académiques des candidats en filière MP-PC au concours de l’X obtenue à partir de leur numéro INE et agrégée sur les années 2010-2014.
Lecture : Entre 2010 et 2014, 19,5 % des candidats au concours en filière MP-PC ont passé leur brevet des collèges dans l’académie de Versailles.
Source : Données agrégées pour les années 2010-2014, tirées de François & Berkouk (2018).
Naturellement, la majorité des élèves s’adaptent à cette culture dominante, tout en ayant conscience des privilèges dont ils bénéficient. Un constat d’ailleurs valable des deux côtés de l’Atlantique, comme le rappelle Robert : « Je tiens à affirmer que […] je suis issu d’un milieu très privilégié. Un résultat direct de ce privilège est que je n’ai pas à m’inquiéter ou à penser à l’argent de manière aussi prégnante que bon nombre d’autres personnes dans la même situation. » Surtout, ces privilèges s’accentuent encore à la sortie d’école et jouent à plein dans la construction des premiers projets professionnels, notamment par des effets de réseau indéniables – plusieurs diplômés de l’X soulignent par exemple comment ils ont pu trouver un stage voire un poste grâce au réseau d’ alumni .
On note en particulier que, parmi les ressources clefs auxquelles les élèves ont accès durant les études, on trouve notamment celles qui sont constitutives du profil entrepreneurial. « J’avais conscience que je bénéficiais d’un privilège extraordinaire, que j’ étais dans une position à laquelle sans doute peu de gens pouvaient avoir accès, dans le sens où j’ai reçu l’éducation pour faire une différence dans le monde. [ …] J’ai été habituée à être traitée avec respect et à ce que mes idées soient prises au sérieux, même lorsque j’ étais très jeune. Et j’ai pu diriger des clubs et des organisations et vraiment perfectionner mes compétences en matière de leadership » , souligne Claire. En plus des forums métiers bien connus et autres appuis dans la gestion des carrières (ateliers pour peaufiner son CV, entraînements à l’entretien d’embauche…), tant Polytechnique que Harvard offrent à leurs étudiants une vie associative riche et un soutien important à l’entrepreneuriat. Aurélien, par exemple, raconte comment il a pu « pitcher » son idée dans le cadre de concours et gagner 70 000 euros de prix en une année puis compter sur le soutien d’anciens X comme premiers investisseurs. « En tant que polytechnicien, on a l’avantage de se baser sur une crédibilité et une solidité » , partage-t-il. À ce titre, d’après le Figaro Étudiant14, l’École polytechnique est passée première cette année (figure 1.2) parmi les fondateurs de licornes françaises (des start-up de nouvelles technologies, créées il y a moins de dix ans, valorisées à au moins 1 milliard de dollars mais pas encore cotées en Bourse), avec sept alumni parmi les 58 fondateurs et cofondateurs des 24 licornes étudiées (soit 12 %)15. Au total, 62 % des fondateurs sont issus des grandes écoles les plus prestigieuses.
Figure 1.2 – Aperçu des 10 premières écoles dont sont issus les fondateurs de licornes françaises
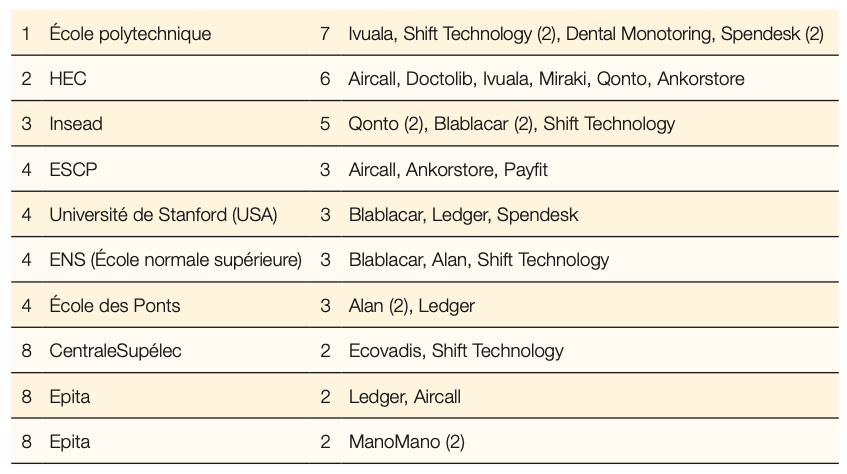
Source : Figaro Étudiant (2022)
Claire, elle, parle même d’un « filet de sécurité » pour caractériser l’écosystème de Harvard, propice pour se lancer dans la voie entrepreneuriale : « Vous n’ êtes qu ’un étudian t, vous pouvez toujours revenir à cela. Vous pouvez toujours être recruté dans le réseau des anciens de Harvard. Je logeais sur le campus, j’avais accès au réfectoire, à la connaissance, avec la Harvard Law School et la Harvard Business School au coin de la rue. Je pouvais aller voir les professeurs et leur demander de l’aide. J’avais des ressources infinies à portée de main. Vous avez un tel filet de sécurité autour de vous qu’il est presque impossible d’ échouer en tant qu ’ entrepreneur. De plus, vous pouvez le mettre sur votre CV : ça vous donne une expérience en leadership » .
Un besoin constant de progresser au travail, des modalités différentes pour y parvenir
La quête perpétuelle de l’excellence est donc commune à ces deux échantillons mais elle se traduit différemment dans la manière d’appréhender le travail. Tout d’abord, les alumni de Harvard semblent encore plus sensibles aux logiques de prestige – ou du moins plus conscients de cette aspiration et ouverts à en parler – que leurs homologues de Polytechnique. C’est ce que suggère en tout cas leur opposition moins ferme à l’égard du conseil, symbole s’il en est de réussite professionnelle, tant en matière de rémunération que de reconnaissance sociale et de réseaux de pouvoir. Que ce soit en France ou aux États-Unis, le conseil vient en effet souvent parachever une formation d’excellence en attirant bon nombre de candidats, dont les « meilleurs » jeunes diplômés. Les alumni de l’X interrogés ne dérogent pas à la règle puisque plusieurs d’entre eux ont démarré leur carrière, ou au moins effectué un stage, dans un cabinet de conseil prestigieux pour intégrer la voie « classique » et « attendue » des étudiants de grandes écoles. Pour la plupart, ils ont fait le choix de ne pas rester dans ce secteur d’activité par la suite. Il semblerait, en effet, que les avis convergent vers une appréciation plutôt mitigée du monde du conseil. Ainsi, Pierre décrit le train de vie « métro-boulot-dodo » caractéristique des consultants comme étant aux antipodes de son équilibre idéal entre vie professionnelle et vie personnelle. Léa se dit très satisfaite de la « méthode de travail » qu’elle a apprise dans le conseil mais a tout de même fini par rejoindre une banque française après près de cinq ans dans un cabinet. Même écho chez Patrick qui, lui aussi, affirme être épanoui dans son métier de consultant mais estime que viendra forcément un jour où il finira par quitter le conseil, jugeant difficilement compatibles les horaires exigés pour des rôles séniors avec une vie de famille. Il rappelle d’ailleurs qu’une prime alléchante est distribuée après 3 ans d’activité pour retenir les salariés ayant tendance à partir à ce moment-là, fréquemment lassés du rythme soutenu demandé. Laura est sans doute l’exemple le plus paradigmatique de cette appréciation négative des cabinets de conseil. Celle-ci a très mal vécu son stage chez l’un des grands de la place. Parmi les points les plus négatifs de son expérience, elle relève les longues heures de travail, la pression permanente, les tâches dénuées de sens et enfin, l’entourage malveillant, superficiel, « qui vous juge même sur la couleur de vos chaussettes » . Précisons toutefois que d’autres « revirements » de carrière ont eu lieu parmi les personnes interviewées, signes de cette période de flou bien connue en début de carrière. Par exemple, Pascal a commencé une thèse à la suite du Corps des mines ; Patrick est passé par un stage dans le secteur de l’e-commerce avant d’opter finalement pour le conseil dans le domaine de l’énergie ; Patrice a œuvré comme stagiaire-ingénieur à la Direction générale de l’armement (DGA) avant de rejoindre les forces de la gendarmerie.
Ce regard critique posé sur les cabinets de conseil apparaît moins flagrant dans les verbatim des alumni de Harvard. Certes, cela peut aussi être lié au fait que l’École polytechnique forme des ingénieurs, pour partie destinés à la haute fonction publique, tandis que Harvard prépare plus exclusivement des étudiants aux métiers du secteur privé, dont ceux du conseil. Les différences auraient peut-être été encore moins marquées avec des alumni de HEC Paris, qui forme notamment aux métiers du management. Mais tout de même, il n’en demeure pas moins que les alumni de Harvard parlent plus explicitement de leurs aspirations en termes de prestige. En particulier, ils expriment fréquemment le souhait de décrocher une première expérience, très convoitée, de product manager dans l’un des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), là encore, selon leurs propres termes, pour le prestige attaché à ce poste et au nom de ces entreprises. Claire explique en effet que les géants du numérique comme Google et Twitter proposent des programmes pour jeunes diplômés (ou graduate schemes ) très sélectifs car très convoités, représentant environ une centaine d’emplois toutes entreprises confondues.
La seconde différence mise en évidence par les entretiens est la soif d’apprentissage constante que semblent chercher à assouvir les élèves de l’X, tandis que les alumni de Harvard sont plus portés sur la montée en grade ou du moins la prise de responsabilités et le sentiment d’avoir une prise sur le déroulement des opérations dont elle est en général synonyme. Sans pour autant être indifférents à l’apprentissage continu (tout comme, à l’inverse, certains polytechniciens interviewés sont clairement attirés par des positions de management), certains alumni de Harvard ont tendance à voir cet aspect davantage comme un service rendu à l’entreprise, par exemple pour répondre à un besoin ponctuel, que comme une priorité personnelle. Peter explique ainsi qu’il pourrait tout à fait concevoir de continuer à apprendre en dehors du travail plutôt qu’au sein même de son entreprise, en lisant des livres ou en s’impliquant dans des activités extracurriculaires. Jade, quant à elle, parle « d’ambition passive » car si elle apprécie de voir sa curiosité éveillée au quotidien, elle insiste sur le fait que son travail n’est pas sa vie et qu’elle a de nombreux hobbies en dehors. En ce sens, les alumni de Harvard semblent mettre davantage l’accent sur leur plan de carrière, leurs perspectives à long terme que sur l’apprentissage quotidien. « Je pense que la plupart des gens veulent avoir un travail où ils peuvent être en maîtrise et devenir vraiment bons. Imaginez, vous êtes chirurgien, peut-être qu’au début, pendant un certain nombre d’interventions, vous tremblez mais à la centième opération, vous êtes un pro. Pour ma part, je voulais un travail où, à chaque fois que je maîtrise un échelon d e l’ échelle, l ’ échelon suivant se trouve en dehors de ma zone de confort. Et donc le seul travail qui pouvait vraiment tenir cette promesse était l ’entrepreneuriat », résume Claire. La balance semble pencher dans l’autre sens pour les X, à l’image de Patrick pour qui la priorité est à la maîtrise : « C’est la seule chose [le fait d’avoir un apprentissage continu] qui me motive à travailler. Dès que je sens que je stagne ou que j’apprends moins ou que j’ai fait le tour de la question, j’ai tendance à me lasser. D’ailleurs, c’est arrivé il n’y a pas longtemps. Et je leur ai dit : “ Mettez-moi sur des choses un peu plus difficiles, un peu plus challengeantes parce que je m’ennuie un peu.” […] C’est un de mes principaux drivers : toujours apprendre, toujours progresser, être en dehors de sa zone de confiance en permanence, même si c’est fatigant. »
Émerge donc des entretiens un besoin commun de constamment progresser, bien qu’il s’exprime sous des modalités légèrement différentes, avec, d’un côté, une tendance à privilégier l’apprentissage continu chez les alumni de l’X et, de l’autre, une volonté accrue de monter en grade chez ceux de Harvard. Au-delà de cette différence, cette volonté constante de se dépasser se traduit de part et d’autre de l’Atlantique par une disposition à se lancer dans la voie entrepreneuriale, déjà soulignée plus haut. Celle-ci est en effet perçue comme un bon moyen de « ne pas stagner » , de « sortir de sa zone de confort » .
- 10 ‒ Il s’agit des anciens élèves de l’École polytechnique qui ont ensuite rejoint le Corps des mines.
- 11 ‒ Cette citation fait écho à la récente tribune de Patrice Caine publiée le 28 janvier 2023 dans Le Journal du Dimanche.
- 12 ‒ Deresiewicz W. (2015). Excellent Sheep : The Miseducation of the American Elite and the Way to a Meaningful Life. Free Press.
- 13 ‒ Voir la tribune de Sophie Audoubert publiée dans Slate, le 10 novembre 2022.
- 14 ‒ Voir l’article « Les meilleurs diplômes pour lancer une start-up à un milliard de dollars », Le Figaro Étudiant, du 13 novembre 2022.
- 15 ‒ N. B. : La French Tech a annoncé en janvier 2022 que ce nombre avait dépassé l’objectif fixé à 25 licornes pour 2025.
Les relations avec ses collègues et sa hiérarchie comme source d’engagement au travail
Les alumni de l’X interrogés accordent pour la plupart une place prépondérante à la bonne entente avec leurs collègues. Au contraire, ceux de Harvard sont plus souvent en faveur du maintien d’une certaine distance affective, signe d’un rapport au travail plus « transactionnel » chez les Américains. Les attentes relationnelles face à sa hiérarchie s’avèrent, quant à elles, assez similaires entre les deux populations, pouvant se résumer par la recherche d’un savant équilibre entre autonomie et accompagnement managérial.
Des attentes différentes sur la proximité entre collègues
Les attentes sur la qualité des relations avec les collègues semblent particulièrement fortes chez les jeunes polytechniciens, qui décrivent comme une grande source de satisfaction d’avoir des liens « amicaux » sur leur lieu de travail. Laura raconte ainsi comment les liens qu’elle avait pu tisser dans son ancienne entreprise ont certainement contribué à la faire rester en dépit des dissonances cognitives et des pratiques de greenwashing qu’elle y a déplorées, par un phénomène qu’elle qualifie de « compensation ». Elle entretient d’ailleurs activement cette recherche de relations qualitatives dans la structure qu’elle a montée depuis lors, en promouvant une « écoute des ressentis » dans la gestion des différends internes et une « écoute empathique » envers ses clients. Sur ce deuxième pan, elle explique n’avoir jamais dit non à un client mais avoir pu « se retirer en douce » et ne pas poursuivre la collaboration en constatant des comportements décevants chez ses interlocuteurs ; de fait, elle juge la qualité de la relation plus importante que l’avancement sur la question écologique pour faire le tri parmi ses prospects.
Les alumni de Harvard, eux, formulent des attentes moins élevées en matière de proximité avec leurs collègues. À l’exception notable de deux d’entre eux, ils préfèrent ouvertement ne pas devenir amis avec leurs collègues. « Le travail, c’est juste le travail. Et puis l’amitié au travail est différente de l’amitié en dehors du travail. Les amis que vous pourriez avoir en entreprise, ça reste une relation professionnelle », résume Chloe. Trois raisons ont été évoquées pour justifier ce maintien d’une certaine distance avec ses collègues. La première tient à la richesse des liens entretenus en dehors et donc à l’inutilité de connexions plus personnelles sur son lieu de travail. La deuxième relève du souhait de garder une certaine autonomie en matière d’organisation de son temps de travail, notamment pour garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, comme le souligne Jade : « Parce que je tiens tellement à l’ équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, je pense que je peux parfois ériger des murs avec mes collègues afin de maintenir une certaine autonomie, liberté, mystère autour de ce que je fais ou ne fais pas tous les jours. » Enfin, les alumni de Harvard relèvent également que des relations de proximité nuisent à la capacité à travailler ensemble et à se parler franchement.
Riche de sa double expérience en France et aux États-Unis, Greg considère que les actifs français ont plus de difficulté à se détacher et à ne pas prendre trop personnellement une situation de désaccord que leurs homologues américains. A contrario, il dit avoir été beaucoup moins à l’aise avec « l’attitude paternaliste » de son employeur français. Il raconte avoir eu tendance à « s’auto-exclure » dans la start-up parisienne où il a travaillé car un « investissement émotionnel » trop important lui était demandé d’après lui. Par exemple, il jugeait inapproprié que la norme soit de participer à des barathons16 tous les jeudis soir ou de partir en vacances au ski avec ses collègues. Les employés français seraient donc, selon lui, davantage traités « comme des enfants », avec les attentes que cela peut entraîner de relations privilégiées, « comme au sein d’une famille ». De même, Ben s’inscrit en faux contre une vision trop « familiale » de l’entreprise qu’il a pu lui-même observer chez certains employeurs américains : « Ils diront que nous sommes comme une famille, comme dans une structure plate où tout le monde contribue, où nous sommes tous soudés. Vous savez, Facebook a ce fameux jour où Zuckerberg est assis dans l’open space avec d’autres ingénieurs, alors que nous savons tous qu’il y a toujours un patron. C’est du fake. » Sam va même jusqu’à percevoir la proximité entre collègues comme la résultante d’une tentative d’instrumentalisation de la part de l’entreprise, soulignant par là même son caractère « aliénant » : « Aux États-Unis, il y a toujours cette tendance, surtout dans les start-up, à dire : “ Oh, nous sommes une famille ! ” . Mais je pense que c’est super toxique. Vous savez, en fin de compte, c’est une façon de pousser les gens à faire plus, à… dans le fond, pour les exploiter : “ Oh, fais ça parce qu’on est une famille, hein ? ” . Est-ce que je veux considérer mes collègues comme ma famille ? Non, pas nécessairement. Si je deviens réellement ami, assez proche d’eux, ce serait en raison d ’un lien personnel, plutôt que du fait d’une telle dynamique de travail qui forcerait cette cohésion, si vous voyez ce que je veux dire » .
Ainsi, il semblerait qu’il existe une différence culturelle entre nos deux échantillons dans le rapport à l’autre au travail, notamment dans la manière de considérer autrui « juste » comme un collègue plutôt que comme un individu dont l’identité ne se réduit pas à sa condition de travailleur. Greg appuie cette interprétation et partage l’idée que le travail serait perçu comme quelque chose d’avant tout « transactionnel » chez les Américains : un échange de temps et d’espace mental contre de l’argent, pour faire simple. Cela se lit notamment dans la pratique de rémunération dans son secteur, sur la base de la valeur ajoutée produite plutôt que sur la base du statut ou de la fonction hiérarchique, contrairement à la norme française. Certains membres de son équipe étaient ainsi mieux payés que le manager, au vu d’une expertise particulière et d’une contribution clef au chiffre d’affaires.
Bien doser autonomie et accompagnement managérial
Pour ce qui est des relations avec leur manager en revanche, les alumni de Harvard et de l’École polytechnique expriment des attentes globalement similaires. En réponse à la question : « Qu’est-ce qui fait un bon manager selon vous ? » , les notions d’autonomie, de confiance, d’écoute, de communication et d’accompagnement (notamment par des instructions claires et un feedback régulier) semblent faire consensus. Autrement dit, d’après les jeunes diplômés interrogés, le manager « idéal » doit faire preuve d’un subtil équilibre entre lâcher prise et présence rassurante ou, pour reprendre les termes de Chloe, il doit savoir à quel moment faire preuve d’implication (« hands-on ») ou au contraire plutôt lâcher prise (« hands-off »). « Par implication [ « hands-on » ] , j’entends que [les managers] puissent résoudre les choses par eux-mêmes, ils peuvent prouver, ils peuvent démontrer […] : “ Si vous ne pouvez pas résoudre la chose, faites-le moi savoir et j’essaierai de trouver un moyen, quel qu’il soit, que ce soit une solution technique ou que nous trouvions des ressources à l’extérieur de l’ équipe. ” [ … ] Deuxièmement, ils savent lâcher prise [ « hands-off » ] . Quand j’ai rejoint l’ équipe en tant que junior, je n ’avais pas d’expérience préalable, mais [en tant que manager], vous pouviez me demander de faire quelque chose et vous me donniez toute la liberté et le contrôle pour explorer, parler aux gens, poser des questions. […] Et si j’ échoue, ce n ’ est pas grave, vous me le dites, vous avez le droit d’avoir raison, mais vous me donnez un retour sur la façon dont nous pouvons nous améliorer, aller de l’avant, devenir meilleurs. Je pense que ces éléments sont très importants. Le manager doit savoir arbitrer entre ce qu’il fait lui-même côté contrôle et le travail qu’il me laisse faire seule », raconte Chloe.
De fait, les jeunes interrogés ont exprimé, de part et d’autre de l’Atlantique, un besoin marqué d’autonomie qui, comme le relève Pascal, va souvent de pair avec la recherche de stimulation intellectuelle évoquée plus haut : « J’ai petit à petit décidé de faire un Master recherche puis de me lancer en doctorat pour trois ans. […] J’aime beaucoup cet environnement de travail, cette liberté, cette capacité à réfléchir sur des problèmes complexes et d’être maître de ce que tu fais parce que tu es un artisan, tu fabriques tes propres outils, etc. Et j’ai toujours eu un peu de mal lorsque mes chefs me demandaient de faire des choses avec lesquelles je n’étais pas d’accord. Quand on me demande de faire des trucs absurdes, j’ai tendance à ne pas les faire. Je préfère cette autonomie intellectuelle, ça me plaît beaucoup. » Autre exemple : Camille qui, sur le fonctionnement de son ministère pourtant très hiérarchisé, explique avoir « été agréablement surprise [par] la confiance et les responsabilités qu’on peut nous donner très vite. […] [Une autre adjointe et moi qui travaillions sur le même sujet avons] été très vite directement en contact avec le cabinet du ministre pour déterminer ce qu’on considérait comme étant le mieux à faire [ …] Je ne pensais pas qu’aussi vite on serait amenées à discuter avec des gens qui prennent des décisions aussi “importantes”, qui ont un impact. C’est quand même une grande confiance qui nous est faite » . Léa fait part de sentiments analogues en estimant avoir « la chance de travailler vraiment dans un cadre de confiance. En fait, je pense que c’est assez unique dans ce type de structure parce que, souvent dans les grands groupes, ça peut être beaucoup plus [cadré]. Je ne dis pas que ça n’existe pas ; il y a sûrement des endroits similaires. Mais en tout cas, mon expérience, c’est que je m’épanouis énormément, personne ne vient me dire : “Il faut faire ci, il faut faire ça.” […] C’est très co-constructif » .
Pour autant, les jeunes diplômés espèrent tout de même pouvoir compter sur leur hiérarchie pour les guider. De fait, la posture d’implication (« hands-on ») évoquée par Chloe suggère la démonstration périodique d’une maîtrise technique, qui fait écho à une attente plus générale d’exemplarité. « Je veux voir mes supérieurs mener par l’exemple. Prenons ma cheffe actuelle […], elle est absolument merveilleuse. […] Elle fait vraiment du bon travail et mène par l’ exemple, prend vraiment le temps d’ écouter et d ’entendre et de regarder autour d’elle, ce que j’apprécie vraiment », partage Sam. De même, Léa, dans sa pratique de manager, essaie de se positionner « en miroir » de ses propres attentes. Toujours dans une optique d’amélioration de soi perpétuelle, les jeunes attendent en outre que cet accompagnement managérial se traduise par la formulation d’objectifs clairs et de retours adaptés : « Je pense que pour être un bon manager, il est essentiel de préparer ses subordonnés à la réussite. Ça passe aussi par reconnaître le talent en le plaçant dans des rôles où il pourra fleurir. […] Je pense qu’il est vraiment important [en tant que salarié] de recevoir à la fois des éloges et du feedback , [c’ est-à-dire] un feedback positif et négatif, dans une boucle où la personne qui reçoit le feedback en question y est réceptive […] : [en tant que manager], vous devez communiquer quand quelqu’un fait vraiment du bon boulot mais aussi communiquer quand il pourrait faire mieux. C’est la seule manière [pour un salarié] de progresser » , souligne Claire. Dans le même ordre d’idées, Ben souligne que la présence de la hiérarchie a le mérite de structurer l’activité, de donner une direction par la définition d’attentes claires, qui facilitent l’évaluation des collaborateurs, bien qu’il estime que cela peut parfois nuire à l’agilité (par exemple lors d’un bug ou d’une absence) par rapport à un fonctionnement horizontal.
On peut interpréter ce besoin de marier autonomie et accompagnement managérial comme la recherche d’un lien de réciprocité avec sa hiérarchie, ou de « bidirectionnalité » selon Leah : « Pour moi, c’est vraiment une question de confiance et cela d’une manière bidirectionnelle en quelque sorte. Votre manager vous fait confiance pour faire votre travail efficacement et n’a pas à vous micromanager, ni à s’inquiéter que vous fassiez mal votre travail, ni à vous critiquer constamment parce qu’il pense que vous le faites mal. Mais je pense qu’il est également très important que vous ayez confiance dans le fait qu’il sera cohérent, juste, là pour vous et fera preuve de constance. » Les jeunes interrogés semblent prêts à reconnaître leurs limites et à s’appuyer sur l’expertise de leur manager pour les combler, comme le souligne Sam : « J’ai une très bonne relation avec ma cheffe actuelle. Je pense que c ’est en partie parce qu’[…] elle est très expérimentée, ce n’est pas son premier tour de piste. » En retour, ils souhaitent que leur encadrement les aide non seulement à réaliser leur potentiel, comme nous l’avons souligné plus haut, mais aussi qu’ils reconnaissent leurs compétences déjà acquises. « Ce n’est pas qu’elle est absente, loin de là. Nous prenons des nouvelles tous les jours, nous sommes en contact permanent. Mais nous avons cette souplesse autour de mon territoire dans le sens où celui-ci est bien délimité : j’en suis l’unique garant, je suis l’expert sur ces sujets. [ …] Cette confiance, je pense que c’est vraiment un changement important en termes de relation employé-employeur, chef-subordonné » , explique Sam. De même, il est souvent attendu que le feedback se joue dans les deux sens ; si les retours du manager sont souvent accueillis positivement comme moyen de progresser, les jeunes diplômés jugent important de pouvoir remonter des informations à leur manager, voire proposer des pistes d’amélioration qui soient effectivement prises en compte.
Symétriquement, les frustrations exprimées à l’égard du management sont tout à fait cohérentes avec ces attentes formulées positivement. Ont notamment été abordés le sentiment de ne pas être assez écouté, de voir ses idées insuffisamment prises en compte, les traitements inéquitables, la tendance à laisser « le sale boulot » aux subordonnés (par exemple en refusant de se mettre d’astreinte) tout en continuant à exercer sur eux une pression considérable, ou encore les comportements inconstants , « à la diable s’habille en Prada » , relevés par Leah : « C’ était quelque chose de très perturbant pour moi, quand je repense aux mauvaises relations que j’ai connues avec ma hiérarchie, cette sorte de volatilité et d ’anxiété qu’elles produisaient. J ’allais au travail tous les jours et, surtout dans mon premier job, je ne savais pas si [mon chef] allait être de bonne humeur et m’acheter un sac à main Gucci… chose curieuse qui s’est littéralement produite […] Puis, le lendemain, je me faisais hurler dessus, littéralement hurler dessus, avec des postillons de furie qui sortaient de sa bouche, pour avoir fait quelque chose de mal que je n’avais en fait pas du tout fait mal… et je maintiens cela à ce jour. »
Ce point constitue sans doute la différence la plus notable entre les deux populations sur cette question du rapport au management. Plus d’ alumni de Harvard ont en effet mentionné d’eux-mêmes des insatisfactions importantes à l’égard de leur superviseur, une observation en phase avec les statistiques nationales américaines17. Selon un sondage mené par Gallup en 202218, au moins la moitié des salariés américains figure parmi ceux que l’on appelle les « démissionnaires silencieux », ces salariés désengagés qui ne font que le strict nécessaire au travail19. Pour les jeunes de moins de 35 ans, la situation s’est particulièrement détériorée depuis le début de la pandémie puisque la part des salariés « activement désengagés », autrement dit les plus explicites sur leur insatisfaction au travail, a augmenté de six points (la part des salariés « engagés » ayant elle chuté de six points, voir figure 2.1). Parmi les raisons citées par l’enquête figure notamment le sentiment de ne pas être suffisamment soutenu (« feeling cared about ») et accompagné dans son développement par son manager20.
Figure 2.1 – Répartition des jeunes employés de moins de 35 ans selon leur niveau d’engagement au travail
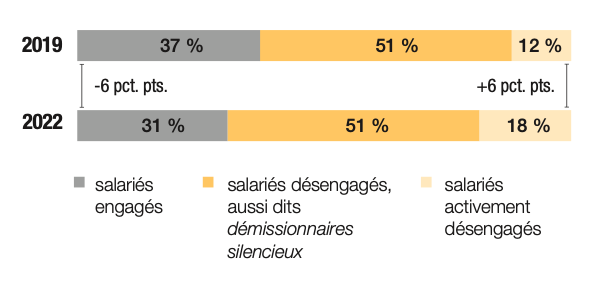
Source : Gallup 2022
Français comme Américains se retrouvent toutefois pour exprimer une aversion profonde envers la bureaucratie et à ses longues chaînes de décision. Patrick, par exemple, a préféré se diriger vers le conseil plutôt que l’industrie où la lenteur du processus de recrutement l’a grandement refroidi : « Dans l’industrie, c’est moi qui ai décidé de ne pas y aller parce qu’en fait, les process de recrutement étaient tellement lents que je me suis dit : “Si les process [pour y entrer] sont tellement lents, je ne m’imagine même pas ce que c’est à l’intérieur.” » Camille souligne de son côté la perte d’efficience induite par « la machine » bureaucratique de son ministère : « Il y a énormément de relectures ; entre le moment où l’on produit quelque chose – essentiellement, ce que je produis, ce sont des notes pour le ministre […] – et le moment où la note arrive au ministre, il y a entre cinq et huit échelons de relecture. C’est long, c’est pénible, ça fait des allers-retours, parfois on perd en gros ce qu’on veut faire passer. […] La hiérarchie […] parfois, c’est vrai que c’est un peu pesant : […] c’est une grosse machine donc il faut trouver sa place. » De la même manière, une bonne partie des alumni interrogés déplorent des dérives bien connues du fonctionnement bureaucratique, telles que la lenteur de la montée en grade, l’application des règles à la lettre, l’hyper-spécialisation ou encore, l’hyper-fragmentation des responsabilités et les jeux de pouvoir afférents (à savoir, le besoin de séduire toutes les parties prenantes d’une longue chaîne de décision, sans que cela soit toujours justifié en matière d’expertise), comme le souligne Sam : « Je commence à être un peu désabusé par [les organisations internationales] où l’on sait très bien qui, dans ces structures, fait réellement les choses. Il y a un tas de «stratèges» ou conseillers, ces titres non spécifiques qui ne font vraiment rien. Vous savez, ça retombe sur la ou les deux personnes de l’ équipe qui font réellement avancer les choses. Donc il y a vraiment cette culture où tout le monde veut être manager mais personne ne veut faire quoi que ce soit. J ’ai mis deux citations de côté [en préparation d’un séminaire à venir avec ma hiérarchie] qui, je pense, seront pertinentes pour vous […] : “ Nous avons une relation en pointillé21, ce qui signifie que je peux vous critiquer sans avoir à vous soutenir d’ une quelconque manière. ” Celle-là est pas mal. Et la seconde […] : “ Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne veut descendre les poubelles. ” Deux cas de figure qui me rebutent vraiment. »
- 16 ‒ Le barathon consiste à boire une boisson alcoolisée dans un maximum de bars se situant dans une même rue, un même quartier ou une même ville.
- 17 ‒ Nuançons toutefois que nous n’avons pas connaissance d’études qui permettent de conclure que le désengagement au travail chez les jeunes salariés est tout aussi voire plus significatif chez les Américains que chez les Français.
- 18 ‒ Une étude menée en juin 2022, sur un échantillon aléatoire de 15 091 employés américains âgés de 18 ans ou plus, actifs à temps plein ou à temps partiel.
- 19 ‒ Sur l’engagement au travail, on distingue traditionnellement trois catégories de salariés : ceux engagés (qui se sentent impliqués et enthousiastes au travail), ceux pas engagés (détachés de leur travail) et ceux activement désengagés (ou « démissionnaires bruyants », qui font le plus de bruit sur leur insatisfaction au travail, notamment sur les réseaux sociaux). Selon le Los Angeles Times, la première mention du terme de « démission silencieuse » aurait été faite par Bryan Creely, coach de carrière, dans une vidéo postée sur TikTok et YouTube en mars 2022.
- 20 ‒ Gallup a relevé quatre leviers principaux d’engagement au travail chez les jeunes américains de moins de 35 ans : avoir des perspectives d’apprentissage et de développement de carrière ; se sentir encouragés dans leur développement ; se sentir soutenus, avoir le sentiment que l’on se préoccupe d’eux ; savoir ce qui est attendu d’eux. Or, le pourcentage de jeunes salariés américains qui estiment qu’on se préoccupe d’eux, qu’on les encourage dans leur développement et qu’on leur offre des opportunités d’apprendre et de se développer satisfaisantes a baissé de 10 points entre 2019 et 2022. La pandémie semble avoir joué un rôle puisque cette baisse passe à 12 points pour les jeunes Américains qui travaillent complètement à distance ou selon des modalités hybrides, moins de quatre salariés sur dix parmi cette même population estimant savoir ce qui est attendu d’eux.
- 21 ‒ Le suivi «en pointillé» (ou dotted-line reporting en anglais) renvoie aux organigrammes où la hiérarchie (solid-line reporting) est assistée par d’autres fonctions d’encadrement «secondaires» (e.g., un chef de projet) puisqu’elles n’assument pas un rôle de supervision directe mais offrent ponctuellement un accompagnement supplémentaire dans la réalisation des tâches en tant que telle.
Revoir la place du travail dans l’expérience d’une vie satisfaisante
La possibilité de consacrer du temps à sa vie extra-professionnelle apparaît comme un enjeu significatif pour la plupart des personnes interrogées. Mais à travers la recherche d’un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle, peut aussi s’exprimer le souhait d’une démarcation nette entre les deux sphères, pouvant parfois aller jusqu’à une rupture au sens identitaire chez les Américains interrogés. Pour autant, le travail à distance, qui décloisonne les sphères domestique et professionnelle, est avant tout perçu comme une évolution positive, source d’autonomie.
Le caractère sacré de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
L’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle a été avancé comme l’un des aspects les plus fondamentaux d’une expérience au travail satisfaisante par la plupart des jeunes interrogés, français comme américains. Ce résultat vient confirmer bon nombre de sondages sur le sujet22. Comme l’exprime bien Patrick, il est souvent fait l’hypothèse que la prétendue « rupture » générationnelle sur le marché de l’emploi se jouerait en bonne partie autour de cette notion de valeur accordée au travail : « Je pense que c’est un facteur qui prend du poids. D’ailleurs, nos parents […] disent qu’on ne veut pas travailler. Je pense que ce n’est pas vrai. Je pense que c’est juste que [cet équilibre] est plus important pour nous et qu’il y a un shift de valeurs. Mes parents ont la valeur du travail mais c’est excessif selon moi. Typiquement, mon père […], jusqu’à mes dix-sept ans, je ne l’ai quasiment pas vu et je pense qu’il s’en veut mais il ne le dit pas. Et je pense que c’est quelque chose que je ne ferai pas. Je ne peux pas sacrifier ça. Je pense que c’est vraiment extrêmement important . » Les jeunes auraient ainsi envie de rééquilibrer la place que prend le travail par rapport à d’autres aspects de leur vie, en choisissant, souvent après une première expérience douloureuse, de ne plus tout « sacrifier » pour faire carrière. Ce souhait d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle n’entre pas en contradiction avec ce qui a été relevé plus haut, à savoir cette attente dominante chez les Américains d’aller dans des voies prestigieuses et sélectives. C’est notamment le cas de Claire : « J’ai réalisé que l’ équilibre vie pro-vie perso, ça fait tout. Et c ’est un peu contre-intuitif parce que j’ai fondé une start-up. Mais, je pense que les start-up, comme la vie elle-même, sont un marathon et non un sprint […]. J’ai beaucoup d’amis qui sont des fondateurs de start-up à succès, qui ont même vendu et quitté leur première entreprise et qui ont ensuite passé deux à trois ans à Bali pour récupérer, tant ils étaient traumatisés et épuisés par cette expérience. […] J ’ai vécu ce genre de vie, où l’on ne vit plus, pendant bien deux ans maintenant. Et j’ai réalisé, il me semble plus tôt cette année, que c’ était insoutenable. [ … ] Ce culte du bourreau de travail […] fait partie de la culture de nombreuses entreprises. Et peu importe à quel point les gens sont malins, ils finissent par partir parce qu’ils ne sont pas heureux. » À en croire les Américains interrogés, l’Europe serait d’ailleurs bien mieux lotie que les États-Unis en la matière : « J’ai travaillé [en Suède] pendant un été, de juin à août. Et [environ] la moitié des Suédois étaient totalement absents du bureau, tout le mois de juillet […] ce qui n’est pas un problème en soi et même bien pour eux. J’ aimerais bien avoir un mois entier de congés au milieu de l’ été. [ …] Je pense que les Américains pourraient certainement apprendre à être un peu plus détendus sur l’ équilibre entre vie pro et vie perso parfois. Souvent, il y a une certaine pression aux États-Unis qui pousse à travailler, travailler, travailler » , partage Ben.
Des nuances ou différences d’interprétation semblent toutefois exister derrière l’importance accordée à cet équilibre par les jeunes diplômés. Une première lecture répandue au sein de notre échantillon est celle exposée plus haut, qui a trait au nombre d’heures travaillées et au nombre de congés octroyés. Pour Pierre, il s’agit avant tout « d’avoir le temps de faire quelque chose après le boulot ». Même Patrick, qui estime pourtant bien supporter la charge du travail caractéristique du monde du conseil, parle d’une « partie incompressible ». « Plus on monte en grade, plus on travaille ; et pour moi, il y a une partie incompressible. Je veux avoir mes heures de sommeil et je veux faire mon sport. Tout le reste du temps, je peux travailler mais si on commence à empiéter sur ça, ça ne va pas le faire. […] Et plus on monte, plus la probabilité qu’on ait un enfant, une femme, etc. augmente ; si vous combinez tout ça, ça fait un cocktail Molotov de “Je n’ai pas le temps” », explique-t-il.
Toutefois, pour une partie des alumni de Harvard interrogés, la variable décisive semble plutôt être celle des marges de manœuvre, c’est-à-dire de qui décide de l’investissement au travail. « L’ équilibre [vie pro-vie perso] est une chose délicate, surtout dans le monde des start-up où il faut travailler très dur. Je travaille vraiment dur. Je travaille environ douze heures par jour. Je n ’ aime pas ça, mais je suis la COO [directrice des opérations] de cette entreprise et cet arbitrage en vaut la peine pour moi. Personne ne me fait travailler aussi dur ; je suppose que c’est là toute la différence. Je suis tout à fait contre le fait de devoir travailler de longues heures le week-end lorsque ce n’ est pas absolument nécessaire, ce qui m’est arrivé par le passé. [Dans mon ancien job en capital-risque], mon chef me contactait le week-end pour vérifier l’adresse de son hôtel… Non, ça, c’est vraiment stupide. J’aurais pu répondre à ce genre de demande le lundi, mais je devais répondre à ce moment-là. Donc c’ était n’importe quoi », explique Leah. Pour certains, il semblerait donc qu’une charge de travail lourde soit d’autant plus acceptable qu’elle découle d’un choix personnel. Autrement dit, l’autonomie exercée en matière d’implication au travail aurait une importance prépondérante par rapport au temps effectivement passé au travail. Par ailleurs, la mission de l’entreprise peut avoir un poids non négligeable dans cette recherche d’équilibre, comme en atteste la position adoptée par Sam : « Ça fait partie de mon image de moi dans le fond. J’ai assurément envie que le travail et ce que je fais comme travail constitue nt une partie, une bonne partie de mon identité. Je tiens à ce que mon travail ait un but. Et donc je suis tout à fait disposé à travailler plus parce que ce que je fais est utile. Et j’ ai vraiment l’impression que mon travail contribue à quelque chose de «plus grand» […] Pour moi, je dirais honnêtement que le travail peut dépasser les traditionnelles 35 heures françaises ou les 40 heures américaines. Le temps passé au travail peut aller au-delà. Ce n’est pas un problème. Vous savez, ça peut même être jusqu’à 55 heures voire plus. » Chloe raconte quant à elle qu’il lui arrive de se connecter le week-end pour apprendre, par exemple, à manier un nouvel outil et ainsi pouvoir travailler de manière plus efficace durant la semaine mais elle souligne qu’elle le fait toujours de son propre chef.
Pour d’autres encore, cet équilibre s’articule principalement autour de la notion de droit à la déconnexion, c’est-à-dire de coupure claire entre la vie professionnelle et la vie privée. Le témoignage de Patrice sur ses deux premières années en gendarmerie résume très bien cet enjeu : « Je pense que j’avais l’une des pires situations de France. […] C’était mal isolé, j’entendais tout. […] J’entendais le téléphone qui sonnait. J’entendais la grille de l’accueil qui s’ouvrait, se fermait à 8 h, midi, 14 h, 18 h. […] J’avais La Poste à côté, le centre de tri. Pareil ! À 7 h du matin, le bruit des chariots, “gling-gling-gling”. Donc il y avait ça : en termes de coupure vie-pro vie-perso, ce n’est pas ouf, surtout que j’avais un escalier de la brigade juste à côté de chez moi. […] Plus le téléphone ! […] Et ça, quand on ne l’a pas vécu, on n’a aucune idée de ce que c’est, c’est l’enfer sur terre. Pendant deux ans, je n’ai jamais éteint mon téléphone pro, jamais, jamais . »
Sur ce besoin d’une démarcation claire entre vie privée et vie professionnelle, les Américains interrogés ajoutent une nuance qui n’est pas amenée aussi explicitement côté français. Pour plusieurs d’entre eux, il est aussi question de frontière ou de « cloisonnement » au sens identitaire, c’est-à-dire, pour reprendre les termes de Leah, d’une séparation nette entre l’identité professionnelle (« work self ») et celle du dehors (« non-work self ») : « J’ai vraiment une identité professionnelle [«work self»] et une identité en dehors [«non- work self»]. J’essaie de mettre de côté mon identité professionnelle autant que je peux, si possible. » Les propos de Robert résument eux aussi très bien cette vision : « Pour moi, ce qui est vraiment important, c’est la capacité de laisser son travail au travail. […] Je veux être constamment en train de me réévaluer, m’assurer que je ne suis jamais dans un job où mon identité devient intrinsèquement liée à mon activité professionnelle. Et ce sentiment de désillusion de soi, je pense qu’il peut se produire dans un job de seulement 40 heures par semaine ou même moins. » De manière intéressante, Robert raconte avoir pu mûrir sa réflexion sur le sujet lors de son semestre d’étude en France : « Aux États-Unis, le mode de conversation par défaut consiste à interroger les gens sur leur travail et leurs projets professionnels […], à tirer des conclusions sur qui est quelqu’un à partir de ce qu’il fait professionnellement. [J’ai étudié en France pendant un semestre] et j’ai trouvé que cette pratique était moins courante lorsque je parlais avec des Français. Je pense que cette [expérience] a peut-être joué un rôle dans la formation de certaines de mes attitudes à l’ égard du travail, en me faisant comprendre que je n ’a i pas à être défini par mon travail. Peu importe à quel point je me sens bien dans mon travail et à quel point il me botte, être une vraie personne, entière, implique bien plus que cela. Votre travail est juste quelque chose que vous faites, ce n’est pas votre étiquette. » On peut voir dans ce témoignage une confirmation d’une hypothèse posée plus haut, à savoir que les jeunes français seraient plus attachés que leurs pairs américains à entretenir des relations plus personnelles au travail. On peut même y trouver une explication possible. En suivant le raisonnement de Robert, les Américains se définiraient donc d’abord par rapport à leur travail et tendraient à ne pas laisser leur vie privée faire irruption sur leur lieu de travail, contrairement à leurs homologues français.
Ainsi, selon cette dernière interprétation, la coupure entre la vie professionnelle et la vie privée doit permettre de préserver l’accès à d’autres sources identitaires que le travail, c’est-à-dire garantir aux jeunes diplômés la possibilité de mener une vie épanouissante par ailleurs, à commencer dans leurs relations intimes d’après Sam : « Pour moi, l’ équilibre vie pro-vie perso consiste à m ’ assurer que j’ai suffisamment de temps pour ne pas mettre à mal mes relations personnelles, en particulier avec mon mari. C’est un point important. Avoir assez de temps pour régulièrement déconnecter pleinement et se couper du travail. C’est un élément clé pour moi. » Ou encore dans leurs activités extra-professionnelles d’après Jade : « Si je n’avais pas à travailler pour gagner de l’argent, je ne le ferais pas. Bien sûr, j ’aime avoir un impact positif sur le monde par mon activité professionnelle, mais j’adorerais ne pas travailler. Il y a tellement de loisirs auxquels je préférerais m’adonner plutôt que de m’asseoir à mon bureau huit heures par jour. […] J’essaie en fin de compte de gagner de l’argent pour pouvoir poursuivre d’autres intérêts. » À ce titre, Robert comme Sam mettent en garde contre une implication extrême dans son travail, notamment par identification avec la mission de l’organisation. Tous deux évoquent le risque d’abandon de soi dans son travail (voire le « complexe du Messie » pour Robert) pouvant aller jusqu’au burn out, typique de professions comme les leurs, mues par l’intérêt général. « Je pense qu ’il est beaucoup plus important de réfléchir aux conditions du maintien d’une certaine distance [avec son travail], en se rappelant que le travail n’est que le travail. C’est très pertinent dans les endroits où je travaille parce que […] beaucoup d’avocats [dans la fonction publique] perdent cet aspect de vue et ont l’impression qu’ils ne travaillent pas seulement dans un domaine qui a une mission sous-jacente vertueuse, mais qu’il leur incombe de se lancer à corps perdu dans leur travail pour sauver le monde, au détriment d’eux-mêmes, ce qui n’est pas la façon dont le travail est censé fonctionner », raconte Robert.
Quand travail à distance rime avec autonomie
Début 2020, l’arrivée de la pandémie de Covid-19 et les règles sanitaires qui en ont découlé ont contraint les entreprises à repenser leur organisation. Le travail à distance, jusqu’alors peu répandu en France, s’est déployé massivement, y compris dans des entreprises qui y étaient réticentes.23
Les alumni de l’École polytechnique ont donc vécu des changements significatifs au cours des confinements, périodes plutôt dures à vivre notamment en raison de l’isolement social. Comme on l’a vu précédemment, ces jeunes polytechniciens nourrissent des attentes particulières sur la qualité de leurs relations avec les collègues. Il n’est donc pas surprenant qu’ils aient mal vécu cet affaiblissement du collectif de travail. Un constat corroboré par une enquête de Terra Nova auprès d’un échantillon de salariés français ayant travaillé à distance entre le 1 er et le 20 avril 2020, qui montre que le manque d’environnement social professionnel était l’une des principales difficultés rencontrées (Pech et Richer, 2020). Un consensus semble d’ailleurs émerger, parmi les alumni de l’X, en faveur d’un travail hybride comprenant entre un et trois jours de télétravail, plusieurs personnes ayant souligné l’importance des échanges en face-à-face pour fluidifier la communication, simplifier la coordination et entretenir des rapports agréables avec leurs collègues. Une autre difficulté relevée par cet échantillon est la difficulté à séparer les sphères professionnelle et privée. Certains ont même souligné une tendance à « s’oublier » dans leur travail en pratiquant des horaires excessifs.
Mais pour les deux échantillons interrogés, le télétravail a avant tout été perçu comme un changement positif, une source de souplesse dans la gestion de son temps et de son lieu de travail, donc synonyme d’un élargissement du champ des possibles. Sans entamer la qualité du travail effectué à domicile, le temps a été réaffecté à d’autres sphères, en particulier à la famille et aux loisirs. Laura raconte par exemple comment le télétravail a rendu possible son projet de s’installer dans la Drôme, sans freiner son projet entrepreneurial d’accompagnement de structures dans leur transition écologique. Le basculement vers le télétravail a ainsi conduit à l’irruption de la vie personnelle des salariés dans leur vie professionnelle (et inversement), brouillant les frontières auxquelles les salariés sont généralement attachés. Ces résultats confirment ceux de Taskin et al. (2022) qui montrent au travers de récits de vie que la crise sanitaire a été l’occasion pour les salariés de renégocier certains arbitrages entre vie professionnelle et vie privée, parfois en concrétisant des aspirations de longue date. Il n’est donc pas étonnant que le travail à distance figure assez haut désormais dans les attentes des jeunes diplômés lors des entretiens d’embauche.
Il faut ici rappeler que les alumni de l’X et de Harvard parlent peu des effets de la crise sanitaire sur leurs représentations du travail. Celle-ci n’a donc pas été l’élément déclencheur de souhaits de réorientation professionnelle voire de rupture, le cas échéant. Comme le suggèrent Taskin et al. , le temps du confinement pourrait avoir donné la possibilité aux salariés de mûrir ou d’accélérer des projets déjà initiés, sans nécessairement remettre radicalement en question la situation professionnelle en cours.
Enfin, une différence apparaît entre les deux populations : les alumni de Harvard sont plus nombreux à vouloir très clairement choisir leur lieu de vie. Qui dit travail à distance – particulièrement à temps complet – dit possibilités démultipliées de choisir où vivre, à court ou à long terme d’ailleurs. Jade raconte être comblée de pouvoir passer fréquemment du temps dans les montagnes de l’Ouest américain avec sa partenaire plutôt que d’être coincée dans le « trou perdu » où est basée son entreprise. Elle ajoute qu’elle a grandement apprécié son séjour en Europe cet été, lors duquel elle a pu combiner loisir et télétravail. Leah, qui travaille pour une entreprise basée dans le Massachussetts alors qu’elle vit à Seattle, affirme qu’elle ne reviendra jamais à un job « non remote [sur site], à moins de devenir la CEO d’Amazon ». Greg explique qu’il voulait absolument travailler à New York, à tel point qu’il a accepté de travailler en horaires décalés de 15 h à minuit depuis Londres, tout en étant rattaché à une équipe new-yorkaise, afin d’augmenter ses chances d’obtenir un visa rapidement. Peter liste également son lieu de résidence parmi ses critères de priorité, indiquant qu’il souhaiterait idéalement retourner dans son pays d’origine ou qu’il se sentirait plus à l’aise dans une grande ville comme New York ou Boston s’il devait rester aux États-Unis.
Ainsi, alors que le bureau reste essentiel pour les jeunes diplômés de l’X dans le cadre d’un travail hybride, ne serait-ce que pour la convivialité et le maintien des relations avec les collègues, il peut être perçu par les alumni de Harvard comme une entrave à la liberté de choix de lieu de résidence et de travail. Nous ne prétendons pas toutefois parler ici de manière représentative de l’ensemble des salariés américains, encore moins affirmer que les Américains seraient moins attachés au bureau que les Français. En effet, une enquête menée mensuellement entre mai 2020 et mars 2021 par le National Bureau of Economic Research (Barrero et al. , 2021), auprès d’un échantillon de 30 000 travailleurs américains âgés de 20 à 64 ans et gagnant plus de 20 000 dollars par an, montre que la moitié environ des employés qui peuvent télétravailler dans leur emploi actuel souhaitent partager leur semaine de travail entre le domicile et les locaux de l’employeur. Notons tout de même que près de 20 % d’entre eux souhaitent désormais télétravailler intégralement, alors qu’ils n’étaient que 5 % avant la pandémie de Covid-19.
- 22 ‒ Voir l’étude de Deloitte (2021).
- 23 ‒ Selon la Dares (2021), seulement 4 % des salariés français télétravaillaient au moins une fois par semaine en 2019.
De l’utilité sociale de son activité
Alors que les alumni de l’X formulent des attentes fortes sur l’engagement de leur entreprise en matière environnementale, les alumni de Harvard tendent à insister davantage sur la dimension matérielle du travail. Mais ceux-ci ne s’avèrent pas pour autant indifférents à la question plus générale de l’utilité sociale de leur activité professionnelle. Sur cette dernière dimension, bon nombre de personnes interrogées de part et d’autre de l’Atlantique expriment par ailleurs un besoin d’équilibrer la force de frappe organisationnelle avec la volonté d’avoir un impact individuel.
Des exigences environnementales particulièrement élevées en France
La cause environnementale est souvent énoncée comme une priorité par les polytechniciens lors du choix de leur employeur. Ce n’est pas véritablement une surprise quand on se souvient que le Manifeste pour un réveil écologique24 a récolté plus de 30 000 signatures auprès d’étudiants de grandes écoles depuis son lancement en 2018. Il se peut même que l’accent mis sur cette cause se double d’une certaine « radicalité », ou du moins, d’une intransigeance accrue par rapport à d’autres missions. Cette hypothèse est nourrie par le parcours de Laura qui, refusant le primat de la rentabilité financière, a préféré monter sa propre structure plutôt que de continuer à travailler pour une organisation participant de facto d’une logique de greenwashing . Ce phénomène de greenwashing est en effet de plus en plus déploré par les jeunes générations : le sentiment de tromperie est d’autant plus fort lorsque l’organisation entretient une rhétorique importante sur le sujet en plaçant la cause environnementale parmi ses priorités officielles. Alors qu’elle travaillait pour une plateforme d’entrepreneurs sociaux active dans les domaines de la reforestation, d’agroforesterie et de conservation forestière, Laura explique avoir terminé en burn out , à la suite de deux épisodes de « prise de conscience » avec des clients, ayant mis en lumière la priorité de facto toujours accordée à la rentabilité financière. Elle dit être très sensible aux « dissonances cognitives » une fois qu’elle s’en rend compte ; en l’occurrence, il lui aura fallu un an pour arriver à « cheminer elle-même » et voir en face les pratiques de greenwashing dont lui avait parlé un ancien collègue. Réalisant que même les organisations qui affirment servir une cause noble peuvent avoir des pratiques douteuses, Laura a alors préféré se mettre à son compte, d’abord pour créer un village éco-responsable, et aujourd’hui pour accompagner tous types de structures dans leur transition environnementale.
Cette décision renvoie en réalité à deux phénomènes, largement relatés par la presse aujourd’hui. Le premier est celui de ces reconversions fulgurantes d’anciens traders ou plus généralement de cadres hautement diplômés, qui deviennent boulangers, bouchers ou encore agriculteurs. Pour autant, Laura n’est pas en cela représentative de la jeunesse française, ni même de celle issue des grandes écoles. D’abord, ces trajectoires en rupture ne représentent qu’un phénomène marginal et sont plus souvent le fait des travailleurs moins qualifiés et au statut précaire (Lhommeau et Michel, 2018). Ensuite, elle s’appuie dans le cas présent sur un capital économique, condition nécessaire à la création de tout commerce, mais aussi sur un capital social, telles que des compétences en management ou un réseau d’anciens élèves, qui influencent fortement la réussite du projet de reconversion radicale (Le Gros, 2020). Le projet de Laura est donc très atypique et ne doit pas être extrapolé au-delà de son cas personnel. Il est en revanche symptomatique de ces nouvelles exigences à l’égard des employeurs en matière sociale et environnementale : selon une étude réalisée par Ticket for Change25, 83 % des Français considèrent que l’impact social et environnemental de leur futur emploi est un critère de choix important. Les plus jeunes sont tout particulièrement concernés par ces préoccupations puisque 30 % des 18-24 ans considèrent cet aspect comme « déterminant », contre 17 % pour les 65 ans et plus.
Nous constatons également cet attachement à la question environnementale à travers le parcours de Pascal qui a décidé, après une expérience décevante en entreprise, de se lancer dans un doctorat sur les événements climatiques extrêmes. Il lui semblait en effet aberrant de poursuivre une voie professionnelle qui ne chercherait pas à résoudre les grands enjeux sociétaux du monde contemporain : « Ta maison est en feu et puis toi, tu tonds la pelouse. Il y a peut-être des choses plus urgentes à faire. C’est ça qui m’a posé problème. C’est cette disproportion-là entre des choses un peu insignifiantes et un peu mesquines qu’on faisait et les enjeux immenses qu’il y avait à côté. Et je pense que dans la recherche, je me sens plus proche de ces enjeux-là. […] Je pense vraiment que ce que je fais et que les méthodes que je peux développer, même si elles se basent sur des outils mathématiques abstraits, ont quand même la possibilité d’avoir un impact très important sur les sociétés humaines. » De manière similaire, Aurélien évoque sa volonté de « rendre à l’État l’investissement qui a été fait » en ayant fondé sa start-up pendant sa scolarité à l’X, dédiée à la fossilisation des déchets : « Tu vois, quand je te dis qu’on peut réduire de 5 % les émissions de gaz à effet de serre français, c’est ce genre de choses qui m’intéresse. C’est d’avoir un impact industriel. »
Ces différentes expériences montrent comment la prise de conscience écologique va jusqu’à modifier ou en tout cas dessiner les parcours professionnels et les orientations de jeunes diplômés de l’École polytechnique. Les modalités pour y parvenir diffèrent d’un individu à l’autre, certains étant prêts à tolérer un certain niveau de compromission quand d’autres à l’image de Laura font des choix plus radicaux. En miroir de ce constat, rares sont les alumni de Harvard à formuler des exigences auprès de leur employeur en matière environnementale. À l’exception notable de Jade, passionnée par le secteur de l’énergie, les personnes interrogées ne semblent pas considérer que les entreprises ont un rôle premier à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique.
La capacité d’action individuelle avant la mission ?
Des Américains moins sensibles à la mission de l’organisation dans l’ensemble
Une différence majeure apparaît entre les deux populations : les considérations pécuniaires semblent davantage entrer en ligne de compte chez les alumni de Harvard que chez les polytechniciens interviewés. Autrement dit, les sujets américains de l’étude apparaissent, dans l’ensemble, eux aussi sensibles à la mission de leur organisation mais pas à n’importe quel prix (littéralement) : « Je dirais qu’[avoir un impact] est un facteur de motivation assez important pour moi [mais] ce n ’est probablement pas l’alpha et l’oméga pour être tout à fait honnête. Est-ce que j’accepterais un job où j’occuperais une position prestigieuse et où je recevrais un salaire élevé dans une entreprise qui fasse quelque chose que je ne pense pas nécessairement être si important ? Je le ferais probablement […] » , partage Leah. Il y aurait donc comme un primat de l’économique sur l’extra-économique dans la représentation américaine du travail.
Ce décalage entre les deux populations va au-delà de la question du rôle des entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique. On le retrouve par exemple dans la définition d’un impact positif pour les Américains : à savoir le contraire d’une action strictement négative, un acte qui ne cause pas de tort ou, toujours selon Leah, « ne pas travailler pour les méchants » : « Il y a une sorte de différence entre être véritablement une entreprise “ à impact ” , comme celle pour laquelle je travaille, et une entreprise pas à impact mais qui au moins ne cause pas de tort. Par exemple, travailler chez Facebook est devenu un bon exemple pour ma génération : c’est une entreprise très prestigieuse, qui paie très bien, où l’on n’a pas besoin de travailler très dur, il y a beaucoup de bonnes choses par rapport à cette entreprise, mais pouah, il faut faire face à des questions difficiles pour travailler chez Facebook au vu de leur impact sur le monde. À l’inverse, prenez […] Lyft, la société de covoiturage. Eh bien, Lyft ne change pas nécessairement la face du monde, le covoiturage est une activité relativement normale [mais] Lyft est une entreprise relativement progressiste. Elle prend position sur des questions clés (elle a fait une déclaration sur Roe v. Wade, par exemple). Elle fait beaucoup de dons. Elle essaie de s’impliquer dans la lutte contre le changement climatique, etc. Donc, même si votre entreprise n’est pas une entreprise à impact, qu’elle n’a pas le label B corp, il faut au moins qu’elle vous donne le sentiment de ne pas travailler pour les méchants, je dirais. Je dirais donc qu’[avoir un impact] est probablement au milieu voire en haut de ma liste de priorités au travail. » Le témoignage de Leah fait écho à la vision de Greg, plus radicale encore, du travail comme « gagne-pain » . Pour celui-ci, qui a fait le choix de s’expatrier aux États-Unis, l’absence d’impact social positif est en réalité la norme dans beaucoup d’entreprises : il estime que peu de modèles d’affaires sont réellement amenés à évoluer, qu’il est souvent question d’innovation incrémentale pour « mettre de l’huile dans les rouages » , « faire d’autant mieux tourner la boutique », ce qu’il ne voit pas d’un mauvais œil, tant qu’il reste bien payé.
Pour une partie des diplômés de Harvard interrogés donc, « business is business ». Cela entraîne des attentes plutôt minimalistes sur l’utilité sociale de l’entreprise, avec la loi comme boussole comme le suggère Chloe : « Pour moi, le sens au travail c’est que, tant que tant que j’ aide l’entreprise ne serait-ce qu’ à fonctionner comme une entreprise prospère, je pense que cela crée de la valeur. Dans le sens où l ’entreprise en tant que telle est capable d’avoir un impact d’une plus vaste ampleur. Donc, tant que l’entreprise est saine, pour moi, ça a du sens. Et en fait, je n’ai pas vraiment réfléchi à la question environnementale ou sociale ou à d’autres grands concepts auxquels l’activité de l’entreprise peut contribuer. Mais au moins, elle ne devrait pas avoir d’impact négatif à ce niveau. Si je sais que l’ entreprise n’a pas de véritable éthique de travail ou ne préserve pas son intégrité commerciale, alors c’est un problème. Mais tant que vous êtes en règle, si vous essayez de gagner de l’argent, de développer une entreprise, tout va bien. Une entreprise a une nature commerciale. »
Ces propos méritent néanmoins d’être nuancés, dans la mesure où d’autres personnes interrogées côté américain font preuve d’attentes plus élevées par rapport à la mission de leur organisation. Peter, par exemple, cite l’impact extra-économique parmi ses priorités principales et apprécie en ce sens l’approche de la fonction publique, qui induit des changements plus systémiques selon lui, même si cela peut se solder parfois par des effets plus localisés ou plus lents à mettre en place que dans le privé. Ou encore, Jade dit être particulièrement sensible à l’hypocrisie de certaines entreprises prétendument vertes : « Pour moi, le sens de l’impact, c’est que mon travail contribue au bien commun et rien qu’au bien commun. Quand on prend la structure capitaliste dans son ensemble, je suis sûre que des gens issus de la finance se réconcilient en quelque sorte avec leur âme en se disant : “ Oui mais nous faisons tourner l’ économie et si l ’ économie ne tournait pas, vous ne pourriez pas réaliser vos projets d’écolos idéalistes. ” Mais je ne pourrais jamais travailler dans le domaine de la finance où l’essence même de mon activité consisterait, chaque jour, à faire des profits juste pour faire des profits … » Soulignons au passage comment elle formule ses exigences : « un travail qui contribue au bien commun et rien qu’au bien commun [… ] » ; ce qu’elle exemplifie de la manière suivante : « Dans mon ancienne entreprise, j’aidais à construire [le] réseau 5G […]. Les télécommunications sont probablement le secteur le plus privatisé et le plus capitaliste des services publics. Je pense que, parfois, c’était vraiment ce qui me plombait, si je puis dire. J’avais l’impression que nous essayions de produire, produire, produire et que ce que nous produisions n’avait pas vraiment d’importance. Mais je pense sincèrement que les services publics sont des infrastructures essentielles. Et la capacité d’ être connectés les uns aux autres renvoie à un besoin nécessaire, à des infrastructures sur lesquelles nous comptons tous vraiment. Leur entretien et leur amélioration so nt quelque chose d’important. J ’y voyais donc quand même cette utilité. [Maintenant, je travaille dans le secteur de l’ énergie et] j’y vois un impact encore plus important car je participe au développement, à la recherche et à l ’amélioration de technologies qui, selon moi, sont vraiment indispensables à notre longévité et à notre bien-être sur cette planète. »
Pour les polytechniciens aussi, l’utilité sociale du travail est une préoccupation importante, même au-delà de la cause environnementale. La mission de l’organisation est un levier de motivation au travail, capable de contrebalancer certains aspects moins désirables tels que des tâches à faible valeur ajoutée : « [L’impact de mon activité] est important pour moi. […] Je fabrique des machines d’imagerie médicale qui servent pour le dépistage du cancer du sein et qui, du coup, servent à sauver des vies. […] C’est super important pour moi. Quand je me dis “Ah, c’est dur, il y a plein de boulot en ce moment” ou “Ce que je fais là n’est pas très motivant” (parce que dans mon job, il y a des tâches qui sont motivantes et d’autres qui sont moins intéressantes), je me dis “OK, c’est pour ça que je le fais.” Et ça me redonne de la motivation » , raconte Caroline. La réflexion sur l’impact de son activité peut aller jusqu’à motiver des reconversions, comme l’explique Patrice qui est passé de l’industrie aéronautique à la gendarmerie : « Il y avait l’idée de faire un métier utile aux autres […] et de sortir un peu du commun, c’est-à-dire [d’] une vie de bureau où mon objectif est d’améliorer l’injection de kérosène sur les nouveaux moteurs […] pour pouvoir gagner 0,2 % en consommation. C’est très chouette mais j’ai du mal à trouver du sens à ce que je fais […]. Il faut […] qu’on m’explique clairement la finalité. En gros, j’améliore les 0,2 % du moteur pour quoi in fine ? […] Pour vendre le moteur un peu plus, dépasser le concurrent, […] faire un effet rebond sur les avions ? Comme ça, il y aura plus d’avions qui pourront voler parce que ça consomme moins, tout ça pour que les gens partent une semaine en vacances à Ibiza. Enfin, je caricature un peu mais tu vois, le sens in fine de mon action ne me paraissait pas bon pour la société au sens large, même pas pour les gens peut-être. »
Pour autant, les jeunes alumni de l’X interrogés ne semblent pas faire preuve de « naïveté » sur les possibilités d’action de leur organisation. Autrement dit, ils n’ont pas formulé des attentes que l’on pourrait qualifier de démesurées, voire d’irréalistes en matière d’utilité sociale. En atteste particulièrement la position de Marc, qui s’interroge sur les manières de limiter les « conséquences non désirables » des usages de l’intelligence artificielle. Ou encore Pierre qui, tout en œuvrant pour le développement des énergies renouvelables, estime que l’impact de son employeur ne peut être que réduit au vu des choix énergétiques français.
Un questionnement partagé sur le pouvoir d’agir de l’individu
De part et d’autre de l’Atlantique, les jeunes diplômés semblent fréquemment confrontés au dilemme suivant, bien résumé par Sam : « Est-ce que vous voulez être le chef de file de votre propre structure, certes petite, mais donc avoir beaucoup d’impact dans cette sphère d’influence à taille réduite ? Ou est-ce que vous voulez être un petit rouage d’une machine plus vaste, et cette machine elle-même a un énorme impact ? » Si la mission de l’organisation ne laisse pas les jeunes diplômés indifférents, il semblerait en effet que la question de leur action individuelle (au sens « d’agency » en anglais) demeure une préoccupation importante pour bon nombre d’entre eux. Ce « tiraillement » semble d’autant plus marqué côté américain, en résonance avec d’autres constats faits précédemment sur l’importance des choix individuels : « J ’aime vraiment voir que mon travail a un impact tangible. […] Je ne vais probablement pas rester indépendant pour toujours. [Si j’arrête un jour de travailler à mon compte], je travaillerais probablement pour une structure de petite taille, tout simplement parce que vous y avez un plus grand pouvoir d’agir individuel [“agency”], de meilleures opportunités d’avoir plus directement un impact. Mais en même temps, si vous deviez parler à quelqu’un dans une entreprise d’une plus grande envergure, comme chez, je ne sais pas, Amazon, il dirait sûrement : “ Nous travaillons avec des produits qui touchent un milliard de personnes. ” Vous verriez un impact énorme à votre activité parce que vous travailleriez sur une échelle beaucoup plus grande. C’est l’arbitrage à faire en travaillant dans un endroit plus petit. Vous n’avez pas cette échelle » , observe Ben. Une appréciation largement relayée par Claire. Mais cette préoccupation se retrouve aussi côté français, notamment dans le besoin de voir « des résultats concrets » aux efforts intellectuels fournis au travail : « Quand vous faites de la théorie et de l’application côte à côte, il y a deux avantages. Première chose, […] vous voyez les fruits de votre recherche. Et deuxième chose, […] vous pouvez voir les limites de vos approches » , remarque Marc.
Des deux côtés de l’Atlantique, ce dilemme se résout parfois dans le sens inverse, c’est-à-dire par une tendance à privilégier la force de frappe de l’organisation sur sa propre capacité d’action individuelle. C’est ce que suggère le récit de Jade qui occupe un poste de data scientist dans une ONG du secteur de l’énergie : « Même s ’il s’agit de quelque chose de modeste, même si un projet échoue, même si je fais un demi-pas en avant, je n’ai pas besoin de créer la prochaine technologie révolutionnaire, je n’ai pas besoin d ’ être célèbre, je n ’ai pas besoin de gagner un prix No bel. Savoir que mes 40 heures par semaine vont aider d’autres personnes à comprendre les émissions de méthane et comment les atténuer, […] cela me suffit. » Repensons aussi à la position de Caroline, pour qui la mission de son entreprise actuelle (dépister des cancers du sein) contrebalance en partie les tâches à faible valeur ajoutée qu’elle doit occasionnellement réaliser. Cet ajustement, cette acceptation de perdre en capacité d’action individuelle « pour alimenter la machine » capable de réellement faire bouger les choses, peut toutefois venir au prix d’un certain « désenchantement », comme l’illustre le cas de Sam : « Je me suis rendu compte que les résultats sous forme de données [et de graphiques] que je produis […] servent en fait à alimenter «la machine», à faire avancer l’ensemble, et ça peut être un peu étouffant. C’est comme s’il n’y avait pas de vrai changement programmatique, programmatique au sens de changement sur le terrain, pour les gens et leurs vies réelles. On peut un peu le vivre comme un désenchantement quand on réalise que “ Oh, au mieux, certaines des choses que nous faisons auront un impact secondaire ” . Parce que, vous savez, votre travail rend la chose possible, mais votre travail ne fait rien directement. Vous faites en sorte que l’argent soit dépensé pour faire X. »
Le niveau de rémunération : un tabou ?
Si la question de l’utilité sociale et environnementale de leur emploi prend de l’ampleur chez les jeunes élites interrogées, celle de la rémunération n’en reste pas moins centrale. Elle est toutefois abordée avec bien plus de transparence par les alumni de Harvard, qui ne se cachent pas de la mettre parmi le top 3, voire en tête de leurs priorités. Ainsi, Leah explique que l’argent est pour elle « vraiment important » : « Je suis très transparente sur l’argent. J’ai travaillé à mon compte. J’avais une compréhension très fine de ma valeur parce que je facturais littéralement à un taux horaire. J’ai une compréhension exceptionnellement précise de ce que je peux gagner sur un marché libre. Dans mon poste actuel, je gagne 160 000 euros par an, sans compter les primes alléchantes qui font grimper ce chiffre à 200 000 euros. Je fais toujours du conseil à côté pour gagner encore plus d’argent parce que je suis motivée par l’argent. […] Si je dois dire quels sont les facteurs en fo nction desquels j ’ évalue une nouvelle opportunité , l ’argent est définitivement dans le top 3, si ce n’est la priorité numéro 1, je dirais. » De même, si Robert, avocat militant pour les droits fondamentaux, dit accepter de revoir à la baisse ses prétentions salariales dans la mesure où l’organisation qui l’emploie dispose de ressources limitées, il reconnaît aisément qu’il existe un plancher en deçà duquel il n’est pas prêt à négocier, sur la base de deux critères : la reconnaissance des longues études qu’il a menées et la possibilité de jouir de fonds suffisants pour vivre une vie qu’il juge épanouissante en dehors du travail. À la lumière de ces témoignages, il semblerait que l’importance accordée au salaire puisse s’expliquer au moins en partie par des motivations instrumentales. Autrement dit, l’argent servirait avant tout de moyen de remplir d’autres besoins, comme le confirme également Robert : « [Je tiens à] avoir suffisamment de revenu réel pour pouvoir m’adonner à mes hobbies, qui me font me sentir plus comme une personne et pas seulement comme un avocat. J’adore aller à des concerts, j’ adore la musique rock. Il est important pour moi que je puisse me permettre chaque mois de payer mon loyer, de faire les courses, de m’offrir l’abonnement HBO Max, de mettre un peu d’argent de côté pour mon avenir et aussi d’aller à un ou deux concerts de groupes que j’aime. »
De manière plus mesurée, Chloe juge acceptable d’être payée à hauteur de la moyenne du marché – à qualifications similaires – voire légèrement en-dessous ; Ben est parfaitement conscient qu’il pourrait gagner davantage dans une autre entreprise plutôt qu’à son compte mais estime gagner au change notamment en termes de flexibilité et d’impact positif sur la société, en plus d’avoir un salaire suffisamment élevé pour subvenir à ses besoins. Ou encore, Sam affirme que dans le domaine du développement économique et social, la rémunération n’est traditionnellement pas une priorité, bien qu’il reconnaisse que tous sont relativement bien lotis dans son organisation internationale. Ce dernier témoignage fait d’ailleurs écho à celui de Peter, chercheur en économie du développement, affirmant lui aussi être dans une situation privilégiée, suffisamment confortable (sans enfants et sans dette étudiante) pour ne pas avoir à opérer d’arbitrages entre rémunération et impact perçu de son activité, qu’il décrit comme l’une de ses priorités principales.
Les entretiens menés avec les jeunes diplômés de l’X ont une tonalité différente. Les personnes interviewées affirment en effet n’accorder que peu d’importance au niveau absolu de leur salaire, surtout comparé à d’autres dimensions de l’expérience au travail, incluant notamment le développement de soi, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la qualité des relations et la mission de l’organisation. Plusieurs enquêtes montrent que les jeunes générations, notamment issues des grandes écoles, nourrissent des attentes particulières au-delà de la seule question de la rémunération. En mars 2021, une étude menée conjointement par Ipsos, BCG ( Boston Consulting Group) et la Conférence des Grandes Écoles auprès de 2 242 étudiants et alumni de grandes écoles note que d’autres considérations comme l’intérêt du poste et l’ambiance au sein de l’entreprise sont, y compris après la crise sanitaire, des critères de choix essentiels, loin devant la rémunération. Toutefois, il ne faudrait pas en conclure que les jeunes alumni négligent la question de la rémunération au seul profit de la « quête de sens ». Il n’est en effet pas exclu que ce manque d’intérêt exprimé par les alumni de l’X soit lié aux vastes opportunités qui leur sont offertes.
Autrement dit, une fois la sécurité financière garantie, il est sans doute plus aisé de se focaliser sur d’autres aspects moins « tangibles », moins « matériels » de l’expérience au travail, comme la mission, l’alignement entre ses propres valeurs et celles de l’organisation, etc. Ce point est bien illustré par le témoignage de Camille : « Je mentirais si je disais que [le sujet de la rémunération] n’était pas important. Ça change quand même ta vie au quotidien. Je pense qu’en France, il y a moins cette comparaison constante sur les salaires. Je suis très proche d’un groupe d’amis de Polytechnique […] ; je pourrais classer les salaires mais je serais incapable de dire exactement combien chaque personne gagne. Ça n’a pas motivé mon choix de rejoindre un corps, même si je savais qu’en début de carrière, les salaires dans les corps sont très corrects, plutôt dans le milieu-haut des salaires de sortie de Polytechnique. Peut-être que dans dix ans, j’aurai un discours différent. Je n’espère pas mais, peut-être que dans dix ans, quand mon salaire sera ridicule par rapport à ceux du privé, je dirai autre chose. Pour l’instant, c’est vrai que ce n’est pas un gros sujet pour moi ; mais c’est plutôt parce que je suis bien lotie. Donc c’est simple de dire ça . »
Corroborant cette hypothèse, un sondage mené conjointement par la Fondation Jean-Jaurès, la Macif et BVA Group en décembre 2021 auprès de 1 000 jeunes de 18 à 24 ans, tous niveaux de diplôme confondus, indique que la première préoccupation des jeunes est d’être bien rémunéré (43 %), avant l’autonomie dans le travail (18 %) ou l’alignement avec des valeurs qui leur tiennent à cœur (16 %). On peut dès lors supposer que les jeunes les moins qualifiés accordent moins d’importance à la quête de sens, celle-ci n’intervenant que lorsque les dimensions matérielles du travail sont satisfaites. De ce point de vue, le verbatim de Caroline au sujet de collègues travaillant sur les lignes de production est particulièrement éclairant : « Ces gens-là, globalement, la seule chose qui les intéresse ou pour les motiver, c’est l’argent. […] S’il n’y a pas l’argent, dans le sens où ils ne sont pas augmentés correctement, ils ne sont pas contents, quoi qu’il arrive. On a beau faire tous les efforts qu’on veut sur tout le reste, ils ne seront pas contents. […] C’est sûr qu’on n’est pas motivé par les mêmes choses. Moi, clairement, ce qui me motive dans mon job, ce n’est pas en premier lieu l’argent. Si je n’avais pas besoin d’argent pour vivre, je pourrais faire ce travail-là, ça ne me dérangerait pas. Ce qui était le plus important dans mon job, c’était d’avoir un job qui m’intéresse, où je fasse des trucs au quotidien qui me donnent envie de venir travailler le matin, que ça ait du sens, beaucoup plus ça que le fait d’avoir un salaire qui soit élevé ou quoi. »
Si les jeunes diplômés de l’X abordent peu le sujet du niveau absolu de leur rémunération, d’autres paramètres apparaissent prioritaires, notamment les procédures de répartition en vigueur. Pour Laura par exemple, il est avant tout question d’assurer une sécurité financière pour tous, puis de mettre en place des procédures qui servent les valeurs de transparence, de délibération et d’équité, avec une part variable majoritairement fonction des efforts fournis, évalués à l’issue d’une discussion des ressentis de chacun. Chez Patrick, on trouve une sensibilité similaire, puisqu’il formule des attentes claires en matière d’équité et de justification quant à la distribution des bonus décidée par les partners de son cabinet de conseil.
- 24 ‒ Voir : https://www.google.com/url?q=https://pour-un-reveil-ecologique.org/fr/&sa=D &source=docs&ust=1674842398787101&usg=AOvVaw0_DzLyXDfCCEN6ZRMmYCjx
- 25 ‒ Ticket for Change est une école de formation pour « acteurs de changement ». Elle forme et accompagne des personnes souhaitant donner du sens à leur activité, à travers des programmes et outils pédagogiques qui s’adressent à la fois à des entrepreneurs, des salariés ou des entreprises.
Le sens au travail comme patchwork
Au-delà des tendances culturelles mises en évidence jusqu’ici, les deux populations étudiées présentent fréquemment un raisonnement par arbitrage entre les différents éléments constitutifs du sens au travail. Dit autrement, alors que les récits médiatiques relaient une certaine radicalité des jeunes élites à l’égard de la mission des organisations, cette partie souligne, au contraire, leur tendance à transiger sur cette dimension en pondérant son importance avec d’autres préoccupations. Ce raisonnement par arbitrage est en partie fonction des sensibilités de chacun.
Raisonnement fréquent par arbitrage
Les étudiants expriment, à des degrés divers, un tiraillement entre des aspirations contradictoires, certaines plutôt altruistes (défense de l’environnement, impact social de l’activité…), d’autres plus matérialistes (rémunération notamment). Contrairement à ce qu’expriment les mécontentements manifestés par les étudiants de grandes écoles, notamment lors des célèbres discours de promotion protestataires, les jeunes alumni de notre étude font part d’un raisonnement « par arbitrage » entre les dimensions constitutives du sens au travail. On aurait pu s’attendre, particulièrement chez les polytechniciens, à une « radicalité » plus marquée sur la préséance de la mission. Si cette question de l’impact a poussé Caroline à passer de l’industrie automobile à celle de la santé, celle-ci reconnaît tout de même ne pas être allée au bout de la logique : « Après, je bosse quand même pour une entreprise capitaliste américaine dont le but est de faire de l’argent. Mais… on ne peut pas tout avoir. Au moins, je le fais pour sauver des vies […]. » Pour Marc, nous l’avons vu, l’utilité sociale de son activité pèse dans la balance mais il ne considère pas cette variable comme majeure dans l’orientation de ses choix professionnels : « Ça dépend aussi de combien on est payés » , dit-il.
Autrement dit, les jeunes interrogés n’accordent pas une priorité « absolue » à la mission de l’organisation, au regard d’autres considérations déjà discutées comme le pouvoir d’action individuelle, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ou le salaire. Le raisonnement par arbitrage entre ces différents critères s’est révélé encore plus explicite du côté des alumni de Harvard. Pour Robert, par exemple, un équilibre doit être trouvé entre la mission, l’intérêt des tâches et la charge de travail : « En ce qui me concerne personnellement, il est important que mon travail soit à la fois porteur de sens [c’est-à-dire qu ’il contribue à une certaine forme de bien commun] et productif [c’est-à-dire qu’il soit source de motivation personnelle et de stimulation intellectuelle]. Je considère que toutes les opportunités professionnelles doivent nécessairement offrir une sorte d’ équilibre ou d’arbitrage entre ces deux éléments. [ …] Je suis prêt à accepter un poste moins intéressant au quotidien si j’ai l’impression qu’il est davantage lié à l’avancement d’une certaine cause, mais seulement jus qu ’ à un certain point. Parce qu’ […] en tant qu’avocat œuvrant pour la justice sociale, il est très facile de s’ épuiser ou de développer une sorte de complexe du Messie, ce que j ’ai beaucoup observé chez certains [anciens collègues] […] Ils se sentaient si concernés par le caractère vertueux de leur travail qu’ils avaient tout simplement renoncé à préserver leur propre bien-être. Je ne suis pas prêt à aller jusque-là. » Autre exemple : Leah semble mettre le prestige social et la rémunération d’un côté de son équation personnelle et, de l’autre côté, la mission de l’organisation. Nous l’avons vu, elle accepterait probablement une position prestigieuse et un salaire élevé dans une entreprise en laquelle elle ne croit pas vraiment. Position qu’elle nuance ensuite : « […] Mais le niveau de prestige devrait assurément être plus élevé pour que je le fasse. Alors que j’accepterais un rôle attaché à un poste légèrement moins prestigieux si je croyais vraiment en l ’entreprise et en son impact. »
Ce raisonnement par arbitrage fait écho à celui d’une étude récente menée par Le Lab de Bpifrance en 202226, selon laquelle seulement 32 % des jeunes Français (de 18 à 25 ans) ne sont pas prêts à transiger sur leurs convictions personnelles au travail, soit deux fois moins que les dirigeants interrogés (65 %) (figure 5.1). De même, ils sont en moyenne quatre fois plus disposés à dissocier leurs convictions personnelles de leur activité professionnelle (24 %) que les dirigeants (6 %). Les discours protestataires tenus dans les grandes écoles et relayés par les médias apparaissent donc en décalage avec notre constat selon lequel plusieurs jeunes au sein de notre échantillon sont prêts à transiger sur la question de l’utilité sociale de leur activité en faveur d’autres préoccupations.
Figure 5.1 – Une intransigeance moins élevée des jeunes sur l’alignement de leurs convictions personnelles et celles de leur organisation
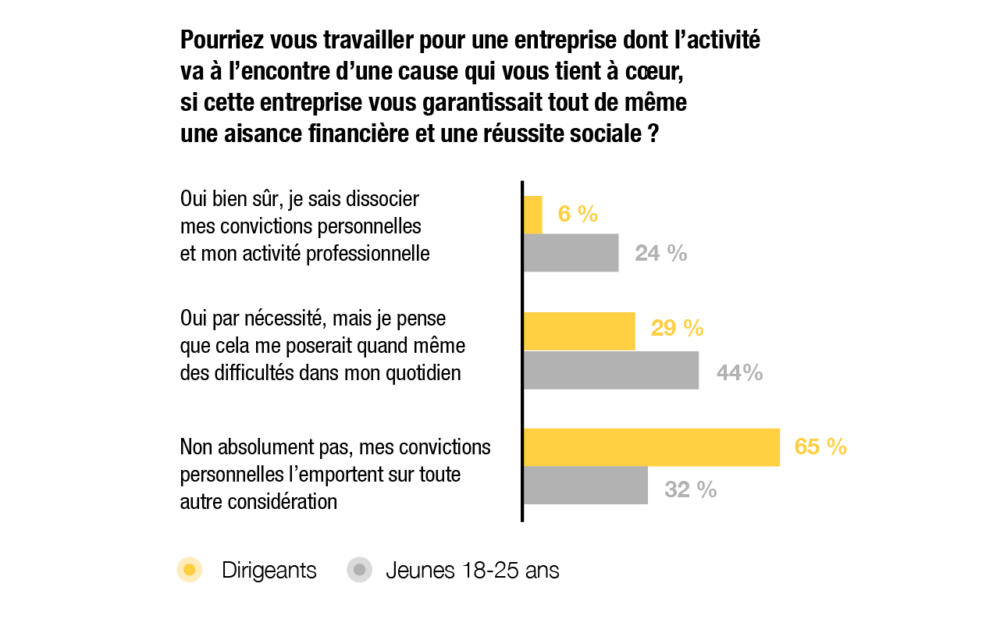
Source : Bpifrance Le Lab (2022)
Autre résultat qui semble aller dans le même sens : les alumni de Harvard comme de Polytechnique n’ont pas ou peu fait mention de leurs valeurs morales et de la mesure selon laquelle ils souhaiteraient voir celles-ci se refléter dans leur pratique professionnelle. Autrement dit, ce que Coutrot et Perez (2021) appellent la recherche d’une « cohérence éthique » au travail, c’est-à-dire, d’un alignement entre les valeurs qui doivent guider l’action individuelle et celles qui figurent dans la charte de valeurs de l’organisation, a été peu abordée durant les entretiens. Font notamment exception les questions de genre et d’inclusion. Camille par exemple mentionne en fin d’interview la question de l’égalité hommes-femmes au travail. Elle estime que les normes sociales autour de la conciliation entre vie professionnelle et vie privée sont en train d’évoluer favorablement, et que les représentants des jeunes générations au sein de son organisation, contrairement aux membres plus seniors de la hiérarchie, ne regardent pas de travers un homme qui doit partir plus tôt pour aller chercher son enfant.
Variables « pivots » : une part résiduelle de subjectivité dans la quête de sens au travail
Les chapitres précédents ont permis de mettre en lumière un certain nombre de grandes tendances culturelles dans le rapport au travail des jeunes diplômés. Par exemple, les alumni français interrogés accordent en moyenne une importance plus grande à la qualité des relations au travail que ceux américains. À l’inverse, ces derniers semblent faire passer la rémunération avant d’autres considérations de manière plus assumée que leurs homologues français. En dépit de ces tendances liées aux différences de contexte socio-culturel, la quête de sens au travail pour les jeunes diplômés conserve un caractère subjectif. Cette part résiduelle de subjectivité s’instancie notamment dans l’exécution en tant que telle du raisonnement par arbitrage exposé ci-dessus. Sans pour autant se départir de ces grandes tendances culturelles en niant l’importance des dimensions soulignées jusqu’ici, les alumni interrogés font preuve d’une plus grande hétérogénéité quant à la définition de leurs « top priorités » à l’égard du travail, c’est-à-dire celles qui pèsent le plus dans la balance. De fait, chacun définit une ou des variables « pivots » , en fonction de son équation personnelle : le hard stop, c’est-à-dire le moment où cette logique d’arbitrage entre les différentes dimensions constitutives du sens au travail cesse d’être envisageable varie d’un individu à l’autre.
Ainsi, pour certains, la mission doit rester première. Nous l’avons vu, le cas de Laura est sans doute paradigmatique de ce type de positionnement : ayant réalisé que même les organisations qui affirment servir la cause environnementale peuvent avoir des pratiques questionnables, virant au greenwashing , celle-ci a préféré se mettre à son compte. Repensons aussi à l’exemple de Jade, qui, formule des exigences en matière de « travail qui contribue au bien commun et rien qu’au bien commun » et de manière similaire à Laura, s’est révélée particulièrement sensible à l’hypocrisie de certaines initiatives de RSE, notamment dans le monde de la finance : « Je ne pourrais jamais travailler dans le domaine de la finance où l’essence même de mon activité consisterait, chaque jour, à faire des profits juste pour faire des profits. […] Ma grande sœur travaille pour Black Rock. [… ] Elle travaille pour leur équipe de développement durable. Et donc le travail qu’elle fait est vraiment cool et lié au développement durable et aux initiatives environnementales, mais comment omettre qu’une entreprise aussi énorme a définitivement les mains dans le pétrole et est définitivement impliquée dans des affaires de corruption et du baratin en tous genres ? »
Pour d’autres, c’est la rémunération qui semble passer avant tout autre considération. Par exemple, une vision du travail davantage « transactionnelle » est incarnée de manière assumée par Greg. Comme nous l’avons vu, celui-ci justifie sa relative insensibilité à la question de l’impact de son organisation par son appréciation du travail avant tout comme « gagne-pain » . Chez d’autres encore, plane une certaine ambivalence, à l’image de Leah pour qui, à nouveau, la rémunération semble être talonnée de près par la question de l’utilité sociale.
Enfin, sans grande surprise par rapport à ce qui a été souligné précédemment, l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est souvent cité, aussi bien par les alumni de Harvard que de l’X, comme condition primordiale d’une expérience au travail épanouissante. Le discours de Jade illustre parfaitement cette position, puisque celle-ci insiste bien sur le fait qu’« aucune somme d’argent » pourrait l’inciter à travailler au-delà d’un certain seuil : « […] Le niveau de rémunération ne doit pas seulement être évalué au regard de la nature de l’activité et de son impact. Ma vie entre aussi en ligne de compte, la question de l’équilibre vie pro-vie perso. Si mon employeur ne respecte pas ça, alors… aucune somme d ’argent ne pourrait me faire travailler 60 heures par semaine. » De manière intéressante, cette limite est posée même par ceux qui ont tendance à accepter une lourde charge de travail parce qu’ils adhèrent à la mission de leur organisation. Rappelons-nous le « complexe du Messie » soulevé par Robert, typique des professions « à vocation » et pouvant mener au burn out.
- 26 ‒ Dessiner la société de demain. Regards croisés des 18-25 ans et des dirigeants de PME-ETI.
Conclusion
En présentant et comparant les attentes au travail exprimées par les alumni de deux écoles prestigieuses, une française et l’autre américaine, notre étude apporte un éclairage nouveau sur la question actuellement très médiatisée du sens au travail. Nous en tirons trois grands enseignements.
Deux grands rapports au travail, transactionnel et relationnel
Sans tomber dans une lecture culturaliste qui virerait au « cliché » , il ressort que les deux populations étudiées présentent au moins une différence majeure dans leur rapport au travail. D’un côté, les alumni de Harvard tendent à aborder le travail plutôt comme une transaction, c’est-à-dire un investissement de soi contre de l’argent, alors que les diplômés de Polytechnique insistent davantage sur la nature relationnelle du travail. Ces derniers se montrent en effet globalement plus exigeants quant à l’ambiance au travail et à la qualité des interactions avec leurs collègues. Ils se distinguent également par leurs attentes élevées concernant l’engagement de l’entreprise en matière environnementale, sujet rarement évoqué par les alumni de Harvard qui, dans l’ensemble, tiennent des propos plus assumés sur la fonction instrumentale du travail. Pour bon nombre d’entre eux, le montant de la rémunération est une question capitale, qui leur permet de mener la vie qu’ils souhaitent en dehors. C’est en effet dans leur vie privée plutôt qu’au travail qu’ils disent s’investir humainement et rechercher des relations satisfaisantes. Plusieurs alumni de Harvard ont même mentionné le besoin de séparer clairement leur identité professionnelle de leur identité en dehors, point qui n’a pas été soulevé aussi explicitement par les polytechniciens.
Ce constat soulève un point de vigilance. Les récits collectés suggèrent que chacun de ces deux partis-pris a ses dérives ou revers potentiels. Côté américain, on peut se demander si la prégnance d’une logique transactionnelle (ou d’une forme de distance sociale et affective sur le lieu de travail) n’est pas l’un des moteurs qui alimente aujourd’hui le phénomène préoccupant de la « démission silencieuse » , en progression chez les plus jeunes. Côté français, à l’opposé, la promesse d’offrir sur le lieu de travail une richesse affective, même si elle accroît un temps l’attractivité de l’employeur, pourrait augmenter les risques d’apparition de dissonance cognitive, de désillusion, voire d’un sentiment de trahison.
Jeux d’arbitrages et construction individuelle du sens au travail
Les réponses récoltées de part et d’autre de l’Atlantique s’avèrent par ailleurs tout à fait concordantes sur un certain nombre de points : la volonté de se dépasser constamment et de sortir de sa zone de confort, la conscience de ses privilèges éducatifs et sociaux, le profil attendu du manager au point d’équilibre entre maîtrise technique et confiance (ou entre implication et lâcher-prise), le souhait d’équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, l’aversion à l’égard des lenteurs bureaucratiques…
Une dernière similitude importante, en conclusion, porte sur leur raisonnement fréquent par arbitrage. Tant les alumni de l’X que de Harvard ont du mal à définir une liste de leurs attentes prioritaires, c’est-à-dire à hiérarchiser clairement les dimensions constitutives du sens au travail selon eux. Au contraire, ils arborent fréquemment une logique de pondération entre les différents critères discutés. En d’autres termes, les récits collectés ne viennent pas corroborer l’idée d’une nouvelle « radicalité » des jeunes élites au sujet de la mission des entreprises, pas même du côté français où l’on entend pourtant fréquemment retransmis des discours protestataires tenus par les étudiants de grandes écoles.
Si ce fonctionnement par arbitrage s’observe parmi les deux populations, son exécution en tant que telle ne se manifeste pas toujours autour des mêmes variables ni des mêmes variables « pivots » (celles selon lesquelles chacun définit le seuil au-delà duquel cette logique d’arbitrage cesse d’être envisageable). Pour certains par exemple, le niveau de rémunération apparaît comme la préoccupation première ; pour d’autres, il s’agit plutôt de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ou, pour d’autres encore, de la mission de l’organisation. En dépit des tendances culturelles exposées plus haut (notamment sur la qualité des relations ou le rapport à l’argent), la quête de sens au travail conserve ainsi un caractère subjectif chez les jeunes diplômés.
Ce résultat suggère qu’il n’y aurait donc pas « un sens universel » à découvrir au travail pour les jeunes diplômés mais bien que ceux-ci aspirent à lui « donner un sens » par eux-mêmes. En d’autres termes, ils ne cherchent pas à « saisir » le sens au travail, tel un objet extérieur à intérioriser, mais plutôt à « l’extraire » d’eux-mêmes, par leurs efforts justement pour « faire sens » des mondes matériel, social et intérieur auxquels tout un chacun doit se confronter pour faire pleinement l’expérience d’un « travail vivant »27.
Un patchwork de pratiques organisationnelles pour accroître le sens au travail
D’un point de vue organisationnel, il ne ressort donc des entretiens aucun paramètre clé à privilégier de la part des employeurs pour attirer et retenir les jeunes diplômés. Aussi prosaïque que cela puisse paraître, c’est au contraire la mise en place d’un patchwork de mesures qui semble particulièrement indiquée. Contrairement à certaines postures, nos résultats suggèrent en effet que la quête de sens au travail chez les alumni d’écoles prestigieuses ne se résoudra pas uniquement par des réformes concernant la mission des organisations ou un engagement véritable et sincère en faveur de l’environnement. Pour pleinement satisfaire les attentes des jeunes diplômés, il paraît au contraire incontournable d’activer d’autres leviers organisationnels « plus tangibles » , dont la possibilité de travailler à distance (avec une préférence pour le travail hybride chez les jeunes interrogés), un salaire attrayant, des tâches variées et à haute valeur ajoutée, un accompagnement managérial qui dose « lâcher prise » et soutien dans la responsabilisation et montée en compétences des jeunes recrues, une vigilance sur la charge de travail pour garantir un bon équilibre vie professionnelle et vie personnelle (cf. à ce titre les expériences croissantes autour de la semaine à quatre jours28) et des pratiques visant à renforcer le collectif plutôt qu’à exacerber la compétition entre les salariés (e.g., par l’instauration de primes collectives plutôt qu’individuelles ou en refusant de reproduire des logiques « up or out » de promotion, typiques du conseil). Somme toute, la meilleure réponse à apporter par les organisations à la prétendue « crise » de sens au travail chez les jeunes diplômés pourrait bien être de ne pas être trop directif ou « paternaliste » et de les laisser libres de combiner les différents ingrédients du sens au travail comme bon leur semble, en fonction de leur équation personnelle.
Cela étant, si l’on adopte le point de vue des employeurs français, on peut comprendre que certaines catégories d’entreprises, notamment les plus anciennes ou celles œuvrant dans les secteurs d’activités manufacturières dits « traditionnels » , aient structurellement plus de difficultés à bâtir de manière crédible une telle offre à l’attention des jeunes talents. La transformation d’une activité industrielle pour qu’elle cesse non seulement d’être polluante ou énergivore mais qu’elle en vienne même à protéger l’environnement ne se fait pas en un jour, or cela s’est déjà hissé au rang des attentes prioritaires chez les jeunes polytechniciens. De même, alors que l’aventure entrepreneuriale est valorisée et même facilitée au sein des jeunes élites, les entreprises du CAC40 et les ETI industrielles auront a fortiori plus de mal à attirer et retenir les jeunes diplômés que les géants du numérique ou les start-up. Ne pouvant nier leur identité propre, elles peuvent à tout le moins veiller à proposer des environnements de travail fluides et dynamiques, aussi peu bureaucratiques que possible. Leur meilleur atout ? Sans doute la soif continuelle d’apprendre et de progresser dans l’art et la technique, exprimée par les jeunes polytechniciens, à laquelle elles ont assurément de quoi répondre.
- 27 ‒ Le « travail vivant », par opposition au travail abstrait et au travail aliéné, se caractérise comme lieu d’actualisation de la subjectivité humaine. Il s’agit d’un concept marxiste à l’origine, qui a ensuite été largement repris dans la littérature sur le travail (e.g., Coutrot et Perez, 2021 ; Cukier, 2016 ; Desjours, 2016).
- 28 ‒ Voir l’article « La semaine à quatre jours : les expériences se multiplient dans les entreprises européennes », La Tribune, du 19 décembre 2022.
Bibliographie
Apec (2022). Cinq enjeux pour l’emploi cadre en 2022. Hors-série. https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Nos%20%C3%A9tudes/pdf/5-enjeux-pour-lemploi-cadre-en-2022
Appadurai, A. (2004). « The capacity to aspire: culture and the terms of recognition » In V. Rao and M. Walton (eds): Culture and Public Action (Stanford, CA, Stanford University Press).
Barrero J.M, Bloom N. & Steven J.D (2021). Why working from home will stick. Working Paper, n°28731.
Barry V., Lagouge A. & Ramajo I. (2022). La France vit-elle une Grande Démission ? Dares.
Bénabou R. & Tirole J. (2003). Intrinsic and extrinsic motivation. The Review of Economic Studies, 70, 489-520.
Bénabou R., Mookherjee D. & Banerjee A.V. (2006). Understanding Poverty . Oxford University Press.
Bpifrance Le Lab (2022). Dessiner la société de demain. Regards croisés des 18-25 ans et des dirigeants de PME-ETI. https://lelab.bpifrance.fr/get_pdf/2793/bpifrance_le_lab_etude_aspirations_societales_vdef_180322.pdf
Boston Consulting Group, Conférence des Grandes Écoles & Ipsos (2021). Baromètre Talents : ce qu’ils attendent de leur emploi. 4ème édition.
Bourdieu P. & Passeron J.C. (1970). La reproduction ; éléments pour une théorie du système d’enseignement . Éditions de Minuit [Paris].
Coutrot T. & Perez C. (2021). Quand le travail perd son sens. Document d’études , Dares.
Cukier A. (2017). Travail vivant et théorie critique. Affects, pouvoir et critique du travail . Éditions PUF.
Deloitte (2021). The Deloitte Global Millenial Survey : A decade in review. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/2021-deloitte-global-millennial-survey-decade-review.pdf
Dejours C. (2016). Travail vivant (Tome 2) : Travail et émancipation . Éditions Payot.
Dejours C., Deranty J.P., Relault E. & Smith N.H. (2018). The return of work in critical theory : self, society politics. Columbia University Press , 59-60.
Deresiewicz W. (2015). Excellent Sheep: The Miseducation of the American Elite and the Way to a Meaningful Life . Free Press.
École polytechnique (2018). Cycle ingénieur polytechnicien, enquête sur le premier emploi. https://programmes.polytechnique.edu/cycle-ingenieur-polytechnicien/a-propos-du-cycle-ingenieur-polytechnicien/carrieres
Fondation Jean-Jaurès, Macif, BVA Group (2021). Les jeunes et l’entreprise. https://www.bva-group.com/sondages/bva-fondation-jean-jaures-macif-jeunes-entreprise/
François, P. & Berkouk, N. (2018). Les concours sont-ils neutres ? Concurrence et parrainage dans l’accès à l’École polytechnique. Sociologie , 9, 169-196 .
Gallup (2022). Is Quiet Quitting Real ? https://www.gallup.com/workplace/398306/quiet-quitting-real.aspx
INSEE (2021). Emploi, chômage, revenus du travail. Insee Références .
Jourdain A. & Naulin S. (2011). La Théorie de Pierre Bourdieu et ses usages sociologiques . Armand Collin [Paris].
Le Gros, L. (2020). La reconversion radicale après une grande école de management : entre rupture et réactivation de dispositions intériorisées. Formation emploi , 152, 119-138.
Lhommeau B. & Michel C. (2018). Changer de métier : quelles personnes et quels emplois sont concernés ? Dares Analyses , 49.
Lips-Wiersma M. & Wright S. (2012). Measuring the Meaning of Meaningful Work: Development and Validation of the Comprehensive Meaningful Work Scale (CMWS). Group & Organization Management , 37(5), 655–685.
Loriol M. (2017). Le(s) rapport(s) des jeunes au travail. Revue de littérature (2006-2016), Rapport d’étude, INJEP.
Parsons T. (1964). The social system . The Free Press/Macmillan.
Pech T. & Richer M. (2020). La révolution du travail à distance – Enquête “#Montravailàdistance, Jenparle !”, Terra Nova, avril.
Mintzberg, H. (1990). Le Management : voyage au centre des organisations , Éditions d’Organisation.
Ray, D. (2006). « Aspirations, Poverty and Economic Change » In A.V. Banerjee, R. Bénabou & D. Mookherjee (eds): Understanding Poverty (Oxford, Oxford University Press).
Schein, EH. (1970). Organizational Psychology . Pearson.
Steger M., Dik B.J. (2009). Work as meaning: individual and organizational benefits of engaging in meaningful work. Oxford Handbook of Positive Psychology and Work .
Taskin L., Laurent M.E & Ughetto P. (2022). Une rupture dans le rapport au travail ? La pandémie de Covid-19 et les temporalités de gestion de leur parcours par les salariés. Revue internationale de psychologie et de gestion des comportements organisationnels , 73, 63-83.
Wagner A.C. (2020). Les classes sociales dans la mondialisation . La Découverte.
Anne-Sophie Dubey et Sonia Bellit (avec la participation d’Elie Saad et d’Adib Alhachem), Les jeunes élites face au travail. Regards croisés entre Polytechnique et Harvard, Les Docs de La Fabrique, Paris, Presses des Mines, 2023. ISBN : 978-2-35671-973-7
© Presses des MINES – TRANSVALOR, 2023
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel – 75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr

