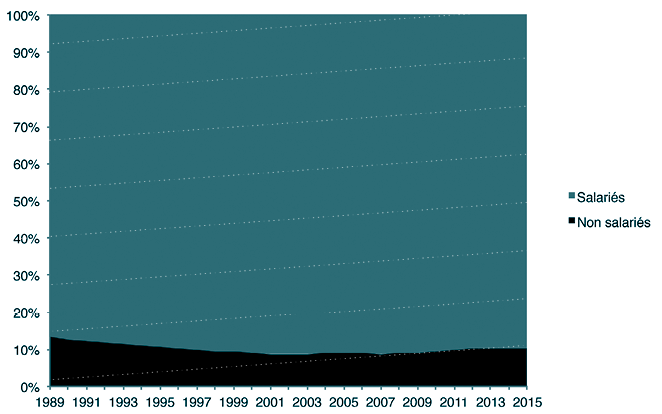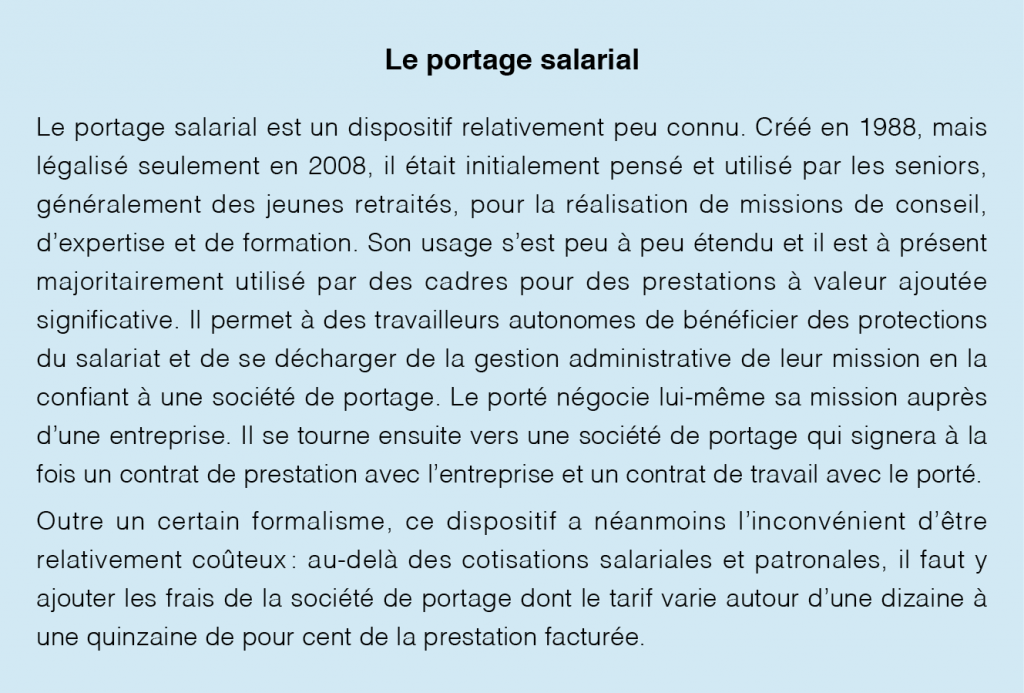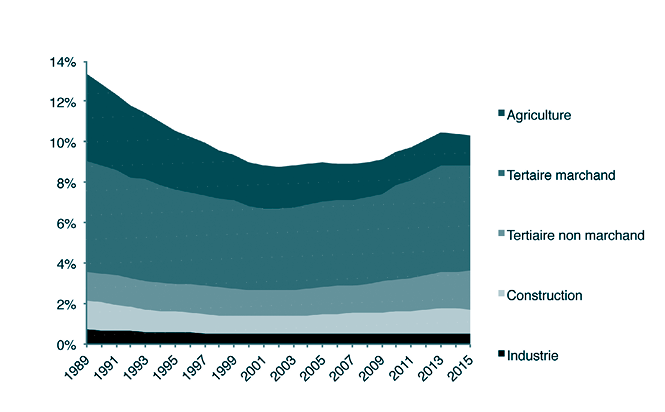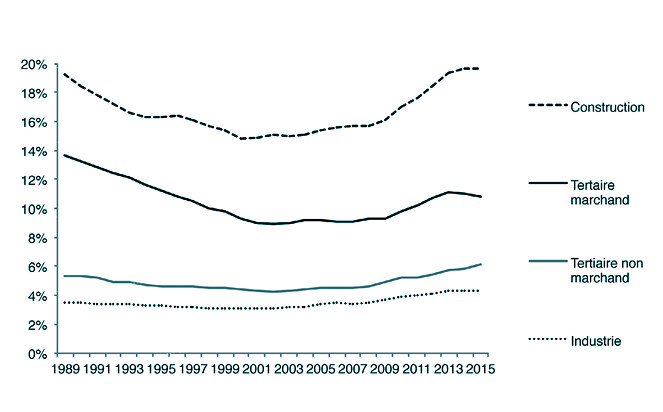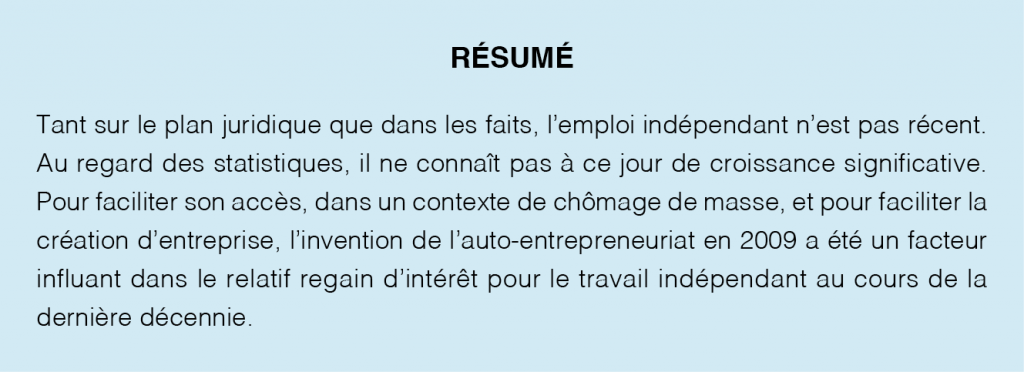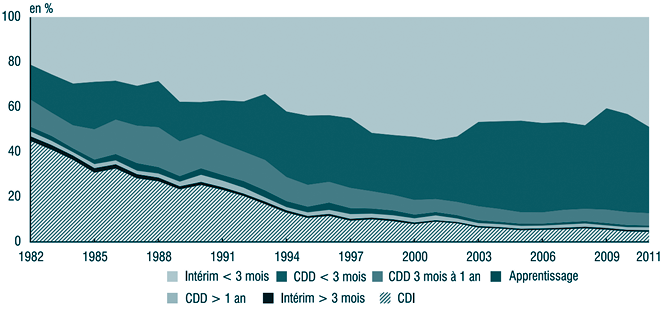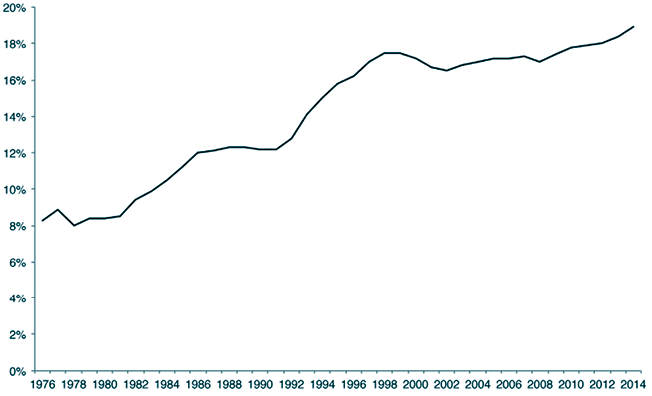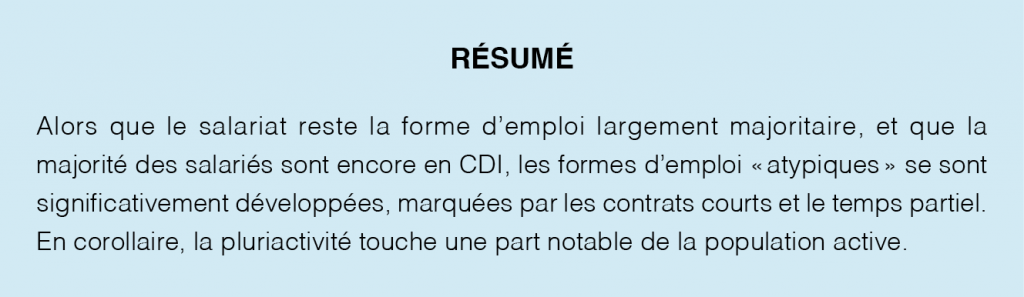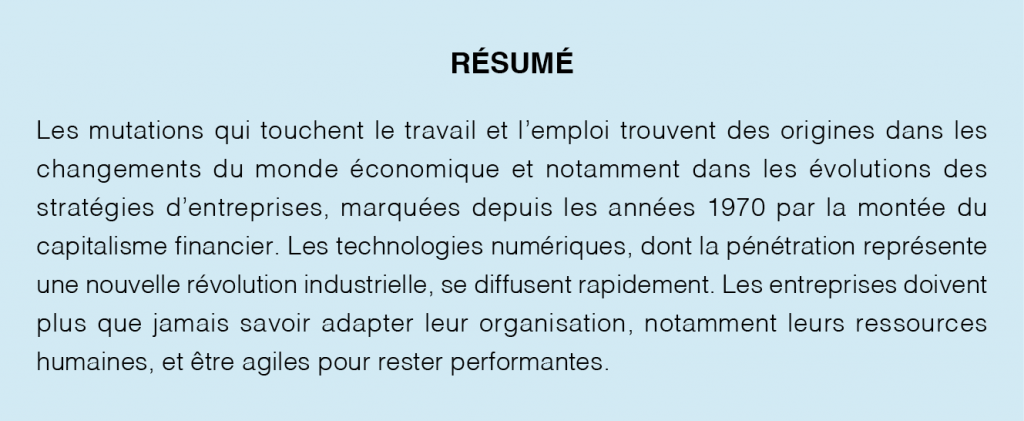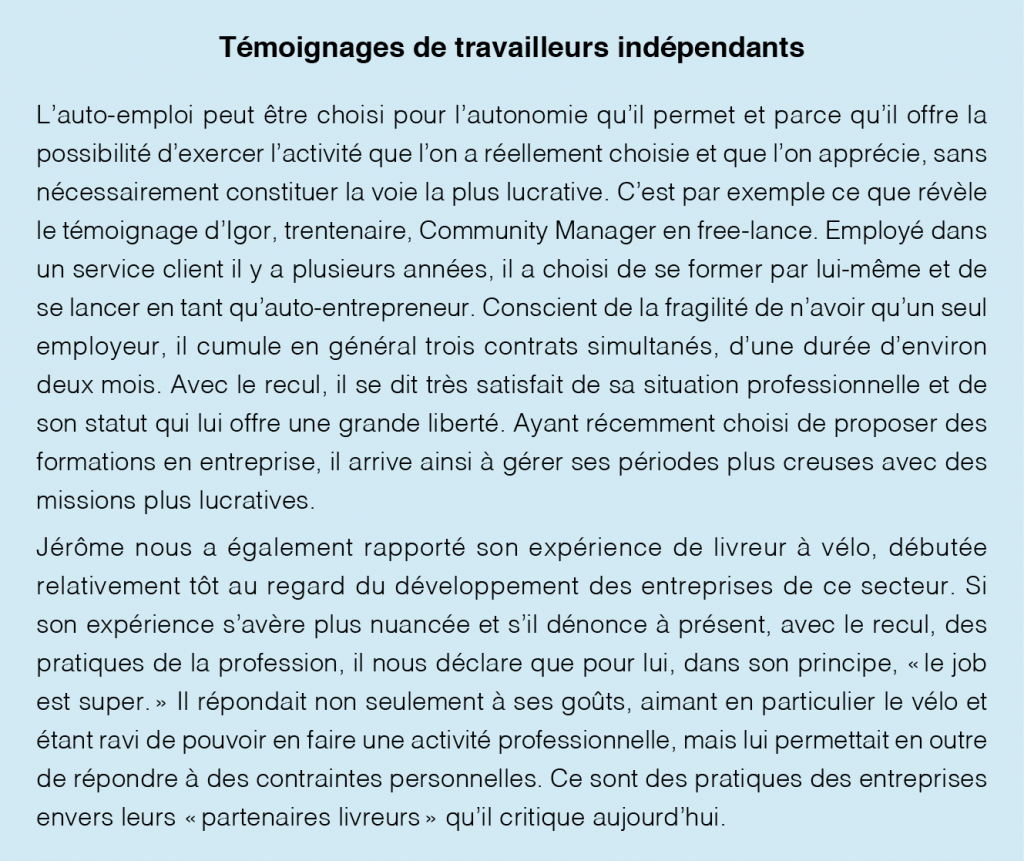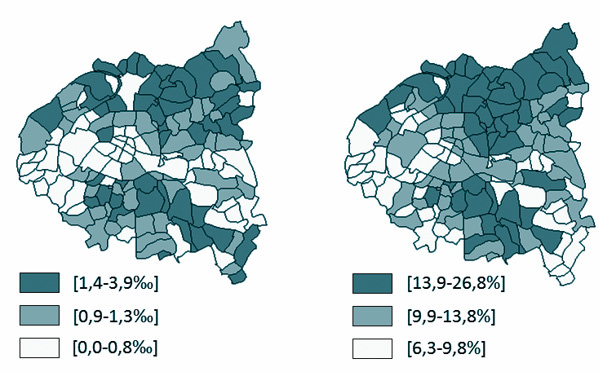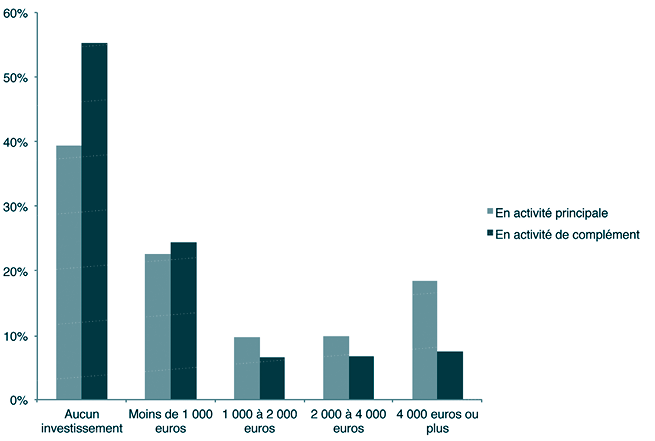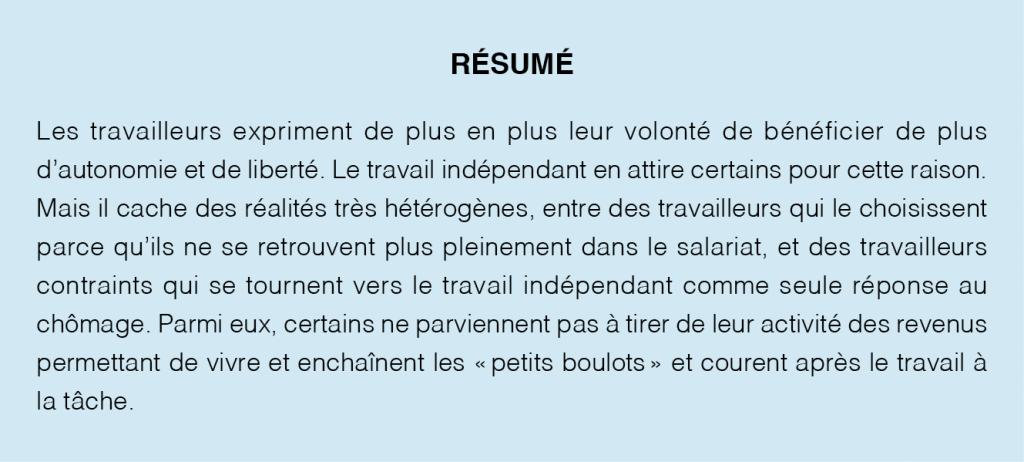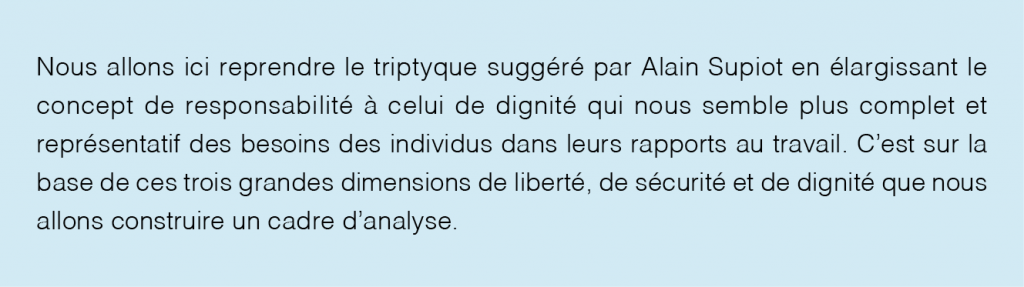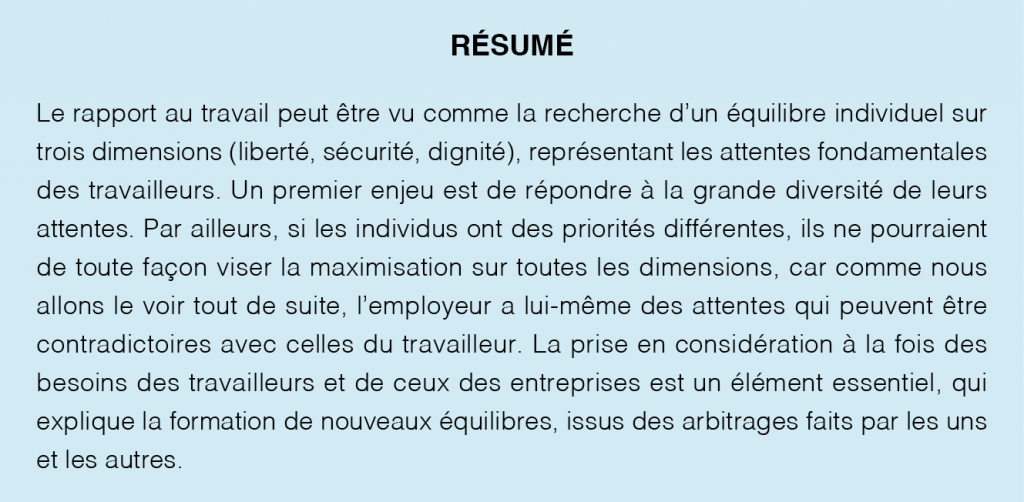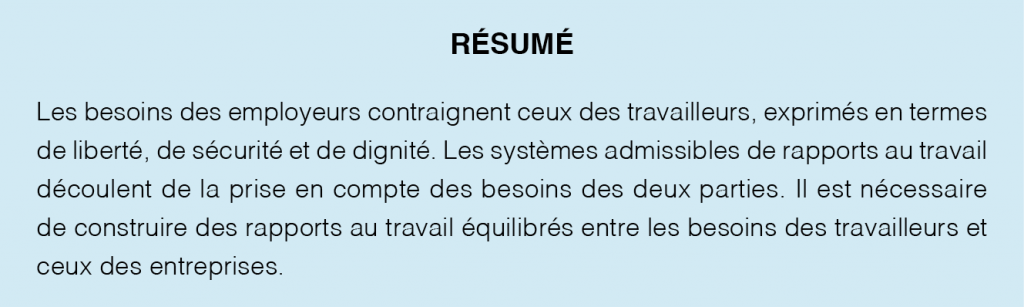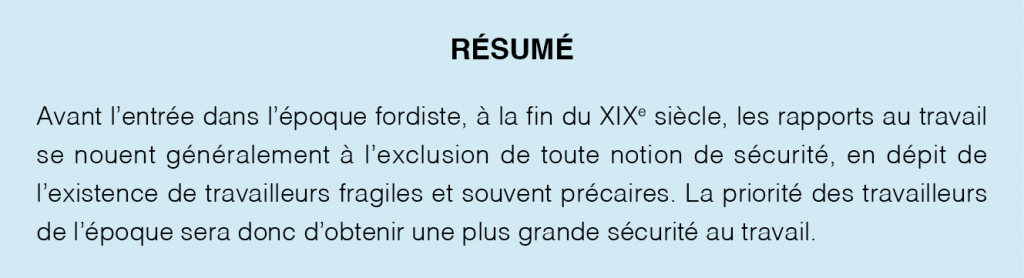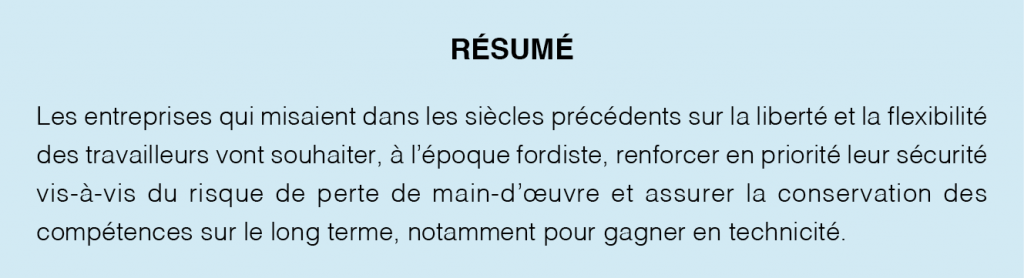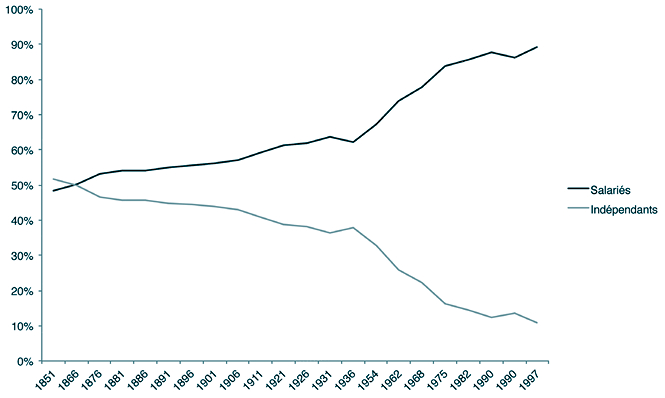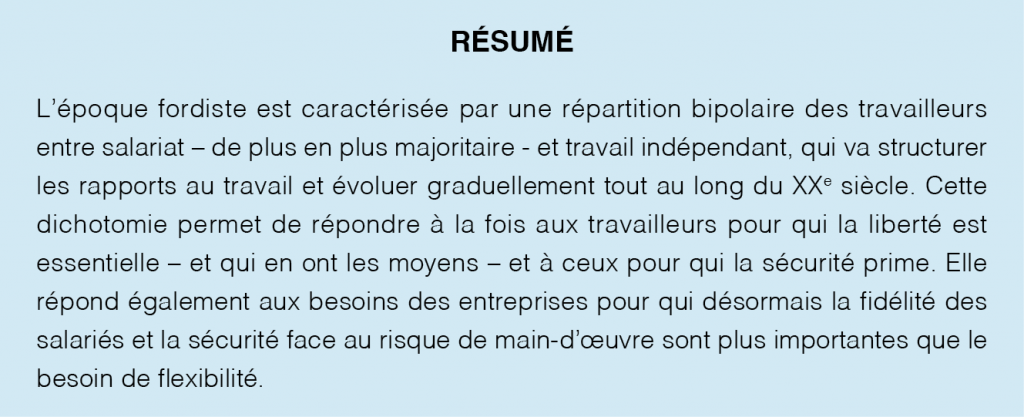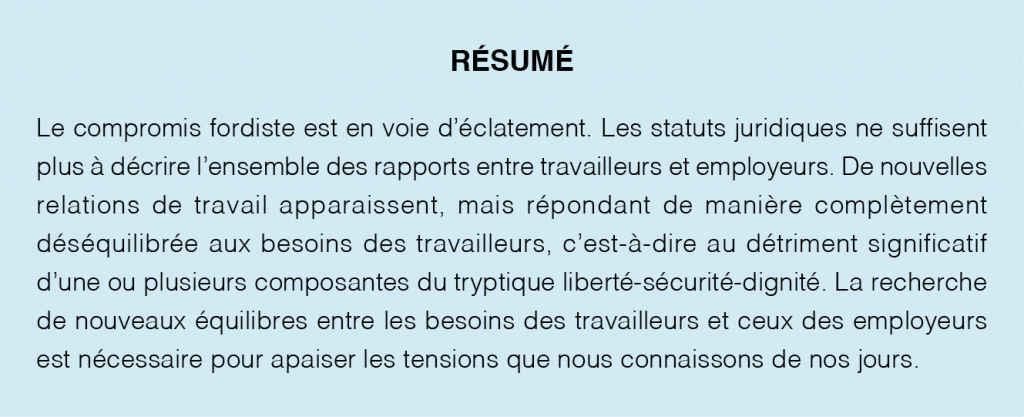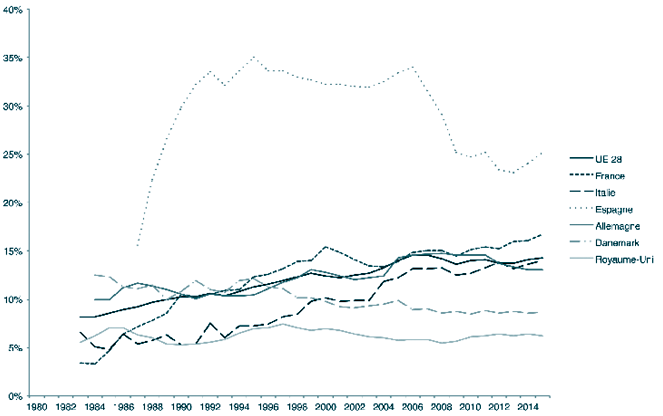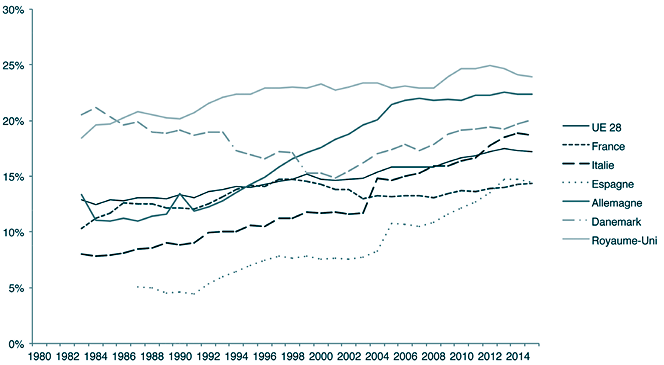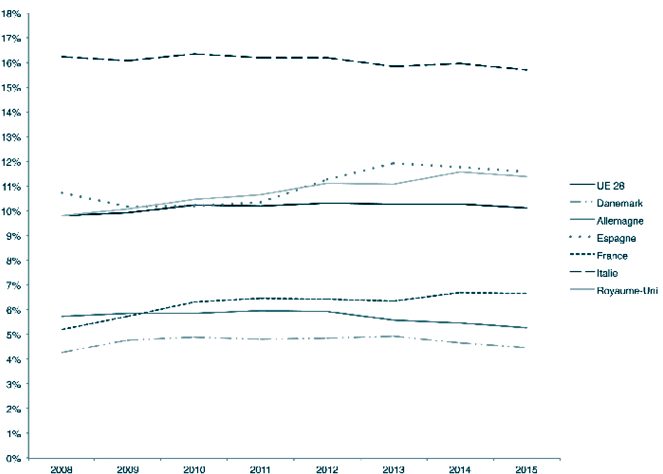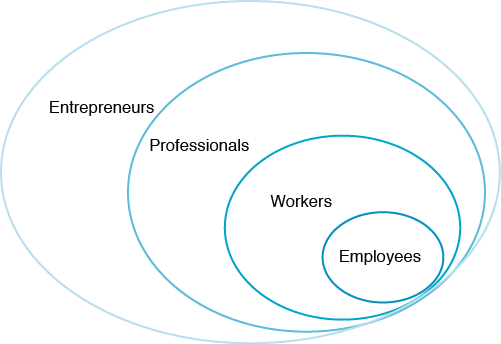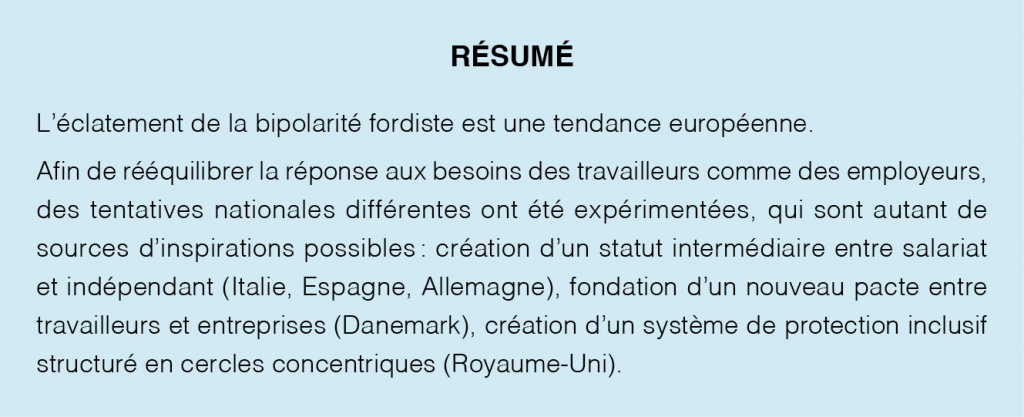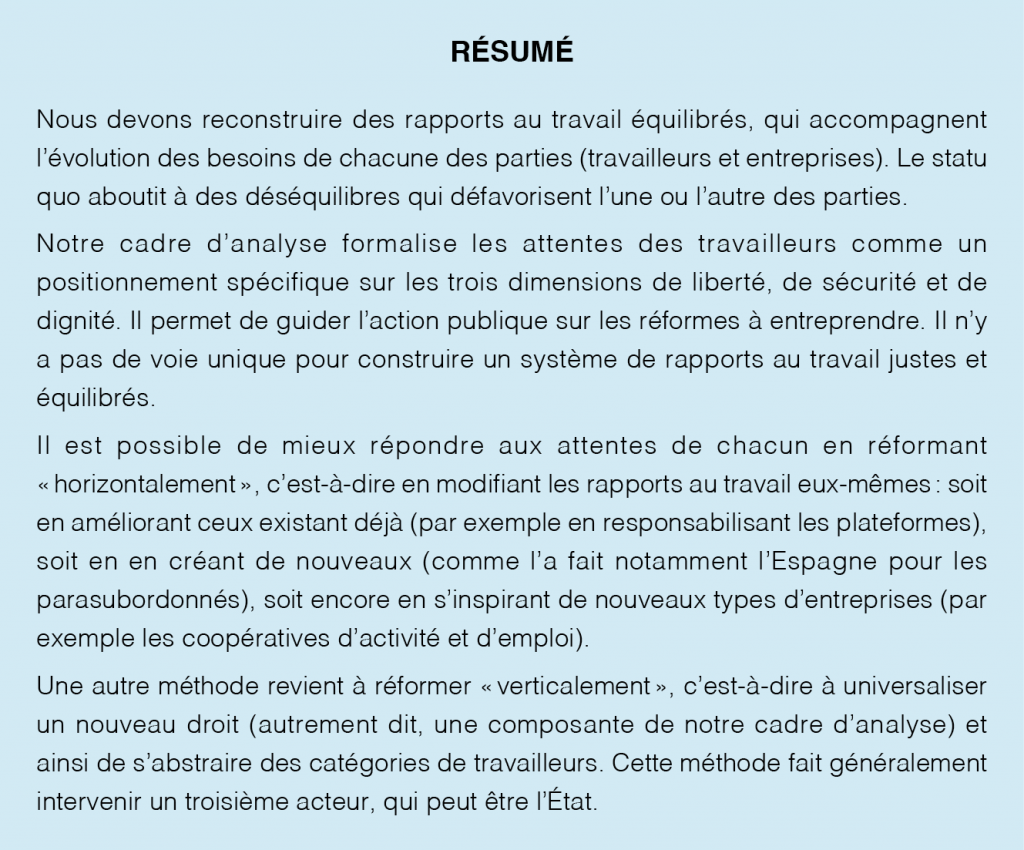Le salariat, un modèle dépassé ?

Avant-propos
La collection des « Docs de La Fabrique » rassemble des textes qui n’ont pas été élaborés à la demande ni sous le contrôle du conseil d’orientation de La Fabrique de l’industrie, mais qui apportent des éléments de réflexion stimulants pour le débat et la prospective sur les enjeux de l’industrie.
Le point de départ de cette étude est la montée des nouvelles formes de travail indépendant sous l’effet du développement de l’économie numérique et des plateformes de rencontre entre offreurs et demandeurs de biens et services, qui fait craindre à certains la fin du travail salarié.
Elle examine dans un premier temps la dynamique de l’emploi en France. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le travail salarié représente encore plus de 85 % de l’emploi total en 2015. Cela étant, il est vrai que les formes de contrats atypiques et la pluriactivité se développent, et que le travail indépendant masque des réalités hétérogènes. D’un côté, on trouve des travailleurs aux profils qualifiés, aux compétences prisées, qui vivent décemment de leur activité, et de l’autre, des indépendants qui travaillent pour un ou quelques donneurs d’ordre dont ils sont économiquement dépendants. Un point commun les lie néanmoins : la quasi-inexistence de droits aux protections sociales et individuelles, la majorité d’entre elles étant assises sur le salariat ou bien accessibles par le biais d’assurances privées.
Pour faire face à ces nouvelles réalités, les auteurs nous invitent à réinterroger les attentes et besoins des travailleurs et des employeurs autour du triptyque : liberté, sécurité, dignité. Ils prennent l’exemple de politiques mises en œuvre dans cinq pays européens, et proposent des pistes de réformes ainsi que des dispositifs qui pourraient être adaptés aux besoins et attentes des travailleurs. C’est ainsi que l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne ont par exemple créé un statut intermédiaire entre le salariat et le travail indépendant, venant renforcer le niveau de protections sociales et individuelles.
Ce travail est le mémoire de deux ingénieurs du Corps des mines en dernière année de formation. La Fabrique n’apporte ni caution ni critique à ces propositions de réformes et d’actions, faute de les avoir mises en discussion avec les parties prenantes. Les ingénieurs-élèves ont rencontré beaucoup d’interlocuteurs qui n’ont pas souhaité être cités nommément. Ils ont donc repris à leur compte les propos qui les ont convaincus, non sans avoir recoupé leurs informations. N’étant pas encore tenus au devoir de réserve qui s’imposera bientôt à eux, ils n’ont pas hésité à exprimer leur point de vue.
L’équipe de La Fabrique
Synthèse
Les médias rivalisent de titres accrocheurs pour évoquer une immense « révolution » en cours en matière d’emploi. Nous serions en train de vivre la fin du salariat qui constituait la norme depuis les révolutions industrielles du XIXe siècle. Le travail indépendant se développerait un peu plus chaque mois – notamment avec l’essor de l’auto-entrepreneuriat, des plateformes numériques et de « l’économie collaborative ».
Pourtant, les faits ne traduisent pas une telle réalité. Le salariat représente, de nos jours, près de 90 % de l’emploi en France. D’un point de vue historique, il s’agit d’ailleurs d’un maximum : le salariat représentait 56 % de l’emploi total en 1900, 65 % en 1950 et 85 % en 1980. Les auto-entrepreneurs sont un peu plus de 600 000 en France1, encore loin du « raz-de-marée » régulièrement annoncé.
Néanmoins, cela ne signifie pas que rien ne se passe. Bien au contraire, nous vivons une époque charnière et de mutations profondes : le salariat d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui d’hier, la pluriactivité des travailleurs se développe, les politiques et stratégies des entreprises se transforment – à commencer par l’expansion du modèle de plateformes – les attentes des travailleurs évoluent… Fondamentalement, les entreprises expriment aujourd’hui un besoin de plus de flexibilité que par le passé, et parallèlement, il existe chez certains travailleurs une soif de plus d’indépendance, mais qui se gagne parfois au prix d’une grande précarité.
Les débats actuels se focalisent sur une opposition issue de la construction historique du salariat : nous aurions le choix entre un salariat protecteur mais contraignant et un entrepreneuriat libérateur mais exposé à une plus grande précarité. Pour sortir de ce clivage, il nous faut revenir à ce qui constitue l’essence des rapports au travail. Ces derniers renvoient en réalité à une grande variété d’attentes et de besoins, des travailleurs comme des entreprises.
Une manière d’analyser les rapports au travail est de les décomposer en trois grandes dimensions essentielles : la liberté, la sécurité et la dignité.
Le salariat est né d’un pacte entre employeurs et travailleurs, au XIXe siècle, pour leur assurer une sécurité réciproque, à une époque où le processus de production requérait de fidéliser les employés sur le long terme. Il a permis d’atteindre une forme d’équilibre, tant pour répondre aux attentes de bon nombre de travailleurs qu’aux besoins des employeurs. Cela a conduit à faire du salariat un « modèle majoritaire » depuis plus d’un siècle, modèle auquel a été alors adossée la plupart des protections sociales.
Les mutations actuelles remettent en cause cet équilibre. La bipolarité qui caractérisait l’époque fordiste entre salariés, bénéficiant de sécurité au prix d’une forme de liberté, et non-salariés, plus libres et autonomes mais aux moindres protections, est en train de disparaître. Et de nombreux enjeux de société (ré)-émergent.
Le salariat tel qu’il a marqué le XXe siècle doit évoluer. C’est d’ailleurs bien ce qu’il a commencé à faire, de nombreuses entreprises ayant compris cette nécessité. L’enjeu est toutefois aujourd’hui à la fois de ne plus raisonner selon une dichotomie entre le salariat et le hors salariat, et de ne plus réduire le travail à la simple dimension de l’emploi.
Le cadre d’analyse – liberté, sécurité, dignité – vise à envisager autrement les éléments constitutifs des rapports au travail. Il doit permettre, au-delà des débats partisans qui animent notre pays et, parfois, ceux de nos voisins européens, d’être un outil pour nourrir la réflexion et construire de nouveaux rapports de travail équilibrés, adaptés aux attentes et aux besoins actuels des travailleurs comme des entreprises.
Plusieurs pistes de réformes seront explorées à cet effet. Elles peuvent, de manière non exclusive les unes des autres, s’appuyer sur des cadres propres à certaines catégories de travailleurs ou traiter de problématiques qui les concernent tous. Cette dernière option revient à universaliser certaines dimensions de l’analyse.
- 1 – Nombre d’auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires en 2015.
Remerciements
Nous remercions très chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté de nous rencontrer, de nous accorder de leur temps et de nous faire partager leurs connaissances, leurs opinions et leur expertise.
Nous adressons de sincères remerciements à Madame Frédérique Pallez, professeure à Mines ParisTech, qui a su habilement nous faire prendre le recul nécessaire à des moments pertinents de notre réflexion. Ses conseils avisés et son attitude bienveillante nous auront assurément permis de structurer et d’affiner notre analyse.
Nos remerciements vont également à Monsieur Claude Riveline qui nous a fait partager sa réflexion sur le sujet si vaste du travail et de l’emploi, nous faire profiter de sa grande expérience, et aura su orienter nos lectures et nos recherches de manière très pertinente.
Nous remercions en outre toutes les personnes que nous avons rencontrées lors des manifestations auxquelles nous avons pris part au sein de COOPANAME. Même lorsque nous n’avons échangé que quelques mots, dans un atelier ou une conférence, elles auront nourri notre réflexion. Nous remercions d’ailleurs toute l’équipe de COOPANAME qui, sous l’égide de Noémie et Stéphane, nous ont fait une place lorsque nous leur en avons fait la demande, convaincus de la pertinence de cette structure que nous souhaitions mieux connaître.
Nous remercions enfin Monsieur Thierry Weil et l’équipe de La Fabrique de l’industrie pour l’intérêt qu’ils ont porté à notre travail, leur écoute et leurs conseils.
Introduction générale
L’uberisation de l’économie fait l’objet d’une grande attention dans le débat public mais l’économie des plateformes n’est qu’un élément parmi d’autres d’une mutation, bien plus large, qui bouleverse les rapports au travail que nous connaissons depuis la généralisation du salariat, il y a presque 150 ans. Contrairement à certaines idées reçues, le salariat est loin d’être mort, mais la structure traditionnelle héritée de l’époque fordiste opposant le salariat au travail indépendant est mise en cause. Nous continuons de mythifier un CDI qui a largement évolué et n’offre plus tout à fait les mêmes protections que par le passé. Aujourd’hui, près de 40 % des CDI conclus durent moins d’un an et 87 % des embauches se font en CDD (contre 55 % en 1982)2. Les nouvelles générations, les actifs de 15-25 ans, vivent directement les mutations en cours : ils ne sont plus que 45 % à avoir un CDI, alors qu’ils étaient plus de 77 % dans les années 19803. Pourtant, notre société semble organisée comme si le CDI « à vie » était la norme : c’est encore le meilleur garant pour louer un logement, obtenir un prêt bancaire, et il est même souvent un marqueur social. Les représentations de l’époque fordiste restent encore bien présentes dans les esprits alors qu’une partie de notre société et du monde économique a largement évolué. Cet héritage perturbe les volontés de réformes et reste source de tensions et de défiances entre les entreprises et les travailleurs.
Il nous faut revenir à l’essence de ce qui constitue, définit et motive les rapports au travail. Le travail n’est pas simplement un échange entre des heures de labeur et une rémunération. Il répond à des attentes et des besoins humains multiples et différents selon les individus : se sentir libre, être protégé, s’exprimer, se développer, partager, construire, œuvrer, contribuer, aider, changer le monde, être ensemble, servir…
En réduisant le travail à la notion restrictive d’emploi, les efforts ont porté, plus ou moins en vain, sur la lutte contre le chômage. Mais pas sur la valorisation du travail. En négligeant certaines facettes du rapport au travail, le système se grippe. Certains employeurs sont frileux pour embaucher, et certains travailleurs en sont réduits à se contenter de l’aspect alimentaire de leur emploi. Ou à recourir à l’auto-emploi, non plus par choix mais faute de mieux. Les entreprises trouvent des moyens alternatifs pour répondre à leurs besoins : en délocalisant, en détournant de leur vocation d’origine des régimes de travail (comme le régime des auto-entrepreneurs par exemple dans l’économie de plateformes), en développant des formes de travail « atypiques », etc.
Les rapports au travail sont des constructions mouvantes et changeantes. Ils ont parfois mis des siècles pour être construits et consolidés. Le sociologue Robert Castel écrivait dans Les métamorphoses de la question sociale : « Il a fallu des siècles de sacrifices, de souffrances et d’exercice continu de la contrainte pour fixer le travailleur à la tâche, puis pour l’y maintenir en lui associant un large éventail de protections qui définissent un statut constitutif de l’identité sociale [le salariat] ». Les rapports au travail n’existent pas per se, ils sont des constructions humaines et sociales complexes, parfois longues, et souvent précaires, qui ont évolué et disparu au cours de l’Histoire en fonction des attentes et des besoins des travailleurs et des entreprises. La dernière construction en date, édifiée autour du pacte du salariat au tournant du XXesiècle, était tellement équilibrée et adaptée aux attentes de chacun, pendant des décennies, que nous en avons oublié que les rapports au travail n’étaient pas immuables, que la société et l’environnement changent. L’enjeu revient à ce que les besoins des entreprises et ceux des travailleurs puissent converger vers de nouveaux équilibres.
Si, au XXe siècle, la société avait réussi à construire des compromis autour d’une bipolarité entre salariat et travail indépendant, les changements culturels et économiques actuels, que nous décrirons dans la première partie de cet ouvrage, les ont rendus caducs. Dans une deuxième partie, nous présenterons un cadre d’analyse qui s’appuie sur les attentes et les besoins des travailleurs. Nous montrerons que fondamentalement un rapport au travail peut être décrit comme un positionnement spécifique sur trois dimensions essentielles : la liberté, la sécurité et la dignité. Dans la troisième partie, nous décrirons comment notre cadre d’analyse peut constituer un outil d’aide à la réforme pertinent, en proposant une méthodologie génératrice d’idées et visant à sortir des antagonismes actuels.
Notre ambition n’est pas de nous ranger derrière telle ou telle orientation politique. Tout l’objet de notre thèse est précisément de montrer que l’action publique peut être guidée par la recherche d’équilibres entre besoins des travailleurs et des entreprises. La comparaison internationale que nous faisons dans la troisième partie montre d’ailleurs que plusieurs méthodes et démarches sont envisageables. Il est clair aujourd’hui que les attentes des entreprises et des travailleurs ont évolué. Il y a, de nos jours, un besoin de flexibilité de plus en plus important chez les entreprises, et une soif nouvelle des travailleurs pour davantage d’autonomie, d’indépendance et de responsabilité. La fondation et la consolidation de rapports au travail nouveaux, équilibrés, et qui prennent en compte les attentes de chacun sans sacrifier tous les acquis du passé, prendront certainement encore du temps. Mais comme le dit le juriste Alain Supiot lorsqu’il évoque la difficulté à s’émanciper des structures fordistes, « la subordination à vie n’est pas un idéal insurpassable ».
- 2 – Source : INSEE, Enquête Emploi.
- 3 – Source : DARES.
Partie 1 – Le monde du travail de nos jours : entre illusions, idées reçues et mutations réelles
La presse, la télévision, les réseaux sociaux rivalisent chaque mois voire chaque semaine de titres accrocheurs pour nous parler de l’immense « révolution » en cours en matière d’emploi. L’économie de plateformes serait en train de faire disparaître le salariat sous l’afflux de millions de travailleurs indépendants. Les auto-entrepreneurs constitueraient une renaissance du travail non-salarié, comme si le travail non salarié avait disparu avant eux. L’économie collaborative, en replaçant la solidarité au centre de l’économie, serait un progrès social pour tous. Nous allons voir dans cette partie qu’une grande partie de ces affirmations sont des contre-vérités, ou a minima des idées reçues.
Néanmoins, si certains propos communément admis et relayés ne sont pas avérés, nous verrons que le monde du travail connaît de nos jours des mutations profondes : le salariat d’aujourd’hui n’a plus rien à voir avec celui d’hier, la pluriactivité des travailleurs se développe, les politiques et stratégies des entreprises évoluent à commencer par l’expansion du modèle de plateformes, certains travailleurs ont des attentes nouvelles, etc. Fondamentalement, nous verrons que les entreprises expriment un besoin de plus de flexibilité, et que parallèlement, il existe chez les travailleurs une soif d’indépendance plus importante qu’au XXe siècle, mais qui se gagne parfois au prix d’une grande précarité.
Nous ne vivons pas la fin du salariat
Le travail à la demande, ou « à la tâche », est aujourd’hui de plus en plus visible dans de nombreux secteurs : livraison, prestations intellectuelles, services à la personne, etc. L’essor de certaines plateformes, notamment les plateformes de service de véhicules de tourisme avec chauffeurs (les VTC) et en particulier la plus connue d’entre elles, Uber, ont amené sur le devant de la scène médiatique le sujet des « nouvelles formes de travail » à tel point que l’on parle à présent couramment d’uberisation de l’économie. Même si ce n’est pas sa seule caractéristique, le modèle économique de plusieurs de ces entreprises repose essentiellement sur le recours à des travailleurs indépendants, généralement qualifiés de « partenaires ». À cet égard, certains médias déclarent même que le XXIe siècle sera celui de la fin du travail salarié. Il semble toutefois que ce discours véhicule de nombreuses idées reçues qu’il convient d’examiner et de contrecarrer.
Un salariat encore omniprésent
Au 31 décembre 2015, l’emploi salarié représentait 89,65 %4 de l’emploi total en France. Autrement dit, presque neuf travailleurs français sur dix sont salariés. Cette omniprésence du salariat encore de nos jours est ainsi représentée de manière claire sur la figure 1.
L’autre information utile concerne l’évolution de cette proportion. Entre 1989 et 2015, il n’y a pas eu d’évolution significative de la place du salariat dans la société. Celui-ci représente plus ou moins 90 % de l’emploi total en France depuis plus de 25 ans. Nous verrons en remontant plus loin dans le passé qu’il n’en a pas toujours été ainsi (cf. Partie 2, chapitre 3).
Figure 1 : Proportion des salariés et des non salariés en France dans l’emploi total entre 1989 et 2015.
Ce constat est le même dans la plupart des pays de l’Union européenne (UE), à quelques exceptions près. Si les proportions diffèrent, pour des raisons diverses, la tendance à la stabilité du salariat se retrouve au sein de l’UE. La proportion moyenne du salariat dans l’ensemble de l’Union européenne n’a pas varié significativement depuis plus de quinze ans, autour de 86 %5. Nous nous intéresserons plus précisément aux autres pays de l’Union dans la troisième partie de cet ouvrage (cf. Partie 3, chapitre 8).
Ainsi, à première vue, il n’y a pas, de nos jours, de changement significatif dans la structure de l’emploi en France. Nous allons néanmoins nous pencher plus précisément sur cette catégorie des travailleurs non-salariés afin de déterminer les évolutions qui s’y opèrent.
Les indépendants, une catégorie ancienne et hétéroclite
Il n’existe pas de définition juridique du travailleur indépendant. Ce sont tous ceux qui n’ont pas le statut de salarié, à savoir toutes les personnes qui exercent à leur compte une activité économique, en en supportant les risques et en s’en appropriant les profits éventuels. À la différence des salariés qui sont en situation de subordination juridique à l’égard de l’employeur avec lequel ils contractent, ils sont complètement autonomes, ce sur quoi nous reviendrons très largement dans la deuxième partie de cet ouvrage.
Les travailleurs indépendants exercent sous divers statuts : artisans, commerçants, professions libérales, associés majoritaires de SARL ou gérant d’EURL (associé unique). Ainsi, certaines professions anciennes en concentrent une large part : agriculteurs, artisans, épiciers… On parle également de freelances depuis plusieurs décennies pour parler de travailleurs à leur compte, souvent très qualifiés, typiquement dans le secteur informatique.
Les travailleurs indépendants relèvent d’un régime spécifique de protection sociale, distinct du régime général. À quelques rares exceptions près, ils ne sont pas soumis aux règles du Code du travail, ce code traitant du travail salarié. Ils peuvent opter pour différents statuts juridiques : créer leur entreprise, recourir au portage salarial ou, depuis 2009, adopter le statut d’auto-entrepreneur, sur lequel nous allons revenir en détail un peu plus tard.
Le secteur tertiaire, gisement des travailleurs indépendants ?
Une analyse de l’emploi non salarié par secteurs d’activité (cf. figure 2) met en évidence la part importante de l’agriculture dans celui-ci. Entre 1989 et 2001, c’est d’ailleurs le secteur primaire qui a fait décroître la part des indépendants dans l’emploi total, la faisant passer de 13 % à 9 %. Depuis 2001, on observe néanmoins un certain regain de l’emploi non salarié, alors pourtant que l’agriculture y contribue de moins en moins. C’est, depuis, le secteur tertiaire (marchand et non marchand) qui prend le relais en faisant passer la proportion des indépendants de 9 % à un peu plus de 10 % entre 2001 et 2015.
Figure 2 : Contribution des différents secteurs d’activité à l’emploi non-salarié entre 1989 et 2015
Source : INSEE
L’examen de la dynamique de l’emploi non salarié au sein de chaque secteur est toutefois nécessaire pour comprendre les mutations qui se dessinent (cf. figure 3).
Figure 3 : Part de l’emploi non salarié dans chaque secteur hors agriculture entre 1989 et 2015
Source : INSEE
En effet, on note que la construction est le seul secteur dans lequel l’emploi non salarié s’accroît de façon significative. C’est d’ailleurs, après l’agriculture (que nous ne présentons pas à la figure 3), celui dans lequel la part d’emploi non salarié est la plus importante (environ 20 %). Au contraire, et de manière peu intuitive, il n’y a que 11 % d’indépendants dans le tertiaire marchand et seulement 6 % dans le tertiaire non marchand. Surtout, en proportion de l’emploi total, il n’y a pratiquement pas plus d’indépendants dans le tertiaire en 2015 qu’en 2001 (0,2 % d’augmentation)6.
Ainsi, on comprend que si la sensible augmentation, au cours de la dernière décennie, de la part d’emplois non-salariés dans l’emploi total concerne le secteur tertiaire, cela ne s’explique pas par une évolution de la structure de l’emploi au sein de ce secteur, mais plutôt par le fait que celui-ci a pris une place plus importante dans l’économie. Il y a aujourd’hui, dans le secteur tertiaire, une proportion respective de salariés et d’indépendants peu différente de celle d’il y a 20 ans.
La création du régime d’auto-entrepreneur
La création du régime d’auto-entrepreneur, devenu micro-entrepreneur en 2015, est une des causes probables du regain du nombre de travailleurs non-salariés depuis le début des années 2000. Créé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, en vigueur depuis le 1er janvier 2009, il avait pour objet essentiel une simplification de l’accès à la création d’entreprise, grâce à des formalités allégées et un mode simplifié de calcul et de paiement des cotisations sociales et d’impôt sur le revenu. Le micro-entrepreneur est ainsi :
- Franchisé de TVA (son prix de vente ne tient pas compte de la TVA) ;
- Soumis à un taux de cotisations sociales avantageux correspondant au régime microsocial, de 13,1 % pour la vente de marchandises et de 22,7 % pour les prestations de services ;
- Soumis à un abattement forfaitaire pour le calcul du résultat de l’entreprise.
- Exonéré de charges sociales en cas d’absence d’activités.
Le régime de l’auto-entreprise peut être adopté pour l’exercice de nombreuses activités qu’il s’agisse de vente de marchandises ou de prestations de services, à quelques exceptions près telles que les agents immobiliers ou les artistes. Pour bénéficier de ce régime, le chiffre d’affaires annuel doit rester inférieur à 82 800€ € pour la vente de marchandise ou 32 900€ € pour les prestations de service.
Il a connu un grand succès dès ses premiers mois d’existence. En 2009, 328 000 personnes ont créé une auto-entreprise, dont la moitié exerçait une activité économique effective. Ce régime représentait alors 55 % des créations d’entreprises. Si ce succès a sensiblement décru, ce statut est choisi par près d’un créateur d’entreprise sur deux (43 % en 2015). À fin juin 2015, les réseaux des URSSAF comptaient 600 000 auto-entrepreneurs économiquement actifs, c’est-à-dire déclarant un chiffre d’affaires.
- 4 – Source : INSEE.
- 5 – Source : Eurostat.
- 6 – Uber a débuté ses activités en France en janvier 2012.
Un besoin des entreprises de plus de flexibilité
La part des emplois non-salariés dans l’emploi total ne connaît pas, à ce jour, de croissance significative et a même décru si on s’y intéresse sur une période de plusieurs décennies. Néanmoins, s’il n’y a pas encore de changement significatif dans la structure globale de l’emploi entre salariés et non-salariés, on peut aujourd’hui faire état de changements culturels profonds tant chez les entreprises que chez les travailleurs.
La fin du CDI ?
Dans le salariat, des contrats et des catégories de travailleurs se multiplient
L’environnement juridique et les types de contrats occupés par les travailleurs salariés ont significativement évolué depuis les années 1980. Alors que le contrat à durée indéterminée à temps plein était la forme juridique « courante » du salariat depuis les Trente Glorieuses – dans un contexte de croissance, de plein-emploi et de fluidité du marché du travail – il a progressivement cédé sa place à des formes « atypiques » d’emploi salarié : intérim, CDD, stages et apprentissage7. En 2015, 85,6 % des salariés du secteur privé étaient en CDI. Ce contrat reste ainsi encore largement majoritaire, malgré un très léger repli depuis 2005, de 1,5 point. Mais si on observe ce qui se passe chez les nouvelles générations, les actifs de 15-25 ans par exemple, on s’aperçoit qu’ils ne sont plus que 45 % à avoir un CDI aujourd’hui, alors qu’ils étaient plus de 77 % dans la même tranche d’âge dans les années 1980.
Si l’on regarde maintenant ce qui se passe en flux (cf. figure 4) nous observons que les périodes d’emploi de moins de trois mois en CDD et intérim représentent près de neuf embauches sur dix de nos jours, contre seulement une sur deux en 1982.
Figure 4 : Part des types de contrats dans les embauches, en flux.
Source : DARES
Ceci traduit un éclatement du marché du travail des salariés, avec d’un côté une population de travailleurs qui restent en CDI (d’où les chiffres reflétant le stock encore très favorable au CDI, même si ces derniers évoluent pour les dernières générations de travailleurs) et de l’autre côté, des travailleurs qui enchaînent les contrats précaires de plus en plus courts.
Ces chiffres peuvent traduire deux phénomènes : soit une plus forte segmentation du marché du travail entre contrats précaires et contrats permanents soit, à tout le moins, une « rigidification » des embauches qui seraient plus régulièrement précédées de contrats courts. Au regard d’une étude de l’OCDE d’août 20168, sur une période de 3 ans, seuls 21 % des salariés passent de l’emploi temporaire à l’emploi permanent. Ceci tend à privilégier l’hypothèse d’une segmentation de plus en plus forte entre les salariés en CDI et les autres. L’INSEE confirme d’ailleurs que le taux de conversion de CDD en CDI est passé de 62 % en 1982 à 25 % en 2011 : alors qu’en 1982, plus d’un salarié en CDD sur deux se voyait proposer une embauche en CDI, ils ne sont plus qu’un sur 5 en 2011.
Parmi les salariés en contrats à durée indéterminée, la part du temps partiel a également progressé ces trente-cinq dernières années. En 2015, 18,8 % des travailleurs sont à temps partiel alors qu’ils n’étaient qu’à peine 8 % en 1975 (cf. figure 5).
Figure 5 : Proportion d’actifs occupés à temps partiel de 1975 à 2014
Source : INSEE
Sur le plan juridique, la nature des contrats existants s’est aussi élargie. Prism’emploi, l’organisation professionnelle des agences d’emploi, rapporte dans son Manifeste pour l’emploi de novembre 2016 que l’on compte désormais 38 types de contrats de travail différents : CDD d’usage, CDD senior, CDI intermittent, portage salarial, groupements d’employeurs, temps partagé, prêt de personnel, détachement de salariés…
Ainsi, malgré la réelle prédominance du CDI, on peut noter que le marché de l’emploi devient de plus en plus complexe à analyser. Les formes d’emploi dites « atypiques », c’est-à-dire qui ne sont pas des CDI à plein-temps, se développent au sein du salariat, en particulier pour répondre au besoin de flexibilité des entreprises.
Malgré la multiplicité des types de contrats, des représentants des entreprises mettent en avant l’incapacité du droit à répondre à leur besoin souplesse9. Ils ajoutent que cette multiplication de contrats introduit une forme de complexité.
Nous montrerons dans la deuxième partie que la multiplication de ces formes atypiques de travail provient d’une inadéquation des rapports au travail hérités de l’époque fordiste (CDI et travail indépendant) à répondre aux besoins nouveaux des entreprises et des salariés.
La pluriactivité se développe
La direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) du ministère du Travail rapporte que le nombre de travailleurs qui déclarent travailler pour plusieurs employeurs voire qui exercent plusieurs professions était de 1,4 million en 201410. Parmi eux, 1,2 million sont salariés dans leur profession principale et 200 000 se déclarent pluriactifs en exerçant une activité non-salariée à titre principal.
Logiquement, la multi-activité se retrouve majoritairement chez les travailleurs à temps partiel dans leur emploi principal (et c’est le cas pour près de 75 % des pluri-employés). Près de 50 % des pluriactifs déclarent être à temps partiel car ils n’ont pas la possibilité de travailler davantage avec leur emploi : le temps partiel est donc majoritairement contraint.
Ce constat est toutefois plus nuancé pour ceux qui exercent plusieurs professions différentes, puisque 55 % d’entre eux exercent une activité principale à temps complet. Il corrobore l’observation qu’un nombre croissant de travailleurs aspire à associer leurs passions à leur vie professionnelle. Ces slasheurs sont des travailleurs qui cumulent des activités parfois très éloignées les unes des autres : journalisme, conseil, cuisinier, enseignant, coach… Le salon des micro-entreprises leur a consacré une étude en 2015. Il y est estimé que la majorité des slasheurs le sont par choix (64 %) et que près d’un tiers exerce une deuxième activité entrepreneuriale. Il s’agit là finalement tant d’une réponse à l’instabilité de l’emploi de nos jours, et à une forme de précarité, qu’une volonté de faire de ses passions un métier. L’étude précise d’ailleurs que cette démarche est parfois née de la contrainte, notamment financière, même si elle a pu ensuite se transformer en un choix.
Les politiques et stratégies des entreprises évoluent
De l’entreprise industrielle à la plateforme
Après la révolution industrielle, le modèle des rapports de domination et de production suivait assez bien la description marxiste d’un système capitaliste distinguant apporteurs de capital et apporteurs de travail
Le XXe siècle a été marqué par la civilisation de l’usine, où fordisme et taylorisme ont façonné l’organisation du travail, selon des principes d’organisation scientifique. Une des clés de succès était de maîtriser l’offre et la capacité de production, au meilleur coût. Cela passait par la forte mécanisation, la standardisation et le contrôle de toute la chaîne de valeur.
Pour accroître la productivité et permettre de répondre à une demande qui dépassait l’offre, il s’agissait alors de poursuivre la mécanisation des usines qui, en quelque sorte, guidait les procédures et les savoir-faire. Le travailleur était d’une certaine manière asservi à l’outil de production dont il fallait tirer le meilleur profit. Les managers organisaient la production pour la rendre la plus efficiente et maîtriser une complexité technique nouvelle. Le moteur de l’innovation était, selon la description d’Armand Hatchuel et Blanche Segrestin11, un projet collectif porté par des ingénieurs et techniciens, tous les acteurs de l’entreprise, en particulier les ouvriers, formant un pacte consistant dans l’engagement de chacun dans une « création collective » inscrite dans la durée. Nous en détaillerons les implications en termes de relations de travail dans la deuxième partie de cet ouvrage.
Dans ce modèle, très majoritaire après la deuxième révolution industrielle, la grande entreprise est le moteur de l’économie et concentre de nombreux pouvoirs12 : un pouvoir économique capable d’influer sur l’offre et la demande, un pouvoir politique qui pèse dans les jeux démocratiques, un pouvoir d’influence des comportements des consommateurs. L’entreprise concentre les pouvoirs et ses dirigeants ne sont finalement soumis qu’à un contrôle limité d’un actionnariat diffus.
Le capitalisme financier a pris naissance dans les années 1980. La théorie de l’agence en fournit un cadre d’analyse : l’entreprise est constituée d’une multitude d’intérêts de différentes parties prenantes, elle est un « nœud de contrats ». L’actionnaire tient une place centrale dans la gouvernance et la rentabilité à court terme prend une importance croissante. Dans un contexte où les perspectives d’investissement étaient moins favorables, les restructurations et rachats d’entreprises ont été encouragés par des réformes juridiques initiées notamment aux États-Unis. On assiste donc, à partir de cette période, à des vagues d’externalisations, de recentrages stratégiques et, dans une moindre mesure, au recours massif à l’intérim ou aux contrats courts. L’entreprise est un centre de contractualisation entre diverses parties prenantes pour concourir à la fourniture d’un produit ou d’un service. Ce sont des mécanismes marchands qui deviennent prépondérants dans les prises de décision.
L’entreprise ne façonne et n’organise alors plus le travail. Elle le divise en tâches et optimise la mise en relation entre offreurs et demandeurs pour en permettre la meilleure exécution par des tiers, sans autre considération que le moindre coût à un niveau de qualité acceptable. Sur le plan juridique, les conséquences sont importantes. Tandis que l’entreprise endosse la responsabilité des actes professionnels de ses salariés, elle renvoie à la responsabilité individuelle des cocontractants lorsqu’elle s’est « contentée » de faire de la mise en relation. Son rôle revient alors à s’assurer que son vivier de « travailleurs », qui lui sont extérieurs, possède a priori les capacités requises pour les tâches qu’ils prétendent exercer. Dans certains cas comme celui des plateformes, elle s’assure également qu’elle donne suffisamment d’informations pour un choix éclairé du contractant, c’est-à-dire le client. Autre considération importante, l’entreprise n’exerçant pas le rôle d’employeur, elle n’a pas à appliquer les règles du Code du travail.
L’externalisation est une pratique courante en entreprise Des compagnies aériennes ont par exemple, depuis de nombreuses années, externalisé la gestion de leur équipage13. Dans un autre domaine, la gestion des ressources informatiques des entreprises est aujourd’hui largement confiée à des entreprises extérieures. Dans le journalisme, les pigistes sont des travailleurs à la tâche, sur un métier stratégique des médias qui les emploient. Des droits particuliers leur ont été définis en France dans la loi dite loi Cressard du 4 juillet 1974. L’uberisation tant évoquée de nos jours n’est donc pas un phénomène nouveau si ce n’est qu’elle confère au client final, dans certains cas, le soin de choisir son prestataire.
Les technologies numériques ne sont pas le support indispensable de cette stratégie d’entreprise ni des modèles de plateformes. Elles le facilitent, notamment parce qu’elles permettent de faire baisser les coûts de transaction, théorisés par Ronald Coase dès 193714. Pour lui, « la firme est un mode de coordination des transactions alternatif au marché ». Si le marché n’est pas l’unique moyen de coordonner l’activité économique, c’est qu’il existe des coûts à recourir au système de prix, des coûts de transaction. Ces coûts de transaction correspondent aux coûts de recherche d’information, de négociation des contrats, de contractualisation répétée… Dans une organisation d’entreprise classique, la répartition des tâches permet des coûts internes inférieurs à ceux du recours à l’achat externe. Certes, un recrutement est coûteux, porteur de risques, engageant, et, de surcroît, long. Mais ce coût reste, dans bien des cas, inférieur à celui de prestations externes. Lorsque les technologies de l’information favorisent la baisse de ces coûts de transaction, le recours à des prestations devient plus facile et l’offre de services plus accessible. Même lorsque la fonction externalisée est en prise directe avec la clientèle, la notation faite par les clients précédents devient un outil d’évaluation préalable qui diminue sensiblement la prise de risque. Pour toutes ces raisons, l’entreprise peut désormais privilégier le recours à la prestation.
En conséquence, les entreprises tendent à employer de moins en moins et à contractualiser de plus en plus à la tâche ou, dans le meilleur des cas, à la mission. Elles ne détiennent parfois que très peu de capital au regard de leur chiffre d’affaires, pour des raisons qui peuvent varier : difficultés à le mobiliser15, recherche de structures plus légères et agiles, stratégie financière…
Si bien que la distinction entre capital et travail ne constitue plus une clé d’analyse pertinente de notre époque. L’uberisation est ainsi la capacité à concevoir des modèles économiques nécessitant moins de capital. Uber fait chaque jour appel à une flotte de centaines de milliers de voitures sans en détenir une seule. AirBnb propose des milliers de chambres et d’appartements partout dans le monde sans avoir un seul actif immobilier (au-delà peut-être de quelques bureaux).
C’est le marché qui devient le régulateur prépondérant, marché dans lequel l’apporteur de travail est un actif comme les autres, plus ou moins valorisable selon ses capacités et dont le prix s’ajuste en fonction de la demande et de la concurrence16.
Plusieurs types d’organisations
On voit ainsi aujourd’hui de nombreuses entreprises s’organiser ou se créer selon ce modèle de plateforme dont les exemples ne manquent pas : VTC, livraisons à domicile, location d’appartements, services aux particuliers, chefs à domicile, conception de CV… Le phénomène se répand à une telle vitesse que ladite ubérisation de l’économie et son prétendu caractère disruptif sont dans presque toutes les bouches.
« On ne construira pourtant pas des nouveaux Airbus avec une myriade de travailleurs indépendants ». Cette phrase que nous reprenons de l’un de nos interlocuteurs pourrait traduire la difficulté à innover de la part des entreprises de type plateforme. Elle renvoie aussi au constat que tout au long de l’histoire industrielle, ce sont toujours les entreprises qui ont fait le lien entre les sciences et les machines. Cette capacité d’innovation des plateformes ne doit pourtant pas être négligée. En matière de services, il est indéniable que l’arrivée des VTC sur le marché du transport à la personne a largement fait évoluer la qualité de l’offre. De façon plus large, des personnalités comme Henri Verdier ou Nicolas Colin ont largement évoqué la pertinence voire la nécessité pour les entreprises (et même l’État) de s’adapter pour devenir des plateformes et des méta-plateformes, en évoquant la puissante capacité d’innovation qu’ils pouvaient gagner de la multitude.
Ceci traduit en tout état de cause l’importance des modes d’organisation des entreprises sur les évolutions de l’emploi et du travail.
France Stratégie a publié en avril 2017 une étude17 prospective sur ce sujet. Il y distingue quatre grands types d’organisations (l’organisation apprenante, la plateforme virtuelle apprenante, le super-intérim et le taylorisme new age) chacune présentant des risques et avantages pour le travailleur de demain, marquées par différents degrés d’autonomie, de qualification ou encore de subordination. Le lecteur pourra se référer à ces modèles que France Stratégie ne présente pas comme des prédictions mais des supports pour nourrir et structurer la réflexion.
Les cycles technologiques s’accélèrent avec les technologies numériques
Notre époque est marquée par ce que certains appellent la « révolution numérique » qui a des impacts concrets sur les entreprises et sur l’emploi. Les conséquences de la robotisation, notamment, font l’objet de débats nourris et de publications multiples. Mais ces débats anciens ne convergent toujours pas. En septembre 2013, Carl Frey et Michael Osborne, chercheurs à l’université d’Oxford, ont beaucoup fait parler d’eux, en estimant que 47 % des emplois aux États-Unis avaient une forte probabilité d’être automatisés à l’échéance d’une à deux décennies. L’OCDE, publiant une étude en mai 2016, estimait quant à elle que ce risque portait sur 9 % des emplois des 21 pays membres de l’Organisation. La nature même des emplois concernés ne fait pas consensus, même si les emplois les moins qualifiés sont plus directement visés.
Les prédictions sont donc plus qu’hasardeuses. En outre, il ne s’agit pas de la première révolution technologique que le monde industriel connaît. L’introduction de la machine à vapeur ou celle des automates avaient fait l’objet de controverses équivalentes.
Les technologies numériques présentent toutefois quelques particularités. Se pose tout d’abord la question du rythme de leur diffusion. Il a fallu 38 ans à la radio pour toucher 50 millions d’Américains, contre seulement 3 ans pour le téléphone mobile et 88 jours pour Google plus18. Des géants comme Google, Amazon ou Facebook se sont développés en des temps très courts par rapport aux entreprises industrielles de taille comparable. L’âge moyen des GAFA est de 23 ans.
La pénétration des technologies numériques, y compris la robotisation et l’automatisation, est ni plus ni moins l’expression de phénomènes d’innovation que l’économie a déjà vécus par le passé. Elles apportent des atouts indéniables, à la fois aux entreprises et aux consommateurs, tant par les gains de productivité précités que par l’amélioration de la qualité des services ou produits.
La vitesse avec laquelle elles se répandent, et de manière sous-jacente l’accélération des cycles technologiques qu’elles caractérisent, ont cependant des conséquences sur les mutations du travail et de l’emploi dont il est impératif de tenir compte. D’autant plus qu’elles font appel à des modalités de travail inhabituelles, notamment le travail nomade. Les technologies numériques remodèlent les organisations des entreprises, tant pour ce qui concerne leurs stratégies, leurs rapports à leurs parties prenantes, que dans leurs processus et leurs rapports aux travailleurs. Les modèles d’affaires peuvent être brutalement bousculés par l’arrivée de barbares19, ces nouveaux entrants qui « attaquent les vieilles citadelles ». Les entreprises ont encore plus qu’avant la nécessité et la faculté technique d’être agiles, accroissant de manière criante le besoin de flexibilité de leur ressource humaine. C’est ce marqueur de la transition numérique qui est crucial, plus que les prédictions d’éventuelles créations ou destructions d’emplois.
- 7 – Rapport INSEE « Une rotation de la main-d’œuvre presque quintuplée en 30 ans », 2014.
- 8 – http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-19991274.htm
- 9 – http://www.medef-idf.fr/les-entreprises-ont-besoin-de-plus-de-flexibilite-sur-la-duree-du-travail/
- 10 – Dares Analyses 2016-60 — Les pluriactifs : quels sont leurs profils et leurs durées de travail ?
- 11 – Cf. Refonder l’entreprise, Editions du Seuil, 2012.
- 12 – Cf. notamment John Kenneth Galbraith, rapporté par Aurélien Acquier. Le Libellio d’AEGIS Vol. 13, Dossier Évolutions du travail, plates-formes et digital, pp. 87-100.
- 13 – Cf. par exemple http://www.tourmag.com/Norwegian-les-confessions-d-un-commandant-de-bord_a84655.html
- 14 – C’est entre autres pour cette théorie des coûts de transaction qu’il aurait reçu le prix Nobel d’économie.
- 15 – Certaines success-story ont d’ailleurs commencé ainsi. Brian Chesky, fondateur d’Airbnb a publié les refus des capitaux-risqueurs qu’il a essuyés. Michael Dell décrit que le modèle de son entreprise éponyme résulte du fait qu’il n’avait que 1000 dollars, capital minimum autorisé par l’État du Texas lorsqu’il l’a créée.
- 16 – Certaines plateformes utilisent d’ailleurs un ajustement dynamique des prix en fonction de la demande et de l’offre disponible, en temps réel.
- 17 – Le travail en 2030 – Ce que nous annoncent les mutations dans l’organisation du travail – France Stratégie, Avril 2017.
- 18 – Source Wall Street Journal.
- 19 – http://barbares.thefamily.co/
Une soif d’indépendance des travailleurs au prix d’une grande précarité
L’indépendance est une aspiration sociétale
Même si les statistiques montrent la prédominance du salariat dans l’emploi total, le développement rapide de structures de types plateformes, la multiplication des profils slasheurs ou pluriactifs et le sensible regain du nombre d’indépendants depuis le milieu des années 2000 invitent à s’intéresser de plus près à cette population.
L’accès à plus d’indépendance a finalement beaucoup d’atouts, que ce soit pour le travailleur ou pour la société : créer de l’activité économique, favoriser l’innovation, décider de sa charge de travail et mieux concilier vie privée et vie professionnelle, choisir son activité et ses missions sans en référer à quiconque et décider de son propre sort. L’accès au travail, par l’auto-emploi et la création d’entreprise, constitue un puissant moyen d’accomplissement permettant à chacun de se réaliser sans dépendre du bon vouloir d’un employeur ou de la solidarité nationale.
« Le CDI c’est vraiment dépassé, c’était pour nos parents. Je veux pouvoir avoir ma liberté, mon indépendance et travailler où je veux et quand je veux. » Pauline Lahary, fondatrice de Mycvfactory, entreprise de rédaction de CV qui travaille avec une cinquantaine de freelances sur des groupes gérés en cloud, sans employé, rapporte ainsi les propos d’un de ses amis20, lui-même en CDI. Elle ajoute également ceux d’une de ces freelances : « J’adore ma situation actuelle : travailler en freelance m’offre une souplesse qu’un job salarié ne permet pas. Dans mon cas (c’est très personnel !), cela m’évite beaucoup de déplacements, je travaille chez moi. J’habite en rase campagne, et auparavant, je faisais plus de cent kilomètres par jour pour me rendre au bureau. Mon aîné passait dix à douze heures par jour chez la nounou, au bas mot, et j’étais en déplacement au moins 3 jours par semaine. Et surtout, j’ai l’habitude de mon indépendance ! J’ai un peu du mal avec un patron sur le dos. J’ai rarement vécu l’expérience, mais à chaque fois, ça a fait des étincelles ! »
L’attrait du statut d’indépendant, pour certaines populations plutôt jeunes et diplômées, est lié à leur rapport au travail. Pour qui sait gérer son employabilité, la prospection et la négociation commerciale, le statut d’indépendant offre une liberté indéniable.
Dans un autre registre, l’anthropologue David Graeber, avait signé un article21 sur les « jobs à la con » décrivant le sentiment vécu par de plus en plus de travailleurs d’occuper un travail inutile. Il a bénéficié d’un écho certain. Sans détailler ou critiquer son contenu, il est assez manifeste que ce sentiment d’inutilité ou de perte de sens encourage certains à s’orienter vers le travail indépendant, en particulier parmi les diplômés qui s’orientent parfois vers des métiers sans lien direct avec leurs études, par passion ou par sentiment d’y trouver plus de sens22.
L’indépendance est aussi une réponse au chômage
L’auto-emploi est aussi, pour d’autres, une réponse à une difficulté à accéder à l’emploi, dans un contexte de chômage de masse. Charles Boissel, alors doctorant à HEC, a rédigé en 2015 un article23 s’interrogeant sur l’origine sociale des chauffeurs de VTC, en écho aux propos de l’entreprise UBER se revendiquant comme une entreprise créatrice d’emplois auprès des populations vulnérables.
Il apparaît assez nettement que la présence de VTC en Ile-de-France est plus forte dans les zones où le chômage est plus élevé. Charles Boissel montrait également la corrélation qui pouvait être faite entre taux de présence de VTC et revenu moyen (plus il est faible, plus le taux de présence de VTC est important), le pourcentage d’ouvriers dans la population active, ou encore le taux de scolarisation des 15-24 ans.
Figure 6 : Proportion de conducteurs VTC dans la population active (à gauche) et taux de chômage (à droite) en 2015.
Source : Carte réalisée en octobre 2015 par Charles Boissel selon des données du registre des VTC du Ministère du Développement durable
La facilité d’accès à l’auto-emploi, tels que celui de VTC, semble bel et bien aussi un moyen d’insertion.
Le micro-entrepreneuriat est souvent un régime d’activité de complément
Nous l’avons vu, le statut d’auto-entrepreneur a connu un succès significatif dès son entrée en vigueur au 1er janvier 2009 et a joué un rôle déterminant dans le regain d’intérêt pour l’emploi non salarié. Malgré une sensible érosion, son succès ne se dément pas puisque près d’une création d’entreprise sur deux l’a été sous ce régime en 2015 et que plus du quart des non-salariés sont des micro-entrepreneurs.
L’examen des données de l’INSEE relatives aux micro-entrepreneurs révèle certains enseignements utiles. Tout d’abord, une partie des créateurs de micro-entreprises n’exercent pas d’activité. La facilité d’accès à ce statut peut expliquer que l’examen préalable du marché soit parfois insuffisant ce qui se traduit par une part significative de micro-entrepreneurs ne démarrant concrètement jamais d’activité à proprement parler. Depuis la création du régime, plus d’un tiers n’aurait pas commencé d’activité selon les données de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), rapportés par l’INSEE. En 2014, 60 % des immatriculés du premier semestre avaient démarré leur activité dans l’année.
Le régime du micro-entrepreneuriat est adopté pour l’accès à une activité de complément dans 46 % des cas, pour les micro-entrepreneurs ayant débuté leur activité en 2014. Toujours en 2014, l’observatoire des micro-entrepreneurs indiquait que, pour 75 % d’entre eux, les revenus générés sous ce régime représentaient moins de 50 % des revenus du foyer.
Le revenu moyen des micro-entrepreneurs actifs est ainsi faible : 410€ € nets mensuels en moyenne, et 460€ € nets pour ceux qui ne cumulent pas d’activité salariée, soit huit fois moins que les indépendants « classiques » dont le revenu global d’activité s’élève à 3 260 euros mensuels en 201324.
Tous ces éléments convergent vers le constat que le micro-entrepreneuriat est souvent une activité de complément. Ce n’est bien entendu pas le statut qui en est responsable. Il offre au contraire l’opportunité de s’engager plus facilement vers la création d’entreprise, avec de moindres contraintes. Mais ceci montre que l’activité n’est pas toujours au rendez-vous et que nombre de micro-entrepreneurs ne parviennent pas à en faire leur activité principale et encore moins à accéder à l’étape suivante de la création d’entreprise « classique ». Parfois, « le micro-entrepreneur individuel apparaît, au-delà des fantasmes, comme la nouvelle figure emblématique du précaire : sa micro-entreprise lui permet de se dégager un micro-revenu, qui lui permet de rembourser son micro-crédit et d’accéder à une micro-protection sociale. »25
Un autre point marquant est d’ailleurs celui de l’investissement consenti par les micro-entrepreneurs lorsqu’ils se lancent : 80 % d’entre eux engagent moins de 4 000€ € et près de 40 % de ceux pour qui il s’agit de l’activité principale n’engagent pas de capital (cf. Figure 7).
Figure 7 : Répartition, selon le capital investi, des auto-entrepreneurs immatriculés au premier semestre 2014 et ayant démarré une activité dans l’année
Source : INSEE
- 20 – https://fr.linkedin.com/pulse/de-la-mort-du-cdivers-un-nouveau-mode-travail-pauline-lahary
- 21 – http://strikemag.org/bullshit-jobs/
- 22 – http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2016/04/22/dans-l-enfer-des-jobs-a-la-con_4907069_4497916.html
- 23 – https://variationseconomiques.wordpress.com/author/cboissel/
- 24 – Données INSEE.
- 25 – De l’auto-emploi à la coopération : le cas des coopératives d’activité et d’emploi, Catherine BODET et Noémie de Grenier, http://www.coopaname.coop/sites/www.coopaname.coop/files/file_fields/2015/07/14/2011-1-bodet-degrenier-de-l-auto-emploi-a-la-cooperation.pdf
Des enjeux nouveaux
Le salariat, un marqueur social qui ne protège plus ?
Le CDI reste, plus qu’un statut juridique, un marqueur social important. Il s’est imposé comme une forme de Graal à conquérir pour s’assurer certaines sécurités. Il est un outil d’insertion encore très important en France. La facilité d’accès au logement ou l’accès à la propriété, par la nécessité de recourir à des prêts bancaires, restent encore largement liés au statut professionnel, en particulier au CDI.
Pourtant certains types de CDI protègent moins. Ainsi, le CDI intermittent ou le CDI de chantier sont presque des appellations antinomiques car les entreprises ne s’engagent plus sur des recrutements de long terme. Elles sécurisent un volume de main-d’œuvre pour une durée limitée même si elle est a priori indéterminée.
Hors du salariat, la question des protections sociales se pose de manière encore plus accrue puisque la majorité des systèmes de protection sont assis sur le salariat, malgré la création de l’assurance maladie universelle. Pour les micro-entrepreneurs, l’assurance contre les risques professionnels et contre les impacts sur leur activité des « risques de la vie » reste un sujet non résolu. Dans l’hypothèse du développement du travail non salarié, c’est même l’équilibre des systèmes de protection sociale qui peut se poser, ceux-ci étant assis sur les cotisations sociales des salariés. Se posera à terme la question de la réorganisation des transferts de solidarité.
Les sublimes et les contraints de l’indépendance
L’auto-emploi recouvre, on l’a vu, des réalités très contrastées. Les plus autonomes, souvent ceux qui ont les compétences les plus prisées, choisissent l’auto-emploi pour répondre à leur aspiration d’une plus grande autonomie et d’une plus grande flexibilité. Ils jouissent d’une réelle indépendance, savent trouver des clients et gérer leur activité.
Dans le même temps, d’autres profils voient la création de la micro-entreprise comme une réponse plus ou moins forcée à la recherche d’emploi jusqu’alors infructueuse. Mais certains de ces profils restent pris dans une logique de survie.
On assiste à l’apparition d’une dichotomie entre « les sublimes », du nom que se donnaient eux-mêmes une poignée d’ouvriers ultra-qualifiés du XIXe siècle, et les contraints qui ne trouvent dans l’auto-emploi que le seul moyen de subsister ; un monde des non-salariés partagés entre les vrais autonomes et ceux cantonnés au travail fragmenté du digital labor d’Amazon Turk ou d’Upwork. Entre ces deux extrêmes, on trouve aussi des travailleurs indépendants qui parviennent à tirer de leur activité un revenu décent et pour qui l’auto-emploi peut être une marche vers l’insertion.
Les inégalités et l’absence de protection des plus faibles restent l’un des déséquilibres majeurs de notre rapport au travail, sur lequel nous reviendrons plus largement dans la deuxième partie de cet ouvrage.
La parasubordination
L’essor des plateformes est indéniablement lié à l’existence de la micro-activité et à la recherche de revenu de compléments. La très grande majorité des travailleurs sur plateformes adoptent ce régime. Il n’est probablement pas toujours imposé par contrat, mais il l’est de fait. Le faible nombre d’heures d’activité et même les coûts associés à une création d’entreprise sous un autre statut remettraient en cause la rentabilité de l’activité du travailleur.
Des plateformes jouent du fait qu’il existe une population qui n’est à la recherche que d’un revenu de complément. Elles déclarent faire appel à des prestataires cherchant un « à côté » (étudiants, salariés par ailleurs) mais ce discours traduit l’hypocrisie sous-jacente à ce que l’on appelle « l’économie collaborative » qui n’a souvent rien de collaboratif. Il ne s’agit souvent que de valoriser et d’exploiter au mieux des actifs (au sens comptable) que les plateformes ne détiennent pas, dans une démarche bel et bien lucrative. On pourrait ainsi estimer que sous la bannière de l’économie collaborative se cache l’exploitation d’une certaine misère sociale, et notamment le fait que la main-d’œuvre ne bénéficie pas des protections sociales du salariat. C’est aussi un moyen de contourner les règles du Code du travail, puisque ce dernier ne concerne que les salariés. Les exemples de travailleurs qui ne gagnent même pas le SMIC horaire, faute d’activité, sont nombreux. Ils ne bénéficient pas de moyen de négociation collective même si certains parviennent à s’organiser de manière informelle grâce aux réseaux sociaux.
Les témoignages que nous avons recueillis rejoignent ceux que l’on peut trouver dans la presse, par exemple dans la livraison à vélo26 : longues périodes d’inactivité (non rémunérée), rythme des missions à l’inverse quasi-intenable, forte pression psychologique… Les plateformes ont intérêt à multiplier le nombre de leurs prestataires pour mieux couvrir leur besoin sans que ceci ne se traduise par des contreparties.
Si finalement on pouvait considérer qu’être prestataire est un comportement librement consenti, on voit clairement que le rapport de force entre employeur et travailleur, que certains qualifient de « mineur social »27, est susceptible de resurgir dans une logique de prestation. Plus encore auprès d’une plateforme numérique qui gagne rapidement une situation de position dominante. Lorsque certaines disparaissent, ou lorsqu’elles décident de revoir leurs conditions contractuelles, leurs prestataires peuvent se retrouver brutalement démunis, sans couverture sociale. C’est par exemple le cas de livreurs de la start-up Take It Easy qui ont cessé leur activité mi 2016. Des livreurs sont passés de revenus d’environ 3 000€ € par mois, au prix certes d’une activité intense, à une existence précaire (vie en camping…), privés brutalement de revenus.
La question du statut des travailleurs économiquement dépendants, ou « parasubordonnés », est donc tout sauf un enjeu secondaire.
La précarité derrière l’indépendance
Comme l’écrivaient, dès 2008, Paul-Henri Mattei et Jean-Christophe Sciberras dans un rapport à ce sujet28, ces travailleurs économiquement dépendants se trouvent « privés deux fois de protection : n’étant pas salariés, ils ne peuvent prétendre à la protection juridique qu’offre le Code du travail ; n’étant pas réellement indépendants, ils ne bénéficient pas de la protection économique que donne la multiplicité des donneurs d’ordre, la rupture de commande d’un seul étant d’effet limité. »
Les plateformes mettent en œuvre des mécanismes violents de mise en concurrence des travailleurs entre eux. La notation par les clients peut ainsi être très mal vécue, d’autant plus qu’une à deux notations défavorables peuvent suffire à mettre à l’écart. Au-delà de la contrainte psychologique liée à cette concurrence féroce, c’est aussi le fait que le client ne note pas nécessairement uniquement la prestation qui est problématique. Un livreur se retrouve parfois dans l’impossibilité matérielle d’effectuer la mission qui lui est attribuée dans le délai imparti, pour des raisons qu’il ne maîtrise pas (commande attribuée tardivement, circulation, panne…). Par colère, le client peut aussi noter sévèrement la livraison alors même que c’est l’objet qui lui disconvient.
Le travail indépendant peut aussi mener à une forme d’isolement. Bien que cela ne soit pas propre au statut d’indépendant, travailler de manière indépendante offre moins d’occasions de partager des moments d’échanges entre collègues dont il serait absurde de négliger l’importance. Dans La France du Bon Coin29, David Menasce évoque le sentiment d’isolement progressif que peuvent ressentir certains travailleurs indépendants.
Au-delà, c’est l’absence de syndicats et d’organes de représentation collective qui est un véritable facteur d’isolement et qui obère le pouvoir de négociation des travailleurs indépendants face à leurs donneurs d’ordre. Les principales organisations syndicales semblent s’être penchées sur le sujet et chercheraient à s’ouvrir à ces travailleurs. Dans certaines professions, telles que les VTC, des acteurs se sont organisés et affiliés à des centrales syndicales existantes. C’est par exemple le cas du SPC VTC UNSA. Ces initiatives visent cependant plutôt à fédérer les travailleurs pour mener des actions d’ampleur. C’est autrement plutôt par les réseaux sociaux que les travailleurs indépendants parviennent tant bien que mal à créer des liens entre eux. Mais leur pouvoir de négociation avec les donneurs d’ordres reste, hors crise, faible.
- 26 – www.lemonde.fr/entreprises/visuel/2017/06/05/pedale-ou-creve-dans-la-peau-d-un-livreur-foodora_5138990_1656994.html?xtmc=livreur&xtcr=1
- 27 – Travailler au XXIe siècle, l’ubérisation de l’économie ?, Jacques Barthelemy et Gilbert Cette, Odile Jacob, 2017
- 28 – « Le travailleur économiquement dépendant : quelle protection ? » Rapport de Paul-Henri Antonmattei et Jean-Christophe Sciberras Novembre 2008.
- 29 – http://www.institut-entreprise.fr/les-publications/la-france-du-bon-coin
Partie 2 – La mécanique du monde du travail
Le travail n’est pas un objet comme les autres. Il ne peut pas se résumer à une marchandise qu’un employeur pourrait acheter au travailleur contre rémunération. En effet, les rapports au travail relèvent aussi d’un contrat implicite30 entre les différentes parties prenantes. Il consiste pour l’entreprise à fidéliser sa main-d’œuvre en échange pour les salariés de revenus stables qui ne fluctuent pas au gré de l’activité économique. Ainsi, on peut voir le travail salarié comme une assurance réciproque qui permet à l’entreprise comme aux travailleurs de se couvrir contre un risque, même si cela représente un coût. Plus généralement, il nous faut comprendre ce qui se cache derrière les rapports au travail afin d’accompagner les mutations du travail au XXIe siècle.
Aussi, l’objectif de cette deuxième partie est de proposer un cadre d’analyse nouveau pour comprendre la « mécanique » des différents rapports au travail. Nous allons commencer par montrer que les rapports au travail renvoient en réalité à une grande variété d’attentes et de besoins des travailleurs comme des entreprises. Dans un deuxième temps, nous utiliserons une perspective historique pour montrer comment, dans le passé, notre société avait réussi à construire des rapports équilibrés notamment avec le pacte du salariat. Enfin, nous montrerons que notre époque se caractérise par un éclatement de l’équilibre bipolaire construit au XXe siècle entre salariés et travailleurs indépendants. Cet éclatement rend les statuts juridiques actuels insuffisants à décrire la réalité des travailleurs de notre époque. Nous conclurons cette seconde partie sur la nécessité de construire de nouveaux équilibres, ce qui sera pleinement développé dans la troisième et dernière partie de cet ouvrage.
- 30 – Cf. la théorie des contrats implicites de Costas Azariadis (1975).
Les rapports au travail : liberté, sécurité, dignité
Très schématiquement, deux camps s’affrontent de nos jours sur les rapports au travail. Le premier défend bec et ongles un CDI décrit comme idéal et protecteur et ne voit dans les formes d’emplois atypiques que le retour à un esclavage moderne. Le second, au contraire, voit ces emplois atypiques, et en premier lieu l’auto-entrepreneuriat, comme un progrès vers l’indépendance et l’autonomie de chacun, et le CDI comme un héritage dépassé emprisonnant les individus dans une subordination déresponsabilisante. Cette dichotomie constitue une impasse. Pour en sortir, il faut revenir à l’essence de ce qui constitue et définit les rapports au travail.
Des attentes multiples
Nous avons souvent tendance à télescoper deux notions pourtant très différentes : le travail et l’emploi. Avoir un emploi, c’est grossièrement échanger sa force de travail contre une rémunération. Comme nous avons tendance à le dire familièrement, « il faut bien un emploi pour payer les factures ». La notion d’emploi est dans tous les esprits. Elle dicte, notamment, les politiques de l’emploi : le gouvernement doit créer de l’emploi parce que l’emploi est nécessaire, pour des raisons de subsistance, peu importe d’ailleurs sa nature et sa qualité. Cette importance donnée à l’emploi a masqué la représentation qu’on se fait, dans le même temps, du travail.
La rémunération fait bien partie de notre rapport au travail, mais nous ne travaillons pas uniquement pour gagner de l’argent. Les attentes à l’égard du travail sont multiples, et souvent différentes selon les individus : se sentir en sécurité face aux risques de la vie, éprouver le plaisir d’être rémunéré pour exercer une activité qui plaît, acquérir de nouvelles compétences, exprimer ses idées, développer ses capacités et son potentiel, participer à une aventure collective, être au service d’une mission porteuse de sens, etc. Chacun aura des priorités différentes. La sécurité d’un salaire stable, par exemple, n’est pas toujours celle qui l’emporte. Les artistes sont souvent prêts à y renoncer pour exercer leur créativité, qui pour eux donne un sens à leur vie. Créer une entreprise ou une startup demande souvent de sacrifier cette même sécurité dans un premier temps, mais une telle démarche permet à celui qui l’entreprend d’avoir la liberté et la dignité de concrétiser ses idées afin de créer une activité économique et d’être son propre patron. Au contraire, d’autres individus ont besoin de se sentir couverts contre les risques de la vie (le chômage, la maladie, la vieillesse, etc.) pour se sentir bien, et c’est pour eux la priorité absolue. Il importe donc de prendre en compte et de concilier tous ces besoins dans les rapports de travail. Nous allons pour cela proposer un cadre d’analyse permettant de caractériser les différents rapports de travail en termes d’attentes et de besoins. Bien sûr, les employeurs ont eux aussi des besoins spécifiques, qui peuvent venir contraindre les précédents.
La construction de ce cadre d’analyse est tout d’abord issue du constat que les travailleurs peuvent trouver, dans les différents types d’emplois, des moyens différents de répondre à leurs attentes qui dépassent la seule rémunération régulière. En outre, aucun des différents types d’emplois ne permet de répondre de manière universelle aux volontés de tous les travailleurs. Pour le formaliser, nous nous sommes alors inspirés des écrits du juriste Alain Supiot et notamment d’un de ses propos dans La fonction anthropologique du droit où il y introduit une représentation nouvelle, à partir de trois « dimensions » essentielles, pour comprendre la nature complexe des rapports au travail : « l’État providence [était] marqué par la protection des travailleurs au prix de leur subordination, les temps sont peut-être mûrs pour un droit du travail qui aurait pour horizon l’émancipation des travailleurs au prix de leur responsabilité. […] Le problème n’est alors plus seulement de prémunir le travailleur contre les risques prévisibles de l’existence, mais aussi de lui donner les moyens d’assumer [une] liberté et [des] responsabilités nouvelles. Le statut du travailleur qui reposait sur deux pieds – la dépendance et la sécurité – en exige alors trois : la liberté, la sécurité et la responsabilité. Ce trépied est nécessaire, car si la liberté implique nécessairement la responsabilité, la responsabilité implique à son tour la sécurité [pour pouvoir s’exercer] ».
La liberté
Le lien entre liberté et travail a toujours été l’objet d’un questionnement philosophique et sociologique foisonnant et passionné. « Le travail est-il pour l’homme un obstacle à la liberté ? » est l’un des sujets phares à l’épreuve de philosophie du baccalauréat en France. Les Grecs de l’antiquité s’intéressaient déjà à cette dimension essentielle du rapport au travail. D’ailleurs, dans la cité d’Athènes, on distinguait deux grands types de travail, l’un désigné par le terme ponos correspondait aux activités laborieuses et pénibles voire dégradantes. L’autre, ergon (l’œuvre), faisait référence au travail libérateur qui permet à l’homme de s’élever, de penser et de façonner le monde à son image face à la nature (c’est le cas des arts et de la politique par exemple).
De nos jours, les rapports au travail sont souvent un mélange complexe de ponos et d’ergon. Il est parfois synonyme de perte de liberté, puisqu’il implique de se soumettre à des règles qu’on ne décide pas : il y a des gestes à acquérir, des procédures et des procédés de fabrication à respecter, parfois même les ordres d’un supérieur auxquels il faut obéir. Mais, en même temps, le travail peut être source de liberté. C’est bien parce que nous travaillons que nous pouvons devenir « indépendants » de la tutelle d’autrui, que nous pouvons subvenir par nous-mêmes à nos besoins et à ceux de nos familles, et au-delà que nous pouvons choisir la manière dont nous voulons vivre, sans dépendre du bon vouloir des autres. Acquérir un savoir-faire est aussi un moyen d’être employable et de s’émanciper de l’entreprise au sein de laquelle on l’a acquis. En ce sens le travail est en effet synonyme de libération.
De nos jours, la notion fondamentale en matière de liberté au travail est certainement celle de la subordination : être soumis à l’autorité de quelqu’un à qui on doit rendre compte de ses actes. Mais il faut se souvenir que la subordination est aussi devenue un moyen pour des millions de travailleurs de se libérer de la tutelle d’autrui, comme nous le montrerons plus loin. Inversement, l’absence de subordination n’est pas forcément synonyme d’une plus grande liberté. Dans la société féodale par exemple, les paysans n’étaient pas subordonnés dans leur activité quotidienne (la plupart travaillent les terres du seigneur sans contrôle opérationnel) mais ils étaient pourtant sous servage du seigneur et n’avaient donc pas le choix de leur condition.
De plus, la notion de subordination ne dit pas tout des attentes des individus en matière de liberté au travail. On peut ne pas être subordonné à une autorité hiérarchique mais dépendant économiquement dans son travail, comme nous l’avons évoqué dans la première partie au sujet des travailleurs indépendants. On peut aussi être subordonné à un supérieur mais décider soi-même des moyens à mettre en œuvre pour réaliser des objectifs assignés, ce qu’on peut qualifier de liberté opératoire.
La sécurité
Le travail a toujours été étroitement lié à l’idée même de sécurité. Chasser, cueillir et, des siècles plus tard, cultiver étaient des travaux dont l’objectif premier était de pouvoir se nourrir, c’est-à-dire d’assurer sa sécurité alimentaire vitale. À long terme, le travail est le seul moyen pour les individus de se nourrir, de se loger, de se soigner, etc. Mais si le travail est nécessaire pour être en sécurité, il n’est pas en soi suffisant, ce qui a nourri de nombreuses luttes sociales dans l’histoire afin d’améliorer les conditions de vie des travailleurs. L’assurance maladie, l’assurance chômage, les systèmes de solidarité pour la retraite… sont autant d’acquis pour la sécurité des individus construits à l’origine, et encore aujourd’hui pour certains, sur le travail ou plus exactement sur le salariat.
Aujourd’hui encore, nombre de débats sur le travail sont focalisés sur cette notion de sécurité. Les défenseurs du CDI par exemple, sont très virulents envers les autres formes d’emplois, comme le travail indépendant, du fait de l’absence d’un certain nombre de protections (stabilité du salaire, droit au chômage, indemnités journalières en cas de maladie…). De même, les manifestations contre le projet de loi El Khomri en France, en 2016, étaient motivées en partie par la crainte de voir la précarité des travailleurs augmenter du fait d’une flexibilisation du marché du travail.
La dignité
Les rapports au travail dépassent la volonté de se sentir libre et en sécurité. Ne cherche-t-on pas également à s’exprimer à travers son travail ? L’ergon (l’œuvre), pour les Grecs de l’antiquité, c’est aussi le travail qui permet à l’homme de s’incarner à travers celui-ci. Un artisan qui fabrique des souliers de grande qualité ne ne fait pas uniquement que produire des articles vestimentaires. Il y a fondamentalement dans son travail une dimension créative et même artistique qui lui permet de s’exprimer et de se perfectionner, de mettre une partie de sa personnalité dans le fruit de son travail. De même, ne peut-on pas considérer qu’un ouvrier chaudronnier qui fabrique les cuves de nos sous-marins ne travaille pas uniquement pour gagner sa vie mais aussi pour la noblesse que son travail lui apporte ? Les ouvrières d’un atelier de maroquinerie de luxe font fondamentalement un travail usant et répétitif. Mais leurs savoir-faire, leurs compétences, et la finalité de leur travail – un objet luxueux et recherché par les clients les plus exigeants – sont tels qu’elles peuvent tirer de leur travail une légitime fierté.
Le travail est aussi vecteur d’intégration et de lien social. Les entreprises sont des lieux collectifs, où nous sommes en permanence en lien avec d’autres individus tant dans le travail lui-même que de manière informelle. La machine à café et la cantine sont souvent d’ailleurs des lieux privilégiés de contact humain entre les travailleurs. Et, au-delà de ce lien social, le travail peut aussi correspondre à une véritable aventure collective. Les équipes ayant conçu le Concorde, par exemple, se sentent pour toujours les pères de ce « bel oiseau ».
On peut enfin travailler pour une cause qui nous est chère. Pour un médecin par exemple, soigner des gens et parfois sauver des vies va bien au-delà des notions de liberté et de sécurité qui nous décrivions plus haut. Le médecin travaille pour une cause porteuse de sens, la santé des autres. Ingénieurs, assistants sociaux, avocats, artisans, psychologues, enseignants, etc. sont autant de professions dans lesquelles les individus peuvent se sentir au service d’une mission qui a du sens. Travailler comme ingénieur en mécanique des fluides chez Space X, ce n’est pas simplement résoudre des équations, c’est œuvrer à son échelle à ce que l’humanité marche un jour sur Mars.
Un cadre d’analyse à trois dimensions
La liberté, la sécurité et la dignité sont donc trois dimensions structurantes de notre rapport au travail. C’est à partir de là que nous proposons un cadre d’analyse des attentes et besoins des travailleurs. Chacune des trois dimensions est subdivisée en plusieurs composantes correspondant à des attentes et besoins spécifiques. Cette subdivision est issue de notre perception des enjeux de chacune des trois composantes que nous avons identifiés au gré de nos rencontres, lectures et échanges dans le cadre de notre réflexion.
La notion de lien de subordination est définie par la Cour de cassation comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».
La dépendance économique caractérise le fait que son revenu dépende majoritairement d’un employeur ou d’un client.
L’autonomie opératoire désigne le fait d’être libre des moyens à utiliser pour réaliser ses objectifs (éventuellement définis par un supérieur).
La sécurité du revenu désigne la garantie d’un salaire stable et suffisant chaque mois.
L’assurance chômage ou l’assurance d’avoir un revenu en cas de perte d’emploi et de disposer d’un appui pour en retrouver un nouveau.
L’assurance maladie concerne non seulement la prise en charge des frais de santé mais aussi le maintien du salaire en cas de maladie. La couverture maladie étant devenue universelle, les frais de santé sont aujourd’hui pris en charge pour tous. Le sujet est plus complexe pour les indemnités journalières.
Le droit à une retraite désigne le droit à bénéficier d’un revenu décent au-delà d’un certain âge ou d’un certain nombre d’annuités de travail.
L’accès au logement désigne la facilité pour le travailleur de pouvoir louer ou acheter un logement.
Développer son potentiel et se former : pouvoir utiliser ses compétences dans son travail et les développer tout au long de sa vie grâce la formation notamment.
Participer à une aventure collective, c’est appartenir à un collectif travaillant pour le même objectif. Ce collectif est en particulier fortement créateur de lien social.
Être au service d’une mission porteuse de sens, c’est ressentir que son travail ne sert pas uniquement à engendrer un profit ou un bienfait personnels mais également à atteindre un objectif créateur de valeur sociétale et humaine.
À première vue, on pourrait penser que les individus cherchent à maximiser chacune des trois dimensions. Nous allons voir dans la section suivante que ce souhait naturel de maximisation est contraint par les attentes des employeurs. Auparavant, on peut déjà interroger l’idée selon laquelle tous les individus auraient des souhaits équivalents. Reprenons par exemple le cas des artistes. Les artistes ne cherchent pas coûte que coûte à maximiser leur qualité de vie matérielle par leur travail. Avant toutes choses, ils souhaitent exprimer leur art et leur créativité. Pour eux, la dimension de dignité est essentielle, davantage que pour d’autres actifs qui chercheront d’abord à maximiser l’une ou l’autre des deux autres dimensions. Le régime des intermittents du spectacle, par exemple, apporte une plus grande sécurité aux artistes, que certains recherchent. Mais, pour d’autres, ce régime contraint leur liberté en leur imposant des règles, entre autres concernant le nombre de missions minimales à effectuer dans l’année.
Autre exemple, autour de la notion de liberté cette fois. La recherche de plus d’indépendance n’est pas une priorité pour tous les travailleurs. Certains préfèrent avoir le sentiment rassurant de la subordination, qui fait porter une grande partie des responsabilités et de la prise d’initiative sur un chef. Ces employés ne souhaitant pas avoir une totale autonomie accordent donc une importance prioritaire à la sécurité, quitte à sacrifier une partie de leur liberté et même à renoncer à une part d’autonomie opératoire.
Tableau 1 : Exemple de catégorie de travailleur et de leurs attentes et besoins dans les trois dimensions de notre cadre d’analyse.
Les besoins des employeurs
Pour comprendre la complexité des rapports au travail et surtout cerner la nature des tensions qu’ils renferment, il nous faut prendre en compte l’autre acteur essentiel des relations de travail, à savoir l’employeur ou donneur d’ordre.
Les attentes des travailleurs sont contraintes par celles des employeurs, souvent dans un rapport de forces. L’assurance d’un salaire stable pour le travailleur, par exemple, implique que l’employeur lui garantisse une relation stable et durable, réduisant ainsi sa propre faculté à pouvoir s’en séparer facilement. De la même manière, un employeur peut vouloir fidéliser un travailleur, en particulier s’il possède des compétences critiques, ce qui nécessitera de construire une relation durable mais limitera certaines des libertés de ce dernier (par exemple celle de cumuler plusieurs emplois). Ainsi, la sécurité des travailleurs sera souvent acquise au détriment de la liberté des employeurs et la liberté des travailleurs aura pour réciproque une faible sécurité des employeurs par rapport au « risque de main-d’œuvre ». Travailleurs et employeurs ont des aspirations étroitement liées en ce qui concerne la troisième et dernière dimension de la dignité, puisque c’est en grande partie la nature de l’entreprise (sa culture, son modèle d’organisation et de gouvernance) qui conditionnera les possibilités pour les travailleurs d’exprimer leur potentiel, de se former, de participer à une aventure collective ou encore d’être au service d’une mission porteuse de sens.
Chaque employeur cherchera à maximiser les dimensions prioritaires à la bonne marche de son entreprise. Toute la difficulté sera alors de trouver un juste équilibre entre ces attentes et celles des travailleurs, qui sont par certains aspects contradictoires. Lorsque le rapport de force entre les attentes de l’entreprise et celles des travailleurs débouche sur un « équilibre » alors un nouveau « pacte » émerge et permet de répondre au mieux aux attentes des deux parties.
Parfois, au contraire, le rapport de forces s’ajoute aux précédentes dimensions et les attentes de l’un pouvant prendre le pas sur les aspirations de l’autre. Par exemple, une entreprise plateforme, pour qui l’essentiel est la flexibilité de sa main-d’œuvre, recrutera le moins possible de travailleurs en CDI. À l’inverse, une entreprise fortement capitalistique, pour qui la durée de vie du capital et la maximisation de son potentiel sont primordiales, aura intérêt à embaucher en CDI une grande partie des travailleurs afin de les fidéliser sur le long terme.
Les besoins de travailleurs et des employeurs étant liés, tout l’enjeu sera donc de construire des équilibres mutuellement satisfaisants entre ces différents besoins. Prendre préférentiellement en compte les besoins de l’un ou l’autre entraînera un déséquilibre source de tensions, entre travailleurs et entreprises mais également à l’intérieur même de ces deux groupes. Par exemple, dans un pays ne proposant qu’un salariat extrêmement contraignant face au licenciement, certaines entreprises ne pourront répondre correctement à leur besoin de flexibilité. Les employeurs non satisfaits, pour survivre à la concurrence mondiale, répondront à leurs besoins en délocalisant, en ayant recours à des travailleurs détachés ou en détournant de leur utilité d’origine des régimes de travail (multiplication des contrats précaires), etc. Ce même cadre contraignant pourrait d’ailleurs mécontenter aussi certains travailleurs souhaitant travailler de manière différente, par exemple des entrepreneurs individuels qui préféreraient s’exiler. À l’inverse, un pays qui prendrait exclusivement en compte le besoin de flexibilité serait condamné à mécontenter les travailleurs pour qui la sécurité est essentielle et même les entreprises ayant besoin de construire des relations de travail sur le long terme.
Une perspective historique sur la naissance d’un équilibre
Nous allons montrer ici, comment, dans le passé et plus particulièrement à l’époque fordiste31, nos sociétés occidentales ont été capables de construire des organisations du travail équilibrées. Pour cela, nous décrirons dans un premier temps les besoins des travailleurs de cette époque. Dans un deuxième temps, nous ferons de même pour les besoins des entreprises. Enfin, nous montrerons comment la prise en compte des besoins de chacune des parties a permis à cette époque de construire un équilibre autour d’une bipolarité entre salariat et travail indépendant.
Les besoins des travailleurs à l’époque fordiste
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la grande majorité des travailleurs vivait dans une grande précarité. Les individus qui ne possédaient aucun capital, c’est-à-dire l’immense majorité de la population en l’absence de classe moyenne, n’avaient pratiquement rien pour se protéger en cas de besoin et vivaient donc dans une grande insécurité sociale. Ces individus sans capital ou « sans situation » se retrouvaient bien souvent en très grande fragilité en cas de maladie, ou lorsqu’ils n’étaient plus en âge de travailler. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, une partie de la population occupait une situation sociale bien définie et intégrée aux régulations du travail de l’époque, par exemple les agriculteurs propriétaires, les compagnons, les maîtres artisans… et tous les ouvriers qui travaillent dans les corporations de métiers. Mais une autre frange de la population se trouvait en marge de la société, en dehors des cadres typiques des formes de travail de l’époque (compagnonnage, corporations de métiers régulés, etc.). Pour survivre, cette frange de « désaffiliés », comme les nomme le sociologue Robert Castel32, est contrainte de vendre au plus offrant la force de ses bras, en dehors de tout droit du travail. Il s’agit en effet à cette époque de contrats commerciaux de gré à gré, sans protection juridique particulière, pouvant être rompus à n’importe quel moment, où le travailleur échange littéralement ses heures de travail contre une rémunération à travers ce qu’on qualifiait le « droit de louage ». Cette insécurité sociale est d’ailleurs renforcée par l’idéologie politique de l’époque, notamment suite à la Révolution de 1789 : après des siècles de servitude des travailleurs du tiers-état dans la société de l’Ancien Régime, on considère le travailleur louant sa force de travail comme une indignité totale, un « vil état », qu’il ne convient pas de soutenir, qu’il faut même réprimer. Cette population de désaffiliés contraints est donc complètement laissée pour compte par les pouvoirs publics. Bien sûr, il n’existe pas à cette époque de protection sociale à proprement parler (c’est-à-dire assurée de manière collective) face au chômage, à la maladie, ou à la retraite. C’est donc uniquement l’appartenance à une catégorie de travailleur qui permet ou non d’être protégé face aux risques de la vie.
Ainsi, à l’aube de l’époque fordiste, la société est structurée en trois grandes catégories de travailleurs : d’un côté ceux qui détiennent un capital, même modeste, et qui peuvent donc vivre de leur propre activité (les agriculteurs et les artisans par exemple), les travailleurs sans capital, mais qui sont intégrés aux corps de métiers régulés (les compagnons, dont la finalité théorique et de pouvoir devenir un jour eux-mêmes artisans, et certains ouvriers), et les « désaffiliés » qui n’ont d’autre choix que de travailler pour autrui en dehors de tout cadre juridique et sans aucune protection.
On peut placer ces catégories de travailleurs dans le cadre introduit à la section précédente.
Tableau 2 : Les catégories de travailleurs avant la société fordiste.
Les « travailleurs indépendants », ceux de la première catégorie, jouissent d’une grande liberté puisqu’ils sont leur propre patron. Même si aucun filet de sécurité n’existe pour eux face aux risques de la vie, la possession d’un capital constitue une sécurité minimale qui peut notamment servir de rente en fin de vie. Leur travail leur apporte également une importante dignité, particulièrement du fait de l’expression et du développement de leurs talents à travers leur œuvre et parfois même la création d’une aventure collective lorsque ces derniers ne sont pas seuls dans leur activité.
Les travailleurs sans capital mais intégrés aux systèmes de travail régulés de l’époque sont parfois subordonnés, mais toujours très autonomes dans la réalisation de leur travail. En l’absence de système de protection sociale collectif, ils ne sont pas véritablement protégés face aux risques de la vie, mais un salaire stable garanti par l’appartenance à une corporation de métier leur apporte néanmoins une sécurité non négligeable (surtout par rapport à ceux de la troisième catégorie). La finalité théorique du compagnonnage étant de devenir soi-même artisan, le développement de leur potentiel et la formation font partie intégrante du rapport au travail de ces travailleurs, même si tous n’atteignent pas cet objectif. Par ailleurs, les corporations de métiers, dont l’entrée est régulée et qui constituent une situation envieuse, représentent souvent des aventures collectives créatrices d’esprit de corps pour ceux qui en font partie.
Les « désaffiliés » qui louent leur force de travail ne sont théoriquement pas subordonnés à leurs employeurs, mais vivent dans une grande dépendance économique vis-à-vis de ces derniers. Leur condition est marquée par une grande insécurité sociale : ils n’appartiennent à aucune corporation de métier et la succession de travaux en louage, souvent de courte durée, n’assure pas un revenu stable. De plus, rien n’est fait pour protéger ces populations pourtant fragiles et démunies face aux aléas de la vie. Leur condition est la plus indigne qui soit à cette époque.
Les besoins des entreprises à l’époque fordiste
L’époque fordiste est marquée par la naissance de « l’entreprise », le mot ne commençant à être utilisé dans son sens moderne qu’à la toute fin du XIXe siècle. Auparavant, dans les « entreprises » traditionnelles, par exemple dans les grandes manufactures des XVIIe et XVIIIe siècles, les ouvriers, apprentis, et compagnons réalisent des tâches parfaitement répertoriées. L’objectif de ces grandes manufactures est en effet le plus souvent de fabriquer en grande quantité certains produits pour fournir une demande de plus en plus importante en Europe. Aussi, les processus de fabrication requièrent des travailleurs dont le métier est parfaitement connu, et il est possible de laisser à ces derniers une grande autonomie opératoire.
Les deux révolutions industrielles du XIXe siècle ont fait entrer les entreprises dans l’ère du machinisme. Désormais, les processus productifs deviennent de plus en plus complexes et font intervenir des machines de plus en plus sophistiquées. Aussi, les compétences requises des travailleurs changent et demandent souvent un temps de formation. De plus, les processus de production vont impliquer une plus grande coopération entre les travailleurs. Alors que les grandes manufactures du XVIIe siècle faisaient souvent intervenir un seul corps de métier, l’entreprise moderne signe le début d’une grande multidisciplinarité, notamment lors des grands projets complexes (d’où d’ailleurs en France l’émergence de l’ingénieur généraliste « intégrateur »). Plus fondamentalement encore, l’entreprise devient un lieu d’innovation et de création collective. Le produit n’est plus connu à l’avance mais procède d’un processus d’innovation faisant intervenir les travailleurs eux-mêmes. Se faisant, les compétences et les métiers évoluent également au cours du temps et les savoir-faire deviennent régulièrement obsolètes au fur et à mesure de ruptures technologiques. Il faut donc régulièrement assurer un renouvellement des méthodes et des savoir-faire, voire des métiers eux-mêmes.
Les entreprises qui se constituent alors ne vont plus pouvoir se satisfaire de travailleurs autonomes. L’interdisciplinarité, l’obsolescence et le renouvellement des compétences, le travail collaboratif, la complexité des machines, et plus encore le processus d’innovation collectif vont obliger les entreprises à former elles-mêmes les travailleurs pour être certaines de leurs qualifications. Les employeurs de l’époque souhaiteront désormais fidéliser les travailleurs sur le long terme, pour capitaliser sur cet investissement en formation et ne pas laisser les compétences s’échapper chez les concurrents.
La création d’une répartition bipolaire
Les entreprises de l’époque fordiste vont donc contribuer à façonner une organisation du travail adaptée à leurs nouveaux besoins en matière de sécurité. La nécessité de former les travailleurs, de leur imposer l’utilisation de telle machine ou telle manière de travailler, va nécessairement conduire à les subordonner et à les priver de leur marge d’initiative dans le processus de production. Mais comment faire accepter une telle subordination, alors que l’esprit de la Révolution française pousse encore à considérer que toutes les formes de sujétion sont comparables au servage d’ancien régime, et qu’il faut leur préférer à tout prix des relations contractuelles libres entre individus égaux ? Comme nous l’avons vu plus haut, les travailleurs souhaitent pour leur part renforcer la sécurité que leur apporte leur travail.
Le pacte qui va alors être rendu possible, et qui va voir naître le contrat de travail, va consister pour le travailleur à « sacrifier » une partie de sa liberté, en acceptant la subordination et en renonçant en particulier à avoir son mot à dire dans le processus de production (autrement dit, une faible autonomie opératoire), en échange d’une plus grande sécurité. Son salaire devient stable et croissant au cours du temps, ce qui lui permet d’accéder au logement et même parfois à la propriété. De plus, le travailleur et désormais couvert contre les risques de la vie, d’abord au travers de caisses d’entreprise puis progressivement, au cours du XXe siècle, par une prise en charge nationale dont l’État est le garant. Son nouveau statut lui ouvre droit à des protections sociales complètes, pour contrebalancer la liberté qu’il a perdue. De plus, dans la plupart des cas, le travailleur ne rentre plus dans l’entreprise pour seulement y exercer un travail mais pour y faire carrière. Il va pouvoir développer son potentiel et se former tout au long de celle-ci, car l’entreprise en a elle-même besoin. Pour une frange privilégiée, mais significative à l’époque de l’essor industriel des Trente Glorieuses, le travailleur fait en outre réellement partie d’une aventure collective, son travail fait partie d’un processus d’innovation faisant intervenir des centaines voire des milliers d’autres travailleurs. Pour les entreprises, ce même pacte consiste à garantir aux travailleurs une grande stabilité de salaire, à fournir ou à contribuer aux protections face aux risques de la vie (par des caisses d’entreprises précitées puis par le biais de cotisations patronales) et à proposer aux salariés une carrière sur le long terme. En échange de quoi l’entreprise se sécurise par rapport au risque de disponibilité de la main-d’œuvre et à la conservation des compétences, par le biais de la subordination.
Tableau 3 : Système bipolaire entre indépendants et salariés caractéristique de l’époque fordiste.
Ce pacte entérine une nouvelle forme de travail, le salariat, qui va progressivement s’étendre à presque toute la société au cours du XXe siècle. Le contrat de travail, qui naît à travers ce pacte, consacre une relation de travail qui assume de manière pragmatique une forme de subordination des travailleurs et qui voit dans celle-ci non pas une régression mais bien un compromis « gagnant-gagnant » répondant aux besoins des travailleurs et des employeurs pour plus de sécurité réciproque.
C’est bien la prise en compte des attentes des deux parties qui a rendu possible la construction d’une relation de travail équilibrée. Bien sûr, tous les travailleurs n’ont pas souhaité renoncer à une partie de leur liberté en échange d’une plus grande sécurité : la catégorie des travailleurs indépendants va donc constituer l’autre forme de travail typique de l’époque fordiste. Les rapports au travail de l’époque fordiste – et durant tout le XXe siècle – se sont structurés autour de cette bipolarité entre salariés et indépendants.
Figure 8 : Parts des salariés et des indépendants dans l’emploi total en France entre 1850 et 1998 .
Source : Olivier Marchand [1998] « Salariat et non-salariat dans une perspective historique »
Progressivement, le salariat s’impose dans une majorité de professions. Dans les années 1870, le salariat concerne 50 % de l’emploi total (cf. figure 8). En 2015, 89,7 % des travailleurs sont salariés33. Au début de l’époque fordiste, le salariat n’était destiné en effet qu’aux franges les plus fragiles de la population, à commencer par les ouvriers peu qualifiés et précaires, qui jusqu’alors louaient leurs services en dehors de tout contrat de travail. Mais, progressivement, l’attractivité des protections sociales adossées au salariat va motiver de plus en plus de professions intermédiaires et supérieures. En 1936, par exemple les ingénieurs constituent une des premières professions aisées à se revendiquer comme salariés. Le 13 juin 1936 est d’ailleurs créé le Syndicat des ingénieurs salariés. Les salariés non ouvriers sont 2,7 millions en 1937 contre près de 8 millions dans les années 198034.
- 31 – Epoque ayant théoriquement débuté en 1908 avec la mise au point par Henry Ford du modèle d’organisation et de développement d’entreprise qui porte son nom, mais que l’on peut faire remonter à la deuxième révolution industrielle des années 1870-1880, le « fordisme » étant l’aboutissement de changements dans les rapports au travail (chaîne de production, subordination, etc.) ayant démarré des décennies plus tôt.
- 32 – Pour Robert Castel, la notion de désaffiliation renvoie au décrochage d’une partie de la population par rapport aux régulations typiques des rapports au travail d’une époque à travers lesquelles la vie sociale se reproduit et se reconduit.
- 33 – Enquête Emploi 2015 de l’INSEE.
- 34 – R. Castel, « Les métamorphoses de la question sociale », p. 597 (édition Folio Essai).
Vers un éclatement de la répartition bipolaire traditionnelle
Cette répartition bipolaire entre salariés et indépendants a perduré pendant tout le XXe siècle. Aujourd’hui encore, notre compréhension des rapports au travail repose sur cette bipolarité fordiste. Le salariat, en particulier, est devenu une quasi-norme. Pourtant, nous avons montré dans la première partie de cet ouvrage que des changements culturels et économiques étaient manifestement à l’œuvre. Les entreprises veulent plus de liberté et de flexibilité et les travailleurs eux-mêmes appellent parfois à plus d’indépendance et d’autonomie, ou y accèdent au prix d’une précarité certaine. Nous allons, dans cette section, expliquer les mutations en cours au prisme de notre cadre d’analyse.
Les besoins des travailleurs aujourd’hui
La priorité, pour une majorité croissante de travailleurs, a donc été jusqu’à présent d’assurer leur sécurité par le travail : avoir un salaire stable et se prémunir contre les risques de la vie (maladie, vieillesse, chômage). Mais comme nous l’évoquions dans la première partie, les attentes des travailleurs évoluent. Tout du moins, le positionnement spécifique du rapport au travail salarié, sur les trois dimensions de notre cadre d’analyse, ne semble plus toujours satisfaisant. La sécurité, objectif prépondérant, s’acquiert en quelque sorte au détriment des deux autres, à savoir la liberté et parfois la dignité, et certains travailleurs veulent aujourd’hui retrouver une forme d’autonomie qui a en partie été perdue dans le salariat fordiste.
Les besoins des employeurs aujourd’hui
Alors que la nécessité d’innovation de l’époque fordiste avait motivé l’embauche et la fidélisation de travailleurs sur le long terme, afin en particulier de les former, les entreprises évoquent régulièrement un besoin de souplesse, en mettant en avant, selon les cas, le besoin d’adaptation aux plans de charge de plus en plus cycliques, le coût du travail, le risque de désajustement à l’embauche, l’accélération des cycles technologiques qui exige de prendre des risques entrepreneuriaux et de pouvoir se séparer des équipes si les projets innovants échouent… Ce besoin de plus de flexibilité s’entrevoit à l’intérieur du salariat, les entreprises ayant de plus en plus recours au temps partiel et au CDD courts. Elles mettent en particulier en avant la difficulté à pouvoir se séparer d’un travailleur en CDI, ou le coût que cela représente, alors que l’époque actuelle les obligerait à faire preuve d’une grande agilité.
Vers un éclatement du compromis fordiste
Entre les deux formes historiques que sont les indépendants et les salariés, ont émergé deux nouvelles catégories de travailleurs.
À côté des salariés « traditionnels », se développe depuis maintenant une vingtaine d’années une nouvelle frange de travailleurs que l’on pourrait qualifier de salariés précaires. Il s’agit des travailleurs en CDD, en intérim, à temps partiel, et des pluriactifs (salariés ou non). Ils ont tous ont le même statut que les salariés en CDI « traditionnel » et pourtant la réalité de leur condition est complètement différente. La succession de contrats courts ou à temps partiel rend leur salaire mensuel très incertain. Cette incertitude complique leur accès au logement. En tant que travailleurs de « court terme » dans l’entreprise, ils sont beaucoup moins intégrés à l’aventure collective voire en sont exclus. L’entreprise ne s’occupe pas non plus de les former ni de développer leur potentiel, puisqu’ils ne sont pas destinés à y rester. Ainsi cette catégorie de travailleurs se caractérise par un rapport au travail dont les dimensions « sécurité » et « dignité » sont réduites alors que leur subordination et leur faible autonomie opératoire sont toujours aussi fortes que chez les salariés traditionnels.
Les travailleurs parasubordonnés forment une autre catégorie (déjà décrite). Ces travailleurs ne sont pas salariés, comme les « vrais » indépendants, ils disposent d’une grande autonomie opératoire et ne sont pas subordonnés. Mais ils sont fortement liés à un donneur d’ordre principal et, plus généralement, sont dans les faits économiquement dépendants. De plus en plus, ils recourent au régime d’auto-entrepreneur, initialement destiné à favoriser la création d’entreprise. Il arrive même que la non-subordination et l’autonomie opératoire ne soient que toutes relatives, la dépendance économique constituant un moyen de pression des employeurs pour imposer certaines règles aux travailleurs. Les chauffeurs à vélo par exemple, qui dépendent d’une ou deux plateformes pour vivre, doivent utiliser les accessoires fournis par ces dernières afin de mettre en avant la « marque » de l’entreprise (à laquelle ils n’appartiennent pas, par définition), et ils ne choisissent pas eux-mêmes le prix de leur course. Par ailleurs, ces travailleurs sont souvent isolés dans leur travail et ne participent à aucune aventure collective. Et, comme les « vrais » indépendants, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes, notamment pour se former et gagner leur salaire, et n’ont aucune protection contre les risques de la vie pour contrebalancer leur dépendance économique.
La première conséquence de cet éclatement est de rendre les statuts hérités de l’époque fordiste insuffisants à décrire la réalité des travailleurs. Salariés précaires et salariés fordistes ont le même statut ; pourtant, nous avons montré à quel point leurs conditions étaient très différentes. De même, il y a bien peu en commun entre les « vrais » indépendants, souvent détenteurs d’un capital et d’un savoir-faire qu’ils savent valoriser, et les indépendants économiquement dépendants.
En réalité, les salariés précaires et les parasubordonnés sont plus proches l’une de l’autre dans notre cadre d’analyse qu’elles ne le sont de leur catégorie « originelle ». Autrement dit, il est apparu entre les « vrais » indépendants et les « vrais » salariés une sorte de continuum, que l’on peut voir comme le fruit des efforts des travailleurs ayant soif d’indépendance et des entreprises ressentant un besoin accru de flexibilité, face à des statuts juridiques semblant de plus en plus inadaptés.
Tableau 4 : L’éclatement de la bipolarité des rapports au travail hérité de l’époque fordiste abouti à la création de deux nouvelles catégories de travailleurs.
Ces deux nouvelles catégories de travail répondent de manière très déséquilibrée aux attentes des travailleurs. Le gain de liberté chez les parasubordonnés se fait au détriment de la sécurité et même parfois de la dignité. Les salariés précaires, eux, paient le besoin des entreprises d’une plus grande flexibilité par une perte de sécurité, sans aucune nouvelle liberté en contrepartie, à l’exception de quelques-uns qui ont la faculté de gérer leur statut sans être exposés à une réelle précarité (les sublimes que nous avons déjà évoqués).
Ces nouvelles catégories de travail sont pourtant nées pour répondre à des besoins nouveaux. Il serait néfaste de ne pas voir ou, pire, de refuser les changements culturels qu’elles révèlent et les tentatives – certes parfois injustes et précaires – qu’elles constituent de redéfinir les rapports au travail au XXIe siècle. Il est clair aujourd’hui que le compromis fordiste auquel nous étions habitués est en train de disparaître. Ce n’est pas une mauvaise nouvelle en soi. En revanche, l’inadaptation de ce compromis aux besoins nouveaux de notre époque en est une.
Ainsi, l’important va être de consolider, de rééquilibrer ou de construire des relations de travail qui répondent aux besoins de chacune des parties, de manière équitable.
Partie 3 – À la recherche de nouveaux équilibres
Les débats sur les formes de travail illustrent souvent une opposition frontale entre les défenseurs des intérêts des entreprises et des travailleurs. Les premiers estiment que le manque de flexibilité freine la création d’activité dans un contexte de compétition internationale. Les seconds, défenseurs des droits des travailleurs, dénoncent une précarisation croissante. Chacun avance ses arguments, pour beaucoup légitimes, mais la recherche du consensus, indispensable à la construction de relations de travail équilibrées, est longue, complexe et imparfaite.
Nous pensons que les attentes des travailleurs comme des entreprises peuvent toujours guider l’action publique, comme lorsqu’ont été construits le CDI et la bipolarité fordiste entre salariés et indépendants. Notre objectif n’est pas de prendre parti pour telle ou telle orientation politique. L’objet de notre thèse est justement de démontrer que l’examen systématique des équilibres entre sécurité, liberté et dignité peut faire évoluer efficacement nos rapports au travail. Nous parlons bien d’équilibres au pluriel, chacun devant rester libre d’adopter le rapport au travail qui lui convient le mieux, au sein d’une organisation qui lui corresponde, selon les aspirations qui lui sont propres.
Pour construire ces équilibres nouveaux, nous allons proposer une méthode sous forme de réformes « horizontales » et « verticales ». Dans une réforme horizontale, l’objectif est de travailler catégorie par catégorie de travailleurs : soit en créant de nouveaux statuts, soit en modifiant des formes de travail ou des statuts existants, soit encore en s’inspirant de nouveaux modèles d’entreprises. Une autre voie consiste à universaliser certaines protections, indépendamment du rapport entre employeur35 et employé. Ce sont les réformes verticales. La charge de cette protection peut ainsi être confiée à un tiers, par exemple l’État, mais pas nécessairement. Apporter plus de sécurité à tous les travailleurs, quel que soit leur statut, permet de sortir des oppositions difficilement conciliables entre travailleurs et employeurs. L’universalisation de la couverture maladie en est un exemple. Tout travailleur – et même toute personne résidant en France – bénéficie aujourd’hui d’une telle protection. Néanmoins, le maintien d’indemnités journalières en cas de maladie couvre les salariés et demeure moindre et plus complexe pour les indépendants.
Cette dernière partie sera structurée comme suit. Dans un premier temps nous montrerons qu’une comparaison européenne peut constituer une source d’inspiration très riche pour rééquilibrer notre système de rapports au travail, l’éclatement des équilibres fordistes ayant eu lieu pratiquement dans tous les pays. Puis, dans un second temps, nous montrerons plus précisément comment notre cadre d’analyse peut constituer une aide pour les décideurs publics. Pour cela, nous donnerons quelques exemples de pistes d’actions qui nous semblent pertinentes.
- 35 – Nous utiliserons dans ce chapitre le terme « employeur » pour qualifier l’entité qui fait appel à un travailleur, que ce soit en l’employant directement ou en faisant appel à lui par le bais d’une prestation.
Comparaisons européennes
Nous avons choisi de travailler sur un panel de cinq pays : l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni. Le choix de ces cinq pays vise à couvrir des situations différentes en matière de marché et de culture du travail.
L’Italie et l’Espagne, tout comme la France, ont un marché du travail très codifié et réglementé, dans lesquels les rapports travailleurs-employeurs sont largement encadrés par la loi et le règlement. Historiquement, ces pays se caractérisent par un droit du travail contraignant face au licenciement, même si les réformes du marché du travail de ces dernières années changent quelque peu la donne (Job Act en Italie voté en 2014 et les lois de 2010, 2011 et 2012 en Espagne).
L’Allemagne et le Danemark sont des pays où la négociation collective, dans les branches et dans l’entreprise, prime pour définir les rapports de travail. Le droit du travail ne fixe que les règles essentielles. L’État n’est là qu’en dernier recours en cas de conflit. Le Danemark (et l’Allemagne dans une moindre mesure) est par ailleurs le symbole de la fléxisécurité : licenciement relativement simple si nécessaire pour l’entreprise, grande sécurité contre le chômage (indemnités généreuses) et forte incitation à la reprise d’activité (formation continue très performante, mais baisse des indemnités en cas de refus répétés de propositions d’emploi).
Le Royaume-Uni est l’archétype du marché du travail libéralisé. Même s’il existe des contrats de travail classiques, les rapports travailleurs-employeurs sont laissés au bon vouloir des parties à travers le droit des contrats. D’ailleurs, il suffit d’un accord verbal entre les parties pour travailler. Le licenciement y est extrêmement simple et les indemnités chômage très faibles.
L’éclatement de la bipolarité fordiste en Europe
La première question à laquelle nous tâchons de répondre concerne l’éclatement de la bipolarité fordiste, que nous avons décrite pour le cas français. Cet éclatement est-il également visible dans les quatre autres pays de notre panel ? Retrouve-t-on les deux mêmes nouvelles catégories de travailleurs qu’en France ? Nous allons montrer que c’est le cas, à l’exception du Danemark qui a fait le choix de réformer en profondeur les catégories historiques pour les adapter aux besoins d’aujourd’hui. La structure des rapports au travail dans les cinq pays de notre panel est présentée dans le tableau 5.
Tableau 5 : Les structures des rapports au travail dans notre panel européen.
* : Le CDI de chantier a vocation à s’arrêter au terme de la mission pour laquelle le salarié est engagé. Le gouvernement d’Edouard Philippe en France souhaite aujourd’hui étendre ce type de contrat de « projet » à d’autres secteurs que le BTP.
** : Relation contractuelle entre travailleurs et apporteur de travail. Nous présentons dans le tableau les contrats les plus courants. Le statut des travailleurs au Royaume-Uni est uniquement jurisprudentiel puisque qu’il n’existe de pas de code du travail à proprement parlé. Aussi, très souvent, le travailleur ne connait même pas son « statut » (employed, worker, ou self-employed).
*** : Sauf en cas de licenciement pour « raisons économiques » si le travailleur a plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise
Le salariat « précaire »
Nous avons montré dans la partie 2 que la première tentative des entreprises en France pour gagner en liberté et en flexibilité a été le recours croissant à des contrats de travail salariés « précaires », comme les contrats temporaires et les contrats à temps partiel. Comme le montre le tableau 5, dans tous les pays étudiés, cette catégorie du salariat « précaire » a pris une place considérable : CDD, intérim, temps partiel, mini job, contrat zéro heure, etc. Ces contrats ont progressé à partir des années 1980 (cf. figures 9 et 10) à l’exception du Danemark, ce que nous expliquerons plus loin. La part moyenne en Europe des travailleurs temporaires (CDD) est passée de 8,2 % en 1983 à 14,2 % en 2015 et celle des travailleurs à temps partiel de 12,8 % à 17,2 % sur la même période.
Figure 9 : Évolution de la part des travailleurs temporaires (CDD) dans les six pays de notre panel et dans l’UE entre 1980 et 2015 (en % de l’emploi total).
Source : OCDE.
En Italie et en France, où le CDI fordiste est protecteur, le travail temporaire a augmenté dans des proportions impressionnantes. Entre 1984 et 2015, cette proportion est passée de 3,3 % à 16,7 % en France et de 5 % à 14 % en Italie. Il en va de même du travail à temps partiel. En Italie sa proportion dans l’emploi total est passée 8 % à 18,5 % dans la même période. En Espagne, la part des contrats temporaires a diminué lors de la crise de 2008, mais elle avait explosé au début des années 1990 en atteignant 33,5 % en 1993, et repart d’ailleurs aujourd’hui à la hausse à 25 % en 2015. Le Royaume-Uni a un faible taux de travail temporaire, mais au prix d’un travail à temps partiel surdéveloppé, avec presque 25 % en 2015 du fait notamment des contrats zéro heure.
Le Danemark se détache de ces tendances communes avec un taux de CDD à moins de 10 %. Certes, le travail à temps partiel y est extrêmement développé (20 % en 2015), mais de nombreuses études (ministère danois du Travail, Eurofound) montrent que le temps partiel serait choisi dans la grande majorité des cas, reflétant un équilibre entre travail et vie de famille. Comme nous le verrons plus loin, le Danemark est un cas à part. Il a su garder une forme de bipolarité entre CDI et travail indépendant, en initiant une refondation complète du pacte du salariat et du CDI en particulier. C’est ce qu’on a souvent appelé la « fléxisécurité » danoise, lancée à partir de 1999.
Figure 10 : Évolution de la part des travailleurs à temps partiel dans les six pays de notre panel et dans l’UE entre 1980 et 2015 (en % de l’emploi total).
Source : OCDE.
Quoi qu’il en soit, le cas particulier du Danemark étant mis à part, nous assistons bien dans tous les autres pays européens au même phénomène d’éclatement du système fordiste et à l’irruption de cette catégorie de plus en plus importante de salariés précaires.
Les indépendants économiquement dépendants
La catégorie de travailleur économiquement dépendant n’a pas de définition juridique identique dans tous les pays d’Europe : en France, ils ont le même statut que les indépendants, alors qu’en Italie et en Espagne par exemple, il s’agit d’une catégorie juridique à part, mais dont les conditions d’appartenance sont différentes. Nous avons donc une difficulté méthodologique pour établir des comparaisons. La solution que nous avons choisie est de travailler avec la catégorie statistique de l’OCDE des « indépendants sans employé », catégorie commune la plus proche des travailleurs économiquement dépendants (une partie des « vrais » indépendants ayant parfois des employés) et qui a le mérite de comparer la même grandeur dans tous les pays d’Europe (mais depuis 2008 uniquement).
Il est aujourd’hui bien difficile de dessiner une tendance nette concernant cette catégorie de travailleurs en Europe. À l’échelle de l’Europe, les indépendants sans employé ont stagné dans la dernière décennie. Entre 2008 et 2015, leur part dans l’emploi total est restée quasiment fixe, autour de 10 %. Néanmoins, la tendance est nettement orientée à la hausse en France, en Espagne, et au Royaume-Uni : la part des indépendants sans employé est passée entre 2008 et 2015 de 5,2 % à 6,7 % en France, de 10 % à 11,6 % en Espagne et de 10,1 % à 11,4 % au Royaume-Uni.
En Italie, cette part diminue très légèrement depuis 2008, mais il faut noter que son niveau absolu est très élevé, avec plus de 15 % de travailleurs indépendants sans employé en 2015. En Allemagne et au Danemark, cette part est en stagnation voire en légère baisse, mais surtout à des niveaux absolus extrêmement bas. En 2015, les indépendants sans employé ne concernent que 4,5 % des travailleurs au Danemark. Nous montrerons plus loin que ce niveau très bas est une conséquence de la fléxisécurité danoise.
Figure 11 : Évolution de la part des travailleurs indépendants sans employé dans les six pays de notre panel et dans l’UE entre 1980 et 2015 (en % de l’emploi total).
Source : OCDE.
Néanmoins, si les tendances statistiques ne sont pas toujours très marquées, la catégorie des indépendants économiquement dépendants a une place importante d’un point de vue juridique. Le tableau 5 montre en effet que, à l’exception du Danemark et de la France dans une moindre mesure, tous les pays de notre panel ont reconnu juridiquement cette catégorie de travailleurs. En France, cette catégorie existe mais, dans les autres pays de notre panel, il existe un contrat de travail spécifique pour cette forme de travail dont les prémisses ont parfois plus de 50 ans :
- Collaborazione coordinata e continuativa en Italie (depuis 1997 et réformé en 2014).
- Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes, en Espagne (depuis 2007).
- Arbeitnehmerähnliche Personen en Allemagne (qui existe de puis le début des années 1960 et que des lois successives ont régulièrement agrémenté de nouvelles protections).
- Workers au Royaume-Uni (depuis 1998).
La définition de ces travailleurs varie d’un pays à un autre, illustrant les nombreuses interrogations que pose encore ce rapport au travail. Pour donner un exemple, pour être reconnu comme dépendant économique, il faut en Espagne avoir un chiffre d’affaires venant à plus de 75 % du même donneur d’ordre. En Allemagne, la définition est beaucoup plus floue et repose sur un faisceau d’indices.
Tous ces pays ont donc considéré que la création d’une catégorie intermédiaire, entre salariés et indépendants, était nécessaire, attestant de l’éclatement de la bipolarité traditionnelle, héritée de l’époque fordiste.
Des stratégies différentes
Nous venons de voir que la progression du salariat précaire et des dépendants économiques était commune à la totalité des pays de notre panel, à l’exception du Danemark. Dans cette section nous allons voir comment les différents pays ont réagi pour reconstruire des rapports au travail équilibrés, répondant aux besoins des travailleurs et des employeurs.
Espagne, Italie et Allemagne : un système tripartite
L’Espagne, l’Italie et l’Allemagne ont donc créé un statut juridique pour la catégorie des indépendants économiquement dépendants. Ces pays ont acté l’éclatement de la bipolarité fordiste et ont fait le choix de le remplacer par un système tripartite. Néanmoins, un tel système tripartite ne sait pas répondre à la forte augmentation du nombre de salariés précaires depuis trente ans.
Les parasubordonnés jouissent d’une plus grande autonomie opératoire que les salariés mais, contrairement aux « vrais » indépendants, ils sont économiquement dépendants. Nous avons montré que cette catégorie de travailleurs était marquée par un manque de sécurité face à leur dépendance économique. L’objectif d’un système tripartite est de proposer une forme de travail plus équilibrée pour les parasubordonnés, en y intégrant des protections adaptées. Le tableau 6 résume les sécurités apportées aux dépendants économiques pour ces trois pays.
Tableau 6 : Protections des parasubordonnés dans les trois pays ayant adopté un système des rapports au travail tripartite.
À partir de ces sécurités spécifiques, on peut comparer le positionnement des indépendants économiquement dépendants selon les pays (tableau 7).
Tableau 7 : Comparaison de la condition des parasubordonnés en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne.
Le Danemark : le choix de la fléxisécurité
Le Danemark constitue un cas à part dans le paysage européen. Les deux catégories de travailleurs que sont les salariés précaires (temps partiel mis à part) et les indépendants économiquement dépendants y sont largement moins présents que dans les autres pays européens. Il n’existe pas au Danemark de contrat de travail spécifique ou adapté aux parasubordonnés. Ainsi, les deux catégories traditionnelles, salariés et indépendants, résistent.
Néanmoins, il ne faut pas voir cette constance comme une survivance du passé. La bipolarité actuelle au Danemark n’a plus rien à voir avec celle de l’époque fordiste. En effet, si de nouvelles formes de rapport au travail ne se sont pas développées au Danemark, c’est parce que la nécessité de trouver des contrats de travail plus libres et plus flexibles que le CDI ne s’est pas faite sentir. Le CDI danois n’a aucun rapport avec le CDI français. Les indemnités de licenciement sont faibles, voire inexistantes , et les motifs de licenciement sont beaucoup plus souples (licenciement pour raisons économiques notamment).
En réalité, le Danemark a réussi à construire un nouveau pacte entre les travailleurs et les entreprises. Il a remplacé le pacte fordiste par un autre, que l’on a souvent nommé la « fléxisécurité », et qui permet de favoriser une mobilité source de dynamisme, de renforcer non pas la sécurité de l’emploi mais l’employabilité des individus, tout en offrant aux individus concernés un haut niveau de protection. Cette fléxisécurité peut être résumée comme suit :
- Licenciement très simple pour les entreprises.
- Dialogue social fort entre patronat et syndicats, eux-mêmes très développés.
- Prise en charge des salariés par l’État en cas de chômage dans des conditions extrêmement avantageuses.
- Forte incitation à reprendre un emploi pour le chômeur (obligations de formation, suivi, sanctions financières, etc.).
Autrement dit, au Danemark, les besoins nouveaux des entreprises (flexibilité) et des travailleurs (responsabilité, autonomie), ont été satisfaits à partir des années 1990, via une refondation du CDI fordiste pour en faire un contrat de travail adapté à l’époque actuelle. Ainsi, le pays a su garder une structure bipolaire, entre salariat et travail indépendant, et se passer de nouvelles formes juridiques de travail.
Notons enfin que la réforme du Job Act italien en 2014 a pour objectif d’aller dans le sens d’une flexibilisation à la danoise. En particulier, un nouveau CDI à droits progressifs, le contrat a tutele crescenti est en train d’être mis en place, dans le but de remplacer à terme le CDI classique. Ce CDI permet aux entreprises de licencier plus facilement dans les premiers mois et années du contrat et de donner aux salariés des droits croissants en fonction de leur ancienneté.
Le Royaume-Uni : un système libéral à la structure originale
Le Royaume-Uni constitue un marché du travail libéral où il n’existe pas à proprement parler de Code du travail. Le droit repose sur un amalgame de textes de loi adoptés par le Parlement et le régime de loi coutumière érigé par la jurisprudence. Il en résulte que la relation entre employeurs et salariés demeure essentiellement contractuelle, c’est-à-dire qu’elle repose sur les termes contractuels négociés par les parties, sous réserve du respect de certaines règles impératives imposées par les textes de loi.
Figure 12 : La structure en cercles concentriques du système de protection britannique.
La législation britannique prévoit un système de protections « concentriques », qui s’éloigne en partie de la bipolarité traditionnelle entre salariés et indépendants, notre point de repère. Le champ d’application de ces protections, qui ne concernent traditionnellement que le travail salarié, a été représenté sur la figure suivante.
La catégorie des employees désigne les salariés. Ils ont le maximum de protections : chômage, assurance maladie, retraite, congés payés, etc.
La catégorie des workers est à mi-chemin entre celle de travailleur salarié (employee) et celle de travailleur indépendant (self-employed), sur le modèle des catégories intermédiaires créées en Italie, en Espagne et en Allemagne. Mais il ne s’agit pas ici d’une catégorie intermédiaire : c’est une catégorie plus vaste qui comprend les travailleurs salariés et ceux qui signent un contrat avec une entreprise sans être nécessairement subordonnés à l’employeur. Les workers bénéficient d’une protection en matière de salaire minimum, de durée du travail et de congés.
La catégorie des professionals correspond à tous les travailleurs indépendants qui exécutent eux-mêmes le travail qu’ils proposent à un apporteur de travail (ils ne peuvent employer d’autres travailleurs pour le faire à leur place). Les professionals ont le droit aux protections anti discrimination (Sex Discrimination Act. 1975). À la différence des workers, les professionals doivent fournir leur propre équipement, ils sont responsables de l’organisation et de la réalisation du travail qui leur est demandé, ils assument au moins une partie du risque financier et sont responsables de leur assurance et de leurs cotisations aux régimes de sécurité sociale.
Enfin, la catégorie des entrepreneurs correspond aux indépendants, mais qui ne réalisent pas forcément eux-mêmes la prestation vendue aux clients.
Une méthode pour construire des rapports au travail équilibrés
Nous allons présenter ici des exemples qui ont surtout pour objectif d’illustrer différentes méthodes de rééquilibrage. Notre cadre d’analyse se veut générateur d’idées : bien d’autres voies sont donc à imaginer pour construire des rapports de travail équilibrés. La stratégie retenue et les choix qu’elle implique restent une décision qui appartient aux pouvoirs publics et qui devra faire l’objet de concertations. Nous allons d’abord présenter des manières de réformer « horizontalement », c’est-à-dire en nous concentrant sur une catégorie de travailleurs. Puis nous montrerons qu’il est également possible d’opérer des rééquilibrages en « universalisant » certaines composantes de notre cadre d’analyse.
Des réformes horizontales
Favoriser les sociétés coopératives d’activité et d’emploi
Les sociétés coopératives d’activité et d’emploi (SCAE) sont des sociétés qui regroupent des entrepreneurs en leur permettant d’avoir un statut d’entrepreneur salarié, en CDI. La loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire clarifie le statut des coopératives et des entrepreneurs-salariés.
Elles peuvent être généralistes ou thématiques. C’est une forme d’entrepreneuriat collectif. Elles sont constituées sous forme de sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) pour garantir une forme de démocratie dans les décisions de fonctionnement, les entrepreneurs salariés devenant rapidement associés dans la SCAE. Il ne s’agit pas ici de mutualiser les profits et le capital. Chacun est rémunéré en fonction de sa propre activité. Il s’agit par contre d’affirmer que la SCAE est une société de personnes et non une société de capital, dans laquelle chaque coopérateur délibère sur la gestion collective avec le même pouvoir de décision que ses homologues.
Les SCAE permettent de répondre à plusieurs des difficultés rencontrées par les travailleurs indépendants (en particulier ceux qui sont économiquement dépendants) :
- Elles donnent aux coopérateurs les mêmes protections sociales que les salariés et un salaire plus stable, car lissé au cours du temps .
- Elles facilitent certaines tâches, en particulier les tâches administratives, et mutualisent certains risques (assurance professionnelle, possibilité d’actions commerciales communes).
- Elles apportent aux coopérateurs un support au fonctionnement de leur « entreprise » (gestion, marketing…).
- Elles recréent une forme de communauté qui brise l’isolement que vivent de nombreux indépendants.
Pouvant partager des espaces de travail, participant au fonctionnement de la structure, trouvant des pairs au sein de la coopérative, échangeant avec des entrepreneurs plus expérimentés ou avec même d’autres entrepreneurs du même écosystème, les coopérateurs retrouvent un collectif qui leur permet de développer leur activité et leur expertise. Ils bénéficient des atouts de l’indépendance, en particulier de la liberté qui leur est propre et de la dignité de participer à une aventure collective et d’exprimer leurs idées. La fragmentation du travail et la fin des carrières longues ont remis en cause l’accompagnement du développement de compétences par les entreprises. Les formes de travail collaboratif redonnent aux travailleurs un environnement favorable à cette démarche, qu’il leur appartient de piloter, et leur redonne, aussi, une forme de sécurité puisqu’ils deviennent plus aguerris et « employables ».
Cette forme d’entreprise est d’autant plus vertueuse que chaque entrepreneur est responsable de sa propre activité. Sans activité, sans effort, pas de revenu, sans que cela ne soit pour autant préjudiciable à la structure. Les entrepreneurs salariés sont autonomes dans leur développement, tout en tant accompagnés.
Tableau 8 : Comparaison des positionnements spécifiques des indépendants et parasubordonnés avec celui des coopérateurs.
Les SCAE combinent la simplicité du régime du micro-entrepreneuriat sans en avoir les limites. Le corolaire est le surcoût des prestations par rapport au micro-entrepreneuriat (ou une moindre rémunération nette à facturation égale). En plus des cotisations salariales et patronales, qui doivent être déduites de la facturation brute, une cotisation pour financer le fonctionnement de la SCAE est également prélevée. Elle représente environ 11 % de la marge brute.
Le réseau Coopérer pour Entreprendre compte plus de 7 000 entrepreneurs salariés au sein de 74 SCAE membres du réseau.
Les SCAE bénéficient souvent de soutiens publics (Région, Département, Fonds européens) qui jouent un rôle important dans l’équilibre financier des coopératives. Ils leur permettent non seulement de limiter le coût de la contribution des coopérateurs, mais surtout de maintenir les activités d’accompagnement. Celles-ci constituent un atout majeur des SCAE, en particulier en matière de dignité. Nous suggérons donc que ces sociétés puissent bénéficier d’un soutien financier pérenne des pouvoirs publics, le cas échéant institutionnalisé et non discrétionnaire, selon des critères à préciser.
Elles constituent de plus un véritable laboratoire de nouvelles formes d’entreprises et des rapports au travail. À cet égard, certains projets pourraient faire l’objet d’un appui financier public ou privé (mécénat, participation des entreprises dans le cadre de leur politique RSE…). Les activités nécessitant un important investissement en capital restent par ailleurs encore complexes à mener dans les SCAE, ce qui explique la forte représentation du secteur tertiaire. Une réflexion pourrait être utilement poursuivie pour déterminer des moyens de rendre de telles activités mieux compatibles avec les SCAE, par exemple en se penchant sur les modalités de financement des investissements.
Il nous semble en outre nécessaire que les structures coopératives puissent bénéficier d’un soutien non financier des pouvoirs publics. Une meilleure information de la part des acteurs du développement économique et de l’entrepreneuriat aiderait certainement à mieux faire connaître les SCAE, loin de l’image politisée qui leur est trop souvent attribuée, à tort.
Responsabiliser les plateformes
Il est important de distinguer deux types de plateformes aux caractéristiques foncièrement différentes : les places de marchés et les opérateurs. Les premières laissent une marge de liberté significative (prix, conditions, etc.) et assurent essentiellement une mise en relation. Les opérateurs sont en revanche bien plus directifs et ne laissent que peu de liberté aux prestataires. Ils fixent de manière unilatérale les tarifs et la nature du service (types de véhicules, tenue vestimentaire, etc.) quand ils ne mettent pas sur la touche certains des travailleurs n’ayant pas des rythmes de travail adaptés à l’activité. Pour citer des exemples parmi les plus connus, Uber ou Helping sont des opérateurs qui déterminent les prix et conditions de réalisation des prestations. Le prestataire ne peut y déroger. À l’inverse, Le Bon Coin ou Littleworker sont des places de marché. Elles peuvent avoir un rôle plus ou moins important dans la mise en relation, c’est-à-dire fixer quelques règles ou principes d’intervention, encadrer les prix, mais elles laissent une marge de manœuvre aux prestataires.
Quoi qu’il en soit, les plateformes ne sont pas incompatibles avec l’épanouissement des travailleurs qui les utilisent. D’ailleurs, certaines d’entre elles, à travers l’utilisation du régime d’auto-entrepreneur, apportent aux travailleurs une autonomie qu’ils ne trouvaient pas avec le salariat. Le réel problème est celui des protections dans les situations de dépendance économique que nous avons décrites dans les parties 1 et 2. L’accès étant facilité au régime d’auto-entrepreneur, plusieurs de ceux qui y recourent sont moins formés et moins conscients de ses tenants et aboutissants, moins préparés à la création d’entreprise et à ses difficultés. Ils ne sont pas au fait des différences de protection. Certaines plateformes peuvent, volontairement ou par leur silence, en abuser. Elles ont à répondre à des situations de précarité, liées à la fragmentation du travail, et de contournements du code du travail, souvent sous le vocable séduisant d’économie « collaborative ». De plus, lorsqu’une entreprise plateforme s’appuie sur une main-d’œuvre pour qui il s’agit d’une activité de complément, elle s’affranchit de certaines règles auxquelles sont soumis ses concurrents qui font appel à des salariés (notamment le versement de cotisations patronales).
Les plateformes ont apporté une innovation non négligeable, favorable aux consommateurs, et répondent aussi à certains besoins. Il ne nous paraît en outre pas judicieux de pénaliser ceux qui en tirent un revenu, aussi faible ou important soit-il, ce qui reviendrait à précariser un peu plus ceux qui parviennent à vivre. L’enjeu revient donc à protéger les travailleurs les plus vulnérables, sans freiner le développement des plateformes. À court terme, certaines d’entre elles nous paraissent devoir gagner en transparence pour que les travailleurs aient la faculté de les choisir en meilleure connaissance de cause. Il s’agirait par exemple d’apporter plus d’information sur les conditions de rémunération des travailleurs, du nombre de travailleurs en activité, voire de décrire quelques principes d’allocation des missions. Cette démarche permettrait a minima que les travailleurs puissent prendre des décisions plus éclairées et rétablirait un début d’équilibre dans le rapport de force entre les plateformes et leurs « partenaires ».
Un bon exemple est l’initiative austro-suédo-allemande Faircrowdwork , à laquelle le syndicat IGMetall a largement pris part. Cette démarche apparaît remarquable, reproductible et semble pouvoir être étendue. Il s’agit d’une plateforme de notation des plateformes, les pratiques de chacune d’entre elles étant évaluées sur la base des expériences vécues. C’est un premier pas vers la structuration de lieux d’échanges entre travailleurs. En Allemagne, huit plateformes ont signé en mars 2017 un code de conduite portant, entre autres points, sur les conditions d’une rémunération équitable, le respect de la liberté et flexibilité, le retour d’expérience et le dialogue ou encore l’apport d’un soutien aux travailleurs et la reconnaissance de leurs compétences.
Tableau 9 : Comparaison des positionnements spécifiques des « vrais » indépendants, des parasubordonnés, et des parasubordonnés sur plateformes « responsables ».
Des initiatives isolées existent en France, qu’elles soient le fait d’entreprises, de partenaires sociaux ou de travailleurs. Les fédérer les rendrait plus visibles et les ferait gagner en efficacité. Instaurer un meilleur dialogue entre elles pourrait de surcroît initier des actions communes allant au-delà de lignes de bonnes conduites. On pourrait envisager utilement l’instauration de formations à destination des indépendants, financées par les plateformes, la création de fonds mutualisés pour accroître la couverture maladie et les pertes d’exploitation des travailleurs ou encore pour le cautionnement du logement, à l’instar de ce que les agences d’emploi ont instauré pour les travailleurs intérimaires.
Toujours dans une logique non contraignante et de promotion des pratiques vertueuses, l’idée d’une labellisation des plateformes, qui avait été suggérée par le Conseil national du numérique dans son rapport Ambition Numérique de juin 2015, permettrait aussi d’impliquer le consommateur dans ses choix. Même si l’ubérisation a été au cœur des campagnes politiques de 2017, le consommateur n’a que rarement une connaissance a priori des pratiques des entreprises dont il est le client. Nul doute que son comportement en serait pourtant influencé.
Faire évoluer le salariat pour répondre au besoin d’autonomie des travailleurs
Le salariat aussi connaît des mutations, les entreprises ayant bien saisi la nécessité de s’assurer la fidélité des salariés sur les compétences les plus critiques tout en accroissant globalement leur productivité et leur performance. Diverses initiatives montrent que ces préoccupations sont devenues prégnantes : la labellisation Great Place to Work, la création de postes de Chief Hapiness Officers … Ces dernières n’enrichissent pas nécessairement une ou plusieurs des dimensions de notre cadre d’analyse. Mais elles offrent aux entreprises un relais pour une réflexion approfondie et objective de leurs pratiques managériales.
Les changements passent parfois par la mise en œuvre d’organisations innovantes. L’entreprise libérée est un exemple actuel d’une telle démarche. Isaac Getz et Brian M.Carney ont théorisé ce mode d’organisation en 2012 dans leur ouvrage Liberté et Cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises sur la base d’observations de pratiques réelles. L’entreprise libérée vise à placer au centre de la construction organisationnelle la confiance, l’autonomie et la liberté des salariés, favorisant ainsi responsabilité, motivation et prise d’initiatives. Ce modèle fait aussi l’objet de critiques, que notre propos n’a pas pour but de conforter ou d’amender. Là encore, nous pensons que la concertation au sein des organisations doit guider leurs règles de fonctionnement et qu’il serait malhabile de prôner tel ou tel modèle de management. Il n’en demeure pas moins que le succès d’entreprises libérées répond à des besoins de notre époque et que certains de ses traits peuvent utilement inspirer les pratiques d’encadrement. Plus largement, des pratiques visant la qualité de vie au travail sont à même de faire évoluer les modèles d’organisation du travail actuels et de tendre vers plus d’autonomie et de sens au travail.
Tableau 10 : Comparaison des positionnements spécifiques des salariés précaires, des salariés fordistes et des salariés travaillant dans des organisations « libérées ».
Des initiatives plus ponctuelles sont aussi dignes d’intérêt. Les entreprises Popchef, Evercontact ou encore Netflix ont par exemple fait parler d’elles pour autoriser des congés illimités. Pour leurs dirigeants : « mieux vaut rester le moins possible mais être productif. » Ils indiquent également qu’ils « n’achètent pas des heures de travail, mais un résultat. » Certes, on pourra reprocher que cette pratique soit une incitation perverse à ne pas prendre de congés si aucun cadre n’est fixé, que l’atteinte du résultat peut nécessiter un engagement finalement plus important que s’il était borné par des horaires. Pourtant, non seulement ces pratiques semblent atteindre leurs objectifs, au regard des propos des entreprises concernées , mais elles se rapprochent en outre d’une logique de contractualisation, que l’on retrouve dans la prestation avec des indépendants, tout en incluant les salariés dans l’entreprise. Elles illustrent aussi très bien le dépassement d’un modèle fordiste dans lequel le temps de travail est une unité de mesure des travailleurs sur des machines imposant les cadences, modèle qui ne correspond plus, ou très peu, au monde économique d’aujourd’hui.
Certaines initiatives se heurtent cependant formellement à des dispositions du Code du travail. Des risques de contentieux existent par exemple dans l’octroi d’un congé illimité, notamment au motif d’une inégalité de traitement de l’ensemble des salariés. Il nous paraît nécessaire que le Code du travail puisse laisser la place à des expérimentations au sein d’entreprises volontaires, avec l’aval des salariés.
Des réformes verticales
Jusqu’à présent, nous avons vu comment mieux répondre aux attentes des travailleurs et des entreprises par l’amélioration des conditions d’une seule catégorie de travailleurs à la fois. La difficulté de telles réformes, dites « horizontales », réside dans le compromis qu’elles réclament pour équilibrer les besoins de chacune des parties. Une autre méthode, que nous allons présenter à partir de quelques exemples, consiste à travailler sur une dimension de notre grille d’analyse, en touchant toutes les catégories de travailleurs à la fois. Ce n’est alors plus le compromis entre le travailleur et l’entreprise qui conditionne l’équilibre mais un tiers qui le garantit de manière universelle. La charge de cet arbitrage peut être confiée à l’État, mais pas nécessairement. L’universalisation de la couverture maladie en est un exemple. Tout travailleur – et même toute personne résidant en France – bénéficie aujourd’hui de cette protection. Rappelons néanmoins que le maintien de rémunération durant les arrêts pour maladie a été étendu aux indépendants, y compris auto-entrepreneurs. C’est le RSI qui les couvre pour les artisans et commerçants ou diverses caisses pour les professions libérales. Mais les indemnités journalières ainsi accordées sont moindres que celles offertes pour les salariés, et leur calcul plus complexe. Les indépendants cotisent parfois volontairement à des assurances personnelles.
Ces réformes verticales aident donc à sortir d’oppositions difficilement conciliables entre travailleurs et employeurs. Elles permettent aussi d’éviter certains effets négatifs. Nous avons constaté en partie 1 une forme de « rigidification » du marché du travail, marqué par une envolée des contrats courts et un accès de plus en plus difficile à l’emploi. Si certaines composantes de « sécurité » deviennent universelles, alors ces effets négatifs s’estompent. Il ne s’agit pas d’imposer aux employeurs d’offrir cette sécurité mais bien de la faire assumer par un tiers à la relation employeur-travailleur. Elle n’est alors plus un enjeu dans cette relation.
Créer une protection universelle contre le chômage
« Je veux que la protection contre le chômage devienne une protection universelle, étendue à ceux qui n’en ont pas le droit aujourd’hui » déclarait Emmanuel Macron, alors candidat à la présidence de la République, le 14 janvier 2017.
Dans la terminologie de notre cadre d’analyse, ce souhait d’Emmanuel Macron revient à vouloir réformer verticalement la composante n°5, l’assurance chômage (cf. tableau 11).
Nous avons rappelé plus haut que les travailleurs non-salariés n’avaient pas accès à l’assurance chômage. Or, si cela peut être considéré comme légitime pour les « vrais » indépendants, qui peuvent avoir un capital sur lequel s’appuyer et qui assument volontairement un risque, le cas des parasubordonnés pose problème. Lorsque la totalité de leur chiffre d’affaires disparaît par la décision de leur unique donneur d’ordres, ils se trouvent totalement démunis. Et, contrairement aux « vrais » indépendants, ils ont rarement de quoi faire face financièrement à une perte temporaire d’activité.
Tableau 11 : L’universalisation de l’assurance chômage voulue par le président Macron.
Une solution pourrait être de travailler de manière spécifique sur cette catégorie de travailleurs, comme l’ont fait d’autres pays. Mais, en France, nous l’avons vu, ni les statuts ni les régimes ne coïncident toujours avec les catégories de travailleurs et nous n’avons pas choisi de créer pour le moment de statut spécifique d’indépendant parasubordonné. L’autre méthode, celle que veut utiliser le Président de la République, est de s’abstraire de la catégorie de travailleurs. L’avantage pour les individus, si une telle réforme est menée à son terme, c’est qu’ils n’auront plus à se demander si leur statut leur donne le droit au chômage ou non. Néanmoins, en procédant ainsi, on augmente drastiquement le nombre de bénéficiaires potentiels (les « vrais » indépendants comme les chefs d’entreprise y auront droit) et donc le coût pour la société. Cela pose donc la question de la soutenabilité financière d’une telle réforme, ce qui est d’ailleurs aussi vrai pour toutes les réformes verticales.
Créer des droits de tirage sociaux
Alain Supiot avait donné une première définition en 1997 du concept de droits de tirage sociaux. Il s’agit des droits que le titulaire pourrait utiliser pour exercer certaines libertés dans sa vie professionnelle, afin de « se libérer du travail subordonné pendant un certain temps pour se consacrer à une autre activité socialement utile », « acquérir de nouvelles connaissances, s’occuper de ses enfants ou de ses parents malades, créer une entreprise, prendre une année sabbatique, exercer pour un temps donné un mandat syndical ou politique, changer de métier, etc. » Ces droits pourraient être abondés par les entreprises, le titulaire ou l’État et pourraient être utilisés à n’importe quel moment de la vie, pas nécessairement lors des périodes de perte d’emploi subies.
Cette définition évoque la valorisation de ces droits dans des situations autres que celles de l’emploi. Mais la particularité essentielle de ces droits, que nous retenons, est qu’ils seraient attachés à la personne du travailleur et non plus à un emploi. Ce principe a d’ailleurs été adopté avec la création du compte personnel d’activité. Il s’agirait de l’étendre et notamment que des droits puissent être acquis et mutualisés entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants. C’est la protection de l’actif et non pas celle du salarié qui est en jeu. Concrètement, cela pourrait porter sur la plupart des éléments de la sécurité et du développement du potentiel. Il s’agirait d’une forme de « sécurité sociale professionnelle », amenée d’ailleurs à remplacer et compléter la sécurité sociale.
Tableau 12 : L’impact des droits de tirages sociaux sur le positionnement spécifique des travailleurs.
Universaliser la stabilité du revenu
Cela peut sembler une utopie : comment assurer un revenu stable à chacun, quelques soient les discontinuités et incidents de parcours ? Le revenu universel, médiatisé par son introduction dans la campagne présidentielle française de 2017, vient rapidement à l’esprit.
À ce stade, le revenu universel nous suggère plusieurs réserves, avant même l’examen de son financement. Un revenu universel ne risque-t-il pas d’engendrer de nouveaux effets de seuil en modifiant la frontière de la pauvreté sans réellement régler le sujet ? Est-il réellement une source d’équité sociale ? Quel doit être son niveau ?
Ces questions ne trouvent pas encore de réponses certaines. Les objectifs assignés à un revenu de base ne sont même pas consensuels parmi ses défenseurs : faire reculer la pauvreté, favoriser l’emploi par une baisse du coût de la main-d’œuvre peu qualifiée, refonder les systèmes de redistribution pour les simplifier… Il focalise en outre les oppositions entre les tenants et opposants de la fin du travail.
Notre opinion est qu’un revenu de base vise d’abord à préserver la dignité de chacun. Recevoir un revenu assure une sécurité minimale, mais ne permettra jamais à lui seul d’acquérir un sentiment d’utilité ou de participation à une aventure collective constructive. C’est une des raisons pour lesquelles nous considérons plus appropriée la notion de contributif. Une expérimentation territoriale a débuté en 2016 sur le territoire de Plaine Commune, qui rassemble neuf communes de la Seine-Saint-Denis, pour y mettre en œuvre un revenu contributif.
Ce revenu a pour particularité d’être conditionnel. Il part du postulat que le travail est important et que chacun aime travailler. Mais il se fonde aussi sur une acception du travail qui privilégie les savoir-faire et le partage des savoirs. Le revenu contributif, à cet égard, s’accommode parfaitement de l’automatisation et de la pénétration des technologies numériques. On peut même dire qu’il vise à en redistribuer les gains de productivité, notamment en direction d’activités qui ont un intérêt social et sociétal plutôt que marchand. Le revenu contributif ne consiste pas à freiner ou taxer la robotisation mais à l’inverse à constater qu’elle peut libérer des tâches les plus répétitives et qu’il faut tirer profit de la productivité gagnée.
En 2010, la direction générale du Trésor estimait qu’entre 1980 et 2007, les gains de productivité pouvaient être à l’origine de 29 % des destructions d’emplois dans l’industrie, expliquant partiellement un transfert des emplois du secteur secondaire vers le secteur tertiaire.
La robotisation et la diffusion des technologies constituent une nouvelle étape d’innovation, telle que l’économie en a déjà connu, en particulier au cours des précédentes révolutions industrielles. Ce processus de destruction créatrice est décrit par Joseph Schumpeter. Antonio Casilli rappelle que la question de l’impact des nouvelles technologies, et notamment du machinisme, est aussi ancienne que la révolution industrielle. Dès le début du XIXe siècle, certains économistes comme Thomas Mortimer ou David Ricardo s’inquiétaient déjà de la substitution massive du travail humain par des machines. Le débat sur les dangers de la robotisation nous semble anachronique, surtout à une époque où on dénombre un nombre croissant de pathologies liées au travail répétitif. En revanche, il est clair que la robotisation va induire des mutations qu’il faudra accompagner et que les politiques de l’emploi ont du mal à s’en accommoder tant qu’elles la considèrent d’une manière comptable. C’est tout l’enjeu d’une prise en compte renouvelée du travail, qui s’exerce au-delà de l’emploi, y compris dans des solidarités de proximité. Le revenu contributif peut être un outil capable d’accompagner les transitions induites par la robotisation.
L’expérimentation et les travaux de recherche doivent être poursuivis pour déterminer les critères de distribution d’un revenu contributif et les modalités de son financement. C’est un projet qui pourrait d’ailleurs aussi ramener dans le monde économique des métiers disparus faute d’être immédiatement rentables. Dégagées de cette contrainte, des activités réellement collaboratives pourraient voir le jour, en particulier celles qui font intervenir une forte part de main-d’œuvre et de personnalisation. C’est aussi un soutien à l’entrepreneuriat, cette fois-ci non pas vécu comme l’espoir de revenir vers l’emploi quand on en est exclu, mais au contraire en jouissant d’une certaine forme de garantie face aux différents freins qu’éprouvent ceux qui hésitent à s’y lancer.
Donner du sens au travail
Nous avons constaté que la construction historique du pacte salarial, puis l’éclatement de la bipolarité entre salariat et travail indépendant, étaient liés à des évolutions culturelles et économiques.
La perception du rôle des entreprises dans la société a elle aussi évolué. Du fait de la financiarisation croissante, on constate une déconnexion entre travailleurs, actionnaires et managers. Les actionnaires, surtout lorsqu’ils sont institutionnels, se préoccupent essentiellement de la rentabilité à court terme de leur investissement. Autrefois jugés sur leur capacité à piloter l’innovation, les managers sont de plus en plus observés par les actionnaires au regard de cette rentabilité avec un horizon stratégique qui s’est énormément raccourci. Les reportings trimestriels en témoignent. Parallèlement, les ambitions de long terme, qu’elles soient technologiques, environnementales ou sociales, ont peu à peu disparu de leurs préoccupations prioritaires.
La passion des débats portant sur le rôle social de l’entreprise témoigne non pas d’un divorce entre la société et les entreprises (sans quoi il n’y aurait pas de débat), mais bel et bien d’un enjeu à réconcilier société et entreprises.
Tableau 13 : La dignité, une dimension essentielle pour toutes les catégories de travailleurs.
Pour y parvenir, Blanche Segrestin, Kevin Levillain, Stéphane Vernac et Armand Hatchuel développent l’idée de sociétés à objet social étendu. Il s’agirait de « refonder en droit la mission des entreprises » et « d’inscrire dans le droit des sociétés une option afin de permettre à l’entreprise, quelle que soit sa forme, d’inscrire dans ses statuts des objectifs sociaux ou environnementaux qu’elle assigne à son activité ». Ils montrent d’ailleurs que des options juridiques sont débattues et expérimentées à travers le monde, en particulier aux États-Unis, pour réformer en ce sens le régime des sociétés commerciales et leurs règles de gouvernance (par exemple les Mission-driven companies).
Nous considérons que de telles expérimentations, dans la continuité pour certaines des démarches des entreprises de qualité de vie au travail doivent être poursuivies. Il s’agirait ici, quelle que soit la catégorie de travailleurs concernés, d’aider chacun à retrouver le sens de son travail. À l’heure où beaucoup doutent de leur utilité et s’interrogent sur leur rôle dans l’entreprise, où les bullshit jobs ou les bore-out deviennent un sujet d’actualité, redonner du sens est devenu impératif. C’est un besoin pour les travailleurs, dont les entreprises tireront nécessairement profit si elles dépassent les horizons courts.
C’est à Richard Branson, fondateur de l’empire Virgin, que l’on attribue la citation « Si vous prenez soin de vos salariés, ils prendront soin de votre entreprise. » Nous pensons que cette thèse dépasse la seule catégorie des salariés et qu’il s’agit aussi d’un moyen de fidéliser des relations durables et constructives avec des prestataires. Et que donner l’envie de travailler passe par la construction de sens au niveau collectif.
Conclusion générale
La force avec laquelle le débat public s’est focalisé sur l’uberisation de l’économie témoigne de l’importance accordée aux changements sociaux, même supposés. Les entreprises et le monde du travail se transforment et s’adaptent, parfois avec difficulté, à une concurrence mondialisée, aux nouvelles attentes des marchés ou encore aux mutations technologiques.
Mais ces débats véhiculent de nombreuses idées reçues, opposant parfois stérilement pro-entreprises et défenseurs des travailleurs. Si les entreprises recherchent bel et bien plus de souplesse et de flexibilité, les travailleurs veulent eux aussi gagner en autonomie, en indépendance et que leur travail ait du sens. Certains, en particulier parmi les plus qualifiés, parviennent à tirer leur épingle du jeu et à prendre leur destin en main comme ils l’entendent. Mais, dans le même temps, un nombre très significatif de travailleurs subit cette indépendance nouvelle. L’auto-emploi constitue pour eux la seule réponse possible face au chômage. Parmi eux, certains se soumettent, presque à leur corps défendant, aux règles de l’économie des plateformes, qu’ils ne peuvent négocier, et restent dans une logique de survie au sein d’une économie faussement « collaborative ».
Le pacte salarial, fondé naguère pour accompagner les besoins d’une économie fordiste, n’est plus parfaitement adapté à notre époque. La frontière entre le salariat et le travail indépendant, s’est peu à peu estompée. Les protections du salariat s’amenuisent tandis que la liberté des indépendants se paye parfois au prix de la précarité.
Nous sommes pourtant aux portes d’une ère nouvelle. Le désir de liberté à laquelle chacun prétend, dont l’accès est facilité par la technologie, se heurte à la subordination prévue par le salariat. Ce désir trouve alors, pour certains individus, une réponse dans de nouvelles formes de travail, qui doivent gagner en sécurité et en dignité. Cela passe d’ailleurs par des protections nouvelles comme un vrai accès à la formation tout au long de la vie pour tous ou des réflexions sur l’accès au logement.
Pour autant rien ne dit que le salariat est voué à mourir. Il répond aussi à des attentes individuelles. Mais il doit lui aussi évoluer.
Il est temps de repenser profondément les rapports au travail, selon une approche qui tienne compte des attentes des individus, autour des valeurs de liberté, sécurité et dignité, et qui réponde aux besoins des entreprises, en particulier celui d’une plus grande flexibilité. Plusieurs de nos voisins européens l’ont fait, avec un certains succès.
À trop considérer le travail par le seul prisme de l’emploi, on le réduit à une marchandise, allant jusqu’à faire disparaitre un certain nombre de métiers, faute de rentabilité mais pas par désintérêt de ceux qui les exerçaient. De nombreuses activités hors de l’emploi (activités bénévoles, familiales, communautaires…) sont précieuses pour notre société et contribuent à l’épanouissement personnel et à l’intérêt général. Des recherches et expérimentations, telles que celles menées sur le revenu contributif, sont prometteuses et doivent être poursuivies pour dépasser leur complexité immédiate.
Références bibliographiques
Antonmattei P.-H., Sciberras J.-C., 2008, « Le travailleur économiquement dépendant : quelle protection ? »
Barthelemy J., Cette G., 2017, « Travailler au XXIe Siècle – L’uberisation de l’économie ? », Odile Jacob
Bodet C., De Grenier N., « De l’auto-emploi à la coopération : le cas des coopératives d’activité et d emploi. »
Boissel C., Variations économiques, 2015, « Is Uber Pop? De l’origine sociale des conducteurs de VTCs. », https://variationseconomiques.wordpress.com/author/cboissel/
Castel R., « Les métamorphoses de la question sociale », 1995, Fayard
Cleiss, Les systèmes nationaux de sécurité sociale, http://www.cleiss.fr/docs/regimes/
Collin P., Colin N., 2013, « Mission d’expertise sur la fiscalité numérique »
Colin N., Verdier H., 2012, « L’âge de la multitude », Armand Colin
Conseil National du Numérique, 2015, « Ambition Numérique »
Conseil National du Numérique, 2016, « Travail, Emploi, Numérique, Les nouvelles trajectoires »
COOPANAME, 2015, Rapport d’activité
DARES Analyses n° 056, juillet 2014, « Entre 2000 et 2012, forte hausse des embauches en contrats temporaires, mais stabilisation de la part des cdi dans l’emploi »
DARES Analyses n° 060, octobre 2016, « Les pluriactifs : quels sont leurs profils et leurs durées de travail ? »
DG Trésor « Le travailleur économiquement dépendant : quelle protection ? » https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/325050
DG Trésor, Les documents de travail de la DG Trésor, numéro 2010/01, Juin 2010, «La désindustrialisation en France»
EUROSTAT, Statistiques sur l’emploi, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics/fr
Frey C. B., Osborne M. A., 2013, « The future of employment: how susceptible are jobs to computerization? »
France Strategie, 2016, « Nouvelles formes du travail et de la protection des actifs », http://francestrategie1727.fr/thematiques/nouvelles-formes-du-travail-et-de-la-protection-sociale/
France Strategie, 2017, « Imaginer l’avenir du travail – Quatre types d’organisation du travail à l’horizon 2030 », http://www.strategie.gouv.fr/publications/imaginer-lavenir-travail-quatre-types-dorganisation-travail-lhorizon-2030
Getz I., Carney B., 2016, « Liberté et Cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises », Clés des champs
INSEE, Enquête emploi en continu, https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1223
INSEE Première, Décembre 2016, Revenus d’activité des non-salariés en 2014
INSEE Références, Edition 2017, « Emploi, chômage, revenus du travail »
INSEE Références, Edition 2016, « France, portrait social »
INSEE Références, Edition 2015, « Emploi et revenus des indépendants »
INSEE Références, Edition 2014, « Emploi et salaires »
INSEE Références, Edition 2008, « L’emploi, nouveaux enjeux »
INSEE, 2016, « Une photographie du marché du travail en 2015 »
INSEE Résultats, 2017, Enquête SINE auprès des auto-entrepreneurs, « Les auto-entrepreneurs de 2014 : situation initiale »
Libellio d’Aegis (Le), Printemps 2017, http://lelibellio.com/
Marchand O., 1998, « Salariat et non-salariat dans une perspective historique », Persée, Economie et statistiques
Mazuyer E., « Les mutations des droits du travail sous influence européenne », Revue de la régulation
Meda D., « Le travail : Une valeur en voie de disparition ? », Flammarion
Menasce D., 2015, « La France du Bon Coin », L’Institut de l’Entreprise
OCDE, « Automatisation et travail indépendant dans une économie numérique », 2016
OCDE, Base de données sur l’emploi, http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/basededonneessurlemploi-indicateurssurlemploi.htm
OCDE, « Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2016 », http://www.oecd.org/fr/emploi/emp/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde-19991274.html
Prism’Emploi, 2016, « Manifeste pour l’emploi »
Ray J.-E., Novembre 2016, « Grande accélération et droit à la déconnexion », Revue Droit Social.
Ray J.-E., Juin 2015, « Actualité des TIC, Tous connectés, partout, tout le temps ? », Revue Droit Social
Ray J.-E., Février 2015, « Qualité de vie(s) et travail de demain », Revue Droit Social
Segrestin B. , Levillain K., Vernac S., Hatchuel A., 2015, « La “Société à Objet Social Étendu” », Presses des Mines
Segrestin B., Hatchuel A., 2012, « Refonder l’entreprise », La République des Idées, Le Seuil.
Stiegler B., 2015, « L’emploi est mort, vive le travail ! », Mille et une nuits
Supiot A., 2016, « La gouvernance par les nombres », Flammarion
Supiot A., 2016, « Au-delà de l’Emploi », Flammarion
Supiot A., 2005, « Homo juridicus: essai sur la fonction anthropologique du droit », Le Seuil
Supiot A., 1997, « Du bon usage des lois en matière d’emploi », Revue Droit Social
Pedersini R., « Travailleurs économiquement dépendants, droit du travail et relations industrielles », Eurofound ?
Union des auto-entrepreneurs, Etudes et chiffres de l’Auto-Entrepreneur
http://www.union-auto-entrepreneurs.com/observatoire/etudes-chiffres-auto-entrepreneur/
Personnes rencontrées
Administrations et organismes consultatifs
M. Yann Bonnet, Secrétaire général, Conseil National du Numérique.
M. Laurent Cytermann, directeur du cabinet en charge de l’emploi.
Chercheurs et universitaires
M. Antonio Casilli, maître de conférences en Digital Humanities à Telecom ParisTech et chercheur associé en sociologie au Centre Edgar-Morin.
M. Pierre-Yves Gomez, professeur de management stratégique, Directeur de l’Institut Français de Gouvernement des Entreprises.
M. Armand Hatchuel, Professeur à Mines Paristech.
M. Vincent Puig, directeur exécutif de l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI – Centre Pompidou).
M. Jean-Emmanuel RAY, professeur de droit à l’Ecole de droit de Paris 1 – Sorbonne.
Coopératives d’activités et d’entrepreneurs
Mme Noémie De Grenier, Co-directrice générale de COOPANAME.
Entrepreneurs et travailleurs indépendants
M. Paul Halle, sociologue et facilitateur de changement.
M. Igor Reteno, Community Manager.
M. Jérôme Pimot, ex-livreur à vélo.
Entreprises
M. Antoine De Saint Affrique, directeur général, Barry Callebaut.
M. Alain Guillou, responsable des ressources humaines et des opérations, Naval Group.
M. Jean-Pierre Loizeau, Directeur Université Total.
M. Jean-Adrien Monleau, responsable des opérations, Ubereats.
Mme Laurence Storelli, directrice du recrutement, Total.
Organisations syndicales
M. Augustin Bourguignat, Secrétaire confédéral en charge des politiques industrielles et de la recherche, CFDT.
Mme Cécile Coterreau, conseillère politique auprès du secrétaire général, CFDT.
Personnalités qualifiées
M. Sébastien Archi, Directeur des affaires économiques, Prism’ Emploi.
M. Yves Caseau, Directeur de la Digital Agency du groupe AXA.
M. Olivier Landau, consultant indépendant, membre du Conseil d’Administration d’Ars Industrialis, Président de l’Institut de Recherche et d’Innovation (IRI – Centre Pompidou).
M. Laurent Morestain, Secrétaire général, Groupe Randstad.
M. Hervé Novelli, ancien ministre.
M. François Roux, Délégué général, Prism’ Emploi.
Mme Erell Thevenon-Poullennec, Directrice des études, Institut de l’entreprise.
M. Henri Verdier, Directeur interministériel du numérique et du système d’information de l’Etat français, adjoint à la secrétaire générale pour la modernisation de l’action publique.
Alexandre Chevallier et Antonin Milza, Le salariat, un modèle dépassé ?, Paris, Presses des Mines, Les Docs de La Fabrique, 2017.
ISBN : 978-2-35671-480-0
© Presses des MINES – TRANSVALOR, 2017
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel – 75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr