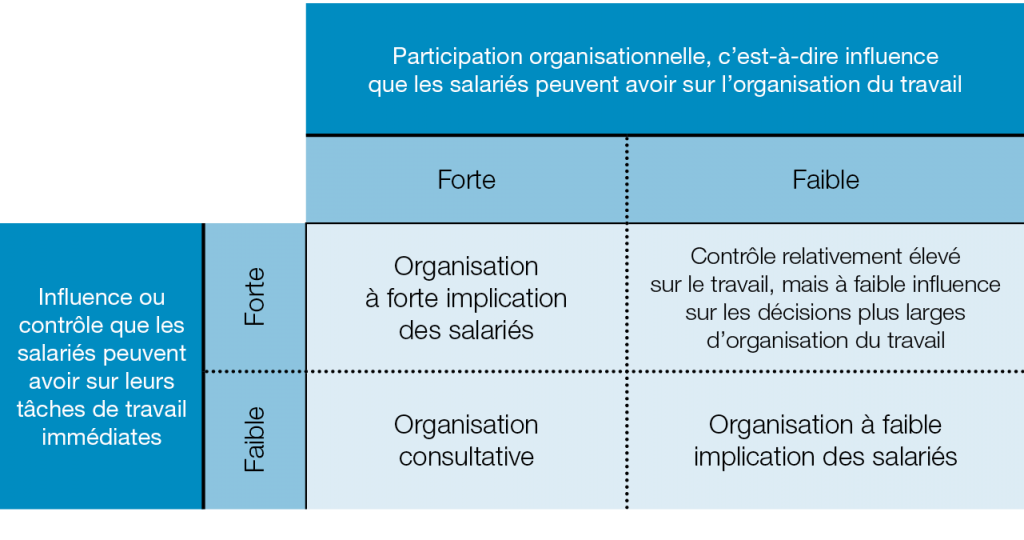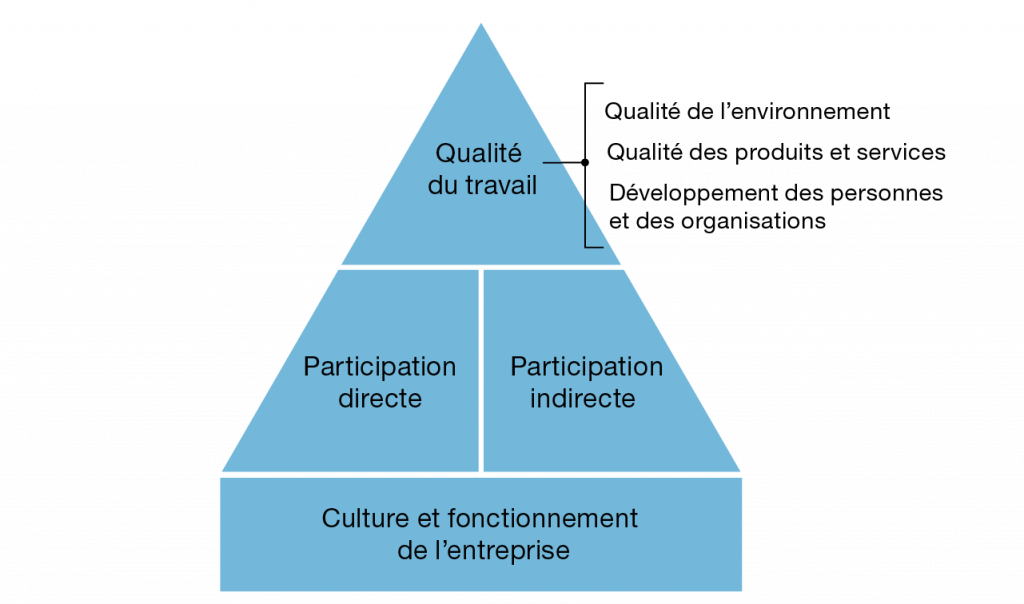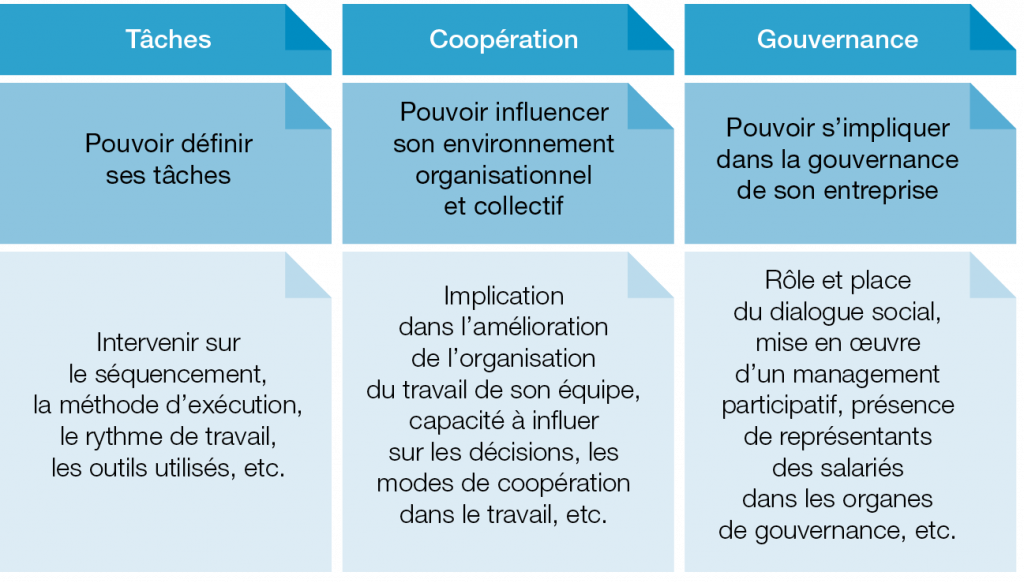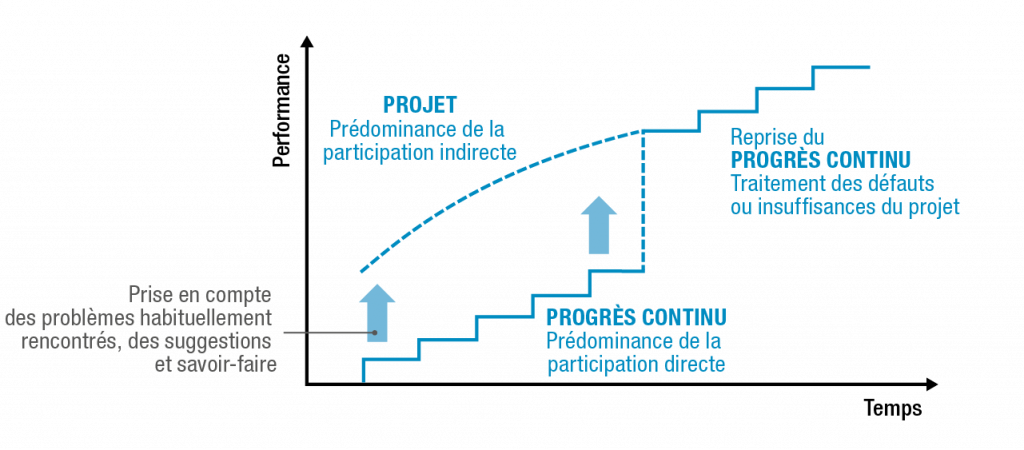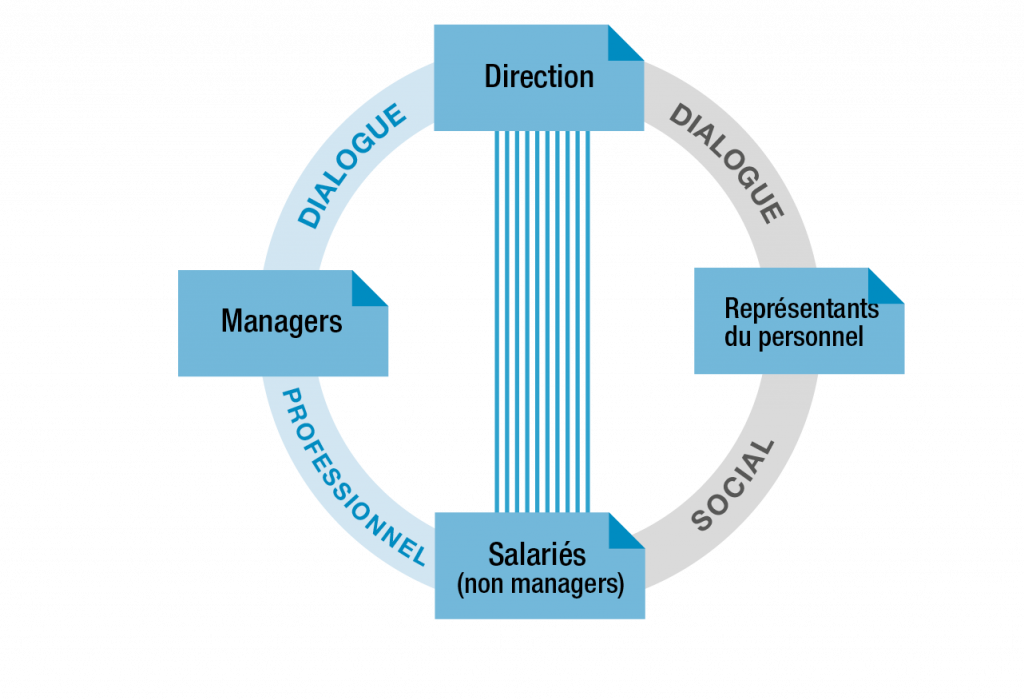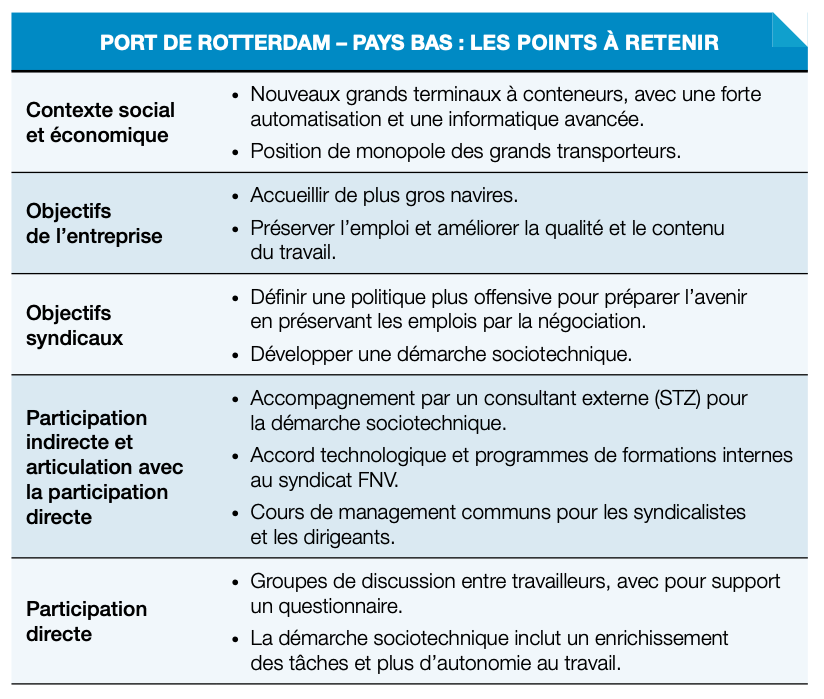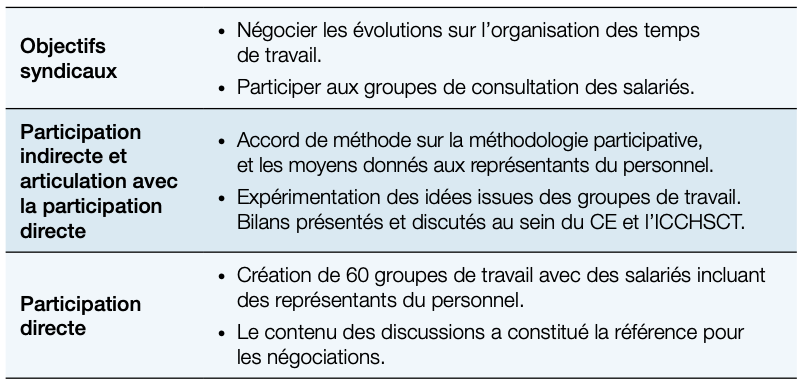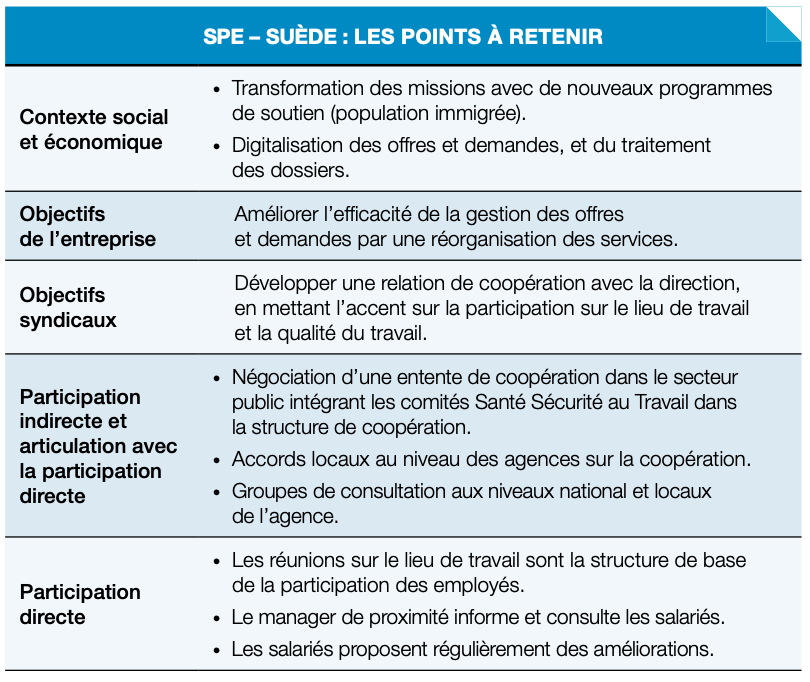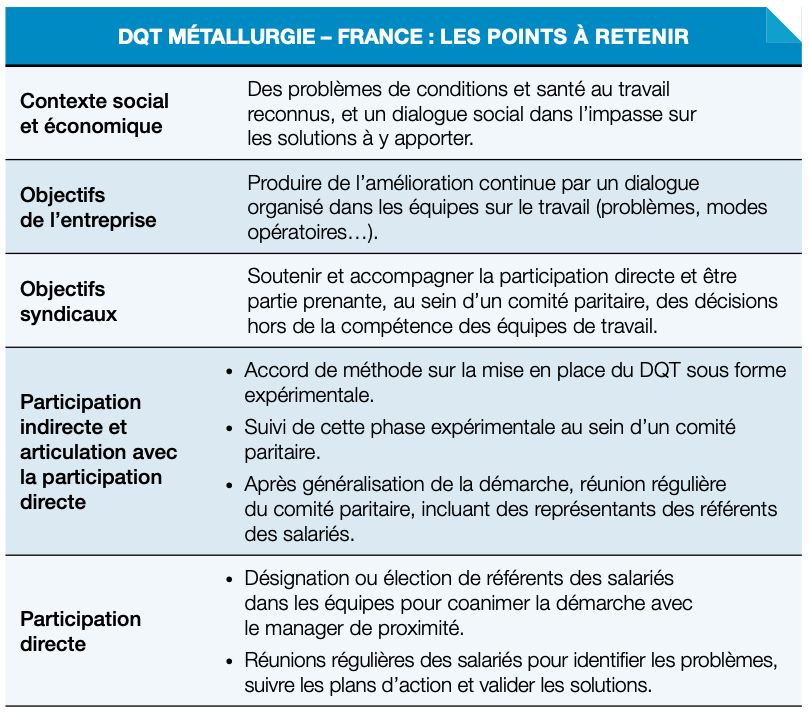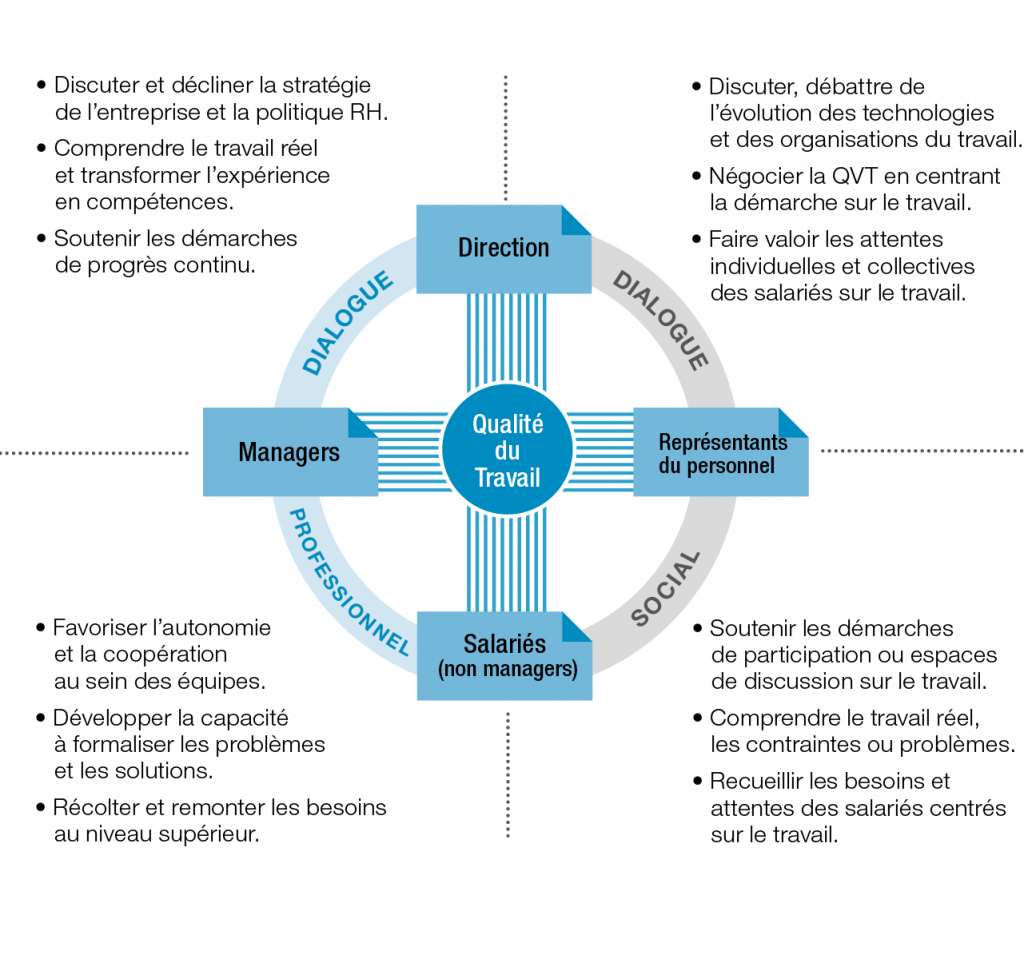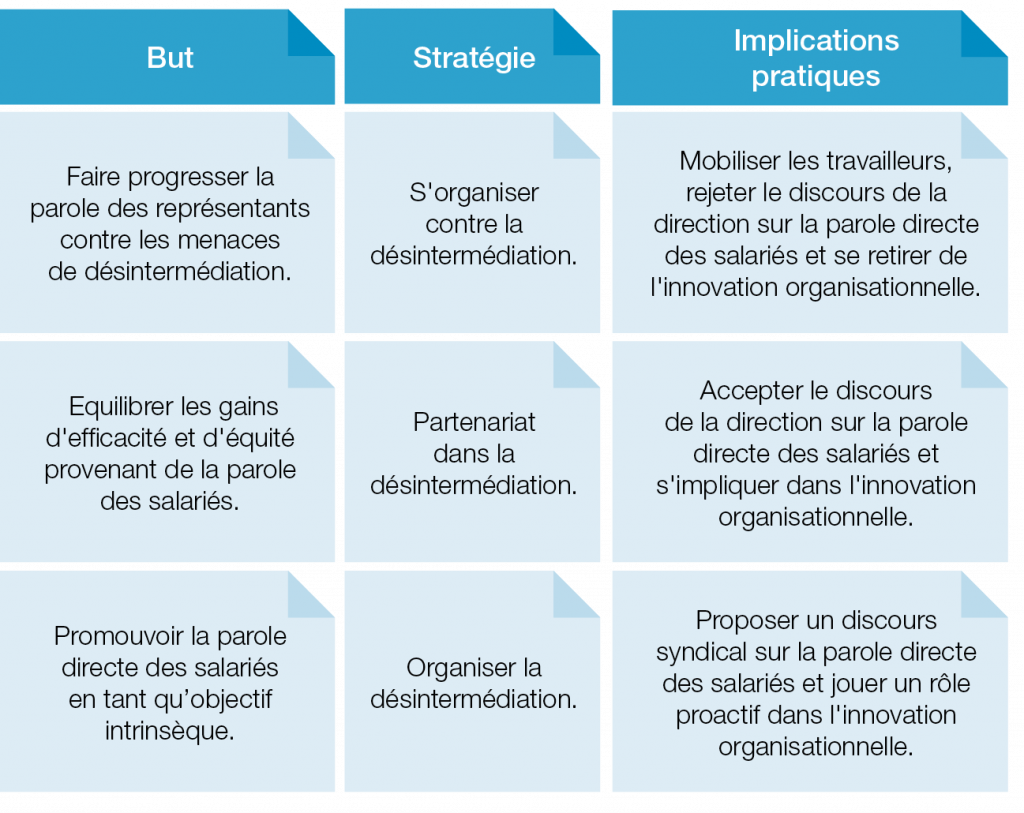Dialogues social et professionnel : comment les articuler ?
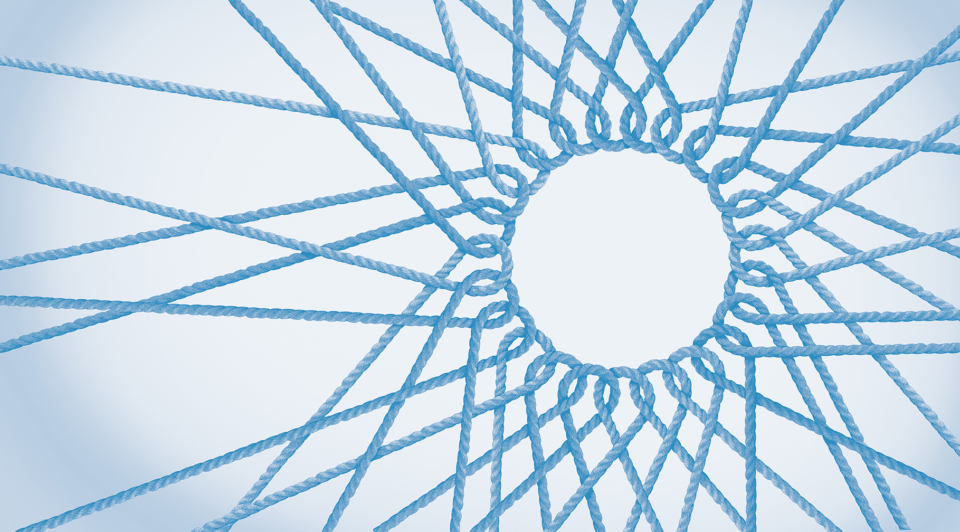
@wildpixel/iStockphoto
Avant-propos
Les entreprises sont constamment pressées d’être toujours plus agiles et réactives, pour s’adapter à leur environnement turbulent. La crise née de la pandémie de Covid-19 en a fourni une nouvelle illustration, les contraignant à adopter dans l’urgence de nouvelles organisations du travail. Le travail hybride, mi-distanciel, mi-présentiel, en est l’exemple phare : un temps envisagé comme une solution provisoire à la sauvegarde de l’activité, il est en train de s’inscrire durablement dans les pratiques, faisant désormais l’objet d’accords-cadres négociés et d’expérimentations sur le terrain. Chaque innovation de ce type amène les entreprises à repenser leurs méthodes de travail mais également leur façon de faire participer les salariés à ces évolutions.
Cet ouvrage vient nourrir ces réflexions en explorant de nouvelles approches de la participation des salariés. Il propose de sortir d’une dichotomie trop exclusive entre participation indirecte (celle qui se joue par l’intermédiaire des partenaires sociaux) et participation directe (toutes les formes de consultation directe des salariés), autrement dit de coordonner et d’articuler ces deux formes de dialogue. De nombreuses études de cas montrent que cette articulation a des effets positifs sur la qualité du travail et la performance des organisations. Et à travers des exemples issus de trois pays européens (Pays-Bas, Suède, France), les auteurs prouvent qu’elle est possible, sans dissimuler la complexité des processus à établir.
Nous espérons que ce document offrira aux dirigeants d’entreprises, aux directions des ressources humaines, aux représentants des salariés et aux organisations syndicales des pistes de réflexion sur les moyens d’enrichir la participation des salariés et de renforcer la qualité du dialogue social.
La collection des « Docs de La Fabrique » rassemble des textes qui n’ont pas été élaborés à la demande ni sous le contrôle de son conseil d’orientation, mais qui apportent des éléments de réflexion stimulants pour le débat et la prospective sur les enjeux de l’industrie.
Les équipes de La Fabrique et de la Chaire FIT²
Résumé
Le dialogue social ou participation indirecte vise à établir des règles collectives et équitables en matière de conditions générales d’emploi et de rémunération via les représentants des travailleurs. Le dialogue professionnel ou participation directe des salariés recouvre les différentes formes de consultation ou de discussion partagée qui s’installent au sein des collectifs dans le cadre de l’exécution quotidienne des activités de travail. Cette participation directe répond à une attente forte des salariés.
La plupart des entreprises développent ces deux formes de participation, avec des niveaux d’implication des salariés (participation directe) et de leurs représentants (participation indirecte) très variés, allant de la simple diffusion d’informations à une réelle participation aux décisions prises par les dirigeants.
Dialogue social et dialogue professionnel sont le plus souvent abordés dans les organisations de façon disjointe. Il est vrai que le dialogue social répond à de nombreuses règles formelles inscrites dans les législations nationales, qui dépendent du système de relations sociales. Celui-ci est souvent centralisé et distant, alors que le dialogue professionnel est par nature local, décentralisé, souvent informel, et rarement inscrit dans des règles de droit − ou quand il l’est, il est rarement appliqué selon ces règles. En outre, ces deux formes de participation n’impliquent ni les mêmes acteurs, ni les mêmes jeux d’acteurs : d’un côté, les directions et les syndicats ; de l’autre, les salariés et les managers.
Pourtant, ces deux formes de dialogue poursuivent et partagent un même objectif : l’amélioration de la qualité du travail comme vecteur de bien-être des travailleurs et de performance des entreprises à long terme. La pratique du dialogue professionnel, en particulier, est facteur d’autonomie, de santé au travail, de développement des « capabilités » des personnes (Sen, 2010), favorisant des dynamiques d’intelligence collective et de coopération qui servent le progrès continu et l’innovation, et rendent l’organisation plus agile, plus réactive et plus rapide pour s’adapter à son environnement.
Plusieurs études européennes et internationales (Eurofound, OCDE) montrent que l’association des « voix directes et indirectes » des salariés est la plus susceptible de produire un environnement de travail de qualité, et postulent que le bon fonctionnement de l’une est associé au bon fonctionnement de l’autre. Sur ce plan, les pays nordiques se différencient des autres pays européens, à la fois par leur taux de syndicalisation très supérieur et par l’attention qu’ils portent à la participation directe des salariés.
Les exemples issus de trois pays européens (Pays-Bas, Suède, France) attestent toutefois de la complexité, de la diversité et de l’étendue variable des pratiques de participation, tout en éclairant les dispositifs originaux mais toujours fragiles mis en œuvre pour en articuler les deux dimensions : au Port de Rotterdam, au Service public de l’emploi suédois, dans une mutuelle d’assurance française, dans plusieurs entreprises du secteur de la métallurgie en France. Souvent idéalisées au travers de pratiques managériales ou sociales dites innovantes, les participations ne se développent pas sans contraintes, tensions ou résistances pouvant venir de toutes parts.
Une première ligne de tension oppose syndicats et directions autour de la question de la participation directe. Les syndicats soupçonnent les directions de vouloir utiliser la participation directe comme un moyen pour contourner les organes représentatifs, et les directions soupçonnent les syndicats de s’y opposer, car cette « désintermédiation » réduirait potentiellement leur influence dans l’organisation. Cette suspicion réciproque, très présente dans le dialogue social, rejaillit sur les manières de concevoir la participation directe.
Les débats autour du référendum d’entreprise et de son instrumentalisation ne doivent pas venir occulter toutes les autres formes de dialogue professionnel informelles ou plus formelles − comme par exemple les ateliers d’amélioration continue ou les plateformes d’innovation participative − qui sont bien plus nombreuses et dynamiques. Plus encore, l’organisation et la qualité du travail sont précisément des terrains sur lesquels directions et représentants des salariés pourraient converger dans le cadre d’un débat constructif, dans une forme de « coopération conflictuelle ».
Des dispositifs de dialogue sur la qualité du travail, permettant de lier dialogues professionnel et social, existent, notamment via des accords de méthode et des instances de délibération réunissant salariés, managers, représentants syndicaux et directions. Ce type d’instance permet d’expérimenter des pratiques sociales où se confrontent les points de vue sur le travail réel de ces quatre catégories d’acteurs.
Une telle approche pose des défis tant aux directions qu’aux syndicats qui doivent rechercher de nouveaux équilibres. Côté direction, il s’agit de s’investir « dans la gestion partagée d’un processus complexe d’innovation organisationnelle » (Armaroli, 2020) et de reconnaître que le syndicalisme a un rôle à jouer en matière d’organisation du travail, à côté de son rôle traditionnel dans des domaines comme l’emploi, le temps de travail et les salaires. Côté syndical, il s’agit d’un renouvellement stratégique majeur consistant à apporter un soutien proactif au développement des formes de participation directe et d’autonomisation des salariés, plutôt que de les craindre ou de s’y opposer. Un tel choix pourrait se révéler décisif pour renouer une relation de confiance entre syndicalisme et salariés, et inverser la courbe de désyndicalisation, particulièrement inquiétante en France. Il repositionnerait les syndicats « au cœur des changements profonds qui s’opèrent dans la société et sur le lieu de travail » (Gregory et Nilsson, 2004). In fine, le dialogue professionnel, loin de menacer l’action syndicale, pourrait au contraire devenir la source de son renouveau, les représentants des salariés se saisissant alors des questions centrales soulevées par le dialogue professionnel dans le cadre du dialogue social, sans pour autant se substituer aux gens de métier dans la résolution de leurs problèmes. Le développement du dialogue professionnel deviendrait ainsi une opportunité majeure pour faire évoluer la qualité du dialogue social.
Présentation des auteurs
Cet ouvrage est le résultat d’une collaboration entre des chercheurs, consultants, praticiens, syndicalistes de trois pays européens qui ont partagé leurs connaissances sur les systèmes de négociation et le syndicalisme.
Michel Sailly a été ergonome, principalement chez Renault, incluant une expatriation chez Nissan au Japon. Dans les années 1970-1980, il a eu des responsabilités à la confédération CFDT et poursuit ses activités de conseil et formation pour la CFDT.
Aslaug Johansen a été consultante en travail à l’ARETE. Elle a exercé de nombreuses missions d’expertise dans le cadre de projets de réorganisation, de restructuration, d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement de l’espace et de risques psychosociaux. Elle a participé à plusieurs projets de recherche européens.
Per Tengblad, a été consultant en travail et chercheur en vie professionnelle à ATK Arbetsliv, Stockholm, un cabinet de conseil suédois. Il a exercé des missions dans plusieurs secteurs (télécoms, sciences de la vie, médias, administrations et services publics) et a participé à des projets de recherche européens.
Maarten van Klaveren, économiste et sociologue du travail, a été chercheur à la confédération syndicale néerlandaise FNV. Il a été consultant en travail dans une vingtaine de projets de développement et de (re)conception dans des entreprises néerlandaises. Il a participé à de nombreux projets de recherche européens et mondiaux, et est auteur ou coauteur de plusieurs ouvrages.
Remerciements
Nous remercions les personnes avec lesquelles nous avons noué les premiers contacts en vue de la publication de cet ouvrage, et qui nous ont encouragés dans notre démarche collective pour améliorer ce projet. Nous tenons à remercier tout particulièrement Marie-Laure Cahier qui a effectué un travail remarquable de relecture et de réorganisation de certaines parties. Ses remarques ou suggestions nous ont obligés à clarifier notre propos, à préciser nos orientations, et cela dans un langage compréhensible pour le plus grand nombre.
Nous remercions toutes celles et ceux, syndicalistes, managers, dirigeants, consultants, chercheurs, qui participent à ces réflexions, enrichissent le débat ou la controverse, et auxquels les auteurs se réfèrent pour proposer en retour une pensée structurée sur le sujet qui nous intéresse.
Introduction
Ce livre aurait tout aussi bien pu s’intituler : La participation directe et indirecte : comment les articuler ?
En français toutefois, le terme de « participation » est polysémique et équivoque. Pour nombre de dirigeants et syndicalistes français, il évoque d’abord un dispositif de redistribution aux salariés d’une partie des bénéfices réalisés par une entreprise. Ce n’est pas ce sens que nous lui attribuons dans cet ouvrage. Sous le vocable de « participation », nous désignons ici l’implication, la sollicitation ou encore la consultation des salariés et de leurs représentants sur les sujets relatifs à l’organisation du travail, aux conditions de travail et à leurs évolutions. Cette participation des salariés recouvre deux dimensions : la participation directe et indirecte. Cette distinction est largement connue et utilisée en Europe mais un peu moins courante en France. C’est pourquoi nous lui préférons une terminologie équivalente consistant à distinguer le dialogue professionnel et le dialogue social. Celle-ci est d’ailleurs reprise dans la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (voir annexe V).
On entend généralement par dialogue professionnel (ou participation directe), celui qui a lieu entre gens de métier, quel que soit leur statut dans l’entreprise ou l’administration. C’est le dialogue entre collègues de travail au sein d’une équipe, entre les membres de cette équipe et leur responsable hiérarchique, entre différents niveaux hiérarchiques, ou encore entre personnels de fonctions ou services différents. Ce dialogue professionnel est le plus souvent informel, mais il peut aussi être « organisé » par des dispositifs qui le favorisent. Le dialogue social (ou participation indirecte), de son côté, se réfère au dialogue entre les représentants du personnel ou les syndicats, avec les salariés d’une part, et avec les directions d’entreprise d’autre part. Le dialogue social inclut toutes les formes institutionnelles de relations avec la direction de l’organisation, à savoir la représentation des salariés dans les instances représentatives du personnel (CSE) et l’ensemble des dispositifs de négociation, quel que soit leur niveau (entreprise, branche professionnelle…). On peut aussi inclure dans le dialogue social toutes les relations informelles entre des représentants du personnel et des représentants des directions, ainsi qu’avec la base des salariés.
Ces deux formes de participation sont le plus souvent disjointes.
La préférence pour les expressions « dialogue social » et « dialogue professionnel » permet également de lever une ambiguïté. En effet, le référendum d’entreprise ou d’autres formes de consultation directe des salariés, à l’initiative d’une direction ou d’un syndicat, cristallisent les débats sous une forme conflictuelle. Le plus souvent, cette participation directe ne relève pas du dialogue professionnel et représente une modalité extrême révélant l’impasse du dialogue social, sur fond de validation d’accords d’entreprise controversés. Le recours au référendum, quel qu’en soit l’initiateur, est souvent révélateur d’un dialogue social dysfonctionnel. Une idée souvent entendue est que le recours à cette forme de participation directe des salariés serait un instrument entre les mains des directions générales visant à contourner les organisations syndicales. À l’inverse, les partisans du référendum y voient une forme embryonnaire de démocratie directe dans les organisations. Au-delà du seul référendum d’entreprise, la consultation directe des salariés est souvent perçue comme un risque de désintermédiation du côté syndical, et symétriquement comme une opportunité du côté patronal. Ces postures de défiance pèsent sur le développement du dialogue professionnel dans son ensemble, alors que celui-ci peut contribuer au contraire à construire des zones de coopération entre les parties, rejaillissant in fine sur la qualité du dialogue social.
Les publications en sciences sociales ou émanant des partenaires sociaux font état de ces modalités de dialogue, mais elles mettent la plupart du temps l’accent plutôt sur l’une ou sur l’autre forme − ce qui peut traduire une préférence idéologique − et abordent rarement leur articulation. Dans les pays nordiques où les relations sociales sont plus apaisées et reposent sur la reconnaissance d’intérêts mutuels, on constate pourtant que les deux formes de dialogue sont associées, notamment dans les pratiques au quotidien, sans que l’une ne vienne se substituer à l’autre. Le patronat et les syndicats ont des intérêts différents mais finalement convergents à articuler ces deux formes de participation. La conviction que nous défendons dans cet ouvrage est que chaque partie – patronale et syndicale – particulièrement en France, a un chemin à faire pour associer intelligemment ces deux dialogues dont les visées sont complémentaires.
La vocation du dialogue social au sein de l’entreprise est, et restera, celle de rechercher des compromis dans les domaines économique et social, et d’organiser la solidarité au sein des collectifs de travail, au travers de dispositions conventionnelles visant à réduire les inégalités de traitement entre statuts et à supprimer les inégalités entre genres ou origines ethniques. Il permet d’uniformiser et d’améliorer les conditions de travail des collectifs.
De son côté, la participation des travailleurs dans le cadre de l’exécution quotidienne du travail (le dialogue professionnel), sous quelque forme que ce soit, demeure un préalable essentiel à la valorisation et à la motivation des personnes, au développement de leurs compétences et à la réalisation de leur bien-être au travail. Elle permet des améliorations en continu de la qualité, du contenu et de l’efficience du travail, accroît l’autonomie des personnes et donne du sens à leur travail. De cette manière, la participation directe des salariés contribue à la performance de l’entreprise via l’accroissement des capacités d’initiative et « d’apprenance » de ses membres, l’organisation augmentant ainsi son adaptabilité et sa réactivité.
La plupart des entreprises développent des formes de participation, mais les niveaux d’implication des salariés (participation directe) et de leurs représentants (participation indirecte) sont très variés, allant de la simple diffusion d’informations à une réelle participation aux décisions prises par les dirigeants. Ces formes dépendent directement de la culture managériale et des modes de fonctionnement à l’œuvre dans l’organisation. Les différences au sein de l’Union européenne sont également significatives, attestant d’une dimension culturelle des systèmes de relations sociales qui influence les formes de participation.
Outre les facteurs culturels, il existe d’autres facteurs objectivables faisant obstacle au développement conjoint de ces deux formes de participation. Plusieurs études1 montrent que les grandes entreprises sont plus centralisées que par le passé, ce qui entraîne de manière parallèle une centralisation du dialogue social incluant les négociations et le fonctionnement des instances de représentation du personnel. Dans la grande majorité des organisations privées ou publiques, les décisions stratégiques et les grands choix organisationnels sont pris au niveau central, laissant peu ou pas de marges de manœuvre à l’encadrement intermédiaire et aux travailleurs. En outre, certains choix organisationnels sont de plus en plus structurés par des systèmes d’information difficiles, voire impossibles à remettre en cause au niveau du terrain. Les intentions louables affichées en faveur d’une plus grande participation et autonomie des salariés, entrent ainsi en tension avec : une complexification accrue des processus (externalisation partielle des activités, découpage plus poussé des tâches, renforcement des contraintes de conformité, etc.) ; une recherche de productivité à court terme ; le maintien de tendances bureaucratiques ; un management fondé principalement sur des processus décisionnels descendants ; une culture du contrôle à partir d’indicateurs de résultats éloignés des réalités du travail, ou encore des outils de gestion rigides empêchant les adaptations locales. En particulier, la participation effective des salariés aux décisions impactant leur travail impliquerait un management davantage basé sur la subsidiarité, et cette transformation de la posture managériale tarde à advenir en maints lieux. De leur côté, les syndicats, qui ont souvent perdu le soutien de la base des travailleurs, doivent instaurer de nouveaux dispositifs d’écoute des salariés, sortir d’une posture strictement « politique » de revendication ou de combat, et s’engager plus activement sur les questions d’organisation du travail réel pour soutenir le développement du pouvoir d’agir des salariés.
Aucun acteur ou partie prenante de l’entreprise ne peut prétendre, à lui seul, détenir les bonnes solutions ou les critères permettant de lier bien-être des salariés et performance de l’entreprise. Si les États et l’Union européenne peuvent donner une impulsion, il revient aux partenaires sociaux de chercher toutes les formes de dialogue propices au développement des personnes et des organisations.
À travers quelques exemples issus de différents pays européens, cet ouvrage invite à une réflexion sur les pratiques de participation et sur leur possible articulation. Il en montre la complexité, la diversité et l’étendue, au prisme d’un regard européen. Souvent idéalisée au travers de pratiques managériales dites innovantes, la participation ne se développe pas sans contraintes, tensions ou résistances pouvant venir de toutes parts. Les prendre en considération est nécessaire pour ouvrir réellement de nouvelles perspectives. Nous verrons comment le dialogue professionnel peut être favorisé et organisé, et comment il peut rejaillir positivement sur le climat du dialogue social. Nous verrons aussi comment les syndicats pourraient se renouveler par la prise en compte dans le dialogue social de certaines problématiques issues du dialogue professionnel. In fine, l’enjeu commun à toutes les formes de participation reste l’amélioration de la qualité du travail comme vecteur de bien-être des travailleurs et de performance de l’entreprise.
- 1 ‒ Par exemple : Évolution des comités d’entreprise : effets et usages des nouveaux outils de consultation issus de la Loi de Sécurisation de l’Emploi (LSE), Rapport de l’IRES en partenariat avec le groupe Alpha, Orseu et Syndex, 2016.
Les dimensions de la participation et de l’autonomie au travail
Les participations directe et indirecte ont des finalités communes mais des histoires différentes. Le dialogue social a des racines anciennes et des objectifs bien intégrés, quand la participation directe, rarement inscrite dans les règles nationales, présente des enjeux plus difficiles à cerner. La participation directe correspond néanmoins à une forte attente des salariés.
Qu’est-ce que la participation des salariés ?
Les deux types de participation
Les deux grands types de participation − indirecte et directe − ont été définis par des instances européennes et internationales. Pour Eurofound (agence tripartite de l’Union européenne), « la participation indirecte des salariés désigne l’implication des représentants du personnel dans les processus de prise de décisions, tandis que la participation directe des salariés décrit l’interaction directe entre les employeurs et les salariés » (Eurofound, 2015). L’OCDE (2019) distingue la parole directe (workers’ voice) et la parole représentée (representative voice). La parole directe « correspond aux différentes formes de communication institutionnalisées entre travailleurs et managers pour aborder des problèmes collectifs. La parole offre également aux employés la possibilité de résoudre les problèmes émergents sur le lieu de travail grâce à la communication avec la direction. » Les « dispositions relatives à la voix représentative comprennent des représentants syndicaux locaux (nommés par le syndicat ou élus par les travailleurs), des comités d’entreprise (généralement un organe légalement établi élu ou nommé par tous les travailleurs de l’entreprise, indépendamment de leur affiliation à un syndicat), ou des représentants des travailleurs (élus ou nommés parmi les travailleurs, syndiqués ou indépendants). »
En résumé, la participation directe des salariés recouvre principalement les niveaux d’autonomie octroyés aux individus et collectifs de travail, et les différentes formes de consultation sur le travail. La participation indirecte, via les représentants du personnel, est déterminée par le système de relations sociales et de négociations collectives (d’entreprise, de branche, interprofessionnel, national), ainsi que par les institutions de représentation des salariés (CSE, administrateurs salariés…), en grande partie inscrits dans les législations nationales.
L’interaction entre ces deux formes de participation peut être appréciée qualitativement. Selon une étude de l’OCDE, « au niveau de l’entreprise, les formes d’expression “directes” et “mixtes”2 sont associées à un environnement de travail de meilleure qualité (par rapport à l’absence de voix). En revanche, la présence de représentants des travailleurs dans les entreprises où il n’existe pas de moyens parallèles d’échange direct entre travailleurs et dirigeants n’est pas associée à un environnement de travail de meilleure qualité » (OCDE, 2019). Un lien est donc ici posé entre l’existence d’un dialogue professionnel dense au quotidien et un dialogue social de qualité. C’est l’association du dialogue professionnel et du dialogue social qui est la plus susceptible de produire un travail de qualité.
L’étendue de la participation directe
Le dialogue social a des racines anciennes ; son principe et ses modalités de mise en œuvre sont largement encadrés à la fois par des conventions internationales (OIT) et par les législations nationales, ce qui ne l’empêche pas d’être parfois hautement dysfonctionnel. Le dialogue professionnel, lui, est beaucoup plus rarement inscrit dans les règles nationales.
Dans ses enquêtes européennes, Eurofound (Ibid.) a établi six niveaux de participation directe des salariés :
i la participation directe limitée des employés : l’information est diffusée par des réunions régulières entre les employés et le manager de proximité, ainsi que par des bulletins d’information, des sites web, etc. ;
ii la participation conventionnelle directe des employés : la communication entre les employés et la direction se fait principalement dans les interactions conventionnelles − réunions régulières entre les employés et les managers de proximité, ou réunions régulières du personnel ouvertes à tous les employés ;
iii la participation directe des employés à la demande : a communication entre la direction et les employés se fait dans des contextes traditionnels (rencontres régulières entre les employés et leur manager de proximité et diffusion de l’information par des médias tels que des bulletins d’information ou des sites web). En outre, lorsque cela est nécessaire, la communication entre les employés et la direction se fait dans des groupes ad hoc ;
iv la participation consultative directe des employés : communication hiérarchique traditionnelle (réunions régulières entre les employés et le manager de proximité et diffusion de l’information par le biais de médias tels que les bulletins et les sites web), en mettant fortement l’accent sur les moyens de communication entre l’employé et la direction (systèmes de suggestion et sondages auprès des employés) ;
v la participation directe étendue des employés Type I : pratiques qui facilitent la communication entre la direction et les employés comme la transmission d’informations descendantes aux employés et la consultation ascendante (collecte d’idées et commentaires des employés). Tous les moyens d’interaction identifiés avec les employés sont déployés dans cette classe ;
vi la participation directe étendue des employés Type II : les pratiques de cette dernière classe sont assez similaires à celles de la classe précédente. Cependant, dans cette classe, la communication via les canaux de masse − tels que les médias sociaux et les sondages − est utilisée plus fréquemment.
Utile pour effectuer des comparaisons européennes, cette classification est insuffisante pour instruire une démarche de participation directe dans les entreprises, car les définitions du rôle décisionnel des salariés sont vagues, y compris au dernier niveau. Elle ne permet pas non plus d’évaluer le réel pouvoir d’influence des salariés sur leur poste de travail ou plus largement sur l’organisation du travail.
Eurofound ne s’en tient d’ailleurs pas à cette typologie. Faisant référence à divers auteurs, l’agence soutient le principe d’un continuum de participation allant du niveau inférieur où les employés « ne reçoivent aucune information sur les décisions imminentes qui permettraient de participer », au niveau le plus élevé où ceux-ci « se voient attribuer un pouvoir de décision, en leur accordant le droit de veto sur les décisions ou par une délégation totale du pouvoir de décision aux salariés ». Eurofound retient notamment la définition de John Geary et Keith Sisson (1994) pour lesquels la participation directe recouvre « les opportunités que le management donne ou les initiatives qu’il soutient sur le lieu de travail par la consultation et/ou la délégation de responsabilités et d’autorité, pour la prise de décision par leurs subordonnés, aussi bien en tant qu’individus qu’en tant que collectifs de travail, liés à la tâche de travail immédiate, à l’organisation du travail et/ou aux conditions de travail ». Dans d’autres publications, comme dans son rapport 2013 sur l’organisation du travail et l’implication des salariés en Europe (Eurofound, 2013), qui s’appuie sur les données de la cinquième enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS 2010), Eurofound caractérise aussi les organisations selon que l’influence des employés porte uniquement sur leur tâche, ou sur des dimensions plus larges de l’organisation du travail (figure 1.1).
Figure 1.1 – Classification des organisations selon le niveau de participation des travailleurs sur leurs tâches et sur l’organisation du travail
Source : Eurofound.
Enjeux et finalités de la participation des travailleurs
La participation repose avant tout sur le socle culturel de management et de fonctionnement de l’entreprise. Celui-ci peut aller d’un fonctionnement autoritaire ou hiérarchique à un fonctionnement « démocratique » associant les salariés et leurs représentants aux prises de décision. La participation est forcément très limitée dans les situations où l’évolution des organisations est définie à l’extérieur des collectifs de travail mais peut à l’inverse prendre tout son sens lorsque les changements font l’objet d’expérimentations ou de boucles de régulation entre les décideurs et les opérationnels. Les effets de la participation seront ainsi significativement différents selon que l’entreprise intègre peu ou prou les concepts de l’organisation apprenante.
Si, au niveau mondial, les différences de management et d’organisation ont eu tendance à se niveler sous l’effet de la globalisation des chaînes de valeur, la notion de participation des salariés paraît bien adaptée aux évolutions contemporaines de l’environnement des affaires. Comme le note Carla I. Koen (2005), « la structure mécaniste (hiérarchique, centralisée, formalisée) s’adapte à un environnement stable car une approche hiérarchique est efficace pour les opérations de routine », alors que « la structure organique (participative, décentralisée, non formalisée) s’adapte à un environnement instable et à des situations de forte incertitude des tâches » − ce qui est le cas aujourd’hui.
Mais la participation a également pour vertu de permettre l’adaptation de la culture managériale dominante aux spécificités des situations locales qui subsistent toujours3. En se fondant sur les travaux de Geert Hofstede et Shalom Schwartz, Koen relève ainsi des différences qui tiennent aux cultures locales, y compris au sein des pays occidentaux, portant par exemple sur : les rapports d’autorité ou la distance hiérarchique, les rôles sociaux de genre, la confiance entre les individus eux-mêmes et avec les managers et dirigeants, l’autonomie ou la capacité des individus et collectifs à expérimenter de nouvelles façons de faire, la prise de risques, l’attitude face à l’incertitude, la gestion des conflits. La participation permet ainsi d’infléchir des principes généraux de management, en les adaptant localement pour permettre leur fonctionnement. Dans un livre récent (Verna, 2021), Alain Verna, patron de l’usine Toshiba TEC de Dieppe, explique comment, avec la participation directe des équipes, il a réussi à retourner le concept de « Total Productivity Patrol » imposé par la direction japonaise. Dans la logique japonaise, la TP patrol est une patrouille d’inspection des ateliers par les équipes de direction. « Toute anomalie constatée par la patrouille sera pointée du doigt et matérialisée par le positionnement d’un post-it jaune sur l’objet du délit… Un outil pas à sa place, post-it ! Un poste de travail mal ordonné, post-it ! […] Nous imaginons les salariés japonais s’excuser en courbant l’échine et s’empresser de remédier aux causes des remontrances qui leur sont ainsi faites aux yeux de tous, au risque de perdre la face devant leurs collègues et leurs supérieurs… Nous allons devoir expliquer à nos zélés amis japonais que ce mode de fonctionnement n’est pas envisageable chez nous et qu’il leur faudra sans doute renoncer à cette idée » (Verna, 2021, p. 64-65). Mais devant l’insistance japonaise, Alain Verna décide de proposer un concept alternatif : les « visites TP ». La patrouille TP, faite de reproches et de vexations, devient une visite planifiée de l’équipe de direction au cours de laquelle les opérateurs exposeront les améliorations dont ils ont eu l’idée et qu’ils ont contribué à mettre en place. Un principe du lean inadapté à la culture locale devient ainsi une occasion de participation directe dans laquelle les auteurs du progrès continu exposent leur démarche avec fierté.
Les enjeux de la participation directe sont aussi différents selon les acteurs considérés. Pour les employeurs, et notamment dans les phases de grands projets, la participation directe des salariés constitue un élément d’une bonne conduite du changement. Elle facilite l’adhésion des salariés et favorise une optimisation de l’organisation future de travail, en recherchant des solutions qui tirent parti de leur expérience. Pour les employés, la participation constitue une source d’épanouissement au travail à condition qu’ils soient écoutés et entendus. Elle offre « aux employés la possibilité de résoudre les problèmes émergents sur le lieu de travail grâce à la communication avec la direction » (OCDE, 2019).
Plus essentiellement, les participations directe et indirecte visent à soutenir la qualité du travail dans trois dimensions majeures : le développement des personnes et des organisations, la qualité des produits et services et la qualité de l’environnement (voir figure 1.2).
Figure 1.2 – Enjeux et finalités de la participation des salariés
Développement des personnes et des organisations
Le développement des personnes suppose « la mise en place de situations d’action qui favorisent la réussite et l’acquisition ou la construction de savoir-faire, de connaissances, de compétences » ; le développement des organisations implique « des processus réflexifs, ouverts aux capacités d’innovation des opérateurs eux-mêmes » (Falzon, 2013).
La participation contribue à donner du sens au travail, en permettant d’associer celles et ceux qui conçoivent le changement et celles et ceux qui seront chargés de le mettre en œuvre4. Elle vise à renforcer la coopération et la cohésion au sein des équipes, et à agir sur les représentations collectives du travail de manière à favoriser leur convergence. Elle conduit à accorder une plus grande place à la dimension subjective au travail et à la nécessité de l’intégrer à une compréhension de l’activité de travail. Elle pose comme principe que l’individu est digne de confiance car il possède les ressources pour faire un travail de qualité et pour développer ses capacités et compétences, son autonomie et son engagement. Elle permet d’aborder différemment les liens entre le travail et la santé en reconnaissant « le rôle actif de l’opérateur dans la construction des modes opératoires les moins défavorables possible à sa santé, et les cas où cette tentative est tenue en échec au fil du temps » (Guérin et al., 2021). Elle représente donc une dimension essentielle du bien-être au travail. Avec l’allongement de la durée de la vie et la tendance au recul de l’âge du départ à la retraite, la participation favorise l’employabilité tout au long de la vie professionnelle qui « est une combinaison de trois éléments : la santé, la motivation ou l’attitude envers le travail et l’apprentissage, et la compétence » (van Klaveren et al., 2020).
Ce développement des personnes forme une boucle vertueuse avec le développement des organisations, incluant la performance de celles-ci. En favorisant l’apprentissage continu, la participation permet aux individus et aux collectifs de travail de sortir des routines du travail et de modifier leurs habitudes. Avec la participation, et selon le principe de l’organisation apprenante, c’est toute l’organisation qui s’inscrit dans un processus continu d’apprentissage, qui apprend de son expérience comme des pratiques de communautés externes, qui s’adapte à l’évolution de l’environnement, qu’il s’agisse de l’évolution des technologies, de l’évolution des besoins des clients ou usagers, des nouvelles normes ou impératifs environnementaux à intégrer.
Cette approche doit conduire à mieux prendre en compte et débattre de la valeur du travail et de la sollicitation des ressources humaines dans cette création de valeur. Pour Guérin et al. (2021), « l’évaluation du travail nécessite donc un dispositif contradictoire », car une organisation peut être « capable de créer de la valeur en engageant la ressource au plus bas coût pour elle, et dégrader en même temps la disponibilité de la ressource qui reste… et hypothéquer ainsi son développement à venir ». Ainsi que nous le développerons au chapitre 4, la participation, à tous les niveaux de l’organisation, doit permettre d’organiser le débat sur les critères de qualité et de reconnaître la performance dialogique (Bonnefond, 2016).
Qualité des produits et services
En ayant commencé par décrire la finalité du développement des personnes et des organisations, nous posons celle-ci comme une condition à la satisfaction des clients, usagers ou patients. L’entreprise opère des arbitrages à plusieurs niveaux hiérarchiques entre la qualité, la productivité, les délais et les coûts. Ce que la participation apporte ici, c’est une discussion plus large sur les critères de qualité basés sur les réalités du travail. Il s’agit tout d’abord de ce qui est mis en œuvre par les opérationnels en écart ou non avec les standards : des procédures non suivies ou détournées, des décisions prises à partir de l’expérience, des intuitions par rapport à des situations déjà rencontrées. Ce travail invisible pour atteindre les résultats demandés requiert souvent un engagement ou des savoir-faire non reconnus. Ce sont aussi des défauts cachés pour ne pas détériorer les indicateurs. Ce sont enfin des arbitrages en faveur des coûts ou des délais au détriment de la qualité qui, dans des situations extrêmes, peuvent produire des risques sanitaires ou des risques pour la sécurité des travailleurs et des populations.
Le débat sur les critères de qualité, préconisé par de nombreux acteurs, et tout particulièrement par Yves Clot du Cnam, vise à sortir d’une ingénierie classique de la qualité, c’est-à-dire d’une qualité réglée, basée sur l’application stricte des standards ou consignes. Impliquer activement les travailleurs par le biais d’une participation directe n’est donc pas seulement un moyen d’améliorer le travail et la santé. C’est aussi un moyen de prendre en considération les clients. Les employés de service, en particulier, ont beaucoup de connaissances directes sur les points de vue des clients, sur la qualité des services attendus, qu’ils peuvent introduire dans l’organisation. Les points de vue des clients sur les produits et services peuvent ainsi, via les employés, se transformer en changements et ajustements innovants des processus. Chaque travailleur et chaque manager devrait pouvoir dire ce qu’est un travail bien fait pour le client, que celui-ci soit interne ou externe à l’entreprise.
Qualité de l’environnement
L’impératif de la transition écologique est intégré par nombre d’acteurs dans les entreprises comme du côté syndical. Les entreprises s’y engagent à travers leur politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Celle-ci fait l’objet de discussions et consultations dans le cadre des instances de représentation du personnel ou au sein des conseils d’administration. Ce que nous pointons, dans ce domaine comme dans d’autres, c’est la verticalité des processus décisionnels laissant une faible place à la participation directe des salariés. Les jeunes générations y sont certainement plus sensibles, mais les préoccupations écologiques gagnent progressivement l’ensemble de la population des salariés. Une enquête réalisée en France par le groupe Cegos en 2021 auprès de collaborateurs et responsables de la RSE montre que 72 % des collaborateurs estiment que l’entreprise devrait associer davantage les collaborateurs à ses réflexions sur la RSE et ses enjeux. 57 % de ceux-ci estiment que la RSE est d’abord une démarche de communication, contre 43 % qui y voient un engagement sincère de l’entreprise.
Quels cadres de pensée pour développer la participation ?
Les approches favorisant la participation directe au travail ne peuvent être portées sans s’interroger d’abord sur la manière dont l’organisation du travail est conçue (processus, procédures, modes de management, dispositifs techniques, systèmes d’information). Au fil des époques, différents cadres de pensée ont influencé les modalités d’organisation du travail et leur lien avec la participation des travailleurs. Parmi celles-ci, on retiendra la démarche sociotechnique qui a eu une grande influence dans les pays du nord de l’Europe et qui présente encore aujourd’hui un intérêt particulier dans le contexte des projets de transformation technologique affectant l’organisation du travail et les emplois. L’autonomie au travail est un aspect essentiel de la démarche sociotechnique. Elle va de pair avec la participation directe des employés qui est le processus par lequel l’autonomie advient. Enfin, la participation doit être pensée dans deux contextes d’action à articuler : le progrès continu et les transformations plus radicales.
La démarche sociotechnique
Dans les années 1950, syndicalistes et chercheurs (et dans une certaine mesure des employeurs tournés vers l’avenir) ont uni leurs forces en quête d’organisations humanistes du travail, visant à proposer aux travailleurs des tâches enrichies. La démarche sociotechnique peut être vue comme une réaction à des écoles de pensée antérieures qui mettaient l’accent soit sur les aspects techniques de l’organisation du travail (la gestion scientifique du travail de F. W. Taylor), soit sur ses aspects sociaux (l’École des relations humaines). Elle vise à intégrer ces deux approches dans un paradigme unique d’« optimisation conjointe » pour faire émerger des organisations du travail qui soient à la fois innovantes et porteuses d’une bonne qualité de l’emploi.
Les précurseurs de ce mouvement ont été les chercheurs du Tavistock Institute of Human Relations basé à Londres, tels qu’Eric Trist, Fred Emery et Ken Bamforth, qui ont inspiré des expériences de groupes (semi) autonomes, notamment dans l’exploitation minière (Socio-Technical Systems Design ou méthode sociotechnique − STSD ou ST).
Plusieurs variantes de la méthode sociotechnique se sont diffusées en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Elles ont notamment trouvé une large application dans la formation des cadres et des représentants des travailleurs. Dans les années 1960 et 1970, ces variantes ont bénéficié d’un contexte favorable en Scandinavie, principalement en Norvège et en Suède, où elles ont été influentes. Dans un contexte de plein-emploi et de dynamisme économique, les employeurs de l’industrie manufacturière estimaient en effet que des organisations moins hiérarchisées et une meilleure qualité du travail représentaient une solution à l’absentéisme élevé et aux pénuries de main-d’œuvre. De leur côté, les syndicats scandinaves considéraient les pratiques de changement fondées sur la sociotechnique comme des moyens d’acquérir de nouveaux droits sociaux et d’atteindre ce qu’on appelait à l’époque la « démocratie industrielle ».
Durant la période 1962-1969, les programmes norvégiens pour la démocratie industrielle, guidés par Fred Emery et Einar Thorsrud, ont généré de nombreux effets d’apprentissage. Premièrement, ils ont conduit au développement de méthodes et à la diffusion de résultats de recherches-actions cherchant à conjuguer plus d’efficacité et plus d’autonomie pour les salariés. Pour ne citer qu’un exemple, une recherche-action dans le transport maritime norvégien avait montré que l’augmentation de l’autonomie des marins nécessitait préalablement une refonte de l’organisation du navire et une nouvelle répartition des responsabilités. Fait intéressant : lorsqu’ils ont officiellement pris fin, certains projets de changement ont été « repris » et poursuivis par des groupes de travailleurs. Deuxièmement, les chercheurs et syndicalistes impliqués dans des projets basés sur la sociotechnique ont stimulé des évolutions législatives, notamment la loi suédoise sur la codétermination au travail (MBL, 1976) et celle de 1977 sur l’environnement de travail.
Dans les années 1980, la méthode ST a été expérimentée avec succès chez Volvo, permettant de mesurer des écarts de productivité significatifs entre des lignes classiques et celles utilisant la démarche sociotechnique. Toutefois, les limites de cette dernière sont devenues visibles lorsqu’en 1993, la direction de Volvo a rendu publique la fermeture des usines d’Uddevalla et de Kalmar dans lesquelles elle avait été mise en œuvre. À cette occasion, a été pointé du doigt l’un des talons d’Achille de l’industrie automobile suédoise, à savoir le manque de dialogue sur le lieu de travail axé sur l’amélioration et l’innovation : « Les dialogues sur le lieu de travail avec une portée, une ampleur et une intensité comparables au modèle japonais, font encore défaut en Scandinavie » (Gustavsen, 1993).
En dépit de ces controverses, la culture sociotechnique a mieux résisté et est restée plus vivace dans les pays scandinaves. Aux Pays-Bas, des éléments de celle-ci ont été repris dans une loi sur les conditions de travail, mais n’en sont pas mieux appliqués pour autant. Cela apporte une fois de plus la preuve que les prescriptions légales ne garantissent en rien des pratiques sociales dynamiques.
L’autonomie au travail
L’autonomisation est un processus de participation directe des salariés − individuellement et collectivement au sein d’une équipe − aux prises de décision concernant leur travail, sans autorisation de niveaux hiérarchiques supérieurs ou de fonctions supports. L’autonomie accroît le niveau de responsabilités des individus et collectifs de travail.
Eurofound (2016) évalue l’autonomie au travail en considérant trois dimensions : l’utilisation des compétences et la « discrétion » (latitude décisionnelle) ; la participation organisationnelle ; le travail en équipe.
L’utilisation des compétences et la latitude décisionnelle discrétionnaire permettent d’influencer la façon dont le travail est effectué et favorisent le développement des travailleurs à travers l’expérience de travail. Cette première dimension est évaluée par : i) la possibilité de choisir ou de modifier l’ordre des tâches ; ii) la possibilité de choisir ou de modifier la vitesse ou le rythme de travail ; iii) la capacité de choisir ou modifier les méthodes de travail ; iv) la possibilité d’avoir son mot à dire dans le choix des collègues de travail.
La participation organisationnelle « signifie les possibilités qu’ont les travailleurs de prendre part aux décisions organisationnelles qui affectent leur travail, en particulier la capacité des travailleurs à influencer les décisions en tant qu’individus plutôt que par l’intermédiaire de leurs représentants ». Elle est évaluée par : i) être consulté avant que les objectifs ne soient fixés pour son propre travail ; ii) être impliqué dans l’amélioration de l’organisation du travail ou des processus de travail de son propre service ou organisation ; iii) avoir la capacité à influencer les décisions importantes concernant le travail.
Les équipes autonomes sont « reconnues pour leur potentiel d’amélioration des performances organisationnelles, pour une meilleure utilisation des connaissances tacites des employés et pour l’amélioration de la communication des employés avec les acteurs extérieurs à leur groupe ». Elles sont évaluées par le pouvoir donné aux membres de l’équipe de décider à la fois de la répartition des tâches, du chef de l’équipe et du déroulement temporel des tâches.
Dans un ouvrage consacré à la qualité de vie au travail, E. Bourdu, M.-M Péretier et M. Richer (2016) proposent un modèle de l’autonomie au travail en trois niveaux (voir aussi figure 1.3), définis comme suit :
Niveau 1 : la définition des tâches que les travailleurs ont à effectuer, déterminée par la latitude dont ils disposent pour intervenir sur le séquencement de leurs tâches, la méthode d’exécution, le rythme de travail, les outils utilisés.
Niveau 2 : l’environnement organisationnel du collectif de travail dans lequel ils évoluent, déterminé par la possibilité d’implication dans l’amélioration de l’organisation du travail de leur équipe, la capacité à influer sur les décisions qui concernent leur travail, la marge de manœuvre pour définir les modes de coopération dans le travail.
Niveau 3 : leur implication dans la gouvernance de leur entreprise, rôle et place du dialogue social, importance de la négociation par rapport à la simple information et consultation, degré d’influence sur le partage de la valeur créée, mise en œuvre d’un mode de management participatif, présence de représentants des salariés dans les organes de gouvernance.
Figure 1.3 – Les trois dimensions de l’autonomie au travail
Source : Adapté de Bourdu, Pérétié, Richer, 2016.
En reprenant ce modèle dans leur ouvrage, T. Weil et A.-S. Dubey (2020) notent que « l’autonomie est majoritairement cantonnée aux modalités d’exercice du travail, qu’elles soient individuelles (manière d’exercer la tâche) ou collectives (règles de fonctionnement, modalités de la coopération), c’est-à-dire au comment, mais qu’elle porte rarement, ou à la marge, sur le quoi, c’est-à-dire sur l’activité elle-même (business model de l’entreprise, stratégie, objectifs) ».
Le progrès continu et les changements radicaux
Quelques entreprises comme Toyota, initiatrice de la démarche de lean management, ont développé une réelle démarche de progrès continu basée sur la participation directe des salariés, tout en opérant à une fréquence régulière des changements plus radicaux. Les deux démarches, kaizen pour l’amélioration continue et kaikaku5 pour les changements plus profonds, s’articulent entre elles. Nous renvoyons sur ce point aux nombreux ouvrages sur le lean management (en particulier, Sailly, 2017).
Beaucoup d’entreprises fonctionnent avec des transformations répétées et parfois contradictoires au rythme des changements de dirigeants ou d’actionnaires. Quand les restructurations sont ininterrompues, imposées d’en haut ou de l’extérieur, dépourvues d’explications ou de sens perceptible, les salariés en ressortent fragilisés. Ainsi en témoigne l’actuel président de Michelin, Florent Menegaux : « Quand vous n’avez pas de croissance pendant dix ans, vous êtes en restructuration permanente. C’est très mauvais pour le moral de tout le monde.6 » Ces changements peuvent être sources de stress lorsque les salariés ne disposent plus momentanément des ressources pour faire face aux nouvelles situations de travail ou doivent acquérir rapidement de nouveaux savoir-faire. Ils peuvent déstabiliser les collectifs de travail et décourager les tentatives et efforts entrepris par le management pour développer le dialogue professionnel.
Le dialogue professionnel s’épanouit plutôt dans des périodes de stabilité et dans le cadre du progrès continu. Le dialogue social est davantage sollicité dans le contexte de changements radicaux ou de projets industriels. Quand il existe dans l’entreprise une tradition de dialogue professionnel, celui-ci peut ensuite venir reprendre sa place pour corriger les insuffisances ou les défauts du projet de transformation. En qualité de P.-D.G. de l’usine de Dieppe de Toshiba TEC Europe, Alain Verna témoigne ainsi du fait que les démarches de progrès continu sollicitant la participation, très bien implantées dans cette entité industrielle, filiale d’un groupe japonais, ont souvent été mises en pause lorsque les circonstances de marché ou les stratégies de la maison-mère conduisaient à mettre en première ligne d’autres priorités. Du fait des routines acquises, elles ont cependant pu être réactivées ultérieurement (Verna, 2021).
- 2 ‒ C’est-à-dire où les représentants des travailleurs coexistent avec un dialogue direct entre travailleurs et managers.
- 3 ‒ Voir sur ce sujet, le tout récent ouvrage : D’Iribarne P. et al. (2022), Cultures et management international : un nouveau paradigme, Presses des Mines.
- 4 ‒ La Chaire FIT2 de Mines ParisTech a nommé cette approche le « design du travail »© (Voir Pellerin et Cahier, 2021).
- 5 ‒ Kaikaku est une notion japonaise signifiant « changement brutal ».
- 6 ‒ Conférence organisée par La Fabrique des Leaders éclairés en avril 2021.
Les logiques du dialogue social et du dialogue professionnel
Si dialogue social et dialogue professionnel ont des visées partagées, ils reposent toutefois sur des logiques différenciées. Ils interviennent le plus souvent à des temps différents dans la vie de l’entreprise, et n’impliquent pas les mêmes acteurs. En outre, la place accordée à la voix indirecte des salariés pourra être plus ou moins contrainte par le système de relations sociales national, selon que celui-ci est fortement centralisé ou qu’il laisse au contraire des marges de manœuvre importantes aux établissements pour conclure des accords locaux adaptés.
Des temps différents
Si les formes de participation ne sont pas exclusives l’une de l’autre, il existe toutefois des temps de prédominance de l’une sur l’autre (figure 2.1).
La participation dans l’activité quotidienne s’inscrit en principe dans un management dit « bottom-up ». Dans ce cadre, les salariés proposent des changements et influencent leur propre situation de travail. Cette participation dans l’activité quotidienne de travail peut être développée sous l’angle de l’autonomisation ou via des dispositifs de discussion sur le travail (voir par exemple Clot et al., 2021). Dans ce cadre, les syndicats (les représentants des salariés) soutiennent la démarche participative et, dans la mesure du possible, s’assurent qu’elle fonctionne réellement, que les salariés sont écoutés et entendus, mais ils n’interviennent pas directement dans la prise de décision qui relève de la responsabilité des membres des équipes de travail avec leurs managers de proximité.
Lors de l’élaboration d’un projet de transformation important, les participations directe et indirecte devraient en théorie être étroitement imbriquées, mais dans la pratique, c’est la participation indirecte qui prédomine. Celle-ci est en effet encadrée par des obligations réglementaires d’information, de consultation ou de négociation des instances représentatives des salariés, notamment sur les enjeux de métiers, d’évolution prévisionnelle des emplois et des compétences et de conditions de travail. En revanche, les modalités de la participation directe ne sont soumises à aucune règle précise. Il y a donc, dans ce type de période, une priorité accordée de jure et de facto à la participation indirecte ou « voix représentative ».
Figure 2.1 – Phases de participation directe et indirecte selon les temps stratégiques de l’entreprise
Acteurs, limites et marges de manœuvre
Le dialogue professionnel et le dialogue social se déroulent la plupart du temps séparément, avec peu de croisements. En outre, ces deux dialogues n’impliquent ni les mêmes acteurs, ni les mêmes jeux d’acteurs.
Ces derniers peuvent être regroupés en quatre catégories : la direction, les représentants du personnel, les managers et les salariés non managers (figure 2.2).
Figure 2.2 – Les acteurs impliqués dans le dialogue professionnel et social
Les relations, liens et intérêts qui se nouent entre ces différentes catégories d’acteurs sont différents selon qu’il s’agit du dialogue professionnel ou du dialogue social. Lorsqu’elle discute du travail et de son organisation, la direction générale se penche normalement sur les exigences et les perspectives de l’entreprise. La haute direction et les RH parlent de la nécessité de changer « l’état d’esprit » de l’organisation lors de la mise en œuvre de nouveaux modèles d’organisation ou de nouvelles technologies. Les cadres intermédiaires sont fortement occupés par les opérations quotidiennes pour tenir les objectifs de résultat et satisfaire les clients. Les salariés qui ont développé leurs compétences au fil des années ont tendance à adopter une perspective plus « historique », conditionnée par les expériences accumulées. Les représentants des salariés devraient avoir simultanément deux perspectives temporelles : la pérennité de l’entreprise sur le long terme et les conditions de travail sur le court terme. Pour être constructifs, les dialogues doivent favoriser une compréhension des perspectives de chaque catégorie d’acteurs.
Les acteurs impliqués dans le dialogue professionnel
Le dialogue professionnel, tel qu’il s’exerce le plus souvent, concerne essentiellement trois catégories d’acteurs : la direction, les managers et les salariés7.
Direction et salariés
Dans un contexte de transformations accélérées, particulièrement sur un plan technologique, les directions ont conscience que l’adhésion des salariés aux projets de changement constitue un prérequis pour leur réussite. C’est pourquoi, des formes de participation directe sont souvent favorisées ou sollicitées8, avec des niveaux variés allant de la simple consultation à la concertation/délibération (quasiment jamais à la codécision) : il peut s’agir de groupes de travail sur les visions et les valeurs, de larges consultations concernant la raison d’être de l’entreprise, de groupes de travail portant sur la suppression des irritants, d’ateliers de progrès, de mise en place de plateformes d’innovation participative9 ou de groupes consultés pour de nouveaux aménagements des espaces de travail, etc. « Il s’agit dans tous les cas de solliciter une participation directe des salariés qui ne soit pas “intermédiée” par le management, les représentants du personnel ou les syndicats. »
Les directions peuvent aussi vouloir tirer parti des connaissances et expériences des salariés concernés par tel ou tel projet, par exemple via des processus de design thinking préalables à l’introduction d’un nouvel outil numérique et destinés aussi à en favoriser l’appropriation. Ces situations de transformation incitent donc les directions à solliciter la participation, mais toujours sur un périmètre restreint et clairement défini au plus haut niveau.
Il existe aussi une autre forme de dialogue informel entre dirigeants et salariés, qui peut s’ouvrir à l’occasion des visites que les dirigeants font sur le terrain (le Gemba des directions générales). Ces visites participatives permettent aux dirigeants de prendre conscience de la réalité du travail, des difficultés rencontrées mais aussi de la richesse des savoir-faire et des capacités détenues par les salariés pour résoudre les problèmes ou contourner les procédures afin de tenir les objectifs. L’équipe dirigeante doit toutefois veiller à ne pas court-circuiter le management local. Rappelons que l’une des causes majeures de l’abandon progressif des cercles de qualité en France, à la fin des années 1980, a été le désintérêt des managers de proximité qui étaient mis à l’écart du dispositif. Comme les groupes de travail étaient généralement transversaux à plusieurs unités de travail, services ou ateliers, ces managers se retrouvaient en situation d’appliquer des décisions prises ailleurs sans y avoir participé.
Managers et salariés
Dans l’activité quotidienne de travail, le dialogue professionnel se déploie principalement entre managers et salariés. Il peut être spontané ou plus ou moins « organisé », par exemple dans le cadre d’ateliers d’amélioration selon la philosophie lean. La réussite de ce type de dialogue dépend considérablement du modèle de management dominant dans l’entreprise. Lors de la grande enquête de la CFDT « Parlons Travail » en 2016, les salariés étaient 47 % à considérer que leur supérieur direct les aide à mener leur tâche à bien, mais 59 % à affirmer qu’il n’est pas particulièrement soucieux de leur bien-être. Les principaux reproches adressés par les salariés non managers à leurs managers de proximité sont : qu’ils n’ont pas été formés pour exercer cette fonction, qu’ils sont trop distants du travail réel et trop absorbés par les outils de gestion, les tâches de reporting et les réunions (Detchessahar, 2019). Toutefois, le dialogue professionnel entre managers de proximité et salariés est souvent de meilleure qualité que les enquêtes et sondages ne le laissent apparaître.
Les salariés ont la plupart du temps conscience que leur manager direct connaît une large part de leurs problèmes et attentes, mais qu’il n’a pas forcément les moyens de les résoudre. Les managers de proximité sont au cœur de contradictions à assumer entre des processus ou normes de travail imposés d’en haut ou par des fonctions support, et les demandes des équipes de travail. Leurs marges de manœuvre pour réguler les activités sont de plus en plus faibles. Ils sont contraints d’utiliser des outils de contrôle des activités qui ne permettent pas d’intégrer la singularité des situations de travail. Ils sont souvent invités par leurs propres responsables hiérarchiques à cacher les problèmes et à mettre les indicateurs au vert − quand ils en ont la possibilité puisque l’automatisation des outils de pilotage tend à leur retirer même cette autonomie. Cette position intermédiaire se révèle souvent difficile à vivre et pèse sur les vocations à devenir manager.
Faute de pouvoir apporter des réponses satisfaisantes aux membres de leurs équipes, les managers de proximité peuvent en arriver à éviter les discussions avec ceux-ci (communication par e-mail et porte fermée). Seul un salarié sur deux déclare comprendre l’intérêt des changements organisationnels et managériaux majeurs qui ont été opérés dans leur entreprise et seulement 15 % d’entre eux estiment avoir été intégrés à la réflexion sur ces changements. À noter qu’un salarié sur deux aurait souhaité l’être davantage (53 %)10.
Direction et managers
Sous le poids d’injonctions contradictoires, le rôle des managers peine à évoluer franchement alors que celui-ci est crucial pour installer dans la durée des démarches participatives. Noyés par le court terme concernant les objectifs à atteindre, les indicateurs à documenter, les problèmes à résoudre, les managers aux premiers niveaux hiérarchiques descendent l’information sans être armés pour engager la discussion avec les collaborateurs. Cette façon de faire génère de la frustration chez les salariés, une perte de confiance et accentue la distance hiérarchique.
Pour mieux assumer leur rôle, les managers devraient être incités par les directions à avoir leurs propres espaces de dialogue sur le travail, afin de pouvoir confronter leurs difficultés de fonctionnement et élaborer des solutions partagées en termes de management des équipes. Il ne paraît pas possible de développer l’autonomie des équipes sans donner en même temps des marges d’autonomie de décision aux managers de proximité. Il incombe aux directions de permettre ce mouvement.
Dans un nouveau mode d’organisation basé sur la subsidiarité et la participation directe des salariés, les managers assument un nouveau rôle d’organisation et de régulation des activités, d’appui et de conseil pour soutenir l’activité des équipes, et de coordination avec d’autres secteurs de l’entreprise pour le traitement des problèmes et la prise de décision. Ils doivent donc être formés à cette nouvelle posture. La subsidiarité ne signifie pas l’absence de stratégie, d’objectifs et de règles venant des comités de direction ou des fonctions support. Des contradictions sont quasi inévitables entre les directives ou objectifs venus d’en haut et les demandes exprimées par les opérationnels. L’enjeu pour le manager de proximité est justement de pouvoir en débattre avec les membres de son équipe, dans un cadre défini par les directions. Pour rendre cela possible, les directions devraient reconnaître ces constructions propres aux équipes de travail, accepter les écarts ou spécificités dans la manière d’appliquer les standards, et réinterroger leurs modes de contrôle et de digitalisation des processus. Ce travail sur l’application des règles doit alimenter en retour les procédures de travail définies ailleurs dans l’organisation. Ce processus de réélaboration à partir des pratiques collectives de métier peut in fine « faire ressource » pour l’organisation.
Les acteurs impliqués dans le dialogue social
Le dialogue social d’entreprise se décompose lui aussi en trois grandes catégories d’acteurs (directions, représentants du personnel, salariés) et en trois types de relations : les discussions ou négociations entre les représentants du personnel et la direction, d’une part ; la relation des représentants du personnel avec les salariés, d’autre part ; enfin, la consultation directe des salariés par les dirigeants ou les représentants des salariés (le cas échéant).
Représentants des salariés et direction
De même que les managers sont mobilisés par les demandes émanant de la direction, les représentants des salariés sont essentiellement absorbés par le dialogue institutionnel avec la direction de l’entreprise. Dans les grands groupes, à quelques exceptions près, l’agenda social prédéfini occupe presque toute l’attention et la disponibilité des représentants des salariés. Lors des nouveaux projets ou de grandes orientations décidées par la direction générale et sur lesquelles, souvent, ils ont été peu ou pas consultés au préalable, les syndicats se concentrent sur les questions prioritaires d’emploi et de droits sociaux, beaucoup plus que sur le devenir du travail lui-même. Dans leurs négociations sur les aspects qui concernent directement l’organisation du travail, ils se focalisent le plus souvent sur des points précis : aménagement du temps de travail, télétravail, charge de travail et adéquation avec les effectifs, risques psychosociaux, critères d’évaluation, aménagement physique des espaces de travail, etc.
Une recherche (Huzzard et al., 2004) portant sur les relations industrielles conflictuelles ou coopératives dans huit pays occidentaux11, montre que les stratégies syndicales dépendent beaucoup des sujets du dialogue social et des contextes. Il ressort que « les syndicats s’engageront rarement, voire jamais, avec les employeurs sur une base entièrement coopérative ou entièrement contradictoire » (Gregory et Nilsson, 2004,), mais qu’il existe de nombreuses tentatives de recherche de coopération, en particulier sur la question de l’organisation du travail. Ces stratégies coopératives, sur lesquelles nous reviendront au chapitre 4, sont souvent associées à une recherche de renouveau du syndicalisme.
Sur la base de l’expérience suédoise, Gregory et Nilsson notent que lorsque la relation entre les employés et les employeurs « est considérée comme fondamentalement contradictoire et que les parties n’ont pas de terrain d’entente, alors la seule véritable option est la négociation, les accords et toute forme de conflit associée. Si, toutefois, la relation est vue de telle manière que les employés et les employeurs partagent au moins certains intérêts communs, par exemple la survie du développement à long terme de l’entreprise et la conviction que des résultats gagnant-gagnant sont possibles, alors il y a un espace de coopération et l’émergence d’une confiance mutuelle. Le partenariat social, du moins lorsqu’il est sur un pied d’égalité, est ainsi caractérisé par l’ouverture et le principe selon lequel les arguments des parties sont centraux et que ces arguments sont fondés sur les compétences des acteurs sur les sujets en question. »
Pour plusieurs organisations syndicales (syndicats suédois, TUC au Royaume-Uni, FIM-CISL en Italie, certaines fédérations syndicales aux états-Unis), la stratégie de coopération est de plus en plus souvent associée au développement de la participation directe des salariés. Dans les pays occidentaux, il y a donc un espace possible pour un renouveau proactif des stratégies syndicales autour des questions d’organisation du travail et de participation directe des salariés, mais celles-ci restent en grande partie liées aux stratégies patronales.
Syndicats et salariés
La désyndicalisation est un phénomène avéré, difficile à contester en France. En 2019, 10,3 % des salariés étaient membres d’un syndicat, et seulement 7,8 % pour le secteur privé12. C’est l’un des taux les plus bas des pays européens. Les pays nordiques (Danemark, Finlande, Suède) se situent en tête du classement avec des taux proches de 60 %, et l’Italie se différencie aussi avec un taux de 32 %13. Le taux de syndicalisation en France était deux fois supérieur dans les années 1980, et quatre fois supérieur dans les années 1950. Dès 1988, Pierre Rosanvallon notait un paradoxe, à savoir que le déclin de la représentativité syndicale s’accompagnait d’une importance croissante du rôle institutionnel des syndicats (Rosanvallon, 1988, p. 24).
Cette crise du syndicalisme, devenue quasiment un lieu commun depuis les années 1990, est évidemment multifactorielle (Andolfatto, Labbé, 2011) : la transformation des modes de production, la tertiarisation de l’économie et l’évolution des emplois, des formes individualisées de gestion des ressources humaines, une élévation du niveau d’éducation et une démocratisation de l’accès à l’information, l’individualisation de la société, le chômage de masse et la montée du travail indépendant, la crise plus générale de toutes les formes de représentativité, en sont les principaux facteurs explicatifs. Comme l’indique le politologue et directeur du département Opinion de l’Ifop, Jérôme Fourquet14, « on n’a pas la même conscience de classe quand on est à la chaîne chez Renault et quand on est vendeur chez Disney ou qu’on va travailler chez Amazon »15. Mais la crise d’adaptation du syndicalisme est également pointée du doigt : institutionnalisation, professionnalisation du militantisme, conservatisme défensif, division…
À cette désaffection des salariés s’ajoute le phénomène des négociations centralisées qui vient renforcer le sentiment de verticalité des syndicats vis-à-vis des salariés. Bien que le syndicalisme ait essayé depuis de nombreuses années de soutenir l’émancipation des travailleurs comme « sujets » et d’appréhender « l’ouvrier au quotidien avec ses attentes et ses peurs, comme individu autant que comme sujet politique » (Rosanvallon, 2018), le mouvement syndical reste majoritairement prisonnier de sa vocation initiale qui consiste « à encadrer et à canaliser l’indépendance individuelle, à l’articuler avec la sphère collective ». Deux logiques s’affrontent ainsi en permanence pour le syndicalisme : celle de l’émancipation des individus et celle de l’extension des solidarités, ce qui conduit à considérer que « l’individu ne peut s’épanouir qu’enraciné dans une communauté collective » (Maire, 1987). Habitué à organiser la controverse avec les dirigeants, le syndicalisme l’est beaucoup moins pour gérer les singularités des collectifs de travail et des individus qui composent ces collectifs.
L’intervention syndicale sur l’organisation du travail doit viser le développement des « capabilités » qu’a un individu « de faire les choses qu’il a des raisons de valoriser » (Sen, 2010). Elle permet de conjoindre les intérêts des individus et du collectif, et ainsi pour le syndicalisme de renouer plus largement avec sa base sociale. Cela suppose que les directions et les représentants du personnel puissent s’entendre pour mettre en œuvre les changements organisationnels selon une démarche expérimentale associant les salariés.
Il faut aussi s’interroger sur le champ d’intervention du syndicalisme qui a tendance à s’élargir à l’intérieur de l’entreprise, avec de nouvelles obligations de négociation d’une part, et d’autre part à l’extérieur, par des représentations dans une multitude d’institutions de la protection sociale, de la formation professionnelle, de l’emploi, des conditions de travail, du logement… Les syndicats sont alors confrontés à un double défi : être une force de propositions sur de nombreux dossiers et garder le contact avec la base.
Directions, syndicats et salariés
Enfin, dans le cadre de négociations d’accords collectifs d’entreprise (dialogue social), les directions (comme d’ailleurs les syndicats) peuvent faire appel à la consultation directe des salariés pour faire valider ou refuser des accords d’entreprise ou pour créer un rapport de force favorable auxdits accords, lorsque le dialogue social est considéré dans une impasse. C’est typiquement le cas des référendums d’entreprise. Nous avons dit en introduction que cette modalité de « participation directe » n’a que peu à voir avec le dialogue professionnel et constitue un recours éminemment politique, généralement très mal vécu par les syndicats, et susceptible de miner durablement la confiance entre les parties. C’est donc souvent un « fusil à un coup » à manier avec la plus extrême prudence.
Le rôle du système de relations sociales
Le système de relations sociales peut peser positivement ou négativement sur la participation directe.
L’OCDE (2019) a classé ses pays membres à partir de quatre variables principales qui structurent leur système de relations sociales : le niveau dominant de négociation (entreprise, sectoriel, interprofessionnel, national), le degré de centralisation/décentralisation, la coordination entre plusieurs niveaux de négociation et la qualité générale des relations sociales (figure 2.3).
Figure 2.3 – Classement des pays selon leur système de négociation collective
Source : OCDE.
La notion de décentralisation dépend « des règles régissant la hiérarchie entre les différents niveaux et la possibilité pour les entreprises de déroger aux accords de niveau supérieur ou de se désengager de leur propre accord en cas de difficultés économiques. En particulier, les systèmes fondés sur des négociations au niveau sectoriel ou national/intersectoriel ne sont pas nécessairement centralisés. Ils peuvent l’être, s’ils ne laissent pas ou peu de place pour modifier les termes des accords au niveau inférieur ; ou ils peuvent être décentralisés lorsque les accords au niveau de l’entreprise jouent un rôle important dans la détermination des conditions d’emploi, tout en étant soumis à des conditions spécifiques fixées soit par la loi, soit par les partenaires sociaux eux-mêmes. » La coordination mesure en particulier la proximité des formes de négociation aux différents niveaux et la confiance réciproque dans leur articulation.
Publiée en 2019, l’étude de l’OCDE se base, pour la France, essentiellement sur des données de 2015. Or, depuis 2015, le droit du travail en France a évolué (loi El Khomri, ordonnances Macron) en introduisant une dose de décentralisation du système de négociation et la possibilité de déroger partiellement (de façon très encadrée et sur des sujets limitativement énumérés) au droit du travail par des accords d’entreprise. Le rapport du comité d’évaluation de ces ordonnances relève que « les branches se sont peu saisies des dispositions nouvelles et spécifiques créées par les ordonnances et notamment celles visant à adapter leur négociation à la situation spécifique des PME. Mais on dispose de peu d’éléments d’analyse globale sur l’impact des ordonnances sur un éventuel basculement partiel de l’activité de négociation des branches vers les entreprises » (France Stratégie, 2021).
La voie vers un système organisé et décentralisé est ainsi tracée mais pour l’heure, la France reste marquée par une culture centralisatrice des relations sociales. Il faudrait que les partenaires sociaux s’y engagent plus activement, car c’est au niveau des entreprises et des établissements que la question de l’organisation du travail doit être abordée pour produire des effets bénéfiques à la fois sur le bien-être des travailleurs et la performance de l’entreprise. Plus les normes sont centralisées et conçues à grande distance des lieux d’action et de décision sans possibilité d’y déroger, plus il y a de chance qu’elles soient inadaptées aux situations réelles de travail. C’est aussi au niveau de l’entreprise que « la voix directe » des salariés a la possibilité de se faire entendre pour produire un environnement de travail de qualité (OCDE, 2019). Il y a donc un lien à considérer entre le système global de relations sociales et la participation directe des salariés. Sans en être une condition unique et suffisante, il apparaît que la décentralisation du système de relations sociales et une certaine autonomie des parties au dialogue social sont favorables à l’intégration de la voix et du vécu des travailleurs pour aboutir à des solutions adaptées au contexte local.
Une corrélation positive entre la qualité du dialogue professionnel et la qualité du dialogue social est mise en évidence par Eurofound et le Cedefop16 (2020) : « L’infrastructure et l’atmosphère qui doivent être en place sur le lieu de travail pour un dialogue social productif sont à bien des égards similaires aux circonstances dans lesquelles la participation directe est la plus susceptible de prospérer. Dans cette perspective, les participations directe et indirecte se complètent. […] Un bon fonctionnement de l’une étant associé à un bon fonctionnement de l’autre. » Parmi les résultats de l’étude auprès d’un échantillon d’établissements de l’UE à 28, il ressort qu’il y a une participation directe régulière et à forte influence dans 31 % des établissements et, parmi ces établissements, 57 % ont simultanément un dialogue social « impliquant, confiant et influent ». À l’opposé, il y a une participation directe des salariés du type « peu d’outils, peu d’influence » dans 13 % des établissements et, parmi ces établissements, seuls 18 % ont un dialogue social « impliquant, confiant et influent ».
Cette relation positive entre la participation directe et indirecte n’est pas nouvelle. En 1997, le livre vert de la Commission européenne Partenariat pour une nouvelle organisation au travail proposait déjà de « développer des formes d’organisation du travail plus efficaces grâce à un dialogue et une participation accrus sur le lieu de travail ».
Toutefois, un haut niveau de suspicion réciproque entre les parties au dialogue social rend la participation directe souvent difficile. Les syndicats soupçonnent les directions de vouloir utiliser la participation directe (entendue ici comme la consultation directe des salariés) comme un moyen pour écarter les organes représentatifs, et les organes représentatifs sont soupçonnés de décourager la direction ou les employés de recourir à la participation directe, car cela réduirait potentiellement leur influence dans l’organisation. À l’occasion de projets de transformations organisationnelles et/ou technologiques, ces soupçons sont amplifiés lorsque : les représentants du personnel sont informés tardivement, sans être réellement consultés, et perçoivent des risques pour les salariés en termes de charge de travail, de mobilité professionnelle, de statut, de suppression d’emplois.
Des chercheurs et praticiens (Huzzard et al., 2004) ont utilisé la métaphore « Boxing or Dancing » pour « désigner respectivement les modes d’engagement dans les relations industrielles conflictuelles et coopératives ». Les auteurs montrent qu’il y a un continuum entre ces extrêmes, et que le choix en faveur de l’un ou de l’autre peut dépendre des objets de discussions ou négociations. Nous défendons l’idée que, sur l’organisation du travail et le management, la culture dominante devrait être la coopération. L’esprit de coopération favorise une attitude proactive, plutôt que réactive. Elle implique le débat, notamment sur les critères de qualité, mais à partir des réalités du travail, tout en prenant en considération le contexte général de l’économie et la nécessité d’une croissance durable respectueuse de l’environnement.
- 7 ‒ La place que pourraient prendre les représentants du personnel dans ce dialogue est justement l’objet de la zone d’articulation à rechercher entre dialogue professionnel et social que nous développons plus loin.
- 8 ‒ De nombreux exemples de cette participation directe favorisée par les directions sont donnés dans : Pellerin et Cahier (2019), p. 67 ss ; Weil et Dubey (2020), p. 69 ss ; Pellerin et Cahier (2021), chapitre 3, p. 71 ss.
- 9 ‒ Voir par exemple le projet de transformation du dirigeant Patrick Negaret à la CPAM des Yvelines, (Weil, T., Dubey, A.-S., p. 65.).
- 10 ‒ Sondage BVA pour Audencia Business School, dans Les Échos, 2018.
- 11 ‒ Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Irlande, Italie, Suède, Hongrie, États-Unis, mais pas la France, dans laquelle les relations sociales sont traditionnellement considérées comme faiblement coopératives.
- 12 ‒ Source DARES France hors Mayotte.
- 13 ‒ Source OCDE.
- 14 ‒ La France sous nos yeux, Le Seuil, 2021.
- 15 ‒ Franceinfo, 11 novembre 2021.
- 16 ‒ European Center for the Development of Vocational Training ou Centre européen pour le développement de la formation professionnelle.
Formes de participation dans quatre secteurs d’activité en Europe
Après avoir exploré les cadres théoriques des participations directe et indirecte, nous analysons ci-dessous quatre situations ou expériences − détaillées en annexe − dans trois pays différents, qui montrent à la fois la diversité des pratiques de participation et l’articulation souvent complexe entre le dialogue social et le dialogue professionnel. On constate qu’il est souvent difficile de faire vivre la participation directe dans la durée. Plusieurs raisons à cela : les entreprises connaissent des changements de plus en plus fréquents sous la pression à la fois des clients, de la concurrence, des pouvoirs publics et plus généralement d’une complexité croissante de l’environnement des affaires, pouvant venir mettre en cause l’attention portée à la participation directe.
Pour comprendre plus finement ces cas – en particulier étrangers – il est nécessaire préalablement de connaître les règles légales ou conventionnelles dans lesquelles ils s’encastrent et qui sont assez différentes d’un pays à l’autre.
Les droits et accords sur la participation directe
Comme nous l’avons vu, les formes de la participation directe sont rarement inscrites dans les règles nationales, celles-ci décrivant essentiellement les modalités du dialogue social. En nous limitant aux trois pays couverts dans cette étude (France, Suède et Pays-Bas), on constate que la France se distingue des Pays-Bas et de la Suède, tant sur les modalités législatives du dialogue professionnel que sur celles concernant le dialogue social. En France, la participation directe des travailleurs est réglementée sous l’appellation de « droit d’expression ». Paradoxalement, c’est aussi le pays où ce « droit » des salariés est le plus faiblement mis en œuvre. Ce paradoxe souligne que les textes de loi ne garantissent pas des pratiques sociales innovantes. Aux Pays-Bas et en Suède, les règles de participation directe ne sont pas fixées par la loi mais régies par convention collective. Elles s’appuient aux Pays-Bas sur les règles cruciales en matière de comités d’entreprise (Works Council Act) et en Suède sur la codétermination (MBL). Les lois néerlandaises sur les conditions de travail et les lois suédoises sur l’environnement de travail incitent elles aussi au développement de la participation directe des travailleurs.
Droit d’expression et référendum en France
Au cours des quarante dernières années, la participation directe des salariés a suscité un fort espoir pour l’amélioration des conditions de travail et l’optimisation des organisations du travail. Deux législations de nature très différente ont tenté d’y répondre : le droit d’expression et le référendum.
Droit d’expression
Un droit d’expression directe des salariés avait été institué en 1982 par les lois Auroux. Très innovant, et vivement critiqué à l’époque, ce droit n’a pas vraiment été appliqué, au sens où il existe des points d’information descendants, mais peu de dispositifs d’écoute et de dialogue clairement institués avec les salariés. La critique que l’on peut adresser rétrospectivement à ce dispositif est d’avoir officiellement instauré un droit à la parole des salariés au sein des équipes de travail sur les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité, sans y avoir associé un véritable droit d’intervention sur leur travail.
L’ordonnance de septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise apporte une précision, en spécifiant notamment que les modalités d’exercice du droit d’expression sont définies dans le cadre de la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. Au niveau national interprofessionnel, c’est donc l’accord « Qualité de vie au travail » de 2013, antérieur à l’ordonnance, qui fait référence17. Celui-ci stipule que « ces espaces de discussion s’organiseront sous la forme de groupes de travail entre salariés d’une entité homogène de production ou de réalisation d’un service. Ils peuvent s’organiser en présence d’un référent métier ou d’un facilitateur chargé d’animer le groupe et d’en restituer l’expression et comportent un temps en présence de leur hiérarchie ». Il précise que « les restitutions validées par le groupe sont portées à la connaissance de la hiérarchie et des institutions représentatives du personnel ». Ainsi, il y a bien un droit d’expression avec une remontée des idées ou propositions vers la hiérarchie, d’une part, et auprès des instances représentatives du personnel, d’autre part, mais sans reconnaissance ni incitation à la prise de décision et mise en œuvre de solutions par les salariés eux-mêmes. Selon cet accord, il s’agit d’un droit à émettre des suggestions ainsi formulé : « Les restitutions issues des espaces d’expression peuvent fournir à l’employeur, des éléments de réflexion sur, d’une part, d’éventuelles évolutions de l’organisation du travail tournée vers davantage d’autonomie et d’autre part, sur le rôle et les moyens du management. »
Référendum
Un nouveau droit est apparu en France en 2016 en lien avec la réforme du droit du travail et les conditions de validation des accords d’entreprise. Il prévoit que lorsque les signataires d’un accord collectif atteignent entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés, ils peuvent demander l’organisation d’un référendum auprès des salariés pour passer outre le refus de signer des organisations majoritaires. L’accord d’entreprise peut ainsi être validé s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Les ordonnances de 2017 ont donné la possibilité à l’employeur de déclencher ce référendum, sauf si l’ensemble des organisations signataires, représentant au moins 30 % des suffrages, s’y oppose.
Plusieurs applications, soit à l’initiative des syndicats (SNCF), soit à celle de l’employeur (Air France), ont montré le caractère hautement politique de ce type de référendum. Il peut toutefois s’avérer utile lors de transformations organisationnelles impactant les conditions de travail ou d’emploi, mais il doit alors être adossé aux autres formes permanentes de participation directe et indirecte que nous développons dans cet ouvrage. Or, la plupart du temps, le référendum est conçu comme une participation par défaut : soit parce qu’il n’est pas connecté à une implication des salariés – ni dans le quotidien de l’activité de travail ni lors des changements successifs opérés dans l’entreprise, soit parce qu’il intervient à la suite d’un échec ou blocage du dialogue social.
La situation est différente pour les entreprises de moins de 21 salariés lorsqu’en l’absence de représentants des salariés, un employeur peut valider une disposition si celle-ci est approuvée par les deux-tiers des salariés. Cette double condition d’une absence d’institution représentative du personnel et d’une faible taille de l’entreprise peut alors conférer au référendum une vraie valeur de participation directe des salariés et/ou de démocratisation de l’entreprise. Mais là encore, cette implication des salariés doit pouvoir se vérifier dans la durée, et pas uniquement dans des circonstances qui « arrangent » l’employeur.
Il est utile de rappeler que, confrontés à un risque de suppression d’activité par les projets de l’entreprise, les syndicats ou représentants des salariés sont logiquement mobilisés pour la défense de l’emploi et les mesures d’accompagnement des salariés. La co-construction de l’avenir du travail et de l’entreprise est impossible à mettre en place lorsque le CSE est consulté trop tardivement, comme c’est le plus souvent le cas. La co-construction est en revanche envisageable lorsque le projet de réorganisation donne lieu à des expérimentations ou projets pilotes avant toute généralisation. La consultation du CSE sur un projet doit être considérée comme une opportunité de dialogue entre les managers responsables du projet et les représentants du personnel. Si ces conditions sont réunies, alors le référendum, complémentaire à la consultation des représentants du personnel, peut être l’un des moyens de renforcer la recherche d’intérêts communs entre l’employeur, les salariés et les représentants du personnel. Il peut ainsi participer d’une gouvernance moderne et contribuer à démocratiser l’entreprise.
Les comités d’entreprise aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, à l’exception de brèves périodes de l’histoire d’après-guerre, les relations sociales peuvent être qualifiées de consensuelles. Au début du XXe siècle, le mouvement syndical néerlandais est « né en dehors des portes de l’usine » et on en voit encore les traces de nos jours. En vertu de la loi de 1950 sur les comités d’entreprise (WOR), les salariés ont le droit d’être représentés dans les comités d’entreprise. Ceux-ci ne sont pas à proprement parler des organes syndicaux, encore que la plupart d’entre eux soient majoritairement composés de syndicalistes. Bien que le taux de syndicalisation soit tombé à 16 % (2018), on estime que deux conseillers néerlandais sur trois sont syndiqués, même s’il peut arriver ici ou là que les syndicalistes y soient minoritaires ou totalement absents. Dans les années 1970, les efforts visant à donner aux délégués syndicaux un statut juridique au niveau de l’entreprise ont échoué. Initialement, ces comités étaient présidés par l’employeur. Cependant, une révision de 1979 du WOR a prévu des comités indépendants de l’employeur, élus tous les trois ou quatre ans, par et parmi les salariés des entreprises d’au moins 50 salariés (avec un régime spécial pour les entreprises de 10 à 49 salariés).
Le comité d’entreprise n’a pas pour seule mission de représenter les travailleurs. La législation stipule que « la consultation auprès des travailleurs et leur représentation sont dans l’intérêt d’une gestion saine de l’entreprise dans tous ses objectifs ». C’est ce qui explique la fréquence des réunions communes entre le comité d’entreprise et la direction. Les comités d’entreprise sont dotés d’un droit d’information et de consultation, ainsi que d’un droit d’approbation plus étendu sur la politique du personnel et le règlement portant sur les conditions de travail. Les discussions lors de ces réunions sont obligatoires avant qu’un employeur puisse prendre une décision sur tout sujet prévu par la loi. Ces matières sont assez strictement prescrites. Dans les années 1990, les syndicats, malgré leurs efforts, n’ont pas réussi à ajouter à ces sujets les expériences de changement organisationnel. Toutefois, l’article 28 du WOR permet une influence plus directe sur l’organisation du travail. Il confie au comité d’entreprise la tâche de stimuler en permanence la consultation des travailleurs sur le travail et la délégation du pouvoir de décision aux niveaux inférieurs de l’organisation, éventuellement par le biais de ses propres propositions. Les évaluations indiquent qu’au fil des années, les comités d’entreprise néerlandais ont sous-utilisé cette combinaison de droits – manquant ainsi des opportunités de développer des formes de participation directe sous le contrôle des représentants des salariés.
Concernant les conditions de travail et les questions environnementales, les comités d’entreprise délèguent souvent leurs droits consultatifs au comité de sécurité, santé, bien-être (et environnement), le VGW (M). Lors d’une révision de la loi sur les conditions de travail (Arbowet) de 1994, les obligations d’évaluation des risques et de prévention inscrites dans la directive-cadre de l’Union européenne de 1989 ont été transposées. L’évaluation des risques dans les projets de développement ou technologiques est devenue un domaine majeur pour les comités d’entreprise. Cependant, contrairement aux comités d’entreprise allemands, leurs équivalents néerlandais ne peuvent pas à eux seuls initier des évaluations des risques. En raison de cette limitation, leur rôle dans ce domaine est resté globalement défensif. Deux autres révisions de la loi sur les conditions de travail ont eu lieu en 1998 et 2007.
La codétermination en Suède
Le système suédois de codétermination repose traditionnellement sur un dialogue social fondé sur la négociation entre l’employeur et les représentants syndicaux. Cette situation résulte en grande partie du niveau élevé du taux de syndicalisation (80 % dans les années 1970, 68 % actuellement) et de couverture de la négociation collective (au moins 85 %), ainsi que d’une forte présence syndicale locale. Au fil des années, le volet coopératif du dialogue social s’est renforcé ainsi que l’intérêt et l’évolution des différentes formes de participation directe, dont le cas du SPE (Service public de l’emploi, ci-après) est un bon exemple.
La loi suédoise sur la codétermination au travail (MBL) de 1976 a été un facteur institutionnel majeur pour soutenir le développement de nouvelles formes d’organisation du travail. Il s’agissait d’une réponse aux troubles industriels des années 1960 et au débat qui en a résulté sur la démocratie économique au travail, comme dans d’autres pays nordiques. Comme dans le programme norvégien pour la démocratie industrielle, la codétermination en Suède est fortement construite sur les syndicats représentant les salariés à différents niveaux. La règle fondamentale est la suivante : « Les décisions sur les changements majeurs qui affectent les employés prises par l’employeur doivent être négociées avec les représentants des travailleurs avant la décision de l’employeur. »
Le format du dialogue social reprend le système coopératif des conseils d’entreprise qui existait antérieurement. Mais la MBL a établi en outre la base des accords collectifs de codétermination entre les partenaires sociaux qui ont été conclus en 1978 pour le secteur public et en 1982 pour le secteur privé. Ces accords réglementent des questions telles que l’information économique, l’organisation du travail, le développement des compétences, les formes du dialogue social, le droit d’utiliser des consultants en matière de travail, et l’information des syndicats sur le temps de travail rémunéré. Les formes de participation directe, comme les réunions sur le lieu de travail, sont également régies par ces accords.
Une législation parallèle, la loi sur l’environnement de travail de 1977 (AML) relative à la santé et la sécurité au travail (SST) stipule que « le travail doit être adapté aux prérequis humains » et que l’employeur et les employés doivent coopérer pour créer un bon environnement de travail. L’AML définit le rôle et le droit du délégué à la sécurité et à la santé mais aussi la responsabilité incontestable de l’employeur sur l’environnement de travail. Il fixe également les règles pour les comités de SST avec une représentation bipartite. Concernant la participation directe, l’AML déclare que « le salarié a la possibilité de participer à la conception de sa propre situation de travail ainsi qu’aux projets de changement et de développement concernant son propre travail. » En 1974, soit avant la MBL et l’AML, une loi sur la position des représentants syndicaux sur le lieu de travail (FML) a été adoptée. Dans la pratique, l’AML joue souvent un rôle considérable, le représentant syndical local étant souvent aussi le représentant local de la sécurité et de la santé.
Synthèse des quatre études de cas
Pour reprendre un critère évoqué au chapitre 1, on peut dire que les cas du port de Rotterdam aux Pays-Bas et de la mutuelle d’assurance en France sont plutôt à classer du côté des projets de transformation mettant en jeu le dialogue social, avec des connexions et répercussions sur le plan de la participation directe dans le cadre de démarches expérimentales. La démarche de dialogue sur la qualité du travail dans la métallurgie en France se situe nettement dans le cadre du progrès continu, mais avec des phases où des projets à plus large spectre sont venus la perturber. Quant à la démarche au Service Public de l’Emploi en Suède, elle rend compte d’une culture permanente de la participation à la fois directe et institutionnelle, avec des limites qui résultent des changements de politiques publiques.
Démarche sociotechnique au port de Rotterdam (Pays-Bas)
Le cas du port de Rotterdam embrasse une histoire de plus de quarante ans de mise en œuvre d’une approche sociotechnique. Dans les années 1980, cette approche s’est particulièrement développée dans les pays nordiques, mais aussi aux Pays-Bas. Elle a ensuite été bousculée par les extensions successives du port de Rotterdam conjuguées à l’évolution du poids relatif des différents acteurs. Au fil de ces évolutions, l’autorité portuaire perd son pouvoir au profit des grands opérateurs de transport maritime. Lors du premier cycle de mutations, les comités d’entreprise (qui ont un rôle différent de leur équivalent CSE en France) des différents opérateurs se coordonnent et coopèrent avec un cabinet de conseil spécialisé dans les changements organisationnels pour organiser la consultation des salariés et la mise en place de groupes de travail. Cela a permis d’améliorer la conception de l’organisation et des emplois dans cette phase d’expansion du port de Rotterdam. Les syndicats et les comités d’entreprise ont tenté de préserver l’approche sociotechnique lors du cycle suivant de changements, mais n’y sont que partiellement parvenus. Les responsables syndicaux considèrent que la qualité des emplois s’est globalement détériorée dans ce cycle, avec une tendance à la spécialisation des tâches. Mais, ils questionnent aussi des éléments de l’approche sociotechnique elle-même, avec la nécessité de mieux intégrer les caractéristiques des salariés dans celle-ci.
Participation directe et dialogue social dans une mutuelle d’assurance (France)
Pour la direction de cette mutuelle d’assurance, l’enjeu était de taille. Comment mieux adapter la gestion du temps de travail et les horaires d’ouverture des agences pour mieux satisfaire les clients ? Le sujet était très sensible pour les salariés et les syndicats. En termes de conduite du changement, la direction a voulu innover avec une démarche participative de grande ampleur. Son objectif était d’établir un « nouveau contrat social » avec les salariés et leurs représentants afin d’obtenir plus de flexibilité dans la gestion du temps de travail moyennant une autonomie accrue accordée aux salariés pour la gestion de leur planning, le télétravail, la gestion des fins de carrière, etc. Craignant d’être contournées, les organisations syndicales ont négocié un accord de méthode prévoyant notamment le droit d’être représentées au sein des groupes de travail. Une série d’expérimentations ont eu lieu afin de tester la faisabilité des idées issues des groupes de travail. Des bilans ont été réalisés sur la base d’indicateurs. Ces bilans ont été présentés et discutés au sein du comité d’entreprise et de l’ICCHSCT, l’instance de coordination des CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Une articulation étroite a ainsi été établie entre les participations directe et indirecte (information, consultation et négociation). Ce processus s’est achevé par la signature d’un accord d’entreprise. Pour être opérationnel, ce projet devait déboucher sur un outil informatique de planification qui s’est révélé difficile à mettre en œuvre. Direction et syndicats ont évalué différemment cette démarche, même si de part et d’autre des problèmes et des avancées ont été reconnus.
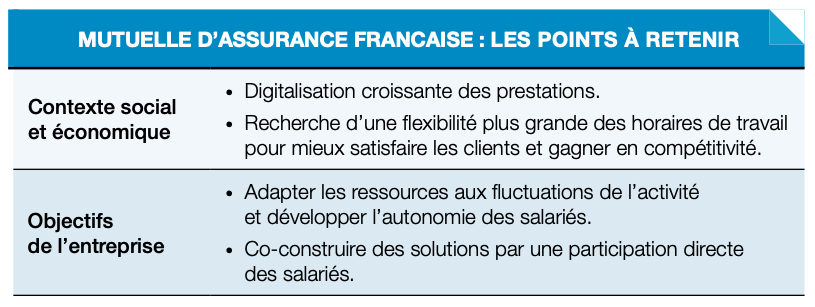
Management participatif au Service Public de l’Emploi (Suède)
Le cas du Service Public de l’Emploi en Suède permet de découvrir les spécificités du dialogue professionnel et social, et leurs combinaisons dans le modèle du marché du travail suédois. La codétermination vise à entremêler la participation directe et indirecte, et à établir des relations plus coopératives. Les syndicats ont particulièrement soutenu ces évolutions, dans le but de préserver la participation directe des salariés et de développer des organisations répondant aux besoins des salariés. Au sein du SPE, la structure de base de la participation directe est formée par des réunions d’équipe sur le lieu de travail. Des groupes de concertation à plusieurs niveaux ont également été mis en place avec des représentants patronaux et syndicaux. Afin de développer les principes de la nouvelle gestion publique, un nouveau directeur général a introduit une nouvelle culture managériale fondée sur la confiance et l’« autogestion », c’est-à-dire une autonomie accrue des employés. Elle s’est appuyée sur un programme de formation managériale, apprécié à la fois par les salariés et les syndicats ; toutefois, il n’a pas produit d’effets chez tous les cadres intermédiaires. Une autre étape dans la réorganisation des services séparant les prestations fournies aux demandeurs d’emploi de celles envers les employeurs a été plus controversée. Les syndicats ont fait appel à un consultant pour poser un diagnostic sur cette nouvelle stratégie organisationnelle et tenter de la faire évoluer. Le dialogue social a ainsi été marqué par une succession de conflits, de compromis et de consensus.
Dialogue sur la qualité du travail dans la métallurgie (France)
Le dernier cas porte sur des dispositifs de dialogue sur la qualité du travail (DQT) dans la métallurgie en France, en lien avec les démarches de progrès continu. Trois situations d’entreprises sont présentées dans ce cadre. Pour le syndicat qui s’est engagé dans cette approche, il s’agit de dépasser le strict « droit d’expression » des salariés pour développer leur pouvoir d’agir sur leurs propres situations de travail. La démarche et les outils du lean management devraient en principe favoriser la pratique réflexive des opérationnels sur leur travail, inclure des lieux pour parler du travail réel, analyser les problèmes et apporter des solutions, mais c’est rarement le cas. L’appellation de « dialogue sur la qualité du travail » et le contenu qui a été donné à ce dispositif sont issus d’une recherche menée chez Renault Flins par l’équipe de psychologues du travail du Cnam, dirigée par Yves Clot, ainsi que de la démarche « 50 minutes de développement » de Toyota à Valenciennes. Dans les deux cas, les organisations syndicales ont été associées à ces projets. Plus que d’autres, la CFDT s’est investie dans ce dispositif dans lequel l’organisation syndicale garde toute sa place mais sans chercher à être systématiquement l’intermédiaire des salariés dans le traitement des problèmes rencontrés. La démarche favorise les relations sur le terrain entre les représentants du personnel et les managers pour traiter localement les problèmes.
- 17 ‒ L’accord de décembre 2020 « pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail » fait référence à l’accord de juin 2013 sur la QVT en indiquant que « bien qu’ayant juridiquement cessé de produire ses effets, cet accord fondateur demeure une référence ».
Développer une culture de la participation combinant dialogue professionnel et social
Développer une culture de la participation implique d’identifier et d’articuler d’un côté les stratégies des dirigeants sur l’organisation du travail, les modes de management, les conditions de travail et d’emploi, et de l’autre les stratégies syndicales à l’œuvre dans le cadre des négociations collectives et des institutions représentatives du personnel. Ces deux stratégies, selon qu’elles sont antagonistes ou convergentes, influencent les contenus de la participation tant indirecte que directe. Elles déterminent la nature des relations professionnelles et sociales sur une échelle pouvant aller de la conflictualité ou défiance à la coopération ou confiance. L’enjeu est de construire un système sociotechnique durable capable de faire converger le plus possible les intérêts des dirigeants et ceux des employés, sans occulter les zones de confrontation. Dans cette optique, le dialogue professionnel vient nourrir le dialogue social sans le contourner, et le dialogue social vient soutenir le dialogue professionnel.
Figure 4.1 – Nouer des fils entre les quatre catégories d’acteurs du dialogue social et professionnel autour de la qualité du travail
La qualité du travail comme objectif commun
Le développement conjoint des deux formes de participation peut représenter un choix gagnant, visant à faire converger les intérêts communs entre dirigeants, salariés et représentants du personnel. Il peut aider à dépasser les clivages entre les dirigeants et les organisations syndicales, en cernant le champ de l’organisation et de la qualité du travail comme sujets d’un débat constructif, dans une forme de « coopération conflictuelle ».
Coordonner sans confondre
Si ces deux types de dialogues doivent mieux se coordonner, les confondre n’aurait cependant aucun sens. Deux auteurs le disent à leur manière. Pour le professeur danois H. Knudsen (1995) : « Pour les décisions concernant des questions opérationnelles ou liées aux produits, l’implication des employés est plus plausible, car ils possèdent le savoir-faire spécifique nécessaire pour apporter leur contribution. Pour les questions qui affectent le bien-être collectif, telles que les salaires, les conditions de travail ou une réorganisation, la représentation des employés par un canal tel qu’un syndicat est susceptible de fournir à la direction l’expertise et l’expérience pertinentes ». La sociologue I. Armaroli (2020) le dit différemment, mais dans le même esprit : « Premièrement, les syndicats contestent la prise de décision managériale à court terme, essentiellement motivée par les pressions du marché, pour englober également les intérêts de leurs membres, contribuant ainsi potentiellement, à long terme, à de meilleures décisions d’efficacité et à leur mise en œuvre plus adaptée […]. Deuxièmement, les pratiques de participation directe peuvent créer des opportunités pour intégrer les besoins des employés en matière de traitement équitable dans les décisions opérationnelles et l’exécution quotidienne des tâches […] »
Le point de convergence entre le dialogue professionnel et le dialogue social peut être la qualité du travail. Au chapitre 1, nous avons identifié trois dimensions de la qualité du travail : le développement des personnes et des organisations, la qualité des produits et services, et la qualité de l’environnement. La première est une condition indispensable à l’atteinte des deux autres.
Une méthode : les espaces de dialogue sur la qualité du travail
Le dialogue sur la qualité du travail (DQT) ou toute autre forme de dispositif de dialogue sur le travail est l’une des méthodes possibles pour conjoindre le dialogue professionnel et social (voir chapitre 3 et annexe 4). « Méthode » n’est sans doute pas le bon terme, car le processus est conçu comme ouvert et adaptable aux situations rencontrées, mais c’est en tout état de cause une nouvelle façon de manager qui implique un engagement de la direction.
Le DQT pose le principe d’organiser la controverse professionnelle sur les critères de qualité du travail (Clot et al., 2021) au sein des équipes, plutôt que de laisser les individus s’enfermer dans le silence, taire leurs problèmes professionnels ou leurs désaccords sur les décisions prises, au prix de leur désengagement et/ou de leur santé. Il s’agit « d’instituer » des espaces où aura lieu un débat sur les critères de qualité du travail (« qu’est-ce qu’un travail bien fait ? ») entre managers, professionnels et représentants du personnel, et où se développeront des relations professionnelles et sociales informelles pour traiter les problèmes liés au travail au plus près du terrain, avant de les remonter si besoin dans les instances représentatives du personnel et aux directions. Il faut veiller toutefois à ce que les débats portent bien sur les pratiques professionnelles et non sur les personnes, sur la compréhension et la résolution des problèmes de travail, afin de favoriser la coopération et la cohésion au sein des équipes. Centrer le dialogue sur le travail permet d’apporter une réponse aux souffrances qui peuvent s’exprimer dans les équipes, voire aux conflits interpersonnels, en favorisant un travail en commun, une reconnaissance entre pairs, mais aussi entre les membres de l’équipe et leurs managers.
Managers et salariés
La question de qui doit débattre avec qui est un enjeu essentiel de l’institutionnalisation de ce processus. Faut-il, par exemple, laisser les membres des équipes débattre seulement entre eux ? Ou doivent-ils débattre en présence et avec leur manager ?
Deux courants s’expriment à ce sujet : pour les uns, l’animation des espaces de dialogue doit s’effectuer sous le pilotage du manager (Detchessahar, 2019 ; Guérin et al., 2021), pour d’autres, elle doit d’abord avoir lieu entre pairs (Clot et al., 2021).
La première approche vise l’efficacité et la pérennité de la démarche. En effet, une discussion en présence du manager aura davantage de chance de déboucher sur des actions concrètes validées et mises en œuvre par les membres de l’équipe, ce qui n’exclut pas l’identification de problèmes ou de solutions qui devront remonter plus haut dans la hiérarchie. C’est aussi le meilleur moyen pour développer un management en prise avec le travail réel et le vécu du travail.
La deuxième approche considère que ce « travail sur le travail […] doit pouvoir être affranchi, dans un premier temps, de la présence de la hiérarchie, que ce soit pour faire vivre le collectif en situation ordinaire ou dans le dialogue lui-même » (Clot et al., 2021). C’est alors le développement de l’autonomie du collectif et de chacun de ses membres qui est privilégié.
Il nous semble que ces deux positions sont en fait conciliables. S’il est important que le manager de proximité soit investi dans l’animation des espaces de dialogue sur le travail et les solutions à mettre en œuvre pour améliorer l’efficience et l’efficacité du travail, il faut aussi prendre en considération le contexte dans lequel une telle démarche se développe. Discuter d’abord entre pairs peut s’avérer nécessaire, lorsque le fonctionnement des équipes de travail et/ou le climat social sont dégradés ou lorsqu’il y a une perte de confiance entre le manager et son équipe. Les causes peuvent en être multiples : un processus décisionnel antérieur très vertical, des changements opérés par le passé sans écoute des salariés, une dégradation de la qualité, des tensions entre collègues, un fort absentéisme… Dans ces situations, l’objectif premier des espaces de discussion est de reconstruire un climat de confiance, d’amener les membres de l’équipe à s’écouter et à faire l’apprentissage de nouvelles formes de relations professionnelles. Cela nécessitera en général un soutien apporté au groupe par une personne ou un expert externe à la situation de travail. Au-delà de ces situations dégradées, on peut aussi envisager une ingénierie mixte des espaces de dialogue, avec une animation plutôt régulière par le manager de proximité, mais des occasions données aux membres de l’équipe, ou à certains d’entre eux de se réunir de façon autonome pour analyser et traiter certains dysfonctionnements. On peut encore envisager une coanimation entre le manager de proximité et un référent des membres de l’équipe18 (voir annexe 4) Nous avons également indiqué qu’il est souhaitable que les managers disposent aussi entre eux de leurs propres espaces de dialogue.
Représentants du personnel et managers
Ce dialogue sur la qualité du travail fait aussi émerger une relation qui n’existait pas dans la configuration précédente, lorsque dialogue professionnel et dialogue social étaient totalement disjoints. Il s’agit de l’axe horizontal de la figure 4.1 qui ouvre à une relation nouvelle entre représentants du personnel et managers (figure 4.2).
Figure 4.2 – Une nouvelle relation entre managers et représentants du personnel
Le travail devient alors ce langage commun qui permet d’ouvrir un dialogue constructif entre syndicalistes et managers. Cette relation directe entre les représentants du personnel et les managers de proximité évite de remonter systématiquement les problèmes de travail dans les instances représentatives du personnel. C’est au plus près du terrain que les représentants du personnel pourront examiner les solutions adéquates pour traiter les problèmes récurrents, y compris lorsqu’il existe déjà des discussions entre salariés et représentants du personnel. C’est une manière aussi pour les représentants du personnel d’avoir une action qui soit moins verticale et centralisée.
Le dialogue social desserre ainsi son « tête à tête » avec la fonction Ressources humaines et la direction générale pour s’ouvrir aux managers, et renouer avec les préoccupations directes de leur base via le travail réel.
Engagement de la direction générale
Le dialogue sur le travail implique un engagement fort de la direction générale, tant sur le processus de participation directe lui-même, que sur le feed-back à donner systématiquement aux problèmes qui remontent et qui n’ont pu être résolus localement. Trop d’expériences de ce type ont échoué faute d’avoir été intégrées aux modes de management ou à la manière dont les décisions sont prises au sein de l’entreprise. A contrario, les entreprises qui ont mieux réussi, comme Toyota, sont celles qui ont su intégrer le maillon « terrain » dans la recherche du progrès continu, en restant très vigilantes à la fois sur la remontée et le traitement des observations émises par les salariés, mais aussi sur les réponses descendantes qui leur sont apportées.
Promouvoir des approches expérimentales impliquant les utilisateurs
Le premier but d’une expérimentation, dans le cadre d’un projet technico-organisationnel, est de tester en réel la pertinence de telle ou telle solution nouvelle du point de vue des travailleurs. Il s’agit d’analyser ce qui marche d’une façon satisfaisante, ce qui peut encore être amélioré et ce qu’il faut modifier.
Dans les projets de transformation organisationnelle, comme celui de la mutuelle, la réussite d’une démarche expérimentale et d’implication des utilisateurs suppose de réunir plusieurs conditions : durée de l’expérimentation, engagement des équipes et de la direction, information des salariés, évaluation des résultats de l’expérimentation à partir de critères préétablis.
La pression des délais peut constituer un obstacle à une meilleure articulation entre le dialogue social et professionnel. Le facteur temps est toujours un élément stratégique dans un processus de changement. Il faut que les directions intègrent dans leur conduite du changement le fait qu’une démarche participative, regroupant un ensemble d’acteurs, prendra plus de temps qu’une décision unilatérale prise en comité de direction : laisser du temps à la consultation des instances représentatives, sans allonger outre mesure les délais, implique de présenter les projets très en amont, quand plusieurs hypothèses sont encore sur la table. Il faut laisser le temps aux représentants du personnel de rencontrer les salariés pour recueillir leur avis et évaluer l’expérimentation. Le temps consacré au dialogue pendant la période de conception du projet sera souvent récompensé en aval par une mise en œuvre plus rapide des actions, une organisation mieux acceptée et donc plus efficace.
Nouer les fils entre les quatre catégories d’acteurs : bonnes pratiques
Comment en définitive nouer les fils entre nos quatre catégories d’acteurs pour améliorer la compréhension mutuelle et les zones de convergence, tout en respectant le rôle de chacun ?
Dans le cadre d’une démarche DQT, Yves Clot et son équipe ont proposé d’instruire la « demande formulée par des collectifs de professionnels, des directions et des organisations syndicales » au sein « d’instances tripartites habilitées à procéder à des arbitrages réversibles en matière de “bien faire” [son travail] ». Ce lieu est destiné à la mise en confrontation des pratiques professionnelles des salariés et des managers, mais aussi des objectifs de la direction et de ceux des représentants du personnel, en entrant « de plain-pied dans l’instruction de dossiers préparés par les professionnels eux-mêmes − soumis, pour parler comme les juristes, au “principe du contradictoire” dans l’analyse de leur travail » (Clot et al., 2021). Si cette idée paraît intéressante, il semble toutefois judicieux de retenir cette « institution » comme un lieu d’expérimentation de pratiques sociales durables, sans en faire ni un droit au sens réglementaire, ni une forme ou modalité universelle. Le principe que nous en retenons est celui de la nécessité de croiser le dialogue professionnel et le dialogue social aux niveaux adéquats d’une entreprise pour débattre et arbitrer sur les conflits de critères de qualité du travail. C’est une invitation à dépasser le strict rôle institutionnel de la fonction de représentation du personnel, sans bien évidemment le remettre en cause (Sundblad, 2010).
Cette instrumentation du débat sur les critères de qualité du travail devrait permettre de poser différemment la question de la performance et des moyens, tant du côté de l’employeur qui tend à raisonner uniquement à court terme, que des syndicats qui revendiquent quasi systématiquement une augmentation des moyens. Chaque partie pourrait s’attacher à mieux prendre en compte et débattre de l’organisation réelle du travail. Progressivement, ce dialogue devrait permettre de sortir d’une approche des ressources humaines vues par les directions uniquement en termes de coûts, pour intégrer les valeurs humaines immatérielles que sont les compétences, le développement professionnel, les gestes professionnels, l’engagement et les initiatives des individus, la confiance, et même la santé au travail. Cette approche de la valeur doit permettre de faire « émerger des solutions auxquelles personne n’avait songé jusque-là » (Bonnefond, 2016).
Un dialogue social et un rôle syndical renouvelés
Nous l’avons dit, les stratégies syndicales, plus ou moins conflictuelles ou coopératives, sont en partie liées aux stratégies patronales. Mais les syndicats peuvent aussi faire le choix de ne pas être seulement dans le « réactif » et adopter des stratégies proactives. L’une de ces stratégies pourrait être d’apporter leur soutien au développement de nouvelles formes de participation directe et d’autonomisation des salariés, ou dit autrement, de soutenir un dialogue professionnel de qualité. Ce choix pourrait se révéler décisif pour renouer une relation de confiance entre syndicalisme et salariés, et inverser la courbe de désyndicalisation. Il repositionnerait les syndicats « au cœur des changements profonds qui s’opèrent dans la société et sur le lieu de travail » (Gregory et Nilsson, 2004). Cela a été la stratégie suivie par la FIM19– CISL italienne de Brescia, comme en rend compte la sociologue Ilaria Armaroli (2020).
Une telle approche renouerait en fait avec une tradition antérieure. Martin Kuhlmann décrit par exemple le consensus qui a existé dans les années 1980-1990 en Allemagne entre les employeurs et IG Metall pour moderniser l’organisation du travail. Il y avait « des dispositions qui comprenaient un haut niveau de coopération […] lorsque la direction et les comités d’entreprise, soutenus par le syndicat, travaillaient ensemble pour introduire de nouvelles formes d’organisation du travail dans les zones de production de haute technologie. Dans certains cas, le comité d’entreprise et des experts syndicaux ont réussi à persuader la direction d’essayer des formes d’organisation du travail moins tayloriennes. » Des membres des comités d’entreprise intervenaient comme experts pour participer activement aux réorganisations du travail. La plupart d’entre eux disaient être « plus fréquemment, pour la première fois officiellement, impliqués dans les décisions de planification et les activités quotidiennes de gestion consistant à conduire et à revoir le processus de réorganisation » (Kuhlmann, 2004). L’auteur explique que cette forte coopération s’est estompée par la suite, mais que ce rôle du syndicalisme en matière d’organisation du travail a pu coexister avec un rôle plus traditionnel sur d’autres domaines comme l’emploi, le temps de travail et les salaires. Ce nouveau rôle syndical portant sur l’organisation du travail nécessite de la part des représentants du personnel de pouvoir se former pour développer leurs capacités à intervenir sur les réorganisations, et simultanément d’accepter de reconnaître un pouvoir direct d’intervention des travailleurs. Mais cela ne peut fonctionner qu’à la condition qu’ils soient reconnus dans ce rôle par les employeurs, qu’ils aient les moyens de l’exercer, et qu’ils puissent se faire assister par des experts extérieurs.
Cela pose des défis nouveaux aux deux parties qui doivent rechercher de nouveaux équilibres. Côté direction, il s’agit de s’investir « dans la gestion partagée d’un processus complexe d’innovation organisationnelle, qui autrement pourrait rencontrer des difficultés et des revers » (Armaroli, 2020). Côté syndical, il s’agit de passer d’une logique de défense conflictuelle des intérêts des salariés à celle de la recherche d’objectifs communs dans un processus gagnant-gagnant. Dans ce but, le syndicat devra construire avec les salariés une relation de confiance réciproque qui ne soit pas basée uniquement sur la présentation de revendications, mais sur un investissement suivi dans les questions d’organisation du travail et les projets de la direction.
Dès lors, la participation directe des salariés cesse d’être uniquement un choix managérial, elle devient aussi un objectif syndical : « Un consensus s’est dégagé parmi les syndicalistes de Brescia sur le rôle important que la participation directe des salariés pourrait jouer pour valoriser le travail des personnes, après des décennies de déshumanisation dans les environnements fordistes, et concevoir une nouvelle identité des cols bleus au sein de la société » (Armaroli, 2020). L’auteure présente trois stratégies syndicales possibles (figure 4.3) pour répondre à la montée de la participation directe qu’elle qualifie de « désintermédiation ». Elle associe en outre la participation directe à une évolution du fonctionnement démocratique interne au syndicat, visant à organiser des relations plus horizontales entre les syndiqués et les membres des structures syndicales.
Figure 4.3 – Trois stratégies syndicales possibles face à la désintermédiation
Source : Armaroli, 2020, p. 5. Traduit par les auteurs.
Le choix de la 3e option du tableau amène les représentants du personnel à sortir du domaine strict de la gestion des ressources humaines pour s’intéresser à des questions du travail plus larges. Or, ces dernières ne sont pas du ressort exclusif des ressources humaines, mais d’abord et surtout de l’ensemble de la ligne managériale. Lors des confrontations instituées avec les référents des métiers et des managers de proximité, les représentants du personnel n’ont pas à arbitrer sur toutes les disputes professionnelles, mais à éclairer les enjeux importants en termes de cohésion sociale, de qualité des produits et services, de développement durable et de performance à long terme de l’entreprise.
C’est ainsi qu’in fine, le dialogue professionnel, loin de menacer l’action syndicale, pourrait au contraire devenir la source de son renouveau.
- 18 ‒ Le référent est l’équivalent du team speaker ou spokesperson en Allemagne. C’est un membre de l’équipe intégré dans le processus de production, sans aucune responsabilité supplémentaire, autre que celle de participer à l’animation des réunions d’équipe et de la représenter à d’autres niveaux.
- 19 ‒ Syndicat de l’industrie mécanique, sidérurgique et métallurgique.
Conclusion
Depuis longtemps, les salariés sont en demande d’une meilleure reconnaissance au travail. La crise du Covid a mis en lumière la nécessité d’une meilleure valorisation des emplois pour de multiples catégories de personnel. Celle-ci nécessite de repenser les niveaux de rémunérations, les écarts de rémunérations et de classifications des emplois pour tendre vers plus d’équité. Ces sujets d’importance font l’objet du dialogue social au plus haut niveau.
Toutefois, les salariés expriment aussi des insatisfactions sous l’angle du contenu du travail, des relations dans et au travail, des possibilités d’agir dans et sur son travail, de l’autonomie au travail, de l’attention portée aux individus au sein des collectifs de travail. La participation directe des salariés est ce qui permet − aux individus et collectifs − de se sentir reconnus et d’avoir une place dans l’organisation. Traditionnellement, la reconnaissance des singularités n’est pas au menu de l’action syndicale qui se préoccupe avant tout du collectif et de l’équité au sein du collectif. Intégrer le rôle de la participation directe des salariés n’est donc pas chose naturelle pour les syndicalistes. Elle l’est d’autant moins si ceux-ci ont le sentiment que cette participation directe est instrumentalisée par les employeurs pour les contourner.
Pourtant, le développement du dialogue professionnel est une opportunité déterminante à saisir pour faire évoluer le syndicalisme autant que le dialogue social. Les syndicats doivent rétablir le dialogue avec les salariés à travers un double mouvement : d’une part, en soutenant leurs aspirations à l’extension de leur pouvoir d’agir sur leur propre travail et en aidant à organiser ce dialogue professionnel, sans vouloir à tout prix l’institutionnaliser de manière rigide ; d’autre part, en se saisissant de certaines questions soulevées par le dialogue professionnel dans le cadre du dialogue social. Cette prise en considération du dialogue professionnel ne doit cependant pas conduire les représentants du personnel à se substituer aux gens de métier dans la résolution de leurs problèmes.
Soutenir l’autonomie au travail, c’est pour les représentants du personnel apprendre à faire confiance aux salariés, reconnaître la capacité des membres des collectifs de travail, avec l’aide de leurs managers de proximité, à régler une bonne partie des problèmes de travail, sans leur intervention. Il revient en revanche à ces représentants d’intervenir dans des situations de blocage − sur le dialogue professionnel proprement dit ou sur les choix de solutions organisationnelles − mais surtout de porter les dimensions plus collectives issues de ce même dialogue professionnel comme, par exemple, les enjeux de développement des compétences, de formations, d’adaptation des postes ou de parcours de carrière et emplois.
Les syndicats et représentants du personnel ont aussi un rôle particulier à jouer dans le cadre des grands projets de transformation. Ce rôle doit évidemment être reconnu par les directions. En se référant au dialogue professionnel, leur rôle est de discuter ou négocier les termes des changements. Ils doivent pouvoir présenter des solutions organisationnelles alternatives pour garantir non seulement la quantité et qualité des emplois, mais aussi la qualité du travail. La participation est une manière de co-construire collectivement le progrès social et économique, par l’implication de toutes les parties prenantes. En ce sens, les meilleures solutions ne sont pas nécessairement le résultat d’un compromis qui consisterait à faire un pas l’un vers l’autre, en s’accordant des concessions réciproques (négociation). La participation − directe et indirecte − doit permettre d’innover, c’est-à-dire de produire des solutions autres que celles proposées initialement par l’une ou l’autre des parties. On connaît l’attachement des dirigeants et concepteurs, voire des syndicalistes, au développement d’outils de toutes natures pour diagnostiquer les situations et les causes racines des problèmes. Sans les rejeter systématiquement, la participation invite surtout à transformer les schémas habituels de pensée et de raisonnement, en organisant la confrontation entre des formes de rationalité calquées sur celles des ingénieurs, avec la subjectivité du travail telle qu’elle s’exprime sur le terrain, dans la manière d’agir de l’individu au cours de l’action de production.
L’un des enjeux pour les syndicalistes est de dépasser la posture qui consiste à considérer la participation directe des salariés soit comme vaine − sous prétexte du lien de subordination qui existe dans l’entreprise capitaliste −, soit comme dangereuse car destinée à les contourner. Les syndicalistes sont donc, eux aussi, invités à faire un effort pour intégrer la participation directe des salariés comme un moyen d’objectiver les situations de travail. La controverse, tension, opposition entre le patronat et les syndicats devrait moins porter sur l’utilité sociale et économique de cette participation que sur les formes à lui donner. Cela exige que dirigeants et syndicalistes puissent, à tout le moins, partager la finalité de la participation telle que nous l’avons précisée : le développement des personnes et des organisations à long terme. La participation s’inscrit alors dans des dispositifs organisationnels conduisant à accroître le pouvoir d’agir des salariés au service d’une organisation apprenante. La participation directe devient plus qu’une démarche, c’est un changement de la culture managériale qui s’appuie sur l’intelligence individuelle et collective au travail et tire parti des expériences de terrain.
En Europe, de nombreuses moyennes et grandes entreprises se sont engagées dans cette voie. Une dynamique plus importante en ce sens doit s’engager sous l’impulsion des grandes organisations patronales et syndicales et des pouvoirs publics.
Bibliographie
Andolfatto D., Labbé D. (2011), Histoire des syndicats. 1906-2006. Paris : Le Seuil.
ARETE (1983), Négocier l’ordinateur ? La concertation sur les nouvelles technologies dans l’entreprise. Paris : La Documentation Française.
Argyris C., Schön D. A. (2001), Apprentissage organisationnel. Théorie, méthode, pratique. Paris : DeBoeck Université.
Armaroli I. (2020), Integrating direct employee voice within the framework of worker representation : The role of an Italian trade union in organising disintermediation, Economic and Industrial Democracy. London : Sage (https://doi.org/10.1177/0143831X20937414).
Bonnefond J.-Y. (2016), L’Intervention dans l’organisation en clinique de l’activité. Le dispositif « DQT » Renault à l’usine de Flins. Thèse pour le doctorat en psychologie, Paris : Cnam.
Bourdu E., Péretié M.-M. et Richer M. (2016), La Qualité de vie au travail : un levier de compétitivité. Refonder les organisations du travail. Les Notes de La Fabrique, Paris : Presses des Mines.
CFDT (2017), Rapport de l’enquête sur le travail de la Cfdt, Paris, édité par la Cfdt.
Clot Y., Bonnefond J.-Y., Bonnemain A., Zittoun M. (2021), Le Prix du travail bien fait. La coopération conflictuelle dans les organisations. Paris : La Découverte.
Detchessahar M. (2019), L’Entreprise délibérée. Refonder le management par le dialogue. Bruyères-le-Châtel : Nouvelle Cité.
Dujarier M.-A. (2006), L’Idéal au travail. Paris : Puf.
Eurofound (2013), Work organisation and employee involvement in Europe. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Eurofound (2015), Third European Company Survey : Direct and indirect employee participation. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Eurofound (2016), Sixth European Working Conditions Survey : Overview report. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Eurofound and Cedefop (2020), European Company Survey 2019 : Workplace practices unlocking employee potential. European Company Survey 2019 series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Falzon P. (2013), Ergonomie constructive. Paris : Puf.
France stratégie (2021), Évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au dialogue social et aux relations de travail, rapport du comité d’évaluation, décembre.
Geary J., Sisson K. (1994), Conceptualising direct participation in organisational change : The EPOC project, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
Gregory D., Nilsson T. (2004), Seconds Away : Naming and Framing the Book. In Huzzard T., Gregory D., Scott (eds) Strategic Unionism and partnership, Boxing or Dancing? New York: Palgrave Macmillan, 1-19.
Guérin F., Pueyo V., Béguin P., Garrigou A., Hubault F., Maline J. et Morlet T. (2021), Concevoir le travail, le défi de l’ergonomie. Toulouse : Octarès.
Gustavsen B. (1993), Work Place Development and Communicative Autonomy. In Van Eijnatten F.-M., The Paradigm that changed the Work Place. Stockholm/Assen : Arbetslivscentrum/Van Gorcum, 185-191.
Huzzard T., Gregory D., Scott R. (eds) (2004), Strategic Unionism and Partnership, Boxing or Dancing? New York : Palgrave Macmillan.
Knudsen H. (1995), Employee Participation. London : Corwin Press.
Koen C. I. (2005), Comparative International Management. New York : McGraw-Hill Education.
Kuhlmann M. (2004), Where now for the German Tango Partners?. In Huzzard T., Gregory D., Scott (eds). Strategic Unionism and partnership, Boxing or Dancing? New York : Palgrave Macmillan, 125-141.
Les é chos
Maire E. (1987), Nouvelles frontières pour le syndicalisme, Paris : Syros.
OCDE (2019), Négocier notre chemin : la négociation collective dans un monde du travail en mutation. Paris : OECD Publishing.
Pellerin F., Cahier M.-L. (2019), Organisation et compétences dans l’usine du futur. Vers un design du travail ?, Les Notes de La Fabrique, Chaire Futurs de l’industrie et du travail. Paris : Presses des Mines.
Pellerin F., Cahier M.-L. (2021), Le Design du travail en action. Transformation des usines et implication des travailleurs. Les Notes de La Fabrique, Chaire Futurs de l’industrie et du travail. Paris : Presses des Mines.
Rosanvallon P. (1988), La question syndicale. Histoire et avenir d’une forme sociale. Paris : Calmann-Lévy.
Rosanvallon P. (2018), Notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018. Paris : Le Seuil.
Sailly M. (2017), Démocratiser le travail, Un nouveau regard sur le lean management. Ivry-sur-Seine : Les Editions de l’atelier.
Sen A. (2010), L’Idée de Justice. Paris : Flammarion.
Sundblad Y. (2010), KTH Royal Institute of Technology, Department HCI (Human – Computer Interaction), History of Nordic Computing 3 (p. 176-186). Stockholm, Sweden.
Van Klaveren M., Gregory D., Johansen A., Tengblad P., Schleicher R. (2020), What About the Workers? Forty Years of Labour Consultancy in Europe. A E-book of the European Employee Support Network (EESUN), disponible sur : https://wageindicator.org/documents/publicationslist/publications-2020/eesun-book-2020.pdf
Verna A. (2021), Fonder une industrie contributive et résiliente. Coll. Les Docs de La Fabrique, Paris : Presses des Mines.
Weil T., Dubey A.-S. (2020), Au-delà de l’entreprise libérée. Enquête sur l’autonomie et ses contraintes. Les Notes de La Fabrique, Chaire Futurs de l’industrie et du travail, Paris : Presses des Mines.
Annexe I – Démarche sociotechnique au port de Rotterdam (Pays-Bas)
Premier cycle de changements : conception conjointe de l’organisation et des tâches
Au cours des années 1980, le transport maritime de marchandises s’est développé massivement, notamment grâce à l’invention des conteneurs. De nouvelles technologies logistiques ont été développées pour l’arrimage des navires et le déplacement des conteneurs vers d’autres navires ou vers le transport intérieur par camions et barges (transport multimodal). Le port de Rotterdam est le plus grand port maritime européen. De grands terminaux à conteneurs intégrant de nouvelles formes d’automatisation ont donc été conçus pour répondre aux nouveaux besoins du fret maritime. ETC (Europe Container Terminal), opérateur logistique dominant dans la région de Rotterdam, a été le premier à s’étendre dans la Plaine de Maas récemment récupérée pour abriter les nouveaux terminaux. Pour accompagner ces changements, il était nécessaire d’imaginer de nouvelles formes d’organisation du travail et d’emploi. Dirigé par un P.-D.G. innovant, ECT a relevé ces défis.
Le port de Rotterdam est un pilier du syndicalisme néerlandais, avec un niveau élevé de syndicalisation : il y avait 80 % de syndiqués dans les années 1980. Pourtant, pendant et après les grèves sauvages des années 1970, la direction du plus grand syndicat du port, le syndicat FNV Transport, avait été critiquée pour son manque de vision de l’avenir. En 1986, la direction syndicale s’est alors lancée dans une politique plus offensive, d’une part, pour regagner la confiance de ses électeurs, et d’autre part, pour faire face aux nouvelles technologies perçues comme des menaces pour l’emploi et la qualité du travail. Au début des processus de conception et de prise de décision, les négociations avec la direction sont vues comme « la voie royale » pour maintenir les emplois et améliorer leur qualité : « négocier le changement technologique » est devenu le nouveau slogan de l’action du syndicat.
Au sein des comités d’entreprise des entreprises logistiques impliquées dans l’activité du port, avec leur forte majorité de militants FNV, l’incertitude est toutefois générale. En 1985-86, la FNV Transport adopte un programme dit de « formation technologique » défini par la confédération FNV, mais il revient ensuite à chaque circonscription syndicale de décliner l’approche globale en actions viables.
Un troisième acteur joue un rôle important dans les changements à l’œuvre, GHR, qui est l’Autorité portuaire municipale. Au milieu des années 1980, il devient évident que les structures de communication des données entre les différentes entreprises agissant sur le port et au-delà, déjà quasiment opérationnelles, vont affecter profondément le travail de milliers de travailleurs. GHR reconnaît alors la nécessité d’intégrer ces processus d’innovation à des relations de travail participatives à tous les niveaux. L’Autorité propose des formations permettant d’aborder le changement de manière participative, à la fois pour le management des entreprises portuaires et pour les syndicalistes, afin de les sensibiliser à ces approches. À l’époque, les employeurs portuaires ne disposent pas d’une association professionnelle sectorielle autorisée à conclure des conventions collectives contraignantes. L’absence persistante d’une telle association se révèlera un frein sérieux au déploiement d’une action syndicale efficace dans les décennies qui suivront.
Au cœur des formations proposées par GHR, se trouve le paradigme du système sociotechnique (STSD), et plus particulièrement de sa variante néerlandaise appelée le renouveau organisationnel intégral (IOR). Tout cela est, à l’époque, très expérimental, et la formation proposée par GHR s’appuie essentiellement sur un exemple : celui du nouveau terminal à conteneurs Delta d’ECT (Europe Container Terminal) qui avait ouvert un peu plus tôt. Sous la pression du comité d’entreprise d’ECT (mais sans sa participation), la conception de ce terminal s’était en effet appuyée sur des propositions sociotechniques de chercheurs universitaires. Stimulés par les cours « GHR », les dirigeants d’autres entreprises logistiques (manutention de conteneurs mais aussi de fret en vrac) adoptent alors cette approche, de même que les leaders du mouvement syndical. STSD/IOR devient ainsi un « langage de communication » entre ce qui semble être devenu des « partenaires sociaux ».
Les initiatives des travailleurs
Cependant, après deux ans d’activité, il devient évident que la qualité des emplois au terminal Delta se dégrade de manière inquiétante. En réaction, le comité d’entreprise d’ECT demande à une société de recherche et conseil, STZ, d’opérer une évaluation. Le comité d’entreprise et STZ divisent les travailleurs du terminal Delta en deux sous-groupes de discussion. Ces discussions permettent de faire émerger les principaux problèmes affectant la qualité des emplois : spécialisation unilatérale, tâches monotones, manque de formation et de possibilités de carrière. Ces problèmes semblent provenir des rythmes extrêmement rapides imposés par le déchargement et le chargement des navires, afin de respecter les horaires de navigation des clients, les grandes compagnies maritimes. La direction d’ECT et les concepteurs du nouveau terminal ont clairement sous-estimé la pression ainsi engendrée.
En avril 1988, le comité d’entreprise d’ECT et les syndicats sont confrontés à un nouveau défi. ECT avait conclu un contrat pour 25 ans avec son plus gros client, SeaLand. Ce contrat prévoyait la construction d’un nouveau terminal à conteneurs dédié, immense, à côté de l’installation « Delta ». Ce nouveau terminal Delta/SeaLand (DS) devait être hautement automatisé et piloté par informatique. Au cours des cinq années précédentes, les équipes de conception d’ECT avaient déjà spécifié la base technologique du nouveau terminal qui prévoyait d’inclure des véhicules à guidage automatique sans pilote (AGV) et des grues automatisées (ASC), pilotées par un système de contrôle de processus, à son tour lié à un système global et centralisé de planification et d’administration. Les rumeurs se répandent et les dockers appellent déjà la future implantation « le terminal fantôme » (au sens de « sans êtres humains »). Dans ces conditions, le FNV Transport et le comité d’entreprise d’ECT décident d’entreprendre un effort concerté pour influencer la conception du futur terminal et des emplois qui y seront associés.
Durant la même année 1988, le comité d’entreprise d’Unitcentre, deuxième opérateur logistique de conteneurs à Rotterdam (qui sera repris en 1993 par ECT), ainsi que les comités d’entreprise des deux principaux opérateurs de fret en vrac (Frans Swarttouw et GEM), entreprennent des efforts similaires. Les quatre comités d’entreprise engagent le même cabinet conseil STZ pour les soutenir. C’est ainsi que, du côté des travailleurs, se met en place un échange intensif d’informations visant à influencer la conception des terminaux du futur.
Les syndicats réussissent ainsi in fine à conclure un accord sociotechnique avec la direction d’ECT concernant le terminal Delta/SeaLand (DS). Celui-ci prévoit :
i la structuration de procédures de concertation avec la direction impliquant quatre cycles de conseil et de négociation dans le cadre de la planification du projet ;
ii l’amélioration de la circulation des informations de gestion, y compris un accès aux équipes de conception et aux études pilotes ;
iii l’intégration à la conception du terminal des recherches des syndicats relatives à « la qualité de l’emploi dans les terminaux du futur ».
Dans le cadre de cette dernière recherche, le comité d’entreprise invite alors au printemps 1989 un travailleur d’ECT sur cinq, choisi au hasard, à participer à des groupes de discussion qui se réunissent pendant les heures de travail. 70 % des invités acceptent de participer. Au cours d’un premier tour, ils discutent à partir d’un questionnaire couvrant 19 éléments de charge de travail, à remplir en partie sous forme d’avis collectifs et en partie individuellement. Le questionnaire couvre les questions suivantes : santé et sécurité, autonomie, rythmes de travail, modèles de coopération, et soutien par des équipements et systèmes informatiques. Les questions relatives à l’aménagement des terminaux et aux systèmes d’information, dont le comité d’entreprise avait discuté avec la direction lors d’un premier tour de consultation, sont ensuite utilisées comme base de travail pour un deuxième tour – permettant aux groupes de discussion de fournir des commentaires sur les points de vue provisoires du comité.
Au cours des quatre années suivantes, les résultats de cette recherche ont servi de guide principal aux travailleurs d’ECT. Ils ont constitué la base des exigences de conception sociale que les comités d’entreprise et les consultants STZ ont introduites dans les cycles de consultation. Ces exigences ont marqué la conception de l’organisation et des emplois au sein du nouveau terminal DS.
Lorsqu’en 1993, ce terminal est devenu opérationnel, il a pu être considéré comme un lieu de travail permettant :
i de passer des tâches opérationnelles à des tâches de contrôle de processus plus complexes grâce à une rotation des emplois, conduisant à développer les compétences ;
ii la mise en œuvre du travail en équipe, y compris l’exécution en équipe de tâches de planification ;
iii l’introduction d’équipements opérationnels et de contrôle des processus avec des systèmes informatiques d’aide à la décision ;
iv la garantie d’une augmentation relative du nombre d’équipes fixes (versus flexibles).
Cinq ans plus tard, en 1998, une étude d’évaluation a montré que tant les travailleurs que la direction évaluaient dans l’ensemble positivement la qualité des emplois au terminal DS. Les évaluations techniques et économiques ayant également eu des résultats positifs, ECT a décidé de faire construire deux autres terminaux, en grande partie selon les mêmes principes de conception.
Deuxième cycle : changement d’échelle et surcapacité
Au début du XXIe siècle, le contexte économique du port de Rotterdam change considérablement, notamment pour ce qui concerne la logistique de conteneurs. De grandes multinationales étrangères s’imposent. En 2002, Hutchison Port Holdings (HPH), filiale d’un conglomérat basé à Hong Kong, acquiert la majorité des actions d’ECT. ECT/HPH gère cinq terminaux à conteneurs à Rotterdam. Un autre acteur majeur apparaît, le danois A. P. Møller-Maersk, la plus grande entreprise de transport par conteneurs au monde. En 1999, Maersk reprend SeaLand et le terminal DS. En 2005 et 2015, la filiale APM Terminals de Maersk démarre la construction de deux nouveaux terminaux à conteneurs. En 2015, le terminal RWG (Rotterdam World Gateway), propriété d’un consortium formé par quatre grands armateurs et un grand opérateur logistique (DP World basé aux Émirats Arabes Unis), devient opérationnel. Tous ces grands terminaux, situés dans la plaine de Maas, sont pour l’essentiel conçus selon les lignes directrices, définies lors de la conception du terminal DS. Par rapport à la situation antérieure, ces nouveaux acteurs sont des multinationales géantes capables d’investissements massifs permettant de réaliser d’importantes économies d’échelle. Pour prendre la mesure du changement d’échelle intervenu en dix ans, on peut rappeler le discours du Nouvel An tenu en janvier 1990 par le P.-D.G. d’ECT. Celui-ci avait annoncé que son entreprise se concentrerait sur les grandes compagnies maritimes « naviguant avec des navires entre 3 000 et 5 000 EVP20 ». Dans les années 2000, les plus gros navires cargos neufs approchent une capacité de près de 24 000 EVP. Au cours des sept dernières années, la demande n’atteignant pas les niveaux espérés, ces investissements colossaux entraînent une surcapacité mondiale − sur mer comme dans les terminaux.
Le système de relations sociales
Lors d’un séminaire international en 2016, des permanents syndicaux de FNV Transport donnent un aperçu des développements concernant l’organisation du travail et la qualité de l’emploi au sein des terminaux à conteneurs de Rotterdam. Dans l’ensemble, la base des travailleurs signale qu’au cours des années 2010, la qualité de l’emploi s’est détériorée. La mise en œuvre des tâches générales conçues pour le terminal DS a été largement mise sous pression. La rotation des tâches a diminué et la spécialisation s’est accrue. Les employeurs annoncent aussi vouloir élargir l’utilisation de pools de travailleurs flexibles. Pour défendre cette forme de flexibilité, les managers impliqués font appel à plusieurs reprises aux leçons du lean management. Par rapport à l’expérience globale des Pays-Bas en matière de flexibilisation, ce mouvement s’est toutefois produit plus tardivement dans les ports néerlandais que dans d’autres secteurs. La puissance relative de l’organisation des dockers a certainement représenté ici un facteur de frein à cette tendance.
Les agents blâment aussi certains aspects des relations sociales sur le port. Ils soulignent certaines carences de la négociation collective. Si le taux de couverture des accords collectifs (CBC) dans le port et les activités connexes reste encore plus élevé que la moyenne néerlandaise (86 % contre 78 %), cela est dû à l’existence de pas moins de 35 conventions d’entreprise (CLA) en vigueur : la négociation multi-employeurs (NME) est complètement absente du secteur de l’arrimage à Rotterdam. À ce jour, toute tentative d’organiser une NME a été contrecarrée par l’absence d’une association d’employeurs autorisée à négocier des accords contractuels contraignants au niveau sectoriel. Cette situation pèse lourdement sur l’harmonisation des conditions de travail. Outre le temps passé à négocier des accords au cas par cas, les responsables syndicaux soulignent la difficulté pour les représentants locaux de résister à la pression qu’exercent sur eux les dirigeants pour qu’ils intègrent des spécificités « dérogatoires » propres à chaque entreprise. Pour autant, certains représentants syndicaux ont aussi conscience qu’une NME impliquerait de renoncer à certains avantages figurant dans les accords d’entreprise existants, par exemple des formes de participation directe au sein des ateliers, et ne la souhaitent donc pas. Enfin, le plus frappant est l’absence totale de GHR, l’autorité municipale portuaire, loin du rôle stimulant qu’elle avait joué dans les années 1980-1990. De manière plus générale, le mouvement syndical et les associations patronales néerlandaises sont devenus de plus en plus passifs face à tout ce qui concerne les changements organisationnels et les problèmes de qualité de l’emploi.
Les limites de la conception sociotechnique
La voie royale par laquelle les travailleurs et leurs représentants ont exercé une influence précoce sur les changements technologiques et organisationnels, s’est avérée dans la pratique une route plutôt sinueuse. Dans les terminaux de Rotterdam conçus selon des principes sociotechniques, la qualité de l’emploi a eu tendance à se dégrader progressivement après une période plus ou moins longue. Si certaines causes sont exogènes comme l’évolution du contexte des affaires, d’autres peuvent relever d’efforts insuffisants pour maintenir le système témoignant du travers consistant à croire qu’une fois celui-ci installé, il s’auto-entretiendra de manière spontanée. Mais d’autres causes encore sont peut-être à rechercher dans le paradigme sociotechnique lui-même. Les évaluations opérées au port de Rotterdam ont révélé des faiblesses structurelles, notamment dans la conception des groupes ou des équipes semi-autonomes, un élément clé de la conception sociotechnique.
Premièrement, au sein des groupes semi-autonomes, des processus de différenciation et de segmentation des tâches se sont développés en de multiples endroits, entraînant l’exclusion progressive des travailleurs âgés, des femmes et des migrants. Deuxièmement, les tâches d’organisation et de pilotage du système dépassent souvent les capacités des travailleurs de ces groupes. Ces problèmes révèlent la nécessité d’intégrer, dès la phase de conception des accords, des dispositions concernant la composition des groupes et l’insertion des personnes dans les groupes semi-autonomes, mais aussi les programmes de rotation des emplois, les systèmes de rémunération ou encore les modes de consultation. Il est également nécessaire d’intégrer le développement de formations et de parcours de carrière susceptibles d’offrir des perspectives individuelles aux travailleurs, en prenant en considération l’âge, le sexe, le niveau initial de compétences et l’expérience. Il apparaît clairement que la « conception ST » ne peut pas être laissée aux seuls « spécialistes ST ». Les découvertes des quatre dernières décennies appellent l’intégration, dès la phase de conception, des connaissances et expériences spécifiques liées aux thèmes organisationnels mentionnés. Ces connaissances et cette expérience se trouvent autant chez les travailleurs et leurs représentants que dans la fonction Ressources humaines (RH).
- 20 ‒ Abréviation française pour Equivalent Vingt Pieds ou TEU (Twenty-Foot Equivalent Unit) en anglais ou conteneurs de 20 pieds, soit la taille standard d’un conteneur.
Annexe II – Participation directe et dialogue social dans une mutuelle d’assurance (France)
L’industrialisation du tertiaire et l’autonomie des salariés
De nombreux emplois dans le secteur tertiaire, tant public que privé, sont aujourd’hui concernés par une « industrialisation » des processus de travail. Ceux-ci sont standardisés, découpés en sous-tâches, en partie automatisés, voire externalisés et pilotés par des systèmes d’information centralisés. La rigidification des processus et le renforcement des contraintes de conformité (Dujarier, 2006) se traduisent par une perte d’autonomie et une réduction de la marge de manœuvre des salariés sur leurs tâches. Certains métiers cumulent plus de contraintes que d’autres. Les centres d’appel en sont une bonne illustration : les salariés doivent faire face à un rythme de travail imposé de l’extérieur, à des procédures fortement normées et à des relations parfois tendues avec les clients.
Faute de pouvoir modifier le travail lui-même, les syndicats du secteur tertiaire négocient souvent sur des points annexes : gestion du temps de travail, élaboration des plannings, télétravail, aménagement physique des espaces de travail, etc. Il s’agit de créer des marges d’autonomie permettant de contrebalancer, au moins partiellement, les contraintes inhérentes aux postes de travail.
Nous analysons en détail ci-après le cas d’une mutuelle d’assurance à l’occasion d’un projet de refonte de l’aménagement du temps de travail au sens large (quotidien, annuel, équilibre vie professionnelle-personnelle). Cette étude de cas est intéressante à un double titre. Premièrement, il s’agit d’un projet ambitieux tant dans sa finalité que dans sa démarche. L’entreprise a engagé un vaste chantier de dialogue social et professionnel, en y associant étroitement les syndicats, les instances représentatives et un grand nombre de salariés. Deuxièmement, la démarche participative a été mise en place très en amont du projet, car celle-ci fait intrinsèquement partie du projet stratégique de l’entreprise.
La refonte de la gestion du temps de travail dans une optique gagnant-gagnant
L’entreprise, qui compte plus de 7 000 salariés, est historiquement ancrée dans les valeurs mutualistes, avec la volonté reconnue d’apporter un service d’excellence dans le secteur de l’assurance − ce qui constitue sa marque de fabrique. Elle est implantée sur l’ensemble du territoire français et comprend à la fois des métiers commerciaux et des métiers administratifs et de gestion. Une part significative des salariés travaille au sein de centres de relations clients.
Le point de départ du projet était le constat fait par la direction que la gestion du temps de travail et les horaires d’ouverture ne correspondaient plus aux besoins des clients, et plus généralement au projet stratégique de l’entreprise. La digitalisation de la société a modifié les attentes et le comportement des clients. Ils se déplacent de moins en moins dans les agences et traitent de plus en plus leurs problèmes à distance (téléphone, internet). Le projet présenté par la direction visait donc à développer un cercle vertueux entre les attentes des clients et celles des salariés, tout en maintenant la performance de l’entreprise par une meilleure adéquation des ressources aux variations de l’activité. Les nouvelles façons d’organiser le travail quotidien devaient satisfaire aux besoins du triptyque : clients, salariés et entreprise. L’objectif était de rechercher des solutions « gagnantes-gagnantes-gagnantes » en adaptant davantage la gestion du temps de travail aux spécificités de chaque métier.
Le projet a immédiatement fait apparaître plusieurs points sensibles, tels que l’extension du travail le samedi et l’annualisation du temps de travail. En contrepartie, l’idée avancée par la direction était de donner davantage d’autonomie aux salariés dans la gestion de leur planning de travail. Une des originalités du projet était que les nouvelles organisations du temps de travail devaient être recherchées métier par métier, en y associant directement les salariés concernés, tout en respectant des critères de qualité définis par la direction dans son projet stratégique (le triptyque).
La négociation préalable d’un accord de méthode
Début 2016, un accord préalable de méthode est signé entre la direction et la quasi-totalité des organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise (cinq sur six). Cet accord définit la méthodologie participative à suivre et les moyens exceptionnels donnés aux syndicats et aux instances représentatives des salariés (IRP) pour pouvoir contribuer à ce projet (crédits d’heures supplémentaires pour la participation à des groupes de travail, à la négociation, etc.).
La « co-construction » a constitué un des mots-clés de l’accord. Ce terme avait une double signification. D’une part, il était un élément essentiel de la conduite du projet. Les nouvelles règles de gestion du temps de travail devaient résulter d’une démarche participative avec les salariés et leurs représentants. D’autre part, l’objectif était de permettre aux salariés de co-construire leur propre planning du travail au quotidien dans l’organisation cible. Il s’agissait donc bien d’inventer des modes de fonctionnement dans lesquels la confiance accordée aux collaborateurs est première et la prise d’initiatives favorisée.
Les organisations syndicales signataires de l’accord ont obtenu d’être représentées au sein des « groupes de travail avec la participation d’un représentant du personnel (CHSCT, CE/DP) ou d’un délégué syndical pour chaque groupe de travail ». Cette participation n’a été rendue possible que grâce à cette négociation préalable d’un accord de méthode, car elle n’était pas prévue initialement par la direction. Les syndicats ont été entendus et ont bénéficié de moyens supplémentaires pour rendre cette participation effective.
L’articulation entre la participation directe des salariés et la participation indirecte via les représentants des syndicats et des instances représentatives a été organisée tout au long du déroulement du projet. La participation directe s’est inscrite dans le cadre du droit à l’expression directe sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette imbrication s’explique par le fait que l’objet visé par la démarche (les horaires et les temps de travail) est soumis juridiquement à l’existence d’un accord validé par les organisations syndicales majoritaires. Si la démarche avait été séquentielle − d’abord une consultation et participation directe des salariés, suivie par une négociation sociale −, le risque perçu par les syndicats aurait été « une mise devant le fait accompli » au moment de la négociation de l’accord.
Il était aussi essentiel que la direction convainque les volontaires aux groupes de travail qu’il n’y avait pas d’agenda caché et que l’accord n’était pas écrit d’avance. Dans ce but, elle a délibérément joué la carte de la transparence et multiplié les efforts de communication sous différentes formes. Par exemple, les idées faisant consensus lors des réunions des groupes de travail étaient immédiatement formalisées puis publiées telles quelles. Parallèlement, les instances représentatives (CE, ICCHSCT) ont également été un lieu de discussion et d’échanges entre les élus et la direction tout au long du projet.
Un projet co-construit par étapes et avec de nombreuses parties prenantes
Le projet s’est étendu sur plusieurs années, en quatre étapes, avec des chevauchements temporels.
La co-construction via une participation directe des salariés
Rares sont les projets qui mobilisent en même temps l’ensemble des métiers d’une entreprise. L’accord de méthode prévoyait la création d’une soixantaine de groupes de travail, issus aussi bien du siège (métiers administratifs) que du réseau (métiers commerciaux). Les groupes de travail ont réuni 731 salariés (soit environ 10 % des effectifs) et ont donné lieu à 578 fiches d’idées. Les salariés volontaires pour participer à la co-construction s’engageaient à être présents pendant trois journées de réunions, programmées entre mars et juin 2016. L’approche a été résolument bottom-up en partant des analyses et des souhaits des salariés. La méthodologie mise en œuvre s’est appuyée sur un modèle d’innovation participative partant d’un diagnostic assez large sur les « irritants » recensés dans l’organisation, mais sans donner des consignes plus précises. Comme nous l’ont rapporté des participants, cette mobilisation sans égale des salariés a été bien perçue par les principaux intéressés : « C’est nouveau, on nous demande de faire des propositions ! », « Au début ce n’était pas évident, on partait d’une feuille blanche : on savait ce qu’on ne voulait pas et c’était difficile de faire des propositions ! » De la même manière, une évolution des pratiques managériales a été initiée avec un plan d’action privilégiant un management participatif et bienveillant.
La phase d’arbitrage et de négociation
La direction a ensuite passé les 578 fiches-idées au filtre du triptyque clients/salariés/entreprise, en retenant celles qui amélioraient au moins l’un des trois pans du triptyque, sans dégrader les deux autres − une logique souvent utilisée en matière de développement durable et que l’on appelle « la théorie du baquet ». Par exemple, améliorer la satisfaction des salariés en dégradant la performance ou la satisfaction des clients n’aurait pas été recevable. Au total, 360 mesures ont ainsi été retenues. Ces dernières ont été regroupées en dix grands principes : auto-positionnement, annualisation du temps de travail, assouplissement de la prise des jours de récupération, télétravail, visibilité sur la charge de travail/temps de travail additionnels, plages de travail adaptées aux attentes des clients, temps partiels plus souples, gestion de crise et réactivité, amélioration de la qualité de vie au travail et gestion des fins de carrière. Chaque thématique a ensuite été négociée avec les organisations syndicales. Il s’agissait de remplacer 13 accords préexistants par un seul accord-cadre.
Dans quelle mesure la phase d’expression des salariés a-t-elle permis d’enrichir la négociation entre les partenaires sociaux ? La réponse est nuancée. Certes, la formulation d’un grand nombre de fiches de propositions a été très riche d’enseignements, y compris pour les représentants du personnel, à travers une meilleure compréhension du vécu du travail, et par les solutions imaginées pour mieux répondre à l’évolution des attentes et pratiques des clients. Toutefois, comme l’explique un représentant syndical, « lors de la négociation, les priorités des syndicats n’étaient pas nécessairement celles retenues par la direction dans le cadre du triptyque. Et, plusieurs demandes formulées par les salariés étaient connues depuis longtemps. » Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une démarche inédite et exemplaire pour combiner au mieux le service aux clients avec les conditions de travail des employés.
Une phase d’expérimentation avec un rôle de suivi du CE et de l’ICCHSCT
Pas moins de 36 expérimentations ont ensuite été mises en place pour tester la faisabilité des idées émises par les groupes de travail. Certains principes ont pu être testés, d’autres pas. Un avenant à l’accord de méthode négocié avec les syndicats a précisé les modalités de suivi de ces tests. L’ensemble des expérimentations a fait l’objet de bilans sur la base d’indicateurs préétablis toujours dans une approche « triptyque » : qualité de service client, productivité et conditions de travail. La responsable de l’équipe projet a régulièrement assuré un retour d’information au comité d’entreprise et à l’ICCHSCT (l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), qui a constitué un lieu d’échanges et de confrontation. Afin de favoriser l’information de l’ensemble des salariés sur le suivi du projet, un espace dédié a été créé sur l’intranet de l’entreprise. L’accord de méthode a également permis à l’ICCHSCT de se faire assister d’un expert extérieur agréé par le ministère du Travail. L’expert a eu pour mission d’établir un bilan qualitatif et indépendant des expérimentations et d’éclairer les élus sur leurs conséquences éventuelles sur l’organisation et les conditions de travail. L’objectif était de créer la base d’un débat contradictoire entre les partenaires sociaux et d’aider l’ICCHSCT à formuler un avis circonstancié lors de l’information et de la consultation sur le nouvel accord.
Les travaux de l’expert ont, par exemple, permis de montrer la complexité de la mise en œuvre du principe de l’auto-positionnement21, c’est-à-dire la possibilité pour un salarié de définir lui-même son planning du travail dans le cadre de certaines règles. Certaines expérimentations ont été concluantes, d’autres n’ont réussi que très partiellement ou ont été abandonnées au moins provisoirement. En effet, l’autonomie accrue laissée aux salariés pour l’élaboration de leur planning de travail s’est révélée être une pratique intéressante mais exigeante. Les expérimentations ont montré que sans un minimum de repères (comme le nombre de permanences à réaliser par semaine, le nombre de vendredis soir à assurer par mois, etc.), la pratique d’auto-positionnement avait beaucoup de mal à fonctionner. La définition de règles du jeu claires constitue un facteur essentiel pour éviter des tensions entre salariés et une dégradation du climat social. Elle limite aussi les besoins de régulation et d’arbitrage a posteriori et rend la planification plus fluide. L’adhésion non seulement des salariés mais également de l’encadrement de proximité est essentielle. Pour cela, les salariés doivent avoir la conviction que ce mode de planification est équitable. Enfin, le principe de co-construction du planning, qui est complexe d’un point de vue technique, ne peut fonctionner sans un outil de planification adapté. Comme nous le verrons, c’est sur ce point que le projet a partiellement achoppé, au moins dans un premier temps. En l’absence d’une refonte de l’outil de planification, certaines expérimentations n’ont été que partiellement significatives.
La signature d’un nouvel accord-cadre sur l’organisation du temps de travail
Avant même que les expérimentations et l’outil de planification ne soient finalisés, un nouvel accord-cadre sur l’organisation du travail a été signé par la direction et trois des six organisations syndicales représentatives : la CFDT, la CFE-CGC et la CAT, soit au total 54,97 % des voix obtenues lors des élections professionnelles. Tandis que le chantier de concertation a duré plus de deux ans, la négociation stricto sensu s’est déroulée en deux mois, soit un temps record. Pour les syndicats non signataires (FO, CGT, UNSA), l’extension du travail le samedi et l’annualisation du temps de travail (par ailleurs impossible à expérimenter à court terme) ont été les arguments avancés pour justifier la non-signature de l’accord. La volonté de mener rapidement à bien les négociations explique sans doute que l’accord ait été signé avant même que le bilan des expérimentations ne soit finalisé. Un membre de la direction a avancé une explication supplémentaire : le processus de négociation de l’accord a été sciemment dissocié des expérimentations, afin de ne pas « faire porter le poids des choix qui seraient faits sur les groupes de travail et les salariés impliqués dans les expérimentations ». La direction a mis en place un large dispositif de communication pour informer les salariés de l’avancement des négociations et des résultats de l’accord-cadre. Elle s’est fortement appuyée sur les managers de proximité pour diffuser l’information auprès des salariés. La position de ces derniers s’est avérée d’autant plus délicate que l’accord-cadre n’était pas encore décliné filière par filière et que beaucoup de questions restaient encore en suspens.
Des visions différentes du bilan
Plus de trois ans après la signature de l’accord-cadre, quel bilan peut-on établir ? La direction s’est déclarée satisfaite. Les objectifs assignés à la négociation ont été largement atteints. Elle a obtenu un élargissement des plages horaires et une souplesse accrue dans l’aménagement du temps de travail.
Pour les syndicats, le bilan est plus mitigé. Les salariés ont obtenu de nouveaux droits (compensation salariale pour le travail le samedi, extension du télétravail, droits élargis pour les temps partiels, modalités nouvelles pour la gestion des fins de carrière, etc.), tout en maintenant des avantages acquis dont une durée annuelle du temps de travail inférieure à la durée légale. En contrepartie, les salariés ont dû accepter de nouvelles contraintes (élargissement des heures d’ouverture, annualisation du temps de travail, élargissement de l’ouverture au samedi, etc.). L’élaboration d’un outil informatique de planification générale, qui devait automatiser la gestion du planning des salariés sur la base de leurs souhaits, s’est avérée très complexe. Ce projet a dû être abandonné. Cette co-construction du planning de travail, principal levier d’une autonomie accrue des salariés, n’a pas vu le jour tel que prévu initialement. Ce renoncement a constitué une déception pour les syndicats. Les salariés ont néanmoins obtenu une autonomie accrue dans la gestion de leur planning. Des solutions sont recherchées direction par direction sans recours à un outil informatique unique. Par la suite, les partenaires sociaux ont signé un accord de télétravail en juillet 2020. Mais, l’extension du télétravail n’a pas remis en cause les principes de l’élaboration du planning. Les règles de planification sont les mêmes, quel que soit le lieu du travail du salarié.
Retour sur la conduite du changement et le dialogue social
Les salariés ont dans l’ensemble été très satisfaits de leur participation aux groupes de travail. C’était une démarche nouvelle au sein de l’entreprise. Elle leur a permis de sortir de la routine quotidienne, mais « l’atterrissage » n’a pas été facile. Les suggestions des groupes de travail n’ont pas toujours été suivies d’effets. Des décalages ont pu exister entre les conclusions des groupes de travail (telles que rapportées aux salariés) et les résultats des négociations avec les syndicats. L’expérience montre ainsi qu’une démarche participative doit être maniée avec précaution.
Les démarches participatives sont surtout mises en place lors de projet de changement d’une certaine ampleur. L’adhésion des salariés est un prérequis pour la réussite de la conduite d’un projet technique et organisationnel. Au-delà de l’adhésion, les directions cherchent aussi à bénéficier des connaissances et de l’expérience des salariés directement concernés par le projet. Ainsi, dans les années 1980 et 1990, les directions ont associé presque systématiquement des salariés à l’élaboration de projets informatiques d’une certaine taille à travers la création de groupes de travail utilisateurs (ARETE, 1983). Sans avoir complètement disparu, de telles démarches se font actuellement plus rares, suite au développement de progiciels et solutions clé en main. Les méthodes d’élaboration des systèmes d’information ont en effet considérablement évolué au fil des années. Afin d’être plus réactives, les entreprises recourent notamment à des méthodes dites « agiles » où un panel de salariés (en nombre très restreint), représentants des utilisateurs et des métiers, est directement intégré dans l’équipe projet (design thinking). Ils participent avec les concepteurs à l’élaboration de l’application, au moins à certaines étapes telles que le design de l’application (interfaces utilisateurs). Bien qu’exigeante, cette méthode produit des résultats positifs22.
Au cours des dernières années, des innovations importantes ont eu lieu dans l’aménagement des espaces de bureaux avec la généralisation de l’open space et le développement du flexoffice, encore renforcé par la pandémie. Elles se traduisent par des évolutions concomitantes de l’organisation du travail. Lors de l’élaboration de ce type de projet, la mise en place d’une démarche participative est devenue partie intégrante d’une bonne conduite du projet23. Plusieurs raisons à cela. Les directions cherchent ici encore à la fois l’adhésion des salariés et de leurs représentants, et une amélioration du projet lui-même par la prise en compte des besoins des utilisateurs.
Quelle que soit la nature du projet, les démarches participatives permettent à l’équipe projet de disposer d’une vision plus claire des enjeux métiers, de pousser la discussion sur les choix d’organisation au cours de la conception et de renforcer l’engagement des salariés concernant le projet de l’entreprise. L’étude de cas de la mutuelle d’assurance montre les multiples enjeux que recouvre l’articulation entre la participation directe et indirecte (information, consultation et négociation). La confiance entre les différents acteurs est essentielle et, pour la construire, le rôle et la place des syndicats et des élus dans la démarche doivent être pensés et précisés. Dans ce cas particulier, la négociation d’un accord de méthode préalable a permis de clarifier les règles du jeu et représente une bonne pratique à suivre.
- 21 ‒ Traditionnellement, c’est le manager de proximité qui élabore le planning de présence des salariés, en les positionnant sur un tableau papier ou numérique. On parle « d’auto- positionnement » dès lors que le salarié choisit ses horaires en se positionnant lui-même sur le planning prévisionnel, toujours dans le respect de certaines règles.
- 22 ‒ L’Agile pour le développement de logiciels et d’applications est une approche itérative et collaborative, capable de prendre en compte les besoins initiaux du client (interne ou externe) et ceux liés aux évolutions du projet. Cette méthode est propice à l’expression des représentants des utilisateurs. Elle permet de conduire le projet en qualifiant les développements au fil de l’eau (au rythme des sprints) et de faire réagir les contributeurs métiers sur des éléments réels et non sur des supports papiers. Ces expériences sont généralement très bien vécues par les salariés qui ont le sentiment d’être écoutés et valorisés. La mise en œuvre de la méthode agile est néanmoins exigeante et peut s’avérer ardue. Le mode itératif implique que certaines personnes soient en mesure de conserver une vision globale du projet et de toutes ses contraintes (charge de travail, limitation des développements spécifiques, etc.) afin que les sprints restent bien inscrits dans le cadrage global.
- 23 ‒ Génie des Lieux, « Performance et bien-être dans les espaces de travail », Guide des bonnes pratiques, 2013.
Annexe III – Management participatif au service public de l’emploi (Suède)
Ce cas décrit les efforts déployés pour créer une culture de management participatif en période de changements et de pressions externes dans une autorité publique en Suède. Pour comprendre les conditions préalables au dialogue social et professionnel, nous commençons par décrire le cadre suédois de la participation en général et dans le secteur public en particulier. Nous présenterons aussi les ambitions de développement des organisations publiques dans le sillage du New Public Management et de la numérisation.
Contexte du management participatif dans le modèle suédois
La Suède a une longue histoire de stratégies de participation sur le lieu de travail impliquant à la fois l’État, les syndicats et les organisations patronales : l’État en termes de soutien à la recherche et au développement ainsi que comme source de réglementation ; les syndicats et les organisations patronales via leurs stratégies et conclusion d’accords. Le modèle suédois de relations sociales laisse une grande liberté aux partenaires sociaux via la conclusion de conventions collectives. L’industrie automobile en particulier, avec des sociétés telles que Volvo et plus tard Scania, a été à l’avant-garde des organisations basées sur des équipes autonomes. Les cultures de management participatif ont également été importantes dans des entreprises comme IKEA, Handelsbanken et Skandia. Toutefois, les modèles de management anglo-saxons et japonais ont laissé de nombreuses traces. Le management de la qualité totale (TQM) au cours des années 1980 et la lean production à partir des années 1990 en sont deux exemples. Les deux ayant souvent (pas toujours) été adaptés à la tradition suédoise, ils ont bénéficié du soutien des syndicats.
Les facteurs institutionnels favorables à ce développement ont été tout d’abord la loi sur la codétermination sur le lieu de travail (MBL) de 1976 (mise en œuvre en 1977) suivie par les conventions collectives sur la participation et le développement dans les différents secteurs du marché du travail. Dans la convention collective du secteur privé de 1982 il est stipulé ce qui suit : « La codétermination dans l’entreprise vise à utiliser les connaissances et les compétences professionnelles des employés […] Le processus visant à rendre la production plus efficace nécessite la participation des employés […] Des tâches diverses et évolutives sont recherchées […] Le travail et l’organisation du travail doivent être conçus en fonction des besoins des salariés […] »
À la suite de cet accord, un certain nombre de programmes de R&D tripartites ont été lancés concernant les nouvelles technologies, le management, les organisations apprenantes, le développement des compétences, etc. L’Institut national de recherche sur la vie professionnelle, créé dans les années 1970, a prospéré. Sa fermeture en 2007 par le gouvernement a révélé une baisse d’intérêt général pour les questions d’organisation du travail et d’évolution de la vie au travail. Les questions de sécurité et santé au travail (SST) sont devenues prioritaires par rapport à la démocratie et au développement des personnes sur le lieu de travail. Mais les valeurs fondamentales sur la participation avaient été établies. En termes de réglementation et de soutien, le rôle de l’employeur et du management est souligné. Les directives sur l’environnement organisationnel et social du travail (2017), publiées par le Conseil National de la Santé et de la Sécurité au Travail, fixent des règles sur la charge de travail, les heures de travail et le harcèlement. « L’employeur doit s’assurer que les tâches effectuées par le salarié ne conduisent pas à une situation de travail insalubre et que les ressources sont adéquates […] L’employeur doit veiller à ce que le salarié connaisse les tâches à effectuer et prioriser, les résultats à atteindre, les méthodes à appliquer […] »
Depuis les années 1970, IfMetall, le syndicat des cols bleus dominant dans le secteur privé, a développé des principes pour le nouveau millénaire, allant du « travail gratifiant » au « travail durable », dont le contenu peut être résumé ainsi :
i) s’organiser pour que tous aient un contenu de travail significatif. Les tâches et les responsabilités doivent pouvoir être développées ;
ii) mixer des tâches en développement et d’autres qui le sont moins ;
iii) faire une analyse des risques des changements planifiés ;
iv) créer des opportunités de développement des compétences et d’employabilité et intégrer l’apprentissage au travail quotidien ;
v) les entreprises et les syndicats doivent développer conjointement l’organisation du travail et les salariés doivent participer de bout en bout au développement de leur propre travail.
Le service public de l’emploi (SPE)
Le SPE est une grande agence publique qui compte aujourd’hui environ 10 000 employés sous la responsabilité d’un directeur général. Il applique depuis de nombreuses années les politiques suédoises de plein emploi avec pour mission d’aider les chômeurs à retrouver un emploi et les entreprises à acquérir les bonnes compétences lors de leurs processus de recrutement.
Au cours des dix dernières années, le SPE a été organisé en régions correspondant à des zones du marché du travail, avec des bureaux géographiquement répartis dans toute la Suède. L’objectif était d’être au plus près des demandeurs d’emploi et des entreprises. Toutefois, le SPE a été beaucoup critiqué pour son inefficacité, les employeurs réussissant bien plus souvent à recruter par le recours à leur réseau ou à des agences privées. Dans le sillage de la numérisation, les services à distance se sont étendus, entraînant la fermeture de nombreux bureaux locaux. Le SPE a augmenté ses effectifs au cours des dernières années en raison de son rôle de plus en plus important dans l’insertion des immigrés sur le marché du travail, mais aussi des personnes passant d’un congé maladie de longue durée au travail via une réadaptation à l’emploi.
Le métier dominant au SPE est celui des agents pour l’emploi travaillant directement avec les chômeurs/demandeurs d’emploi. Au cours des dernières années, la spécialisation s’est développée. Dans le sillage de la digitalisation des services, les métiers de l’informatique et du service « client » se sont multipliés. En assumant de nouvelles tâches sur l’immigration et la réadaptation, de nouvelles compétences ont dû être développées, telles que le coaching, l’ergothérapie, le consulting, etc. La situation de travail pour les employés s’est aussi caractérisée au fil des années par l’application d’une réglementation tatillonne et compliquée, alors que le support informatique restait peu développé et défaillant. Comme dans d’autres services nationaux de l’emploi, la conjonction des missions de contrôle (allocations chômage) et d’accompagnement (recherche d’emploi, formation…) des individus s’est révélée compliquée.
Coopération et participation au SPE
En termes de participation institutionnelle, le SPE entre dans le champ de l’accord de coopération du secteur public. Les principaux syndicats d’État sont TCO (au SPE représenté par Förbundet ST), SACO et SEKO. ST (qui fait partie de TCO) est un syndicat vertical regroupant tous les employés, du personnel administratif aux cadres. SACO est une confédération des syndicats universitaires. SEKO organise les cols bleus et entretient des liens étroits avec le parti social-démocrate. TCO et SACO sont politiquement indépendants.
ST est le syndicat dominant au sein du SPE, mais la force du SACO se développe à la suite d’exigences accrues en matière de personnel détenant des compétences de niveau universitaire. Toutes ces organisations ont des représentants dans les différents groupes de consultation et mandats de négociation.
Initialement, les stratégies syndicales sur la codétermination visaient à donner un rôle majeur aux représentants syndicaux et aux négociations. Le secteur public a été le premier à conclure un accord de codétermination sectoriel en 1978 résultant de la loi sur la codétermination. Des accords locaux ont ensuite été négociés sur la base de l’accord national. Ces stratégies syndicales ont conduit, 20 ans plus tard, en 1996, à une modification de l’accord de codétermination dans le sens d’une relation plus coopérative, mettant également l’accent sur la participation au travail. Il s’agissait également d’intégrer les comités de sécurité et de santé au travail (SST) dans la nouvelle structure coopérative.
De nouveaux ajustements ont été opérés en 2017 sous la nouvelle rubrique de « Coopération pour l’avenir ». Au fil des années, de nombreux accords locaux ont été conclus, mais pas dans toutes les agences du SPE. Dans certaines agences, le mécontentement des syndicats locaux a conduit à la rupture des accords locaux, menant à un retour à une forme de codétermination basée sur l’information et la négociation selon la loi de 1978, ainsi qu’à la mise en place de comités de SST basés sur la loi sur l’environnement de travail.
Structures participatives dans les SPE
Au Service public de l’emploi, la structure de base de la participation est constituée de réunions sur le lieu de travail/unité, où le responsable de première ligne informe et consulte les employés sur les questions générales et les décisions à prendre. Ceci est complété par des groupes d’information et de consultation aux niveaux organisationnels supérieurs. Le SPE a conclu des accords locaux de coopération au fil des ans, adaptant l’accord central aux nouvelles structures organisationnelles.
Au niveau départemental ou régional, il existe un groupe de concertation composé du responsable départemental ou régional, des représentants des RH, des syndicats et de la sécurité. Dans ce groupe, l’employeur remplit ses obligations selon la loi sur la codétermination et la loi sur l’environnement de travail.
Au niveau central, il existe des groupes de concertation, en partie avec la même structure qu’au niveau départemental/régional, auxquels s’ajoutent souvent des groupes de travail ou de concertation spécifiques paritaires qui peuvent évoluer dans le temps (SST, redéploiement, informatique…). Les dirigeants syndicaux rencontrent régulièrement le directeur général de manière informelle. Le SPE est dirigé par un conseil d’administration nommé politiquement par le ministre du Travail. À ce conseil de huit membres au total, participent deux représentants du personnel nommés par les syndicats avec droit à l’information et à l’expression. Le SPE représentant un enjeu politique important, les syndicats (locaux et nationaux ensemble) ont sporadiquement des contacts avec des représentants du gouvernement et du parlement.
Un nouveau directeur général pour un renouveau de la culture managériale
En 2014, un nouveau directeur général a pris ses fonctions, engageant l’organisation dans une « voie de renouvellement » dans le but d’améliorer les services de l’agence, notamment envers les employeurs. Le nouveau directeur général, d’origine syndicale, a remplacé un directeur général plus controversé qui était entré en conflit avec l’organisation et les syndicats. Dès ses débuts, un dialogue constructif a ainsi pu s’établir entre les syndicats et la DG concernant cette voie de renouveau.
Au cours des cinq années suivantes, le SPE a vécu des changements majeurs, à commencer par un changement de culture du management. Celui-ci avait pour but de faire émerger un nouveau business model basé en grande partie sur la numérisation des services. Cela signifiait, entre autres, limiter le contact direct entre le demandeur d’emploi et « son » agent de placement au profit de la création de centres de « clientèle ».
Cette nouvelle culture managériale, fondée sur l’autonomie accrue des salariés, est devenue l’un des concepts-clés de l’organisation. Un vaste programme de formation par des consultants pour les cadres supérieurs et intermédiaires a été lancé. L’idée de base était de changer la culture organisationnelle et le comportement managérial vers une logique de management fondée sur la confiance plutôt que sur le contrôle. Ce modèle était encouragé et soutenu par le gouvernement pour pallier certains aspects négatifs du New Public Management (contrôle et systèmes de mesure excessifs). Un programme de formation pour les employés a également été lancé en matière de droit administratif et de grands principes à suivre pour l’appliquer. L’un des aspects importants du processus a été une forme de déréglementation, laissant une plus grande latitude aux agents pour décider du type de soutien à apporter aux demandeurs d’emploi. Pour obtenir ce résultat, la haute direction, soutenue par les syndicats, a fait pression sur le gouvernement central pour qu’il facilite l’application des règles sur le chômage dans le travail quotidien.
Une évaluation menée quelques années après la mise en place de la nouvelle culture de management, a montré qu’une majorité de salariés appréciait les résultats, notamment en termes d’élargissement de leur périmètre de contrôle sur leur travail et de qualité du dialogue entre salariés, managers et responsables hiérarchiques. Toutefois, les représentants syndicaux à différents niveaux ont pointé du doigt le fait que certains cadres intermédiaires ne pouvaient ou ne voulaient pas assumer le nouveau rôle basé sur la confiance et préféraient conserver l’ancien style de management plus autocratique. Il y avait aussi des problèmes pour rendre le nouveau cadre d’autonomie plus clair dans l’exercice du travail quotidien. Le support informatique restait également à la traîne. Une enquête initiée par les syndicats auprès des représentants de la SST a montré que plus de 70 % d’entre eux jugeaient le travail plus efficace mais que 40 % considéraient que la qualité de l’environnement de travail avait régressé. Des critiques ont été émises par les syndicats concernant la partie de la stratégie orientée vers le management intermédiaire, sur le cabinet de conseil retenu pour les formations, et sur le manque de clarté dans la fixation des objectifs et le suivi du processus.
De la construction d’une nouvelle culture à la conception d’un modèle organisationnel
L’étape suivante du développement organisationnel a été plus controversée. En termes d’organisation, un service client spécialisé et un service digital − « SPE Direct » − a été mis en place, construit autour d’outils digitaux en self-service. L’idée de base était de créer au sein de l’agence deux nouvelles divisions orientées « client » : l’une tournée vers les demandeurs d’emploi et l’autre vers les employeurs. L’espoir était que cela se traduise par une organisation plus efficace, surtout vis-à-vis des employeurs, dans un contexte de surchauffe économique et de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Toutefois, les avis étaient partagés quant aux avantages de ce nouveau modèle. Des inquiétudes se sont exprimées sur le fait que cette organisation allait créer une division du travail improductive avec des risques de duplication et des surcharges de communication. Les syndicats ont fait appel à un consultant en travail pour obtenir un deuxième avis sur la stratégie organisationnelle. Une partie du processus a consisté en une vaste enquête auprès des cadres intermédiaires, révélant que nombre d’entre eux étaient sceptiques quant à la nouvelle organisation. Une analyse des risques internes basée sur des discussions dans les groupes d’information et de consultation a montré des risques élevés, notamment sur la relation client à court terme. Les consultants en travail ont fait des propositions d’adaptation. En réponse, le directeur général, a pris note de certains des risques et des mesures d’atténuation suggérées, notamment des ajustements du calendrier, tout en maintenant pour l’essentiel le plan initial.
Conclusions sur les différents dialogues développés au cours du processus
Le cas du SPE montre les manières complexes dont une organisation du travail peut évoluer vers plus d’autorégulation et sa dépendance vis-à-vis de la stratégie et de la culture de management. L’objectif principal de cette transformation était de créer une structure de décision décentralisée permettant aux employés ainsi qu’aux managers de première ligne d’assumer davantage de responsabilité dans le support au client. Si la vision stratégique promeut le « bas vers le haut », sa mise en œuvre effective a plutôt été du haut vers le bas.
Le dialogue professionnel a eu pour effet notable d’amener à ce que le cadre réglementaire soit moins détaillé dans sa mise en œuvre, de façon à donner des latitudes aux agents. Mais les systèmes informatiques destinés à soutenir la transformation n’ont pas toujours suivi, ni du côté des agents, ni du côté des usagers. Dans l’ensemble, sur le plan managérial, la culture basée sur la confiance a pris du temps à s’établir, notamment chez les managers intermédiaires. Il y a eu globalement une augmentation du turn-over chez les managers au cours du processus.
La construction de l’organisation basée sur la confiance, ainsi que les ambitions de numérisation, ont été menées en coopération entre la direction générale et les représentants du personnel. L’autonomisation des employés et le développement professionnel par la formation ont été appréciés par les syndicats. Plus problématique a été la dissolution de la relation personnelle entre le demandeur d’emploi et l’agent. La question des salaires des agents a également été une source de conflit.
Mais, dans le cadre du dialogue social, le conflit le plus important a porté sur la division organisationnelle : le découpage des responsabilités entre les employeurs, d’une part, et les demandeurs d’emploi, d’autre part, rendait, selon les syndicats, le processus d’appariement plus difficile. La fermeture des bureaux locaux, poussée par la direction, en tant qu’effet secondaire de la numérisation, a également été une zone de conflit.
Le dialogue social se déploie toujours comme une succession de conflits, de compromis et de consensus. Souvent sur des sujets différents. Dans le cas du SPE, le changement structurel est devenu le domaine le plus conflictuel, et celui que les représentants syndicaux ont eu le plus de difficulté à influencer. Les arguments et les solutions alternatives proposées avec l’appui des consultants n’ont pas suffi à changer la stratégie du directeur général.
Même quand les stratégies sont globalement coopératives, les compromis deviennent plus difficiles dès qu’on aborde les structures organisationnelles qui déterminent la répartition du pouvoir. Les syndicats, comme le montre ce cas, n’ont pas réussi à infléchir ce qui représente la prérogative fondamentale de l’employeur, à savoir « le droit exclusif des employeurs de diriger et de répartir les tâches entre les employés ». Ce socle fait partie intégrante du modèle suédois des relations sociales. Et pour une autorité publique, la prérogative patronale est renforcée par la notion de « propriété » publique, le DG étant nommé directement par le ministre.
Post-scriptum : Pendant la mise en place de la nouvelle organisation, il y a eu un changement de gouvernement qui a conduit à des coupes budgétaires importantes au SPE, à la privatisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi et au licenciement de 2 000 salariés. Mais ceci est une autre histoire.
Annexe IV- Dialogue sur la qualité du travail dans la métallurgie (France)
Espaces de dialogue et d’action sur le travail
Les acteurs des sciences sociales et des organismes tels que l’ANACT24 soutiennent depuis longtemps le développement d’espaces de discussion sur le travail. Au début des années 2010, Yves Clot et son équipe du Cnam les ont promus sous l’appellation de « Dialogue sur la Qualité de Travail » (DQT), à partir d’une démarche de clinique du travail à l’usine Renault de Flins. Celle-ci a fait écho au sein de la fédération CFDT de la métallurgie qui, depuis le milieu des années 1990, s’efforçait, sans vraiment y parvenir, de passer d’une vision négative centrée sur la souffrance au travail, à une vision positive visant à instaurer des relations de confiance entre les différentes composantes de l’entreprise.
En 2014, deux initiatives d’ampleur s’opèrent simultanément sans avoir été préalablement coordonnées ou planifiées : le caractère opérationnel de la démarche d’Yves Clot chez Renault à Flins (Yvelines), et l’accord QVT incluant la mise en œuvre du dispositif « 50 minutes de développement » (voir ci-après) chez Toyota à Onnaing (Nord). Avec ses équipes locales, la fédération CFDT de la métallurgie soutien ces deux démarches et précise la sienne, en retenant l’appellation DQT qui permet de dépasser la notion de « droit d’expression » sur le travail pour mettre l’accent sur l’intervention des travailleurs, d’une part, et la cible de qualité du travail, d’autre part. Depuis le milieu des années 2010, cette démarche a été mise en œuvre sous différentes formes, dans plusieurs PME ou groupes industriels, à l’initiative tantôt de directions d’entreprises, tantôt de la fédération ou de syndicats CFDT de la métallurgie, ou encore dans le cadre de projets partagés entre les deux.
Nous allons présenter brièvement cette démarche telle qu’elle a été mise en œuvre chez Toyota à Onnaing, chez Renault à Flins (Yvelines), et chez Navailles25 à Hagetmau (Landes) depuis 2019. En 2021 deux nouvelles grandes entreprises se sont engagées dans la démarche : à l’initiative de la CFDT chez Safran Helicopter Engines, et à l’initiative des dirigeants lors de la création de la nouvelle société Renault ElectriCity. Dans cette dernière entreprise, Luciano Biondo, directeur industriel du Pôle Nord de Renault, et précédemment directeur de l’usine de Toyota à Onnaing, a proposé la mise en place de la démarche sous l’appellation de cercles de qualité, sur un contenu similaire aux « 50 minutes de développement » de Toyota. Ces deux dernières démarches sont cependant trop récentes pour que nous puissions en rendre compte, mais témoignent de l’intérêt que cette approche suscite au sein de grands groupes industriels.
Les démarches présentées ont systématiquement fait l’objet d’un dialogue social et/ou de négociations préalables. Elles ont d’abord été mises en œuvre sous forme expérimentale pour que tous les acteurs (travailleurs, managers et représentants du personnel) soient en mesure d’en évaluer l’impact sur le bien-être au travail et la performance, avant de procéder à leur généralisation.
Le principe proposé est la création d’un espace de dialogue et d’action sur le travail réel, tel qu’il s’accomplit, s’organise et s’effectue quotidiennement. Ces espaces peuvent prendre des formes différentes, adaptées aux activités et modes de fonctionnement de chaque entreprise. Ils fonctionnent dans le cadre des unités ou équipes de travail existantes, et sont animés par des managers de proximité, secondés par un référent élu ou désigné par les membres de l’équipe. La durée et la fréquence des réunions d’échange et d’intervention sur le travail (correction des problèmes…) doivent en principe être de l’ordre d’une heure mensuelle si l’on veut instruire une véritable démarche de progrès continu. Une fréquence de réunion trop faible réduirait la démarche à une simple séance de libération de la parole sans enjeu de transformation du travail et de développement des personnes. Le dialogue sur le travail doit permettre d’exprimer les problèmes rencontrés dans le travail, d’en analyser les causes, de discuter et valider des solutions.
Chez Navailles, après une année et demie de fonctionnement, ce dialogue a permis de mettre en place des petits matériels pour faciliter le travail, mais aussi de changer certaines données figurant dans les ordres de fabrication ou encore de modifier la conception des housses de fauteuils pour en faciliter la production. À l’usine Renault de Flins, en 2017, alors que la démarche avait été déployée sur l’ensemble de l’usine (soit un équivalent de 3 000 personnes, intérimaires inclus), on était sur un rythme annuel de 1 700 problèmes identifiés, avec un taux de résolution ou de traitement des problèmes de l’ordre de 70 %. Pour la production, et par ordre décroissant en nombre, les catégories de problèmes les plus fréquemment rencontrées étaient : process (procédures de travail), moyens techniques (outillages), implantation des postes de travail, temps alloués pour exécuter les opérations, sécurité aux postes, conception des pièces à assembler, et logistique.
Au-delà de la résolution de problèmes matériels et techniques, les espaces de dialogue sont conçus comme des moments de réflexion sur le travail permettant la confrontation des savoir-faire entre membres d’une équipe, pouvant conduire à modifier l’organisation du travail au sein de l’équipe. Chez Navailles, des réflexions sont en cours sur des réorganisations plus importantes des lignes de fabrication ou encore sur l’intégration de nouvelles colles moins toxiques.
Le dialogue dans le cadre d’un mode de management basé sur la subsidiarité
À l’usine Toyota de Valenciennes, la réunion d’échange et de traitement des problèmes est organisée toutes les deux semaines, durant 50 minutes, avec arrêt de la production. Ce principe est cohérent avec le Toyota Production System (TPS) et plus largement avec les principes d’un lean management authentique, car le DQT est clairement positionné comme une démarche de progrès continu. Il s’insère dans un mode de management bottom-up qui a pour finalité affichée l’amélioration de la performance, mais aussi le développement des personnes, d’où l’appellation choisie de « 50 minutes de développement ». Toyota présente habituellement la démarche de progrès continu sous la forme d’une pyramide inversée avec un double mouvement : une remontée quotidienne des anomalies aux différents niveaux hiérarchiques et un soutien descendant de toute la ligne managériale à la démarche de progrès continu. Les managers sont invités à descendre sur le terrain (le Gemba dans la pratique du lean) pour comprendre le travail réel et les difficultés rencontrées par les opérationnels, et pour les encourager à trouver par eux-mêmes les solutions.
Chez Toyota, comme chez Renault et Safran Helicopter Engines, la démarche DQT vient compléter les outils du lean management. Les outils habituels, tels que le QRQC (Quick Response Quality Control), n’impliquent pas vraiment les opérationnels dans une réflexion sur leur travail. D’autres outils comme les « top 5 » ou « top 10 » le permettent encore moins, car il s’agit la plupart du temps de séances de descente d’information, sans réelle possibilité pour les opérationnels de s’exprimer. Le DQT vient corriger cette carence.
La démarche DQT intègre ainsi le principe de subsidiarité qui consiste à laisser traiter les problèmes et à laisser prendre les décisions au niveau où ils apparaissent par les équipes concernées, en fonction des capacités des individus et du collectif. Pour les problèmes qui nécessitent d’être traités à un niveau supérieur ou dans des fonctions support externes à l’unité de travail, les managers ont obligation de faire un retour rapide aux équipes sur les décisions prises. Dans le cadre du principe de subsidiarité, les managers deviennent essentiellement des coachs ou des apporteurs de soutien professionnel.
Pour le bon fonctionnement du DQT, la ligne hiérarchique doit être impliquée dans la démarche de manière à favoriser la prise en compte du travail réel : « […] le management de première ligne doit être lui aussi partie prenante d’un espace de discussion d’un niveau supérieur au sein duquel pourront être portés les produits de la discussion locale et discutées les solutions de niveau méso-organisationnel » (Detchessahar, 2019). C’est ce qui a été mis en œuvre, au moins en début du processus, à l’usine Renault de Flins, afin de permettre aux managers de proximité d’échanger sur leurs propres difficultés à résoudre les problèmes ou sur les obstacles rencontrés avec les niveaux hiérarchiques supérieurs et les fonctions support (la technostructure) de l’entreprise. Le succès et la durabilité de la démarche DQT reposent fortement sur cette implication de toute la ligne hiérarchique, depuis le manager de proximité jusqu’à la direction générale, chargés de soutenir les propositions des opérationnels, de suivre la mise en œuvre des plans d’action, et d’assurer un feed-back sur les décisions prises à l’extérieur des unités de travail. Elle requiert aussi des fonctions support (ingénierie, logistique…) qui soient réellement positionnées comme des apporteurs de services là où se crée la valeur ajoutée pour les clients (la production).
Vers l’organisation apprenante
La démarche DQT, telle que mise en œuvre dans les expérimentations ici recensées, a eu un impact plus limité relativement à une autre de ses ambitions : développer progressivement l’autonomie des équipes de travail, c’est-à-dire l’étendue des décisions pouvant être prises au sein des unités de travail.
Toute démarche participative a en principe vocation à s’inscrire dans une courbe de progression au sens de la double boucle d’apprentissage proposée par Argyris et Schön (2001). Pour générer de la confiance (en soi et dans les autres), il faut commencer par résoudre des problèmes dans le cadre des fonctionnements, normes ou processus existants. On traite dans ce cadre les irritants quotidiens. Progressivement, on passe à un niveau supérieur qui permet de transformer plus radicalement les façons de faire. Chez Toyota, les travailleurs utilisent les outils du lean tels que le kaizen, l’A3 de résolution de problèmes, le diagramme d’Ishikawa etc., et ont une habilitation pour l’utilisation de petits outillages (perceuse, meuleuse…) nécessaires à la transformation des postes de travail. Le DQT permet de commencer à développer chez les opérationnels des capacités d’analyse critique des situations de travail basées sur un retour d’expérience, et de recherche de solutions partagées par le collectif, nécessitant l’apprentissage de nouveaux comportements et compétences. La démarche permet aux « employés de se parler et de travailler sur un plan d’égalité, en réalisant des efforts considérables et constants de résolution de problèmes, en organisant le feed-back immédiat pour permettre à tous les employés de voir la situation évoluer sous leurs yeux » (Sailly, 2017). Mais les espaces de dialogue sur le travail ne peuvent réussir à produire tous leurs effets que s’ils s’inscrivent dans un mouvement plus large d’évolution des organisations du travail, incluant le principe de subsidiarité, le management bottom-up du progrès continu, l’autonomie au travail, et le décloisonnement des fonctions dans l’entreprise.
C’est l’ensemble de ces paramètres qui produisent une nouvelle forme d’organisation du travail, conduisant à faire travailler ensemble des personnes de différents niveaux hiérarchiques et de différentes fonctions de l’entreprise. Le dialogue sur la qualité du travail est ainsi conçu comme un processus permettant d’utiliser et de développer les capacités d’intervention de tous les acteurs (opérationnels et managers) − qui ne peut réussir durablement que s’il est soutenu par la direction de l’entreprise.
Articulation du DQT avec le dialogue social sur le travail
Dans les trois entreprises citées (Toyota, Renault, Navailles), les dispositifs de dialogue sur le travail ont fait l’objet de discussions ou négociations préalables avec les représentants du personnel. Chez Toyota, les « 50 minutes de développement » ont été l’une des dispositions figurant dans l’accord « bien-être au travail » conclu en 2014.
Chez Navailles, la négociation s’est engagée à la suite d’une enquête sur la qualité du travail réalisée en août 2018 par la CFDT auprès des salariés, et l’accord a été signé en novembre 2018. Les résultats de l’enquête étaient relativement contrastés avec une large majorité de salariés considérant avoir les moyens et le temps pour faire un travail de qualité, mais une toute aussi forte majorité qui estimait les effectifs insuffisants au regard de la charge de travail ou considérait manquer de reconnaissance pour le travail effectué. Il y avait aussi et surtout de fortes disparités de vécu du travail selon les secteurs de l’entreprise, et une inquiétude générale sur l’avenir de la société.
Chez Renault, le dispositif a été déployé suite à une intervention de plusieurs années conduite initialement par Yves Clot et Jean-Yves Bonnefond de la chaire de psychologie du travail du Cnam. Cette intervention « faisait suite à un dialogue social en impasse au plus haut niveau de l’entreprise sur l’appréciation des situations de travail en matière de qualité et de santé » (Bonnefond, 2016). La proposition d’expérimenter le « dialogue sur la qualité du travail » a été initialement acceptée par toutes les organisations syndicales, puis diversement soutenue par la suite. On reviendra plus loin sur ces réticences syndicales.
Dans ces trois entreprises, les représentants du personnel ont acquis un droit de regard sur le fonctionnement du dispositif à travers l’organisation de comités paritaires de suivi et/ou la désignation, parmi les représentants du personnel, de représentants DQT ou QVT devenus les interlocuteurs privilégiés des managers. La désignation de référents des membres de l’équipe (une personne désignée ou élue) chez Renault Flins et chez Navailles permet par ailleurs aux représentants du personnel d’avoir de nouveaux interlocuteurs privilégiés au sein des ateliers ou services. Chez Toyota, par exemple, les représentants du personnel ont renforcé leur proximité avec les Team leaders et les Group leaders. Plus généralement, les représentants du personnel sont davantage reconnus par les managers qu’auparavant. Le DQT leur permet de parler le même langage, qui est celui du travail, et de développer un syndicalisme de proximité avec les travailleurs.
Limites de la démarche
Ces dispositifs ne suppriment pas pour autant tous les problèmes liés aux conditions de travail. Certaines caractéristiques d’intensité du travail demeurent liées à son rythme ou à son caractère répétitif. Mais souvent, ce dont les travailleurs souffrent le plus est de ne pas pouvoir s’exprimer sur leur travail.
Des conflits peuvent aussi subsister localement soit lors de l’arrivée de nouveaux managers qui ont l’habitude d’un management plus hiérarchique, soit parce que les fonctions support imposent des standards de travail inadaptés et contraignants. Sur ce dernier point, les principes du lean management sont appliqués différemment selon les cultures de management. Chez Nissan au Japon (où l’un des auteurs a travaillé), les standards au poste favorisent la qualité de la formation et l’intégration d’opérateurs nouvellement affectés à un poste de travail. Une fois le poste maîtrisé, ces opérateurs peuvent appliquer le standard de façon plus souple. En France, le standard devient une « norme » à respecter en toutes circonstances. Surgit dès lors un dilemme sur les critères de qualité à prendre en compte qui, lorsqu’ils ne sont pas arbitrés en faveur des opérateurs, peuvent générer des risques pour leur santé psychique et produire du désengagement. Cette différence d’approche des standards, que l’on peut qualifier de pragmatiste versus idéaliste (Pellerin et Cahier, 2021), pourrait expliquer les résultats contrastés de l’application du lean dans notre pays.
Plus généralement, et comme nous l’avons indiqué plus haut, les grands groupes industriels considèrent que leurs outils de type QRQC (Quick Response Quality Control), 5S… permettent d’impliquer les travailleurs. Mais l’expression et la capacité d’intervention des travailleurs et managers de proximité restent très théoriques, lorsque le management est basé essentiellement sur la prescription, le contrôle, ou lorsque les procédures ou règles d’action sont définies par avance, en dehors de toute prise en compte du travail réel. Ces pratiques que nous qualifions de « lean outil » se caractérisent par de faibles niveaux de contrôle des salariés sur leur propre travail, alors même qu’on leur demande par ailleurs de prendre des responsabilités. Cela pourrait expliquer en partie la réserve des managers de proximité à ouvrir une mise en discussion du travail quand eux-mêmes ne disposent pas des ressources pour régler les problèmes soulevés par les opérationnels.
Les obstacles peuvent aussi provenir des organisations syndicales qui craignent une remise en cause du rôle traditionnel du syndicat ou rejettent toute forme de coopération entre le syndicat et la direction, assimilée à une compromission. La fédération CFDT de la métallurgie a d’ailleurs été amenée à s’interroger sur un « DQT syndical », c’est-à-dire une application de celui-ci à son propre fonctionnement interne avec les adhérents et les salariés.
Ces résistances, tant patronales que syndicales, expliquent la longueur des discussions et négociations, qui s’étalent parfois sur plusieurs années, avant de parvenir à un accord, comme cela a été le cas par exemple chez Safran Helicopter Engines. Dans cette entreprise, il a fallu l’arrivée d’un nouveau président qui comprenne l’enjeu du développement des personnes et des organisations pour que le dispositif soit finalement accepté (ou concédé) par plusieurs organisations syndicales. À ce jour les expérimentations se déroulent de façon très satisfaisante et les réticences ou scepticismes s’estompent.
La désignation de référents des travailleurs pour coanimer la démarche entre le terrain et les managers de proximité (à Navailles et Renault Flins) peut accentuer la crainte d’une remise en cause de la légitimité ou du contournement des représentants du personnel. Chez Navailles, ces référents des équipes métiers ont été désignés conjointement par la direction et la CFDT, seule organisation syndicale présente ; il n’y a donc pas eu de tension à ce sujet. Le problème a été plus prégnant chez Renault où les référents ont été élus directement par les membres des équipes de travail. Toutefois, la démarche proposée par Yves Clot comprend l’installation d’une institution tripartite pérenne permettant de réaliser une jonction entre le dialogue professionnel et le dialogue social, en incluant quatre catégories d’acteurs : la direction, des référents des salariés (opérateurs), des référents des managers de proximité, et des représentants du personnel. À noter que seule une petite partie des référents des salariés et des managers de proximité est présente dans cette instance : ce sont en quelque sorte les référents des référents. Pour des raisons de stratégies syndicales difficiles à expliciter, certaines organisations syndicales se sont par la suite désintéressées du dispositif ou s’en sont retirées.
Faut-il passer par une négociation préalable pour adopter ce type de dispositif ? En France, on procède par la négociation parce qu’il est difficile de construire un processus dynamique de dialogue basé sur la recherche d’intérêts communs, y compris sur la question du travail et de son organisation. Et même lorsqu’un accord finit par être conclu, la négociation aura été un lieu d’affrontement qui n’ouvre pas nécessairement la voie à une meilleure coopération. De plus, la conclusion d’un accord après des mois ou années de discussion ne garantit pas qu’il soit appliqué. Il faudrait privilégier un temps initial de négociation relativement court, comme cela a été le cas chez Navailles, puis une mise en œuvre de la démarche sous forme expérimentale, c’est-à-dire provisoire, suivie éventuellement d’une renégociation pour prolonger le dispositif, l’adapter, voire le remettre en cause plus fondamentalement en fonction des enseignements tirés par les acteurs concernés. Cela implique que ceux qui expérimentent puissent déroger à l’accord initial, prendre de l’autonomie sur la manière de faire fonctionner ces espaces de dialogue sur le travail, comme c’est le cas actuellement chez Safran Helicopter Engines. Expérimenter, ce serait concevoir une autre façon d’articuler le processus de négociation ou de dialogue social avec le processus de participation directe des travailleurs ou dialogue professionnel, permettant un apprentissage de la démarche par tous les acteurs concernés : dirigeants, managers, travailleurs et représentants du personnel.
Fluctuations et fragilité des dispositifs DQT
Chez Navailles, même la crise du Covid-19 n’a pas eu d’impact négatif sur le dispositif qui est en vigueur depuis maintenant trois ans. Une nouvelle enquête auprès des salariés conduite en 2021 a fait apparaître des progrès significatifs sur dix-sept des dix-huit variables de qualité du travail retenues. Seuls deux ateliers dans lesquels le dispositif n’était pas implanté, ressortent en négatif. La direction a donc proposé un avenant à l’accord pour étendre les espaces de dialogue à ceux-ci.
Chez Renault, et plus récemment chez Toyota, la démarche a été jalonnée de périodes difficiles. La démarche chez Renault a été mise entre parenthèses en 2016 lors de l’introduction en fabrication de la Nissan Micra à l’usine de Flins. La même situation s’est reproduite chez Toyota avec la production de la nouvelle génération de la Yaris 4 au milieu de l’année 2020, et l’introduction en fabrication de la Yaris Cross au début de 2021. Plusieurs éléments peuvent être avancés pour expliquer cette interruption de la démarche à l’occasion de la mise en fabrication de nouveaux véhicules. Ceux-ci sont conçus et industrialisés par des fonctions ingénierie externes aux usines, respectivement au Technocentre de Guyancourt pour Renault et au Centre européen de design avancé de Toyota à Sophia Antipolis. Dans ces groupes industriels, l’information sur la démarche DQT ne dépasse pas le cadre de l’usine. Les directeurs et ingénieurs des centres technologiques les ignorent, et suivent leurs propres modes de fonctionnement indépendants de ceux des usines. Il n’y a pas une articulation satisfaisante entre ceux qui industrialisent un nouveau véhicule et ceux qui vont le produire. Chacun a ses propres priorités. En outre, lors de l’introduction de nouveaux véhicules, les fonctions support des usines sont entièrement mobilisées par le projet et ne parviennent plus à répondre aux sollicitations issues des espaces de dialogue sur le travail. De ce fait, les problèmes des opérateurs nécessitant une intervention de ces fonctions support ne sont plus réglés.
D’autres facteurs peuvent venir perturber le dispositif. La démarche tient essentiellement par l’engagement des directeurs d’usines et des responsables des ressources humaines. Si ceux-ci sont mutés ou moins présents pour des raisons diverses, une période d’incertitude s’installe. Comme il s’agit toujours de démarches locales qui ne sont pas intégrées dans la politique générale du groupe industriel, il faut à chaque fois re-convaincre le nouveau directeur ou responsable RH de poursuivre la démarche. Chez Toyota, par exemple, l’usine a procédé à un recrutement important de nouveaux managers provenant d’un autre constructeur automobile. Ces derniers ne soutiennent pas forcément la démarche DQT, ni n’essaient de tirer parti de la culture de management de Toyota schématisée par sa pyramide inversée. Ce qui fait dire à un syndicaliste CFDT de Toyota « qu’on a un management de plus en plus à la française », qui contribue à dégrader le climat social.
En conclusion, on constate des fluctuations de natures différentes dans la mise en œuvre de la démarche. Celle-ci exige un engagement et une coopération de tous les acteurs, et subit donc dans le temps une instabilité compréhensible. Des conflits localisés peuvent survenir quand des problèmes répétitifs ne trouvent pas de réponse satisfaisante. Les interruptions de la démarche lors de changements plus radicaux sont regrettables. Quand une telle démarche est à l’œuvre, il devient inadmissible pour des opérateurs, de trouver leur poste modifié le lundi matin, sans y avoir été associé, du fait de transformations introduites durant le week-end par des membres des fonctions support. De même, il serait souhaitable que les fonctions centrales d’ingénierie intègrent mieux les modes de fonctionnement et pratiques sociales des usines dans le pilotage de leurs projets. Il faudrait penser en amont l’articulation du dialogue sur la qualité du travail avec les démarches d’ingénierie de projets. Par exemple, chez Nissan, les Team leaders ou superviseurs documentent une fiche A4 concernant les problèmes et idées d’amélioration qui ne peuvent être prises en compte en « vie série » (période de fabrication du véhicule). Lors de l’industrialisation d’un nouveau véhicule, les ingénieurs et techniciens ont obligation d’examiner les fiches A4 qui les concernent et d’apporter une réponse à la fabrication sur les décisions prises. Renault a repris l’appellation − Revue For Next Model − mais l’a transformé en une procédure qualité qui l’éloigne de la démarche participative initiale.
Enfin, les dérives managériales, telles que celles évoquées chez Toyota, peuvent menacer à terme tout l’édifice de la démarche en ébranlant le fondement de la confiance, s’il n’y a pas une réaction rapide et à la hauteur, de la part des dirigeants de l’établissement. Elles peuvent pénaliser durablement toute tentative ultérieure de redévelopper la participation directe des travailleurs et la coopération avec les syndicats.
Tel qu’il s’est actuellement développé, avec les limites évoquées, le dialogue sur la qualité du travail reste cependant un espace de confrontation/coopération entre dirigeants, managers, employés et syndicats, permettant à chaque partie de faire entendre ses intérêts et arguments fondés sur le travail et les compétences de chacun. Il permet de construire une forme de partenariat social dans le domaine de l’organisation du travail, à même de répondre aux besoins des employeurs comme des employés, en apportant des améliorations concrètes sur la manière d’exercer le travail et d’en améliorer la performance.
- 24 ‒ Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail. Cette agence tripartite a développé plusieurs outils sur ce sujet, dont un kit « espaces de discussion ».
- 25 ‒ Navailles est un fabricant de sièges ergonomiques à architecture métallique pour les bureaux, le médical, la production et les laboratoires.
Annexe V – Extrait de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022
Article 43. Place du dialogue professionnel au sein du dialogue en entreprise
Les signataires de la présente convention entendent promouvoir une vision du dialogue en entreprise en tant que facteur de progrès social, d’efficacité économique et d’amélioration des relations de travail.
La qualité de ce dialogue doit s’apprécier en termes de capacité à traiter des réalités du travail et à les faire évoluer. Elle favorise également la circulation de l’information au sein de l’entreprise, la compétitivité et la performance au travers des discussions sur la réalisation du travail, le bien-être au travail, et contribue à la fidélisation des salariés. Dans cette optique, le dialogue dans l’entreprise doit s’entendre largement, comme renvoyant à l’ensemble des échanges, débats et négociations qui ont lieu entre les différents acteurs de l’entreprise, dans l’objectif de concourir au développement de l’entreprise et à l’amélioration des conditions de travail.
Au regard de ces considérations, deux constituantes du dialogue en entreprise sont identifiées.
La première, le dialogue social, comprend :
• les mécanismes de dialogue réglementés par un ensemble riche de dispositions du Code du travail, ce qui inclut tous types de négociation, consultation ou échange d’informations entre les représentants du personnel, élus ou désignés, et l’employeur ;
• l’ensemble des échanges informels entre l’employeur et les représentants du personnel, sans que ces échanges s’inscrivent dans une procédure réglementée.
La seconde, le dialogue professionnel, comprend des voies de dialogue permettant, sans empiéter sur le dialogue social, ni l’entraver, d’impliquer plus directement les salariés sur les questions opérationnelles des activités de l’entreprise.
Ainsi, le dialogue professionnel désigne toute forme de communication et de partage direct d’informations relatives à la vie de l’entreprise, à son organisation et à la réalisation du travail. Ce dialogue englobe l’ensemble des échanges au sein de la communauté de travail et, le cas échéant, avec l’employeur.
Le dialogue professionnel permet d’agir sur la qualité du travail, de redonner du sens au travail, en explicitant les liens avec les objectifs de l’entreprise.
Les responsables hiérarchiques occupent une place essentielle dans l’animation du dialogue professionnel, du fait de leur positionnement entre la direction et les salariés. Représentants de la direction auprès des salariés, acteurs du relais des actualités de l’entreprise, ils concourent à la création et au développement d’un dialogue de proximité. En contact direct avec les salariés, les managers de proximité exercent donc un rôle central dans la promotion d’un dialogue professionnel durable et de qualité. En ce sens, les managers de proximité concourent à entretenir le lien social dans l’entreprise.
Le dialogue social et le dialogue professionnel s’exercent de façon complémentaire, en vue de la réalisation d’intérêts communs.
La diversité des canaux de dialogue favorise la richesse et la profondeur des échanges entre les parties prenantes.
Michel Sailly, Aslaug Johansen, Per Tengblad et Maarten van Klaveren, Dialogues social et professionnel : comment les articuler ?, Les Docs de La Fabrique, Paris, Presses des Mines, 2022. ISBN : 978-2-35671-769-6
© Presses des MINES – TRANSVALOR, 2021
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel – 75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr