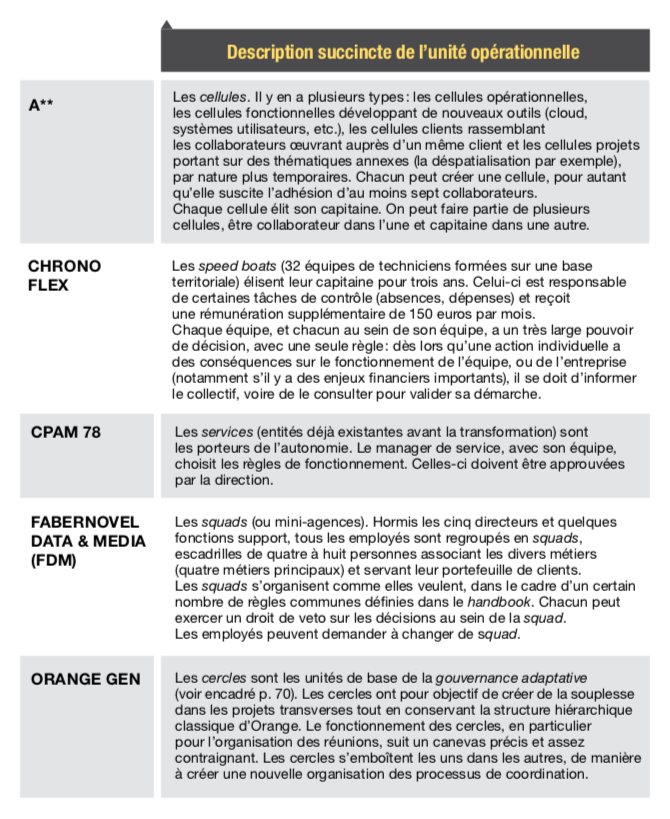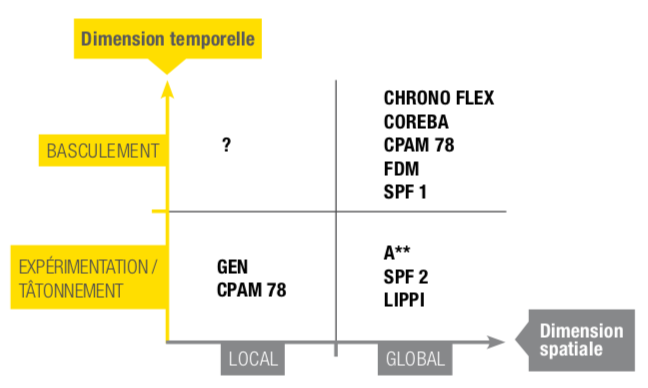Au-delà de l’entreprise libérée

Répétition, « Trapèze » (C. Reed), 1955 Voinquel Raymond (1912-1994) © RMN-Grand Palais – Gestion droit d'auteur
Préface
Par Jean-Dominique Senard, président du groupe Renault
Les dirigeants d’entreprise réfléchissent en permanence aux moyens d’adapter leur organisation à un environnement turbulent et de plus en plus exigeant. En impliquant ses collaborateurs et son management, l’entreprise doit ainsi régulièrement se réinventer pour affronter ces défis.
Face à une rationalisation des structures qui trouve ses limites, les transformations actuelles tendent à vouloir « libérer l’entreprise », ses organigrammes, ses processus de décisions, ses projets, ses talents. Il s’agit de placer le développement de l’autonomie des acteurs au cœur du dispositif.
Sur ce sujet, l’étude réalisée par Thierry Weil et Anne-Sophie Dubey est éclairante à plusieurs titres. Au-delà de détailler les principes fondamentaux de l’entreprise libérée et de l’autonomie des salariés, elle nous fait découvrir des cas concrets d’entreprises engagées dans ces changements, et aborde la question des moyens, de la méthode et des points de vigilance.
Pour un constructeur automobile, cet enjeu est aussi celui de l’ouverture sur son écosystème. Celui de la mobilité est en pleine évolution. La voiture et son client s’intègrent aujourd’hui dans une infrastructure connectée, apprenante et intermodale. Cette recherche d’ouverture relève de la responsabilité des dirigeants, mais chaque collaborateur peut être porteur de ces nouvelles valeurs, et l’entreprise peut bénéficier de sa curiosité et de ses initiatives.
Comment libérer les organisations et les Hommes ? Car c’est bien ce « comment » qui est au centre des débats lorsque l’on s’engage sur les chemins de l’autonomisation.
L’étude montre que les solutions sont multiples et doivent prendre en compte le contexte de chaque entreprise, notamment ses valeurs et sa culture.
Il faudra pour cela mobiliser tous les talents et développer les nouvelles compétences, notamment les soft skills, que ces démarches exigent.
Dans cette perspective, je suis convaincu que l’autonomie grandissante des acteurs, l’agilité de nos organisations et l’intelligence collective permettront de trouver et de renforcer le sens que chacun puise dans son activité au service de la mission de l’entreprise.
Résumé exécutif
Si certaines entreprises déclarent appartenir au mouvement des « entreprises libérées », elles sont considérablement plus nombreuses à vouloir favoriser la montée en autonomie et la participation des salariés, sans référence à un modèle particulier. À vrai dire, beaucoup considèrent qu’elles n’ont plus le choix. L’effacement du taylorisme semble inéluctable : la séparation des tâches de décision, de conception et d’exécution ne correspond plus aux besoins d’organisations qui doivent être réactives, agiles, apprenantes, inventives, capables de personnaliser leur offre en fonction des attentes de chaque client, et d’être en prise avec les évolutions de la société. Pour y parvenir, il faut s’affranchir des habitudes qui étouffent l’initiative et mobiliser l’intelligence individuelle et collective des collaborateurs, qui s’impliqueront davantage du fait de leur adhésion aux objectifs de l’entreprise et du sens qu’ils trouveront à leur travail.
Cette note expose les résultats d’une recherche destinée à mieux comprendre les pratiques diverses qui visent à renforcer l’autonomie des salariés dans les collectifs de travail. Elle repose sur une enquête auprès d’une dizaine d’organisations de natures différentes (entreprises familiales, filiales de groupe, coopératives, administrations). Des entretiens avec une dizaine d’interlocuteurs de tous niveaux ont été menés dans chacune d’elles.
Il en résulte que « libérer les énergies » ou « changer l’état d’esprit » est loin d’être un long fleuve tranquille ; cela nécessite de s’intéresser de près à l’intendance et à de multiples paramètres. Or, la littérature la plus visible sur ces nouvelles formes d’organisation accorde une attention très limitée au « comment faire ? » : comment introduire et pérenniser l’autonomie ? Quelles sont les difficultés rencontrées et comment parvenir à les surmonter ? Comment s’adapter au contexte et à l’histoire spécifiques de chaque organisation ? Les méthodes de gestion, comme les médicaments, ont en effet des indications, une posologie, parfois des effets secondaires indésirables et des contrindications qu’il convient d’analyser.
Nos observations nous conduisent à affirmer que la montée en autonomie nécessite une préparation et une organisation. Il n’y a pas d’auto-organisation spontanée qui découlerait de quelques conditions simples, telles que le « lâcher prise » du dirigeant, l’écoute des salariés ou le partage actif de la vision du dirigeant avec les collaborateurs, bien que ces points aient évidemment toute leur importance. Dans tous les cas, la transformation des modes de fonctionnement nécessite une très forte mobilisation et un accompagnement intensif. Il est important de noter que cette « organisation » n’a cependant pas grand-chose à voir avec une planification, dans la mesure où l’objectif à atteindre peut être en partie indéterminé et où de nombreuses difficultés apparaîtront chemin faisant. Le processus pour atteindre cet horizon flou doit tolérer la turbulence, le tâtonnement, l’itération, et le temps nécessaire à l’appropriation du changement. Le voyage est, en quelque sorte, plus important que la destination. On pourrait même aller jusqu’à dire que c’est le type de voyage qui crée a destination. C’est pourquoi l’utilité des modèles « clés en main » se révèle souvent assez limitée.
Bien que les modalités de transformation soient très diverses, nous avons cependant repéré quelques récurrences. La transformation provient le plus souvent d’une initiative du dirigeant ou d’une équipe très restreinte. La grande majorité des entreprises qui veulent favoriser l’autonomie agissent, cumulativement ou alternativement, sur les six points suivants.
– L’aplatissement de la structure hiérarchique (réduction du nombre de strates) pour raccourcir la chaîne de décision. Notons cependant que quelques organisations favorisent l’horizontalité et la transversalité à côté de la structure hiérarchique traditionnelle, et non en lieu et place de celle-ci.
– Le design organisationnel, afin de constituer des unités opérationnelles de petite taille (de 5 à 40 personnes) qui constitueront le cadre dans lequel s’exercera l’autonomie de l’équipe et des individus qui la composent.
– La distance hiérarchique, en réduisant ou éliminant les marqueurs du pouvoir irritants pour les collaborateurs (places de parking, restaurants, bureaux, voyages en classe supérieure ou accès à l’information réservés à quelques-uns).
– La posture des managers, priés de devenir coaches, aidants ou facilitateurs, de réduire les contrôles et de faire confiance à leurs équipes. Cela se traduit parfois par un changement d’appellation des managers (team leaders, animateurs, capitaines, mentors) et de leur mode de désignation (élection, cooptation). Une forme de coordination managériale reste perçue comme nécessaire, mais elle ne doit plus avoir ni le goût ni l’odeur du management traditionnel.
– La création d’espaces d’expression, de concertation ou de délibération, permettant aux salariés d’identifier les tensions et de débattre des problèmes, de les résoudre, de proposer de nouvelles solutions ou d’exprimer une volonté collective. Ces espaces (cercles, cellules, groupes de travail, ateliers, tresses, etc.) sont ouverts à la participation volontaire, et sont souvent transfonctionnels et multi-niveaux. Ils favorisent les appartenances croisées, le cumul de fonctions et de rôles par un même individu, et la construction progressive de relations décloisonnées et plus denses au sein de l’organisation.
– Les modes d’intervention des services support (RH, Achats, Systèmes d’information), qui doivent désormais apporter appui et assistance aux unités opérationnelles, en renonçant à certaines de leurs prérogatives ou en partageant la décision avec les équipes (par exemple pour le recrutement).
Les champs de l’autonomie concernent le plus souvent la manière de réaliser la tâche et la construction de l’environnement organisationnel (les règles du «comment»). Dans l’écrasante majorité de nos cas – à l’exception des SCOP – l’autonomie et la participation ne portent ni sur le « quoi » (objectifs et stratégie de l’entreprise), ni sur la gouvernance, ni sur la personne du dirigeant. Le « pourquoi » (raison d’être de l’entreprise et contribution à la société) est en revanche de plus en plus ouvert à la concertation. Mais cet exercice, apprécié des salariés soucieux du sens de leur travail, n’a pas de conséquences directes sur les conditions d’exercice de celui-ci.
Les attributs de l’autonomie relèvent du pouvoir de décider sans demander la permission, pour autant que les valeurs et les règles qui gouvernent l’entreprise aient été correctement intégrées par les collaborateurs. Le salarié sera d’autant plus autonome que ces règles et valeurs auront été explicitées, et celles-ci seront d’autant mieux acceptées qu’il aura contribué à les construire (droit de participer à la construction de la prescription). Chacun dispose donc d’un domaine de décision et d’initiative, limité par l’impact que ses décisions peuvent avoir sur le travail des autres et sur l’efficacité de l’organisation (primat du collectif sur l’individu) – limites qui se révèlent cependant assez floues. L’expression droit à l’erreur, souvent utilisée, suppose surtout la construction d’un environnement bienveillant dans lequel les conséquences éventuellement fâcheuses d’une initiative (droit à l’initiative) ne seront pas sanctionnées, sous peine de voir les salariés s’autocensurer. La qualité d’une transformation se mesure aussi au traitement qui sera réservé aux « objecteurs », c’est-à-dire à ceux qui ne souhaitent pas accéder à davantage d’autonomie pour diverses raisons (droit de retrait ou au moins écoute respectueuse de leurs réticences). Encourager l’autonomie ne revient pas à contraindre les équipes à devenir autonomes.
Au niveau de l’instrumentation chaque organisation tâtonne pour adapter à sa manière les outils de gestion afin de susciter ou d’ancrer de nouvelles modalités de travail, avec quelques récurrences. Une souplesse se développe dans l’organisation des temps de présence et du télétravail, les plannings d’astreinte sont élaborés au niveau des équipes, de nombreuses dépenses peuvent être engagées sans autorisation préalable, des initiatives commerciales peuvent être déléguées à la base, les réunions suivent un formalisme encourageant l’expression des plus inhibés ou des moins gradés. Les équipes ont plus de latitude pour recruter, l’évaluation fait la part belle au retour des pairs (360°). La mobilité horizontale est encouragée, qui permet d’accroître la polyvalence et les compétences des personnes, sans progression hiérarchique, plus difficile dans une structure aplatie. La formation est largement proposée, y compris dans des domaines éloignés de la tâche exercée, comme les techniques de facilitation ou le développement personnel.
La dynamique de la transformation s’appuie souvent sur la construction plus ou moins collective d’un projet partagé pour l’entreprise. La crédibilité de l’équipe dirigeante se manifeste notamment dans la manière de créer un climat de confiance, de prêter la plus grande attention aux attentes de chacun et particulièrement de l’encadrement, souvent très déstabilisé par la perte de ses prérogatives. Elle passe aussi par la capacité à associer les institutions représentatives du personnel et à éviter l’hypocrisie organisationnelle, en clarifiant dès le départ ce qui est ouvert à la concertation et ce qui en est exclu (zones bleues et zones rouges), au moins à ce stade. Le rythme de la transformation – par basculement ou par expérimentation/tâtonnement – dépend de plusieurs facteurs, dont le tempérament plus ou moins aventureux du dirigeant, ses convictions quant à la nature de la concertation à mener, la maturité du corps social, la taille de l’entreprise ou encore l’urgence d’une transformation.
Les obstacles à surmonter sont multiples. Un ensemble de difficultés peuvent naître du fait que les dirigeants sous-estiment – ou parfois surestiment – les contraintes de l’action collective : coordination de l’action, capitalisation des savoirs et des connaissances, respect des obligations légales et réglementaires, sécurité, attentes de la gouvernance, ruptures stratégiques majeures… Face à la complexité des productions et des enjeux, il n’est pas toujours judicieux ni efficient de transformer une entreprise en un réseau d’équipes indépendantes. Chaque entreprise doit donc placer son curseur en matière d’autonomie en fonction de la nature de ses activités. Dans la conduite opérationnelle de la transformation, des difficultés récurrentes apparaissent : le dirigeant qui peine à lâcher prise en dépit de ses intentions et déclarations, celui qui communique trop au risque de décevoir les attentes, les managers insuffisamment accompagnés dans leur changement de posture et dont le comportement fait obstacle, les risques psychosociaux qui augmentent du fait d’un surinvestissement des salariés ayant perdu leurs repères, un turn-over mal anticipé provoqué par la transformation, la transparence et le contrôle social qui dégradent l’ambiance, etc.
Pour aider ceux qui veulent introduire plus de subsidiarité dans leur fonctionnement et développer l’autonomie dans leur organisation, cette étude se conclut par l’énoncé de dix points de vigilance permettant d’anticiper et de déjouer les pièges les plus courants.
1. Il n’y a pas de modèle à imiter mais un principe de cohérence à respecter. Si les réponses sont singulières et les bricolages fréquents, il est important que les principes retenus soient cohérents.
2. La volonté du dirigeant est nécessaire mais non suffisante. La bonne volonté du dirigeant ne suffit pas pour créer les conditions d’une organisation capable de fonctionner. Certains processus de coordination, de développement des capacités, de sécurité, de fiabilité et d’agilité stratégique, ne sont pas spontanément assurés par les actions autonomes des salariés, aussi responsables et bien intentionnés soient-ils.
3. Le dirigeant doit être au clair sur ses capacités, ses attentes et l’espace qu’il entend allouer à la concertation. Il doit savoir à peu près ce qu’il attend de la transformation de son entreprise, connaître sa tolérance face à l’indétermination et aux turbulences, voire aux mises en cause de ses propres pratiques et de son autorité.
4. Expliciter les zones rouges et les zones bleues de la démarche est un facteur de crédibilité de celle-ci. Plutôt que de prétendre que chacun a le même pouvoir de décision au sein de l’organisation, il est important d’indiquer clairement aux collaborateurs quelles sont les zones rouges (ce qui ne sera pas ouvert à la concertation) et les décisions qui restent arbitrées par le dirigeant, sans quoi un sincère désir d’encourager la participation pourra être considéré comme une manipulation hypocrite.
5. Il peut être préférable de procéder par expérimentation. Sauf pour de petites organisations (start-up), nos observations conduisent à recommander les expérimentations locales dans des unités volontaires, qui permettent un retour d’expérience et des ajustements, plutôt qu’un basculement global de toute l’organisation et un « passage en force ».
6. Le management et les collaborateurs doivent être accompagnés dans la montée en autonomie. Le « débrouille-toi, on te fait confiance » peut être anxiogène si les collaborateurs ont le sentiment de ne pas disposer des moyens de réaliser ce que l’on attend d’eux, voire si ces attentes sont trop ambiguës. Une mise à disposition de ressources, des formations, permettront de réduire cette anxiété.
7. La tolérance aux objecteurs est un marqueur de la qualité de la transformation. Il est important de réfléchir à la manière dont on traitera ceux qui manquent d’enthousiasme à l’égard de la démarche d’autonomie. Il peut être judicieux de prévoir des garants des droits des salariés qui soient indépendants de la direction.
8. La transparence est à manier avec précaution. Elle peut venir réduire la liberté individuelle, être oppressante et détériorer le climat de l’entreprise.
9. La communication externe est une arme à double tranchant. Au vu des attentes, des impatiences ou des inquiétudes que crée une communication trop emphatique sur la transformation, la discrétion semble parfois préférable.
10. Il est utile d’évaluer les progrès. Plutôt que de s’illusionner sur la réussite de la transformation et la perception positive qu’en ont les salariés, il est judicieux de définir en début de transformation quelques objectifs ou critères de réussite, voire de suivre un baromètre de la satisfaction des salariés et des clients.
Enfin, il faut garder à l’esprit qu’une transformation profonde et durable de l’entreprise demande du temps, que tous n’avancent pas au même rythme, que la confiance, tant en soi qu’entre les collaborateurs, se construit au fil des expériences. Il faut s’armer de bienveillance et de patience, allier persévérance dans l’intention et pragmatisme pour s’adapter aux retours du terrain.
Remerciements
Cette enquête sur le développement de l’autonomie des salariés a été conduite par la chaire FIT2 de Mines ParisTech, à la demande de ses mécènes : Fabernovel, Kea & Partners, La Fabrique de l’industrie, le groupe Mäder, Theano Advisors (au 1er novembre 2019).
Nous tenons avant tout à remercier les entreprises qui nous ont accueillis et ont accepté notre regard critique : Ardelaine, Chrono Flex, Coreba, la CPAM 78, Fabernovel Data & Media, Lippi, Orange GEN, le SPF Mobilité et Transports. D’autres entreprises ont accepté de longs échanges à l’occasion du séminaire Aventures Industrielles (co-organisé par l’UIMM, La Fabrique de l’industrie et l’École de Paris du management), comme SEW USOCOME, ou lors de rencontres individuelles, comme le groupe Hervé Thermique. Nous remercions particulièrement Michelin pour une visite très inspirante de son usine de Roanne.
Cette étude a bénéficié des apports très importants d’Elisabeth Bourguinat (rédactrice des cas Lippi, Ardelaine, Coreba), Marie-Laure Cahier (qui a contribué à l’ensemble de la rédaction et supervisé l’édition de ce texte), Laurence Decréau (cas Chrono Flex), Charles de Lastic (cas CPAM 78 et certaines analyses transversales), Dimitri Pleplé (initiation du projet et des contacts, participation aux cas Fabernovel Data & Media et SPF), ainsi que de quatre séances de travail d’un groupe de pilotage auquel ont notamment participé : Fanny Ar- naud (Institut Veolia), Thibaud Brière (Philos), Vincent Charlet (La Fabrique de l’industrie), Thibaut Cournarie (Kea & Partners), Thomas Coutrot (DARES), Isabelle Magne (Université de Clermont-Auvergne), François Maisonneuve (Kea & Partners), Jean-Louis Mercier et ses associés de l’APAP Toulouse, Tom Morisse (Fabernovel), Brigitte Nivet (ESC Clermont- Ferrand), François Pellerin (Sudinnove), Hélène Picard (Grenoble École de management), Nathalie Raulet-Croset (IAE Paris 1) et Martin Richer (Management & RSE).
Le manuscrit de cette note a bénéficié des retours éclairants de Frédéric d’Arrentières (Renault), Michel Berry (École de Paris du management), Yves Clot (Cnam), Patrick Gilbert (IAE Paris 1), Elisabeth Klein (groupe Metallians), Michel Lallement (Cnam), Isabelle Magne (Université de Clermont-Auvergne), Clémentine Marcovici (doctorante i3, Paris Sciences et Lettres), Christophe Midler (i3, École polytechnique), Patrick Pirrat (Chantiers de l’Atlantique), Grégoire Postel-Vinay (Ministère de l’économie), Andrej Racz (Fabernovel), Claude Riveline (Mines, Paris Sciences et Lettres), Michel Zarka (Theano Advisors), que nous remercions chaleureusement pour leur implication.
Les synthèses des entretiens exploités dans cette étude sont disponibles sur le site web de la chaire FIT2. On y trouvera aussi des synthèses validées trop tardivement pour être utilisées dans ce premier ouvrage, sur WebAtrio (par l’APAP de Toulouse) ou Mobil Wood (par Mathieu Battistelli, doctorant au CRG de l’X).
Introduction
L’entreprise libérée, une appellation attractive, des réalités multiples
L’entreprise libérée est un concept séduisant, mais assez mal défini. Elle est au confluent de plusieurs traditions qui soulignent la plus grande efficacité d’organisations dont les membres sont motivés. Ceux-ci peuvent l’être grâce au sens qu’ils trouvent à leur travail, souvent grâce aux responsabilités qu’ils exercent et à l’autonomie dont ils disposent, au plaisir d’appartenir à un groupe dont les valeurs sont congruentes aux leurs, à leur adhésion à des objectifs sur lesquels ils sont consultés, au désir et à la capacité de se montrer dignes de la considération et de la confiance dont on les honore. Un environnement turbulent favorise les organisations agiles, capables de s’adapter en mobilisant l’intelligence collective de leurs membres. De telles entreprises sont plus attirantes que les organisations bureaucratiques et hiérarchiques fondées sur la parcellisation des tâches et le cloisonnement des équipes. Elles savent valoriser et stimuler l’altruisme et l’implication de leurs participants.
Il existe cependant des manières très diverses de rompre avec les organisations hiérarchiques traditionnelles. Certaines peuvent susciter l’enthousiasme, conduire les salariés à se dépasser, individuellement et collectivement. D’autres peuvent être anxiogènes, lorsque les objectifs sont contradictoires ou lorsque l’individu se trouve investi d’une responsabilité sans avoir les ressources nécessaires pour y faire face. D’autres peuvent même être hypocrites, lorsque certaines tensions sont occultées, lorsque des décisions échappent à ceux qui sont censés y participer. D’autres, enfin, peuvent être oppressantes, lorsque l’individu doit se plier à un consensus qui heurte certaines de ses convictions et qu’une attitude réservée est considérée comme une trahison.
Sur la manière de « libérer » une entreprise ou d’y favoriser une plus grande autonomie des salariés, les prescriptions sont multiples. Certains, comme Isaac Getz et Brian M. Carney, privilégient l’état d’esprit du dirigeant et son aptitude à lâcher prise et à faire confiance ; d’autres, comme Frédéric Laloux ou Brian J. Robertson, considèrent plutôt les dispositifs organisationnels et les modes de régulation à mettre en place. D’autres encore, comme Yves Clot et Mathieu Detchessahar, insistent sur la mise en place d’espaces et de processus de délibération. Par ailleurs, l’autonomie des individus et des équipes peut porter sur la seule manière de réaliser des objectifs fixés par la direction ou – plus rarement – conduire à participer à la construction de ces objectifs, voire à discuter de la mission et de la raison d’être de l’organisation.
Enfin, certains changements demandent du temps avant que les individus et l’organisation puissent en tirer parti. Une période d’apprentissage est nécessaire, notamment pour permettre la construction de la confiance, l’évolution des comportements et des attitudes. Lorsque la nouveauté n’a pas porté les fruits attendus, les convaincus pensent qu’on n’a pas encore été assez loin ou attendu assez longtemps, tandis que les sceptiques considèrent qu’on a déjà été trop loin dans une voie infructueuse.
Face au mouvement de libération des entreprises, on trouve donc des évangélistes persuadés qu’il s’agit du stade ultime de l’évolution et que cette modalité d’organisation collective avantageuse l’emportera nécessairement, et doit donc être adoptée au plus vite. Des sceptiques « attendent pour voir », ou remarquent, goguenards, que plusieurs entreprises présentées comme des modèles de libération ont fait marche arrière et préféré revenir à des modalités d’organisation plus traditionnelles. Enfin, des pragmatiques, dont font partie les auteurs de ce travail, reconnaissent la pertinence des motivations invoquées par les « libérateurs », sans occulter les difficultés pratiques à surmonter. Ces pragmatiques ne veulent ni se priver de la possibilité d’améliorer le fonctionnement de leur entreprise et la satisfaction de ses parties prenantes, ni déstabiliser ce qui marche plutôt bien et bousculer inutilement des salariés, des clients et des actionnaires qui apprécient le fonctionnement actuel.
Il nous a donc paru opportun d’entreprendre une enquête dépassionnée dans quelques organisations ayant expérimenté diverses formes de renforcement de l’autonomie et de la participation de leurs collaborateurs. Pour que cette enquête soit fructueuse, nous avons élaboré une grille d’analyse, dont l’objectif est de mieux caractériser chaque expérience et son contexte. En effet, tant les enthousiastes que les plus réfractaires minimisent la diversité et la complexité des modalités de renforcement de l’autonomie des salariés et de mise en place de plus de subsidiarité. Nous avons au contraire souhaité donner à voir celles-ci, afin que ceux qui envisagent de s’engager dans la voie d’une plus grande autonomie puissent considérer les alternatives qui s’offrent à eux, en prenant en compte les spécificités de leur activité et de leur démarche. Nous évitons d’ailleurs l’expression d’entreprise libérée, dont nous verrons qu’elle est porteuse de contradictions, notamment sur le rôle du « libérateur » et sur ce dont il s’agit de se libérer.
Notre projet est ouvert, interactif et itératif. Cette note est un point d’étape, élaboré à l’issue des premières investigations. Elle s’enrichira des réactions de ses lecteurs, de la confrontation avec d’autres expériences et d’autres enquêtes. La synthèse de chacun de nos cas est librement accessible sur le site web du projet1, et la base de cas s’enrichira d’apports extérieurs et de nos travaux futurs.
Après un bref rappel des origines du mouvement de renforcement de l’autonomie et de ses enjeux (chapitre 1), nous exposerons les résultats de l’analyse transversale de nos cas en quatre chapitres portant respectivement sur : les motivations de la transformation (chapitre 2), les sujets et objets de l’autonomie (chapitre 3), les instruments de gestion de l’autonomie (chapitre 4), la dynamique de la transformation (chapitre 5). Nous conclurons par quelques recommandations pour ceux qui souhaitent s’engager dans une démarche de développement de l’autonomie (chapitre 6). Ce dernier chapitre ne vise pas à promouvoir un modèle mais à encourager la vigilance sur certaines difficultés couramment observées.
- 1. https://bit.ly/2NiweIF
Aux origines de la « libération »
Le but de cette partie n’est pas de nous livrer à une analyse de l’abondante littérature portant sur l’autonomie et la responsabilisation des personnels dans les organisations, mais de rappeler quelques perspectives sur le sujet.
Nous allons d’abord voir pourquoi, bien que l’organisation taylorienne ait été historiquement une forme de libération, diverses raisons conduisent à dépasser l’organisation scientifique du travail, devenue source d’aliénation et de perte de sens, et à promouvoir une plus grande autonomie des salariés. Nous présenterons sommairement les principes de « l’entreprise libérée » promus, entre autres, par Carney et Getz. Nous rappellerons ensuite les contraintes de l’action collective que les formes alternatives d’organisation de la production doivent respecter et sur lesquelles certaines présentations classiques des entreprises libérées passent pour le moins rapidement. Ceci nous conduira à présenter quelques autres formes alternatives paradigmatiques : les organisations prosaïques, la sociocratie et son dérivé holacratique, les organisations opales et l’entreprise délibérée.
L’organisation scientifique du travail, une première libération ambiguë
Une des caractéristiques historiques de l’Homme libre est de ne pas devoir travailler. Dans l’Antiquité, le travail est le lot de l’esclave, dans la société féodale, celui du serf. Entre celui qui travaille la terre ou la matière et la classe dominante oisive, il y a souvent des classes intermédiaires, métèques, bourgeois, clercs ou artisans, vivant du commerce (le négoce, étymologiquement neg-otium, absence de loisir, sans qu’il s’agisse toutefois de travail pénible ou dégradant), assurant l’organisation du travail des autres et le fonctionnement des institutions ou exerçant des métiers demandant un long apprentissage. Sauf pour quelques révolutionnaires, la question ne se pose pas de libérer le travail ou les esclaves qui l’accomplissent mais de bien traiter ces derniers, de les protéger ou même parfois de les affranchir en leur octroyant certains droits.
Si le travail est si pénible, c’est souvent parce qu’il est peu efficace. Beaucoup d’efforts et de peine produisent peu de résultats. L’efficacité du travail peut être améliorée de plusieurs manières.
Le progrès technique, par exemple dans les techniques agronomiques et l’outillage: de la charrue des paysans jusqu’à l’électroménager, dont les publicités des années soixante affirment qu’il «libère la femme» (sic), la force animale puis celle de la machine à vapeur ou du moteur électrique, permettent de réduire la dépense énergétique du travailleur pour accomplir une tâche donnée.
La codification des savoirs et la formation : certains travaux, notamment ceux des artisans, exigent l’acquisition de qualifications sophistiquées. Les corporations organisent ces professions autour d’itinéraires de formation professionnelle permettant aux apprentis de devenir compagnons, voire maîtres. Des encyclopédies collationnent les savoirs. La qualification, acquise par une formation longue encadrée, devient la voie d’accès à une certaine liberté.
L’organisation scientifique du travail, par exemple par la division des tâches de la mythique manufacture d’épingles d’Adam Smith, permet une production collective bien supérieure des employés.
À ces trois facteurs de productivité se sont ajoutées, beaucoup plus récemment, les technologies de l’information qui permettent de mieux connaître le besoin spécifique d’un client afin de ne produire que ce qui a de la valeur pour lui, et de réduire ainsi un gaspillage de temps et d’énergie1.
La rationalisation du travail introduite par Frederick W. Taylor permet de tirer le meilleur parti de l’effort des travailleurs. Elle s’appuie sur les progrès de la technique, sur la mise au point des « bonnes » méthodes par des collaborateurs qualifiés, rares à l’époque, portant sur la simplification des tâches confiées à ceux qui sont peu qualifiés. Grâce à l’organisation scientifique du travail, l’immigrant arrivant à Détroit sans formation aux métiers de l’industrie peut être suffisamment productif pour gagner rapidement de quoi nourrir sa famille. Henry Ford peut ainsi octroyer des salaires avec lesquels ses ouvriers peuvent acheter les voitures qu’ils produisent.
Cette meilleure productivité obtenue grâce aux méthodes de Taylor et Fayol se traduit à la fois par une augmentation des profits de l’employeur et par une amélioration du sort du travailleur, qui travaillera moins ou verra son pouvoir d’achat augmenter. Elle constitue donc historiquement une libération par rapport au sort misérable des prolétaires du début de la révolution industrielle2.
Mais le travail ainsi organisé par des tiers se révèle aliénant. À une moindre pénibilité physique se substitue la pénibilité psychologique liée à l’absence d’autonomie, aux cadences imposées, au manque de vision d’ensemble du processus de production permettant de comprendre le sens de son action. Ce « travail en miettes » (Friedmann, 1964), asservi, ne constitue pas davantage une source de satisfaction. Il est considéré par les économistes comme une « désutilité » (quelque chose qu’on évite si on en a les moyens) acceptée pour les contreparties monétaires qu’elle offre, par les philosophes comme une aliénation (Weil, 1951 ; Arendt, 1958/1961), par les penseurs politiques comme une exploitation.
La rationalisation du travail ne se limitera d’ailleurs pas aux opérations de production physique. Les fonctions support, comme les achats ou les ressources humaines, voire les processus d’analyse et de décision stratégiques, seront aussi optimisés, limitant largement la marge d’initiative des employés et des cadres même supérieurs, formatés dans les business schools à appliquer au sein de leur périmètre de responsabilité des méthodes standardisées.
Justifications de l’autonomie au travail
Les alternatives au modèle productiviste hétéronome, où le travail est prescrit à ceux qui le réalisent par des « optimisateurs » visant à obtenir le rendement maximal de chaque ressource, émergeront à partir de traditions diverses, avec des justifications psychologiques, sociologiques, politiques ou philosophiques qui s’interpénètrent, mais aussi, pour certains, avec la conviction que ces alternatives peuvent conduire à des performances économiques supérieures.
Une tradition politique et normative
Certains modes de production alternatifs ont été pensés, à plus ou moins grande échelle, à partir de réflexions sur ce qui constituait une société harmonieuse, auxquelles ont notamment contribué Charles Fourier, PierreJoseph Proudhon ou Karl Marx. Le familistère de Jean-Baptiste André Godin à Guise constituera une des seules réalisations un peu durables du XIXe siècle, suivie des usines de chaussures Bat’a en Tchécoslovaquie au XXe siècle. À grande échelle, le communisme ne mettra pas en place des modalités de travail agricole ou industriel très différentes des organisations hiérarchiques occidentales, si ce n’est par l’usage fait des profits ou plutôt par leur absence fréquente. En France, certaines centrales syndicales militent pour une participation des salariés aux instances de décision de l’entreprise et pour une organisation en équipes semi-autonomes (Dubreuil, 1948). À un niveau plus local, le mouvement coopératif produit certaines formes d’organisation intéressantes (SCOP, SCIC, CAE3 en France, kibboutz en Israël), dont certaines sont représentées dans notre enquête.
Plus récemment, les néo-institutionnalistes comme James G. March et Johan P. Olsen (1983) opposent la régulation « agrégative » par le marché (l’échange libre de ressources) à la régulation « intégrative » par la délibération sur ce qui est juste (la construction d’institutions), en rappelant que les dispositifs réels sont toujours un mélange de ces deux idéaux-types. Plus précisément, les périodes d’abondance favorisent la logique agrégative du marché (chacun veut sa part du gâteau), tandis que les périodes de pénurie favorisent une logique intégrative (pour surmonter ce qui menace l’existence même de la communauté ou combattre son effondrement). Dans une logique agrégative, l’entreprise est une collection de contrats où chacun négocie en fonction des ressources qu’il détient. Dans une logique intégrative, elle est un espace de délibération sur les objectifs pertinents4. On peut aussi rattacher à cette tradition les réflexions du think tank Terra Nova (Richer, 2018 ; Rayssac, Kaisergruber et Richer, 2019) ou de Thomas Coutrot (2018) sur la démocratie dans l’entreprise.
Une tradition psychologique
Étudiant dans une perspective d’organisation scientifique du travail les relations entre l’éclairage d’un atelier de Western Electric à Hawthorne et la productivité des ouvrières, l’équipe d’Elton Mayo constata que la productivité s’améliorait aussi bien lorsqu’on augmentait l’intensité lumineuse que lorsqu’on la diminuait. Au cours de l’étude, les chercheurs découvrirent que le fait qu’on s’intéresse aux conditions de travail des ouvriers induisait une plus grande motivation de leur part. L’école des relations humaines, et l’institut Tavistock qui s’en inspira, s’intéressèrent alors aux déterminants de cette motivation. Abraham Maslow (1943) formalisa sa hiérarchie des besoins humains (physiologiques, de sécurité, d’appartenance, d’estime de soi, de s’accomplir)5. L’organisation hiérarchique traditionnelle répond mal aux deux derniers besoins pour ceux dont le travail est prescrit par d’autres, sans qu’on juge utile de les consulter.
Douglas McGregor (1960) a montré ensuite que postuler que l’employé aime travailler et satisfaire son besoin d’autonomie et de créativité (ce qu’il nomme « théorie Y ») conduit à des organisations beaucoup plus satisfaisantes pour les employés et plus efficaces que l’hypothèse inverse (« théorie X »).
Enfin, dans le champ de la psychologie cognitive et des théories de la décision, les travaux de Richard M. Cyert, March et Herbert A. Simon, parmi beaucoup d’autres, ont souligné que la description des économistes selon laquelle les individus au sein des organisations maximiseraient de façon rationnelle leur « utilité » ne rendait pas compte des comportements observés (March et Simon, 1958 ; Cyert et March, 1963). Chacun agit aussi en fonction du modèle qu’il a de son identité, des caractéristiques de son rôle, parfois au détriment de son intérêt immédiat. Mark Granovetter (1985) donne l’exemple de l’économiste supposé rationnel qui, déjeunant dans une ville où personne ne le connaît et où il ne pense jamais revenir, donnera selon l’usage et contre toute rationalité économique un pourboire à un serveur inconnu. Des expériences plus récentes du jeu Ultima6 montrent aussi que chacun agit en fonction de normes sociales, en faisant mentir les prédictions de la théorie des jeux.
Des approches sociologiques
Bien que l’autonomie ne figure que rarement dans les dictionnaires de sociologie, la discipline s’est intéressée à cette notion, particulièrement en France, pour rendre compte des transformations du travail, et plus généralement des métamorphoses du capitalisme (Lallement, 2015). Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux conceptions de l’autonomie s’opposent dans les sciences sociales : l’autonomie au travail (ou dans le travail) et l’autonomie du travail. Les sociologues du travail s’intéressent plutôt à la première, les philosophes du social à la seconde dans une perspective radicale de critique du capitalisme.
Les sociologues attribuent historiquement deux types de signification à l’autonomie dans les pratiques qu’ils observent. D’une part, l’autonomie peut correspondre aux tactiques que les travailleurs emploient pour échapper à l’emprise des multiples régulations qui les enserrent (aménagement des cadences, choix des postures, organisation des pauses, etc.). Ces observations sont alors interprétées comme des marques de résistance et de rejet de l’organisation taylorienne. Mais d’autre part, les écarts par rapport aux règles ou la construction collective de nouvelles règles par les travailleurs peuvent aussi révéler leur implication : ils les adoptent pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Dès lors, le management tolère, voire favorise, cette « autonomie », dans la mesure où celle-ci permet d’atteindre une meilleure efficacité que l’application aveugle de normes prescriptives. Les sociologues en viennent ainsi à se distancer quelque peu des schémas néomarxistes qui assimilent autonomie et résistance, et adoptent une position moins défensive : le travail apparaît comme un compromis entre une régulation de contrôle (qui se réfère à la prescription hiérarchique) et une régulation autonome (déterminée par les subordonnés pour accomplir leurs tâches).
À partir des années 1990, l’autonomie a pris un nouveau visage, en lien avec la montée des politiques de flexibilité qui promeuvent l’initiative, la réactivité et la créativité des salariés. Chacun est prié de devenir un petit entrepreneur de soi, et l’autonomie ne se gagne plus contre la hiérarchie, mais avec l’actif concours de celle-ci. La plupart des sociologues constatent qu’il y a davantage d’autonomie au travail que par le passé, mais simultanément que les contraintes de toutes natures n’ont cessé d’augmenter : elles ne sont plus seulement imposées par la hiérarchie, mais aussi par les clients, les fournisseurs ou les pairs. Dans ce contexte, ils se sont particulièrement intéressés à la souffrance au travail (dépressions, suicides, burn-out) engendrée par la conjonction détonante de l’autonomie et des contraintes, quand les salariés ne disposent pas des ressources nécessaires pour faire face à leurs nouvelles responsabilités. Enfin, l’autonomie intéresse aussi les sociologues qui observent les formes alternatives de travail (coopératives, hackerspaces et fablabs), qui sont autant des espaces de production et de coopération que des espaces politiques où s’exprime un rejet des dominations traditionnelles (utopies réelles). C’est dans ces espaces en élaboration, considèrent certains, que l’autonomie au travail pourrait rejoindre l’autonomie du travail défendue par les philosophes (Michel Foucault, Cornelius Castoriadis, André Gorz, etc.).
Des approches anthropologiques
Certains travaux sur l’évolution des groupes humains et animaux suggèrent que ceux qui développent des capacités et des habitudes de coopération entre leurs membres survivent et se développent mieux que d’autres (Harari, 2011/2012). Outre leur meilleure capacité à faire face à des menaces collectives ou à des situations de pénurie (Diamond, 2004/2006), ces groupes coopératifs sont probablement soumis à un moindre stress pathogène (Wilkinson, 2000/2002).
Certains promoteurs d’une plus grande considération et responsabilisation des personnes qui travaillent au sein de l’entreprise sont animés par leurs convictions personnelles, philosophiques ou religieuses, plutôt que par des considérations rationnelles utilitaristes : ils se réclament par exemple de la doctrine sociale de l’Église catholique7 ou d’autres traditions humanistes (Lecomte, 2016). Ils croient que l’Homme est bon et digne de confiance, d’autant plus que, comme nous allons l’expliquer dans le paragraphe qui suit, cette hypothèse est souvent auto-réalisatrice. Nous verrons que ces convaincus sont cependant amenés à dialoguer avec des sceptiques qui ne partagent pas leurs convictions ; les premiers cherchent alors à montrer que leur « modèle » est efficace, afin d’obtenir les ressources et les marges de manœuvre nécessaires pour le mettre en pratique.
Une approche performative et progressive de la confiance et de l’autonomie
Peut-on faire confiance aux collaborateurs ? Est-il naïf d’abolir les contrôles qui, selon Jean-François Zobrist (2014), vexent les salariés honnêtes et leur font perdre leur temps, et dont le coût serait souvent supérieur à celui des abus que d’autres pourraient être tentés de commettre ? L’un de nous a montré ailleurs (Weil, 2008) qu’il faut distinguer la confiance calculée, construite et postulée.
La première n’est pas de la confiance, mais le constat, sur la base d’un certain nombre d’informations objectives, que mon interlocuteur aurait plus à perdre à me décevoir qu’à se comporter loyalement. Comme le professe March, « aimer qui est aimable, croire qui est digne de foi, ce n’est ni de l’amour, ni de la confiance, c’est de l’économie » (Weil, 2000). La deuxième repose sur la construction d’une situation où l’interlocuteur perdrait son crédit, s’exclurait de la communauté, se mettrait en porte à faux par rapport à son identité et au contexte social dans lequel s’encastre chacune de ses décisions, s’il venait à se montrer déloyal. Le bénéfice immédiat qu’il tirerait de sa trahison serait largement compensé par la perte de son crédit au sein de la communauté qui n’en ferait plus un partenaire attractif. Cette construction d’une identité et d’une réputation peut reposer sur une allégeance commune à certaines institutions8. Elle passe aussi par la formation professionnelle pour l’acquisition des savoir-faire nécessaires, l’intégration au sein de clubs, d’associations professionnelles qui promeuvent des valeurs partagées. La troisième modalité de la confiance est un pari performatif : je rends digne de confiance celui que j’honore de ma confiance. Ainsi lorsqu’au début des Misérables, Monseigneur Bienvenue persuade Jean Valjean que celui-ci n’a pas volé ses chandeliers d’argent, mais les a reçus en échange de son engagement d’honnêteté, il oblige Jean Valjean à devenir honnête et digne de la confiance que l’évêque fait à l’ancien bagnard qui vient en réalité de le voler.
En pratique, il y a évidemment des degrés dans la loyauté, la capacité et la vertu des personnes, comme dans la confiance et le crédit qu’on leur accorde. C’est ce qui permet une dynamique vertueuse de construction progressive d’une relation confiante, au niveau individuel ou collectif. On a des informations objectives qui permettent d’anticiper la loyauté du partenaire (confiance calculée). On les complète par des dispositifs qui renchérissent le coût potentiel d’une trahison (confiance construite). Enfin, on se risque un peu au-delà de ce que justifieraient ces garanties (confiance postulée). On s’engage ainsi dans une escalade contrôlée, où le champ de la confiance s’étend progressivement au fil de transactions répétées aux enjeux croissants. Le risque est limité car la relation qui s’est déjà construite donne des gages de fiabilité aux participants et l’espoir des bénéfices qui résulteront de la poursuite de la collaboration encourage leur loyauté.
Comme la confiance, l’autonomie peut être une construction progressive. Au fur et à mesure que le champ de la subsidiarité est étendu, que la marge de décision du salarié s’élargit, celui-ci acquiert la maîtrise qui lui permettra de faire bon usage de son autonomie croissante.
L’entreprise libérée, un concept alternatif ?
Quand le concept d’entreprise libérée apparaît en 2009, une grande part de son succès provient du fait qu’il permet de synthétiser en un raccourci saisissant la longue marche des organisations vers la montée en autonomie des salariés, dans un momentum qui, cette fois, semble le bon.
De nombreuses démarches participatives avaient, en effet, déjà été documentées. Nous avons évoqué le familistère de Godin, l’entreprise tchèque Bat’a, les kibboutz, les coopératives ouvrières. Certaines expériences associaient les salariés à la gestion de l’entreprise, voire la leur confiaient (administrateurs salariés, autogestion, coopératives). D’autres leur donnaient un pouvoir d’analyse et de proposition sur l’organisation du travail de production, comme les groupes semi-autonomes de production expérimentés chez Volvo ou Saab au début des années 1970. Les cercles de qualité des années 1980 (Midler et al., 1984) ont beaucoup contribué à l’introduction des méthodes lean, à une plus grande flexibilité des ateliers, à une meilleure gestion des stocks et à une politique d’amélioration continue aux résultats souvent remarquables. Beaucoup reposaient sur le concept d’empowerment, de subsidiarité, de délégation maximale aux personnes les plus proches de la ligne de production ou des clients, considérant que ceux qui font le travail en connaissent les multiples contraintes et repèrent mieux les opportunités d’amélioration ou d’innovation : « c’est celui qui fait qui sait ». Alors que les grandes bases de données informatiques se développent, qui permettent aux services centraux de connaître les détails de la production de chaque usine, on remarque les vertus d’une faible information des dirigeants et de contrôles espacés sur des performances globales, donnant plus de marge d’expérimentation à l’échelon local (Riveline, 2005, 2018 ; Rigal et Weil, 1986).
En 1983, deux consultants de McKinsey publient un livre de management qui se vendra à plus de trois millions d’exemplaires, Le prix de l’excellence (Peters et Waterman, 1982/1983). Selon leur thèse, parmi les huit principes qui permettent aux entreprises de leur échantillon d’être beaucoup plus performantes que les autres, deux concernent directement notre sujet : « [les entreprises excellentes] favorisent l’autonomie et l’esprit novateur », « elles fondent la productivité sur la motivation du personnel ». Qu’importe qu’une enquête de Businessweek menée deux ans plus tard révèle que les deux tiers des entreprises sélectionnées par Tom Peters et Robert Waterman connaissent alors de sérieuses difficultés. Peters prolongera ce livre en 1992 par Liberation Management (traduit chez Dunod sous le titre L’entreprise libérée en 1993). Tout au long de 700 pages d’exemples édifiants, l’auteur distille 50 recommandations pour décentraliser radicalement l’entreprise en une multitude d’équipes autonomes fonctionnant en réseau.
Il faudra encore une quinzaine d’années pour qu’en 2009 (2012 pour la première version française), Carney et Getz publient Liberté & Cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises. Entre-temps, les sujets relatifs à l’agilité des organisations et aux risques psychosociaux (suite aux cas de suicide parmi les salariés de France Telecom-Orange en 2009) sont progressivement montés en puissance, et l’ouvrage arrive donc au bon moment. Les auteurs considèrent que l’essentiel est de convaincre le PDG de lâcher prise, de renoncer à tout contrôler et de déléguer largement à ses collaborateurs. Getz dépose la marque « Entreprise libérée » à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), tandis que d’autres chercheurs interrogent l’originalité du concept par rapport aux principes établis du management participatif, en menant une enquête sur trois entreprises se réclamant des principes de l’auteur : Favi, Poult et Chrono Flex (Gilbert et al., 2017b) – notons que les deux premières sont depuis lors revenues à un management traditionnel.
Les quatre principes de l’entreprise libérée selon Carney et Getz
L’entreprise libérée renvoie à « une forme organisationnelle radicalement différente dans laquelle les salariés sont entièrement libres d’agir pour le bien de l’entreprise » (Getz, 2012, p. 27). Carney et Getz ajoutent à cette définition quatre principes de fonctionnement pour n’importe quel dirigeant de société (2009/2016, p.15) :
1. Le principe d’égalité : « Cesser de parler et commencer à écouter ». Pour cela, il faut commencer par supprimer les symboles du pouvoir qui marquent les différences entre direction et salariés.
2. Le principe d’appréciation : « Commencer à partager ouvertement et activement sa vision de l’entreprise pour permettre aux salariés de se l’approprier ».
3. Le principe d’auto-motivation et d’auto-direction : « Arrêter d’essayer de motiver les salariés ». Dès lors qu’ils sont libres d’agir, la motivation des salariés est au rendez-vous.
4. Le principe de durabilité : « Rester vigilant ». Le dirigeant libérateur doit veiller à ce qu’il n’y ait pas de dérive.
Le 20 février 2015, un documentaire diffusé par Arte, Le bonheur au travail(Meissonier, 2014), contribue à la notoriété des entreprises libérées et bat des records d’audience.
Le concept d’entreprise libérée rencontre néanmoins une résistance, notamment de la part de DRH caustiques, dont certains se regroupent dans un collectif baptisé #MECREANTS (2016) qui pointe le dogmatisme des apologistes de l’entreprise libérée. Si la sur-administration des entreprises par des fonctions centrales envahissantes peut paralyser l’initiative et entraîner une sclérose de l’entreprise et une démotivation des salariés, traiter tous les fonctionnels et l’encadrement intermédiaire de parasites et prôner leur élimination semble une solution un peu simpliste dans des sociétés ayant à faire face à des exigences lourdes de sécurité des produits et des procédés et à rendre compte de leur stricte conformité à de nombreuses régulations.
Certaines entreprises, comme Michelin, tenteront de s’inspirer du courant de l’entreprise libérée et de ses pionniers pour adapter avec pragmatisme leurs pratiques de management. Ne cachant pas leur dette envers cette source d’inspiration, mais avançant avec circonspection, ces entreprises s’excusent presque de leur pusillanimité, disant ne pas être encore prêtes à sauter dans le grand bain et préférant multiplier les expérimentations dans les sites volontaires et les faire connaître en interne. Elles seront parfois enrôlées malgré elles et citées comme caution d’un mouvement qu’elles regardent avec intérêt, respect et prudence.
Une raison de leur circonspection est que Carney et Getz se focalisent sur la psychologie du dirigeant et la nécessité que celui-ci lâche prise. Si nous jugeons ce volontarisme des dirigeants essentiel, il ne suffit pas à garantir que l’entreprise saura faire face à tous les défis de l’action collective, notamment ceux que nous allons rappeler dans les lignes qui suivent. Le caractère volontairement incomplet des prescriptions de Carney et Getz9 explique peut-être le succès de certaines approches alternatives ou complémentaires à l’entreprise libérée que nous examinerons dans la suite de ce chapitre.
Point aveugle de l’entreprise libérée : les contraintes de l’action collective
La division taylorienne entre les prescripteurs du travail et les exécutants s’avère à la fois frustrante pour ces derniers et inefficace dans un monde instable, nécessitant une forte agilité pour adapter ou réinventer en permanence l’offre et la manière de la produire, en mobilisant toute l’intelligence disponible dans l’organisation. L’exigence d’agilité ne doit cependant pas faire oublier que l’action collective efficace induit des contraintes que les organisations les plus soucieuses de l’épanouissement de leurs membres doivent prendre en compte.
Coordination de l’action
L’artisan libéral est plus autonome que le salarié des entreprises traditionnelles. Mais si l’artisanat est bien adapté aux cas où un individu peut acquérir seul la maîtrise de son art, beaucoup d’activités reposent sur la coordination de compétences trop nombreuses pour qu’un seul individu les maîtrise toutes. Une organisation stable, au sein de laquelle les rôles sont bien définis, est plus adaptée à la gestion d’une centrale nucléaire ou d’un porte-avions qu’un groupement d’artisans. Selon Ronald Coase (1937), les entreprises (dont les salariés dépendent d’une autorité régulatrice, en général la hiérarchie) sont plus efficaces que les marchés (sur lesquels chaque transaction fait l’objet d’une négociation ponctuelle indépendante) pour des tâches demandant beaucoup de coordination.
Il existe par ailleurs des formes intermédiaires entre la dépendance du salarié au sein de l’entreprise et l’indépendance entre acteurs d’un marché. Walter W. Powell (1990) a ainsi décrit le fonctionnement de réseaux d’acteurs interdépendants appelés à travailler ensemble de manière récurrente, comme les divers corps de métiers sur un chantier ou la coopération entre petites entreprises technologiques qui associent leurs compétences pour fournir un produit intégré. Nous verrons dans notre enquête comment certaines entreprises se sont inspirées de ce modèle, en imaginant l’interaction de mini-entreprises au sein d’une organisation plus vaste.
Développement et capitalisation des compétences individuelles et collectives
Pour accomplir ses objectifs, une organisation doit développer des compétences tant individuelles que collectives. Ces savoir-faire complexes et distinctifs doivent être capitalisés pour les rendre accessibles aux collaborateurs lorsqu’ils en ont besoin, notamment ceux qui sont nouveaux dans l’organisation. Cette capitalisation a parfois lieu dans divers pôles d’expertise ainsi que dans les règles et procédures encadrant le travail. Or les promoteurs des entreprises libérées cherchent à lutter contre la prolifération des services fonctionnels et des procédures contraignantes. Il faut donc trouver d’autres moyens de conserver et de développer ces savoir-faire, y compris ceux qui concernent l’articulation des actions individuelles, des savoirs (ou compétences) de management et d’organisation qui permettent, selon l’expression souvent attribuée à Peter Drucker, « d’accomplir des choses extraordinaires avec des gens ordinaires ».
Respect des attentes des tiers et des obligations réglementaires
L’autonomie peut aussi être une source de danger. Le pilote de ligne ou le conducteur de train doivent respecter à la lettre les consignes pour ne pas mettre en péril la sécurité des passagers, quitte à participer par ailleurs à une réflexion sur l’amélioration de ces règles. Quand bien même la violation des consignes permettrait de mieux atteindre l’objectif, comme lorsque le pilote “Sully” sauve ses passagers en atterrissant sur l’Hudson10 ou que le Prince de Hombourg de Heinrich von Kleist gagne la bataille en enfreignant les ordres, elle ne peut être encouragée par les institutions.
D’une manière générale, une entreprise doit respecter des contraintes réglementaires afin de garantir la qualité et l’absence de dangerosité de ses produits et la sécurité de ses salariés. Cette responsabilité collective contraint fortement l’autonomie de chacun, oblige à une traçabilité dans des formes imposées. Une chaîne de fabrication de médicaments ou de produits alimentaires doit garantir l’absence de contamination. Jusqu’où peut-on se passer de l’expertise des services en charge de la conformité aux différentes législations et règlements ? Jusqu’où peut-on laisser leur consultation à l’initiative d’acteurs de terrain agacés par le foisonnement des procédures ?
Rupture dans la stratégie et les objectifs du collectif
L’entreprise peut être amenée à adapter ses objectifs ou l’architecture de son offre, parfois de façon brutale, voire à promouvoir des innovations qui repositionnent les rôles de chacun. Peut-on raisonnablement attendre que les salariés d’une entreprise de marine à voile décident spontanément qu’il faut miser sur la technologie encore peu performante des bateaux à vapeur ? Ceux des relais de poste à cheval, sur l’avènement de l’automobile, ou les fabricants de bougies, sur la production d’ampoules électriques ? La crème des chimistes spécialistes des films photosensibles de Kodak pouvait-elle pousser l’entreprise à miser sur un passage rapide à la photographie numérique ? Il faut des organisations d’une grande maturité pour prêter une attention collective aux signaux faibles susceptibles de mettre en question leur identité. Une cellule de réflexion stratégique peut y contribuer.
Nous venons de voir que la nature des activités d’une entreprise conditionne les marges d’autonomie qu’elle peut accorder à ses collaborateurs. Si l’organisation industrielle s’avère, pour des productions complexes et pour la capitalisation des savoirs, plus efficace que la réunion d’artisans isolés, est-il toujours judicieux de transformer les entreprises en un réseau d’équipes indépendantes ? Face aux contraintes de coordination d’un énorme projet, l’autonomie dévolue aux équipes n’est-elle pas largement illusoire ?
Quelques autres alternatives à l’organisation taylorienne
Comme nous venons de le voir, le fait que le leader « libérateur » lâche prise, écoute ses collaborateurs et renonce à ses attributs statutaires ne suffit pas à garantir que l’organisation libérée résolve ses problèmes de coordination de l’action collective, de développement et de capitalisation des compétences, de garanties données aux tiers, ni sa capacité à se transformer plus ou moins radicalement lorsque c’est opportun. Quelques formes complémentaires d’organisation pourront donc être utiles aux dirigeants souhaitant donner plus d’autonomie à leurs collaborateurs. Nous allons en examiner quelques-unes.
Les organisations prosaïques
Sans chercher à promouvoir par principe des organisations au leader discret, March (1982/2000, 1988) montre que le succès d’une organisation tient rarement à la présence d’un leader héroïque, et que, comme dans Guerre et paix, de flegmatiques, ternes et méthodiques Khoutouzov l’emportent souvent sur des Napoléon plus flamboyants et interventionnistes.
Parmi les conditions permettant à des organisations de fonctionner sans leader omniprésent, March identifie la compétence diffuse (les gens qui font le travail savent le faire et ceux qui ne savent pas sont empêchés ou s’interdisent eux-mêmes de le faire), l’initiative (les problèmes sont traités localement, rapidement et de manière autonome, ce qui repose sur le droit à l’erreur11), l’identification (le fait que les membres de l’organisation aient le sentiment d’un destin partagé, d’une confiance mutuelle, d’une identité collective) et la coordination discrète (grâce à des procédures routinières, des modes opératoires standardisés, des flux de signaux et d’informations qui font que chacun peut comprendre ce qui se passe et anticiper ce que d’autres vont faire, et aussi grâce à une certaine redondance12).
Libérer une organisation du besoin d’une hiérarchie contraignante ou d’un leader héroïque repose donc sur la construction d’un environnement particulièrement favorable et adapté au contexte des actions à mener. Sans cette construction délicate, l’organisation risque de manquer d’efficacité, de résilience, de durabilité. L’objet de notre démarche est de documenter comment certaines organisations ont tenté et parfois réussi une telle construction.
Trois des points évoqués par March nous semblent mériter une attention particulière : la construction et la promotion d’une vision commune et d’un récit partagé, la capacité d’explorer, de s’adapter et d’apprendre que permet une certaine tolérance aux erreurs et aux déviances, enfin, la préservation de la cohésion en cas de divergence. Nous examinerons comment les organisations de notre échantillon abordent ces sujets.
La sociocratie et l’holacratie
Sociocratie et holacratie entretiennent d’évidentes parentés en tant que modes d’organisation alternatifs. Ce sont des systèmes très codés, reposant sur un vocabulaire spécifique figurant ci-après en italique.
La sociocratie nous vient des Pays-Bas, même si le terme en a été forgé par Auguste Comte dès 1851 dans le cadre de ses réflexions de philosophie politique. Au sens large, elle peut être vue comme un domaine de pratiques et de connaissances se référant à l’exercice direct du pouvoir par des personnes reliées les unes aux autres autour d’intentions communes. Dans les années 1970, elle a été mise en place dans son entreprise familiale par l’ingénieur néerlandais de culture quaker Gerard Endenburg (1998), qui en a exposé les règles.
La sociocratie repose sur quatre principes13.
L’organisation en cercles. Chaque individu est membre d’au moins un cercle, celui de son unité de travail. Chaque cercle établit ses propres règles de fonctionnement, choisit son facilitateur et son secrétaire. Il veille à la réalisation de sa mission, à l’amélioration de la qualité et à l’éducation permanente de ses membres. Il y a une hiérarchie de cercles, le cercle supérieur jouant le rôle de conseil d’administration. Des cercles peuvent être créés pour résoudre des problèmes spécifiques.
La prise de décision par consentement. La prise de décision se fait par consentement : tant qu’un membre d’un groupe a une objection importante et raisonnable, le groupe discute pour lever celle-ci (en cas de blocage, la décision remonte dans la structure de l’organisation).
Le double lien. Un cercle est lié au cercle supérieur par un double lien : un premier lien (que nous pourrions assimiler à un « préfet »14, responsable de l’unité opérationnelle) est nommé par le cercle supérieur, tandis qu’un second lien, distinct (que nous assimilons à un « député »), est désigné par le cercle et donne ou non son consentement aux décisions prises par le cercle supérieur.
L’élection sans candidat. Les fonctions (dont celle de «député») sont attribuées à l’issue d’une élection sans candidat. Chacun propose une personne pour une fonction en justifiant son choix.
Notons que la sociocratie fonctionne à côté de la hiérarchie traditionnelle. Elle crée un espace de décision par consentement dans lequel la hiérarchie est temporairement effacée, ce qui n’est pas sans poser des problèmes : il peut être difficile au sein des cercles de s’abstraire du pouvoir qui existe hors des cercles. La sociocratie semble avoir essentiellement pour fonction de s’assurer que chacun a voix au chapitre. Il semble implicite que le premier lien du cercle supérieur (non élu) est le patron de l’entreprise.
L’holacratie peut être considérée comme un produit dérivé de la sociocratie. Elle a été développée par Robertson (2015/2016) dans sa propre entreprise de logiciels à Philadelphie, qui l’a ensuite déposée comme marque (Holacracy®). Elle repose – moyennant un certain nombre de variantes terminologiques et d’adjonctions (l’holacratie distingue, par exemple, les réunions organisationnelles et opérationnelles, elle introduit les concepts de rôles et de redevabilités, ainsi que l’expression des tensions) – sur des processus d’organisation similaires à ceux de la sociocratie. Mais à la différence de celle-ci, elle vise à réaliser une « holarchie », c’est-à-dire un système de distribution du pouvoir à l’ensemble des acteurs de l’organisation. Autre élément différenciant, elle se présente comme un système d’exploitation complet « clé en mains » avec une constitution (la version 4.1, disponible sur Internet15, ne fait pas moins de 28 pages) qui s’inspire de la structure des langages de programmation orientés objets. L’autorégulation recherchée des entités autonomes s’appuie donc sur un système perçu comme passablement prescriptif et rigide par ceux qui le critiquent16.
Le fonctionnement holacratique semble poursuivre un objectif de dépersonnalisation des décisions : le collaborateur est défini par son (ou ses) rôles, rien de personnel ou d’affectif dans ce qu’il subit ou impose ; tout doit être explicite17. L’holacratie met moins en place une démocratie qu’une subsidiarité effective : tout ce qui fait consensus parmi les rôles concernés est décidé sans recours à l’autorité supérieure.
Si la sociocratie et l’holacratie apparaissent comme deux modes d’organisation libérés de l’arbitraire des chefs, où tout semble discutable, où toute décision semble « traçable » et peut formellement être mise en cause, il reste à prouver que le poids des règles, des procédures et des rituels n’est pas plus oppressant que celui des chefs qui assument parfois brutalement leur pouvoir, et que le premier lien du cercle supérieur arbitre avec plus de discernement que le patron qu’il est de fait. Toute organisation est, en effet, gouvernée à la fois par des personnes et par des règles qu’on applique sans toujours connaître leur origine ou leur justification (Cyert et March, 1963). La question de la manière dont ces règles évoluent est cruciale pour que l’organisation s’adapte aux évolutions de son environnement et aux aspirations de ses membres.
Les organisations opales
En 2014 (2015 pour la version française), Laloux, ancien consultant chez McKinsey, publie Reinventing Organizations, où il présente les « entreprises opales » comme le stade le plus évolué d’une succession de formes organisationnelles, après ceux de l’impulsivité, du conformisme, de la réussite et du pluralisme18. Sa référence est la capacité d’auto-organisation des êtres vivants. Les exemples recouvrent assez largement les entreprises libérées identifiées par Carney et Getz (2009/2016), mais l’analyse de Laloux se penche aussi sur les dispositifs concrets de coordination et d’ajustement des acteurs, avec des exemples particulièrement inspirants comme le réseau d’infirmières à domicile Buurtzorg aux Pays-Bas. Notons que dans son ouvrage, Laloux fait aussi explicitement référence à HolacracyOne, la société de services créée par Robertson pour diffuser son « produit » Holacracy®.
Le regard de Laloux sur les organisations est porteur de trois idées majeures : l’autoorganisation (self-management) des individus et des équipes, à la manière des cellules et des organes qui ont leur fonctionnement autonome ; la prise en compte des individus dans toutes leurs facettes (wholeness), en intégrant autant que la raison, la force et la détermination actuellement valorisées, d’autres facettes comme la vulnérabilité, les émotions ou l’intuition ; une raison d’être évolutive (evolutionary purpose), qui se révèle en se mettant à l’écoute de ce que l’organisation veut devenir et servir, mais qui ne se définit pas a priori en vue de l’atteindre. On retrouve ces deux derniers points dans le modèle des « organisations tressées » (braided organizations) (Zarka et al., 2019).
Laloux ne se contente pas d’énoncer ces principes mais s’intéresse de près à la façon dont ils peuvent être déclinés concrètement au sein des organisations.
L’entreprise délibérée
Bien que visant, elle aussi, à lutter contre l’hétéronomie au travail, le désengagement des salariés et les risques psychosociaux, la notion d’entreprise délibérée, issue des travaux de Clot (2010) et du titre éponyme de l’ouvrage collectif dirigé par Detchessahar (2019), provient d’une toute autre tradition. Elle combine l’approche des sciences de gestion avec celle de la psychologie du travail dans le cadre d’une vision politique (i.e. qui est relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir dans une société organisée) de l’entreprise. Ce qui est étudié dans cette perspective, ce sont les conditions d’un dialogue « authentique » – non instrumental et non déconnecté de la réalité du travail – autour de la qualité du travail et de la construction de la prescription du travail, en cherchant à lever les obstacles qui empêchent le travail « bien fait ». Foin ici de libération de la parole, d’écoute même bienveillante ou d’espaces autonomes d’expression ! Ce qui est central, c’est le processus de décision. Il ne s’agit pas de discuter pour discuter, mais de décider de l’action commune et de ses règles à travers un dialogue qui en tisse et retisse les fils. L’entreprise délibérée cherche l’espace pour une fonction politique de la discussion ; elle vise à construire un cadre où puisse se déployer la controverse sur les critères d’un travail bien fait (conflits de critères ou coopération conflictuelle) et sur les règles de l’art de l’activité. Selon Clot, la controverse en elle-même, dans la confrontation des différents points de vue, permet de découvrir des « angles morts », des niches de performance, « à mesure que les objections repoussent les limites du connu » (Detchessahar, 2019, p. 10). C’est ainsi que l’organisation augmente sa puissance d’agir.
Mais là où Detchessahar propose de faire animer espaces et dispositifs de délibération par l’autorité hiérarchique, en considérant que « pour peser sur le cadre politique de l’action, [la discussion] doit se dérouler en présence de l’autorité » (2019, p. 12), Clot met en garde contre le fait que la présence de la hiérarchie constitue parfois un facteur d’empêchement, inhibant l’expression nécessaire de certaines tensions. C’est, selon le rapport parlementaire du député Michel Coffineau (1993), une des causes de la désaffection progressive envers l’exercice du droit d’expression des salariés mis en place par les lois Auroux en 198219. Coffineau indique aussi que « faute de temps et des moyens nécessaires, les salariés ne peuvent préparer les réunions. Il est donc difficile au groupe de résoudre ses conflits latents avant la réunion d’expression. Les participants préfèrent donc se censurer plutôt que de mettre en péril, pour un résultat aléatoire, la cohésion du collectif de travail » (1993, p. 29).
Aussi cette démarche, appliquée chez Renault à l’usine de Flins (Bonnefond, 2019), consiste-t-elle à « équiper » les collectifs dans l’instruction de leurs propres conflits de critères internes pour qu’ils se sentent comptables de leur propre activité. C’est ce qui leur donne le crédit suffisant pour faire autorité auprès de la hiérarchie qui peut alors être mise dans la boucle de délibération et de décision. Un opérateur référent-métier, élu par ses pairs, prépare avec la hiérarchie et les syndicats l’organisation de la « coopération conflictuelle » autour de la qualité du travail.
Detchessahar montre d’autres exemples de délibération fructueuse dans d’autres contextes (banque, professions de santé). À certains égards, la transformation entreprise dans certains sites de Michelin, qui ne se revendique d’aucun modèle particulier, semblerait avoir aussi puisé à cette source d’inspiration (Ballarin, 2019).
Le bricolage
Si nous avons décrit quelques modèles de référence, ce n’est pas pour suggérer qu’une entreprise devrait choisir entre eux. Tous ces modèles ont été développés pour répondre à un besoin (la rationalisation des processus, l’expression et l’implication des collaborateurs, la résilience, le besoin de règles équitables, la stimulation de l’auto-organisation, la mise en œuvre d’une délibération efficace…). Tous et bien d’autres peuvent inspirer des responsables, qui piocheront ici ou là telle idée, telle pratique, tel outil ou instrument qui leur sembleront adaptés aux besoins de leur organisation, en respectant cependant un principe de cohérence entre les outils utilisés (voir chapitre 6).
Le management, comme toute science du concret20, est fondé sur un bricolage21, un « bris-collage » de diverses idées (Lévi-Strauss, 1962). Nous allons voir à travers une dizaine de cas comment des entreprises, dans des contextes très divers, ont su bricoler une transformation conduisant à renforcer l’autonomie de leurs collaborateurs. Notre lecteur pourra à son tour bricoler à partir des pratiques qu’il jugera intéressantes.
- 1. Nous ne développons pas ici les autres caractéristiques de l’économie de la connaissance qui se développe grâce aux technologies de la donnée.
- 2. Au grand scandale de certains de ses camarades de la CGT, Hyacinthe Dubreuil, de retour en 1929 d’une expérience de travail chez Ford à Détroit, vantera dans Standards les mérites de la machine et du travail à la chaîne.
- 3. Les sociétés coopératives de production peuvent prendre en France la forme juridique de société coopérative et participative (SCOP) ou de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), selon que leur capital est plus ou moins ouvert à des parties prenantes extérieures à l’entreprise. Les coopératives d’activités et d’emploi (CAE) offrent un statut d’entrepreneur salarié à des travailleurs indépendants souhaitant mutualiser certaines fonctions et bénéficier du support de la coopérative.
- 4. Les rapports d’Agnès Touraine et Stanislas Guérini, puis de Nicole Notat et Jean-Dominique Senard sur la « raison d’être » des entreprises, qui ont été produits dans le cadre des réflexions préliminaires à la loi PACTE, renouent avec cette approche institutionnaliste. Mathieu Detchessahar (2019) propose une analyse de ces processus de délibération et de leur organisation.
- 5. Souvent représentée ultérieurement par une pyramide dans la littérature sur la motivation.
- 6. Dans le jeu Ultima, on donne à un premier joueur une somme de 100$ $ à partager selon les règles qu’il fixera avec un second joueur qu’il ne voit ni ne connaît et dont il est inconnu. Le jeu ne se reproduira pas. Le second joueur accepte ou non le partage. S’il le refuse, les joueurs ne reçoivent rien. La théorie des jeux suggère que le second a intérêt à accepter tout partage, même très inégal, puisque sinon il n’a rien, donc que le premier a intérêt à presque tout garder pour lui, en proposant par exemple 1$ $ au second. On observe en fait expérimentalement que le premier proposera plutôt en moyenne 40$ $ au second, sans abuser de sa position stratégique. Bien lui en prend, car les seconds joueurs refusent souvent des rétributions trop faibles, préférant se rebiffer que d’empocher les 10$ $ que le premier leur aurait laissés.
- 7. Voir la thèse de doctorat (en cours) de Louise Roblin au CERAS ou les travaux animés par le Père Baudoin Roger, Armand Hatchuel et Olivier Favereau au Collège des Bernardins.
- 8. C’est ce que font deux partenaires méfiants qui stipulent dans leur contrat l’autorité d’arbitrage ou judiciaire à laquelle ils entendent soumettre leurs éventuels différends.
- 9. Pour Carney et Getz, chaque entreprise doit trouver une méthode de mise en œuvre de la libération adaptée à son contexte. Ils ne se préoccupent donc pas des détails d’intendance (de minimis non curat praetor ).
- 10. Le 15 janvier 2009, Chesley B. Sullenberger dit Sully sauva son avion en détresse et ses passagers, en se posant sur l’Hudson au mépris des procédures de sécurité.
- 11. Ce droit à l’erreur sera plus facile à mettre en œuvre si des dispositifs permettent d’éviter que tout le monde voie en permanence tout ce qui se passe, ce qui peut être contradictoire avec une injonction de transparence (voir ci-après, chapitre 5).
- 12. Cette redondance, des individus, de leurs compétences ou des ressources, donne à l’organisation une certaine résilience si quelqu’un est indisponible ou défaillant, notamment le chef (tout le monde est important, mais personne n’est indispensable), ou lorsqu’il faut faire face à une augmentation des demandes externes.
- 13. Cette description de la sociocratie est principalement fondée sur l’article dédié de Wikipedia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociocratie, consulté le 30/8/2019).
- 14. Ces appellations de préfet et député sont les nôtres et reflètent notre compréhension du système.
- 15. Voir https://github.com/holacracyone/Holacracy-Constitution-4.1-FRENCH/blob/master/Constitution-Holacracy.md
- 16. Voir par exemple la critique du Centre français de sociocratie, qui porte également sur le versant mercantile de l’holacratie, disponible sur http://www.sociocratie-france.fr/2018/05/quelles-differences-entre-la-sociocratie-et-l-holacratie.html
- 17. L’article 4.1.5 de la constitution (version 4.1) précise explicitement que « les attentes implicites n’ont aucun poids ».
- 18. Laloux distingue les organisations primitives fondées sur l’impulsivité du chef de gang et la pensée magique (rouges), les systèmes policés par des institutions, des règles et une organisation hiérarchique liées aux statuts et traditions (ambres), des sociétés fondées sur la méritocratie, l’innovation, le désir de réussite (oranges), des familles acceptant la différence des normes et le pluralisme des talents (vertes) et enfin les organisations évolutives (opales) dont le chef peut s’effacer puisque la « raison d’être » collective sert de boussole à chacun.
- 19. Dans la foulée de l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République (mai 1981), l’esprit général des lois Auroux et du rapport qui les avait précédées peut être résumé par deux grandes idées : la première était l’idée d’une extension de la citoyenneté à la sphère de l’entreprise – « citoyens dans la cité, les travailleurs doivent l’être aussi dans leur entreprise » (Auroux, 1982, p. 4). La seconde était que « les travailleurs doivent devenir les acteurs du changement dans l’entreprise » (Ibid ., p. 19).
- 20. Claude Lévi-Strauss oppose la science première ou « science du concret » – nous parlons plutôt de technologie dans le champ du management (Weil, 2012) – à la science moderne.
- 21. « Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; mais, à la différence de l’ingénieur, il ne subordonne pas chacune d’elles à l’obtention de matières premières et d’outils conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers instrumental est clos, et la règle de son jeu est de toujours s’arranger avec les “moyens du bord”, c’est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d’outils et de matériaux, hétéroclites au surplus, parce que la composition de l’ensemble n’est pas en rapport avec le projet du moment, ni d’ailleurs avec aucun projet particulier, mais est le résultat contingent de toutes les occasions qui se sont présentées de renouveler ou d’enrichir le stock, ou de l’entretenir avec les résidus de construction et de destruction antérieures. L’ensemble des moyens du bricoleur n’est donc pas définissable par un projet (ce qui supposerait d’ailleurs, comme chez l’ingénieur, l’existence d’autant d’ensembles instrumentaux que de genres de projets, au moins en théorie) ; il se définit seulement par son instrumentalité, autrement dit et pour employer le langage même du bricoleur, parce que “ça peut toujours servir” » (Lévi-Strauss, 1962, p. 27).
L’enquête Analyse transversale des cas
Introduction à l’analyse transversale
Notre enquête vise à combler une lacune dans la littérature empirique, puisqu’il existe peu d’études à la fois approfondies et comparatives sur les expériences récentes de « libération » d’entreprises (hormis notamment Picard, 2015 et Gilbert et al., 2017a). La majorité des études sur le sujet se concentrent sur une seule entreprise (par exemple : Hervé et Brière, 2011 ; Fox et Pichault, 2017 ; Marmorat et Nivet, 2017 ; Rousseau et Ruffier, 2017 ; Chabanet et al., 2017 ; Bourguinat, 2019) ou ne donnent la parole qu’aux dirigeants initiateurs de la démarche (par exemple, Carney et Getz, 2009/2016). Or, en toute bonne foi, les dirigeants peuvent surestimer les retours favorables et sous-estimer les réactions moins enthousiastes1.
Cette étude s’appuie au contraire sur une double perspective : nombre et diversité des organisations incluses dans l’échantillon, d’une part2, et multiplicité des regards au sein de chaque organisation, d’autre part, puisque les entretiens menés ont concerné en moyenne dix personnes de rangs et fonctions différents dans chaque organisation.
En outre, la sélection des organisations ne s’est pas cantonnée à des entreprises dites libérées, mais s’est fondée sur l’existence de modes de gestion favorables à l’autonomie et à la responsabilisation des salariés (par exemple, holacratie, fonctionnement coopératif, etc.).
Une plateforme ouverte
L’étude s’inscrit dans une logique de partage de l’information, favorable à la mise en débat d’un phénomène d’actualité. Nous avons choisi de rendre les études de cas disponibles en accès libre sur un site Internet3. Le matériau issu de la recherche est mis à disposition de tous sous copyleft : chacun peut donc utiliser les cas mais en citant leur auteur qui reste le seul ayant-droit moral.
Le projet s’enrichit progressivement de nouveaux cas et de nouvelles réflexions mis en ligne sur la plateforme. Ceux qui le souhaitent peuvent proposer de nouveaux cas, en respectant autant que possible son protocole et la grille d’analyse. Lorsque le recueil d’information n’a pas suivi notre protocole, cette spécificité est signalée en introduction de la synthèse du cas.
Choix des organisations
Dix études de cas ont été menées par le groupe de travail de la chaire FIT. Sept d’entre elles sont disponibles en accès libre sur la plateforme. Un cas n’a pas reçu le feu vert du dirigeant (A**). Il est donc traité anonymement dans la présente étude transversale. Une entreprise (Fabernovel Data & Media) a accepté l’exploitation transversale de son cas dans la présente étude, mais jugé que la publication de l’étude de cas complète était trop compliquée à valider ; cette dernière ne figure donc pas dans la base de cas. Pour un autre cas (B**), il nous était difficile de présenter la synthèse à la direction sans risquer de créer des problèmes pour certains de nos informateurs, nous avons donc provisoirement renoncé à exploiter ce cas. Un résumé des cas analysés figure en annexe de la présente note (voir p. 152).
Les organisations ont été sélectionnées pour illustrer la diversité de secteurs, de tailles et d’approches dans la manière de développer l’autonomie de leurs salariés.
L’échantillon comprend deux administrations publiques (SPF Mobilité et Transports, CPAM 78), deux divisions de groupes (GEN chez Orange et Fabernovel Data & Media chez Fabernovel), deux SCOP (Coreba et Ardelaine) et trois entreprises petites à moyennes (Chrono Flex, Lippi et A**). Ces structures comptent entre 50 et 1 300 employés.
SPF Mobilité et Transports et CPAM 78. Ces deux administrations publiques sont révélatrices d’une culture initialement bureaucratique. Les méthodes utilisées pour desserrer l’emprise de la bureaucratie sont donc particulièrement intéressantes à étudier.
GEN (Orange). Le cas GEN présente trois intérêts majeurs : tout d’abord, il s’agissait d’inclure dans l’échantillon une organisation adepte du management agile, plus précisément, de la gouvernance adaptative qui est une méthode d’organisation sociocratique encourageant une gestion de projet horizontale, à l’aide de cercles transfonctionnels qui se superposent à la hiérarchie existante. Deuxièmement, il a paru intéressant aux chercheurs impliqués de comprendre comment ce mode de gouvernance, plus horizontal, pouvait émerger au sein d’un grand groupe au fonctionnement très hiérarchique (le groupe Orange). Enfin, les chercheurs ont voulu observer les avantages et inconvénients d’un accompagnement sur la durée par un cabinet de conseil externe.
Chrono Flex. Chrono Flex est l’une des entreprises libérées les plus connues en France. Le cas s’avère particulièrement fécond car, contrairement à d’autres organisations célèbres comme Favi ou Poult, la libération de Chrono Flex semble pérenne. En effet, le processus a été lancé il y a bientôt dix ans et aucun signe de contreréforme n’a été relevé durant l’enquête.
Lippi. Nous avons intégré Lippi à l’échantillon afin de mettre en exergue les enjeux propres à la transformation d’une PME familiale. Les chercheurs ont également trouvé intéressant de documenter la manière dont Lippi s’est transformé au fil des opportunités, sans suivre de modèle préétabli et en tirant parti des outils numériques.
Coreba et Ardelaine. Les SCOP appartiennent au secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS). Par principe, elles sont fondées sur l’égalité de leurs membres et promeuvent la participation de tous aux décisions et à la gouvernance. Il a semblé particulièrement intéressant d’analyser leur modus operandi pour le comparer à celui d’entreprises dont le capital est principalement la propriété des dirigeants ou d’actionnaires extérieurs à l’entreprise.
A** et Fabernovel Data & Media. A** est une entreprise de services du numérique de province et Fabernovel Data & Media (FDM dans ce qui suit), une filiale d’une ETI également spécialisée dans le digital. Dans le cas de A**, le dirigeant n’a pas donné son accord pour publier le cas, estimant que notre synthèse reflétait mal le modèle organisationnel mis en place et son impact sur les collaborateurs. La méthodologie appliquée a pourtant été exactement la même que pour les autres entreprises et tous les entretiens ont été validés par les personnes interrogées.
Tableau récapitulatif des cas analysés

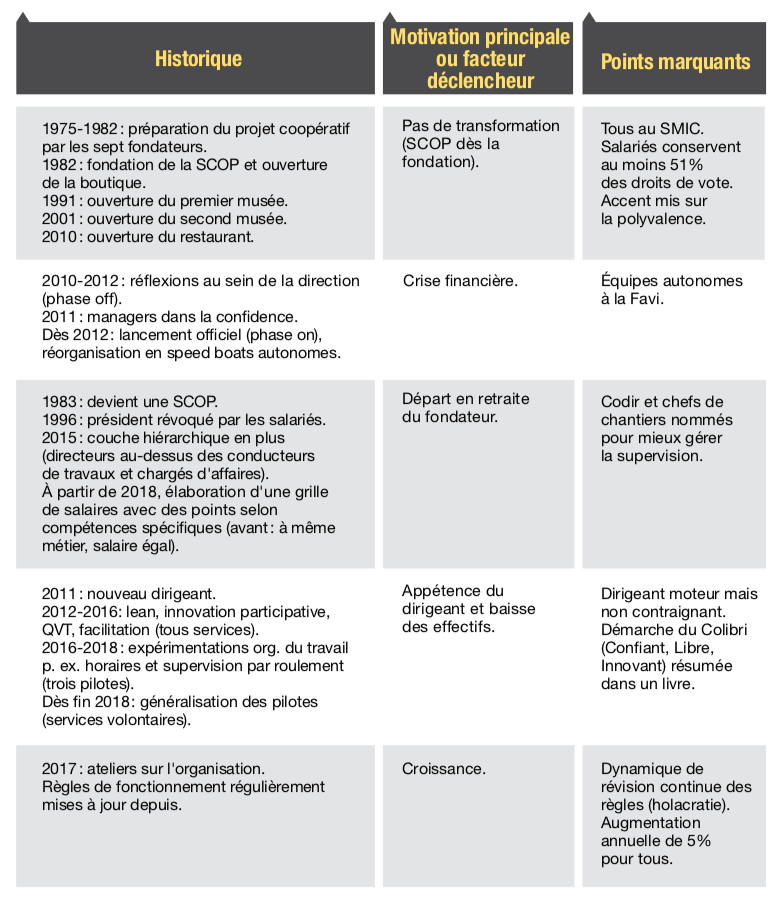
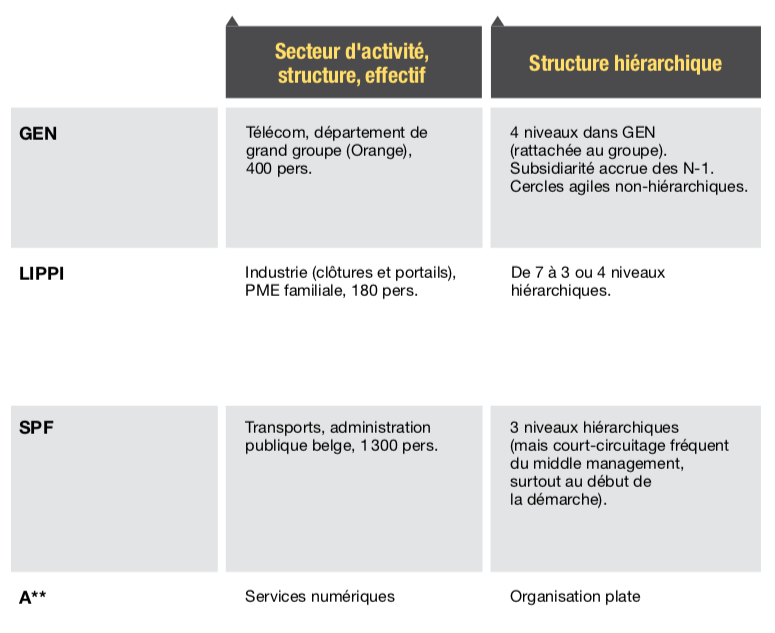
Méthodologie de l’enquête
Il s’agit d’une enquête qualitative. Les données ont été récoltées sur la base d’entretiens individuels semi-directifs, en personne ou au téléphone. Après un rapide survol de son parcours professionnel, chaque interlocuteur a répondu à des questions ouvertes sur le déroulement de la transformation, son rôle dans celle-ci et les avantages et inconvénients qu’il y voit.
Dans la mesure du possible, deux chercheurs ont participé à chaque entretien. Les entretiens n’ont pas été systématiquement enregistrés pour ne pas entraver la spontanéité du témoin. Un compte-rendu écrit de l’entretien a ensuite été soumis à chaque interlocuteur pour validation. Ces comptes-rendus sont strictement confidentiels et réservés à l’équipe de recherche.
Au moins dix employés aux profils et positions hiérarchiques variés ont été interviewés dans chaque organisation4. Les sondés n’ont pas été sélectionnés de manière aléatoire. Pour chaque étude de cas, le dirigeant a été impliqué dans le choix des interlocuteurs, ce qui est susceptible d’avoir introduit un biais. Le niveau d’adhésion réel de ceux avec qui nous avons discuté était donc peutêtre supérieur à celui de la moyenne des salariés, dans la mesure où il peut être avantageux d’afficher son enthousiasme pour la transformation. Toutefois, dans la mesure du possible, au moins deux (idéalement trois) salariés aux fonctions et positions similaires ont été interrogés, tant pour renforcer la robustesse des résultats en recoupant les informations que pour assurer l’anonymat des réponses. Par ailleurs, dans plusieurs cas, l’équipe de recherche a utilisé ses relations pour compléter la liste des témoins ou demandé la permission au dirigeant d’interviewer d’autres contacts suggérés durant la première série d’entretiens. Il est arrivé que le dirigeant nous donne de lui-même le contact d’employés partis mécontents ou d’un syndicaliste persistant dans ses objections.
Les résultats ont fait l’objet d’un rapport final soumis au dirigeant avant publication. Cette synthèse ne comporte aucune information qui pourrait révéler l’identité précise des interviewés (hormis dans quelques cas où l’interlocuteur a donné explicitement son consentement). Le dirigeant a pu demander à ne pas divulguer certaines informations sensibles ou insérer ses commentaires (présentés explicitement comme tels dans la synthèse) en cas de désaccord avec les témoignages récoltés ou avec leur interprétation.
La procédure de validation a souvent été longue. Plus d’un dirigeant a été perturbé et déçu de constater, à travers nos synthèses, qu’il y avait encore beaucoup de réticence ou d’appréhension, voire d’incompréhension chez une partie des salariés. Certains avaient pourtant obtenu des résultats tout à fait remarquables et une forte adhésion globale, mais la réalité restait en-deçà de leurs espérances. Le fait qu’ils aient cependant accepté de rendre leur cas public est tout à leur honneur et témoigne de leur volonté de transparence et de leur désir sincère d’accepter le retour d’expérience.
La grille d’analyse
Chaque étude de cas suit la même grille d’analyse, constituée de cinq sections et 37 items. La première section décrit brièvement l’entreprise et son environnement économique. La deuxième se penche sur les étapes de la transformation et sur ses motivations. La troisième discute de l’étendue des zones rouges, c’est-à-dire le cadre ou les limites de la subsidiarité. La quatrième décrit les zones bleues de la subsidiarité, c’est-à-dire les sujets, l’étendue et la nature de l’autonomie. La dernière partie se consacre à l’instrumentation de l’autonomie, c’est-à-dire aux outils de gestion.
Cette grille d’analyse a été construite avec l’aide du groupe de pilotage du projet (voir Remerciements). Il s’agissait de créer une grille à la fois systématique et générique, destinée à faire ressortir la variété d’approches et de pratiques. Elle a été conçue pour permettre d’analyser de manière transversale diverses transformations organisationnelles en faveur de l’autonomie.
Malgré la présence de biais (aussi bien dans la sélection des interlocuteurs que dans leurs réponses, par autocensure ou loyauté), nous pensons que notre approche est plus robuste que celle des enquêtes fondées uniquement sur des entretiens avec les dirigeants et plus approfondie que les enquêtes reposant sur un questionnaire en ligne. La grille d’analyse permet de faire ressortir les tensions et éventuelles contradictions à surmonter au sein des organisations qui mettent en place des démarches d’autonomisation.
Autres sources
La présente publication fait également état d’autres expériences de transformation en faveur de l’autonomie, documentées par ailleurs : les exemples du groupe Hervé (Hervé et al., 2007 ; Hervé et Brière, 2011 ; Hervé, 2015), de Favi (Zobrist, 2014), de Michelin (Ballarin, 2019), de SEW USOCOME (Munzenhuter et Lemaire, 2016 ; Pellerin et Cahier, 2019), sont tirés de la littérature mais aussi d’échanges privés avec des dirigeants et anciens dirigeants de ces entreprises (Michelin, Poult, SEW USOCOME). Certaines entreprises de notre échantillon ont également fait l’objet de publications plus ou moins récentes (Bourguinat, 2019, pour Lippi ; Gérard, 2017, pour Chrono Flex).
Les cinq chapitres qui suivent sont consacrés aux résultats de l’analyse transversale de notre enquête.
- 1. Michel Hervé raconte dans son témoignage à l’École de Paris du management (https://www.ecole.org/fr/seance/416-parthenay-ou-les-infortunes-de-la-vertu) son désappointement de voir que les électeurs de Parthenay n’ont pas su apprécier les méthodes de participation qu’il avait mises en place dans la commune lorsqu’il en était maire. Il y appliquait pourtant les mêmes principes que dans son entreprise.
- 2. Cet ouvrage est une analyse transversale de nos neuf premiers cas, mais le travail se poursuit (thèse en cours d’un des auteurs).
- 3. Voir https://bit.ly/2NiweIF
- 4. À l’exception de Coreba (deux entretiens) et Ardelaine (sept entretiens), pour des raisons détaillées dans la synthèse de ces cas.
Motivations de la transformation
La transformation d’une organisation représente une charge de travail particulièrement lourde. C’est un point commun à tous les cas de l’étude. Faire changer les structures et les modes de management exige une implication très forte du ou des dirigeants. Cette charge peut même conduire ceux-ci à négliger les opérations du quotidien, au risque de mettre en péril l’activité de l’entreprise. Cette implication et cette prise de risque ne peuvent s’expliquer sans de profondes et sérieuses motivations.
Après avoir rappelé le rôle crucial du dirigeant dans les transformations observées, nous allons discuter ses motivations personnelles, idéologiques ou économiques, ainsi que les facteurs externes qui font apparaître la transformation opportune ou nécessaire.
Le rôle essentiel du dirigeant
Dans tous les cas que nous avons étudiés, excepté celui de la SCOP Coreba1, la décision de transformer l’entreprise ou un de ses départements est celle de son dirigeant. Cette décision est – au moins au départ – majoritairement solitaire, même si le dirigeant initiateur peut souvent s’appuyer sur des alliés, soit déjà présents dans l’entreprise (il s’agit souvent d’un autre associé ou du DRH), soit recrutés pour l’occasion (la responsable de la transformation agile chez GEN, par exemple), soit externes (consultants).
Lorsque le dirigeant est l’actionnaire unique ou largement majoritaire et peu endetté, la décision peut reposer sur sa seule conviction (Lippi, Hervé Thermique). Sinon, il faut convaincre de la pertinence de ces réformes un supérieur hiérarchique (GEN), une tutelle (SPF), des actionnaires – même familiaux – ou des banquiers… ou faire en sorte qu’ils ne s’aperçoivent pas de ce qui se passe. Dans certaines organisations, l’expérimentation locale est tolérée tant qu’elle n’affecte pas le reste de l’entreprise et son environnement (GEN, SPF Mobilité et Transports, Michelin). De manière paradoxale, le projet d’autonomisation et de participation des salariés – désigné aussi parfois sous le terme de projet de « libération des énergies » – est souvent le fait du Prince ou d’un comité très restreint, à l’exception des SCOP où la décision est par nature collective.
Motivations personnelles
Nous remarquons que les dirigeants qui ont voulu transformer leur organisation dans la voie de l’autonomie des équipes ont fréquemment des profils atypiques. Ce sont parfois des « métèques culturels »2 qui ont vécu des expériences dans des organisations très différentes : Michel Hervé (Groupe Hervé) est à la fois chef d’entreprise et engagé en politique, Aliette Mousnier-Lompré (Orange GEN) a mené ses études à Sciences Po en étant joueuse de football au Paris Saint-Germain avant d’être nommée responsable dans une entreprise où la plupart des dirigeants sont ingénieurs, Bertrand Ballarin (Michelin) était officier dans l’armée de terre, tandis que Patrick Négaret (CPAM 78), fils d’un pilote de l’US Air Force, se dit très marqué par la culture américaine de l’action. Pour ce qui est de Laurent Ledoux, ancien dirigeant du SPF Mobilité et Transports, le passage par de nombreuses entreprises privées avait créé chez lui une désillusion quant à la pertinence et à l’efficacité du management conventionnel.
Ces dirigeants sont souvent mus par des convictions personnelles fortes, mais s’inscrivent dans des traditions qui peuvent être très différentes3. Dans un article sur la généalogie du concept d’entreprise libérée, Alain d’Iribarne (2017) montre que celui-ci est au confluent de trois traditions radicalement distinctes : des libertaires de l’économie sociale à la recherche d’une alternative au capitalisme, s’appuyant sur la quête du bien commun et sur l’économie collaborative ou de partage ; des libertariens au service d’un capitalisme débridé marqué par l’esprit de la Silicon Valley ; des entrepreneurs réformistes à la recherche d’une société plus humaine4. Les dirigeants de notre échantillon sont représentatifs de ces différentes tendances ou reflètent des postures hybrides. Il peut aussi s’agir pour un dirigeant, surtout à l’occasion d’un changement de direction, d’imprimer sa marque et son style ou, dans les grandes organisations, de se faire remarquer pour sa capacité à changer les choses.
Certains, comme Jean-François Zobrist (Favi), Alexandre Gérard (Chrono Flex), Michel Hervé (Groupe Hervé), affichent clairement leurs convictions à travers de nombreux écrits et conférences. D’autres sont plus discrets, par pudeur, par respect des convictions potentiellement différentes de leur entourage ou pour ne pas s’exposer à la méfiance de leurs actionnaires, de leur hiérarchie, de leur banquier ou de leurs collaborateurs, et préfèrent ne communiquer que sur des motivations plus utilitaristes.
Se dessinent ainsi deux grands profils de dirigeants transformateurs : les extravertis sûrs d’eux-mêmes et les prudents. Comme nous le verrons, chacune de ces catégories aura des manières différentes de piloter la transformation et de communiquer sur elle (voir chapitre 5).
Les dirigeants sont assez nombreux à mentionner des rencontres et des lectures qui les ont inspirés : les ouvrages et conférences de Jean-François Zobrist (2014), Isaac Getz (2009/2016), Frédéric Laloux (2014/2015) sont les plus souvent cités, mais Ricardo Semler (1993), Vineet Nayar (2010/2011) ou Les quatre accords toltèques du chaman mexicain Don Miguel Ruiz (1999/2005), font aussi recette. Plus original, Michel Hervé, sans reconnaître une dette particulière envers un auteur ou un chef d’entreprise, affiche dans ses propres ouvrages des sources d’inspiration diverses : sur le processus d’auto-évaluation des salariés, il se définit comme un disciple d’Ivan Illich ; s’agissant de son mode de management et de la formation, il indique avoir puisé chez les pédagogues Célestin Freinet et Maria Montessori ; dans son livre Une nouvelle ère (2015), il cite aussi Piaget ; quant à l’organisation « fractale » de son entreprise, structurée, selon lui, par analogie avec le monde du vivant, il dit s’être inspiré des travaux du biologiste et prix Nobel Christian de Duve (2005). Il indique se plonger toujours avec gourmandise dans des ouvrages de biologie, de paléontologie, d’histoire et de philosophie.
Pour certains dirigeants, la participation au cercle de réflexion des « entrepreneurs libérateurs », Via 7, créé en 2011 et réunissant initialement quatre entreprises (Poult, Mecabor, Lippi et IMA Technologies), permet des échanges féconds qui prolongent la réflexion.
Motivations utilitaristes ou économiques
Dans une grande majorité de cas, la transformation est qualifiée de nécessaire pour la survie de l’entreprise dans un monde qui change vite et auquel il faut s’adapter pour ne pas mourir. Comme l’indique une collaboratrice interviewée : « soit on se transforme, soit on crève » (Orange GEN).
Agilité. Agilité. Dans un univers VICA (volatile, incertain, complexe, ambigu), où les clients demandent des produits et services personnalisés et rapidement disponibles, où les technologies et les marchés évoluent vite, la division des tâches tayloriennes n’est plus efficace. Pour une plus grande réactivité et rapidité, c’est au plus près du terrain que doivent désormais se prendre des initiatives adaptées, à condition que les salariés aient les compétences, l’information, les moyens
d’action et la latitude de décision nécessaires (Pellerin et Cahier, 2019). C’est l’agilité de l’organisation (voir encadré ci-contre) qui est recherchée à travers la simplification des processus décisionnels et l’allègement du poids des hiérarchies, avec en toile de fond l’exemple des start-up qui représentent un modèle sous-jacent plus ou moins avoué. Ainsi chez GEN, le changement induit par le passage d’un réseau physique à un réseau virtuel et la concurrence des GAFA obligeaient ce service d’Orange à se réorganiser rapidement, quitte à introduire pour cela les règles de la gouvernance adaptative (voir infra encadré p. 70), en bousculant les processus habituels du groupe.
L’agilité
L’agilité correspond à un paradigme managérial regroupant plusieurs méthodes (comme la méthodologie Scrum, le test and learn, etc.) dont les dénominateurs communs sont résumés dans le Manifeste agile, publié en 2001 et directement issu du monde du logiciel. Par analogie, le management agile revendique quatre valeurs centrales :
– L’adaptation au changement (plutôt que le suivi d’un plan)
– La primauté des interactions (sur les processus)
– La collaboration avec le client (plutôt que la négociation contractuelle) – L’efficacité (plutôt que l’exhaustivité).
Amélioration continue. L’amélioration continue est à la base des principes du lean management. Elle implique que chaque salarié ait la possibilité (et l’envie) de s’exprimer sur la manière d’exercer sa tâche de façon à réduire les gaspillages et les délais qui sont sans valeur ajoutée pour les clients ou les usagers. Bien compris – ce qui n’a pas toujours été le cas par le passé –, le Kaizen (ou amélioration continue en japonais) est donc porteur d’une rupture antitaylorienne, puisque tout part des propositions du terrain. Pour que les salariés se saisissent de cette possibilité, le management doit évidemment changer de posture et créer un environnement bienveillant dans lequel le salarié aura le désir de s’exprimer ou de prendre les initiatives contribuant à cette amélioration continue : c’est la reconnaissance du fameux « c’est celui qui fait qui sait » qui ouvre la voie à l’application de la subsidiarité.
À la CPAM 78, chez Lippi ou encore chez Michelin, c’est l’introduction des méthodes lean qui a conduit à entamer une réflexion sur les marges d’autonomie des salariés, sans lesquelles le lean imposé d’en haut peut se traduire par une pressurisation supplémentaire des équipes aboutissant à l’effet inverse de celui qui était recherché.
Intelligence collective. Composante de l’agilité, le développement d’une intelligence collective au sein de l’organisation est l’un des buzz words les plus cités par les dirigeants. Alexandre Gérard de Chrono Flex déclare, par exemple, que son management précédent, centralisateur et parfois autoritaire, l’avait privé d’un gisement précieux: l’intelligence collective des salariés. Ce concept à la mode reste cependant peu aisé à définir voir encadré infra. L’intelligence collective émergerait plus facilement dans les groupes de petite taille car les échanges y sont plus denses et fructueux.
La subsidiarité
La subsidiarité est, d’après le Grand Robert de la langue française, le principe selon lequel une autorité ne peut effectuer que les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à un échelon inférieur.
L’intelligence collective
L’intelligence collective est la somme des intelligences individuelles des membres d’une équipe augmentée par l’intensité de leurs relations: « Ce qui distingue une intelligence collective d’un simple travail collectif, c’est ce dépassement dû à la relation entre les membres du collectif » (Gréselle-Zaïbet, 2007, p. 43).
Elle reposerait sur des capacités individuelles (savoirs, compétences, maîtrise du métier), sur un certain niveau de confiance entre les membres du collectif, sur leur diversité (de culture, de genre, de formation…), sur l’existence d’un référentiel commun partagé et sur un certain niveau d’autonomie préalable à la fois à l’échelle des individus et des équipes.
Implication des salariés. On trouve aussi comme source de motivation déclarée, le besoin d’une meilleure implication des salariés au travail, nécessitant d’agir sur les facteurs de la qualité de vie au travail. Patrick Négaret pour la CPAM 78 parle ainsi de « bien-être au service de la performance » qui passe par différents leviers : sens, confiance, autonomie, reconnaissance, fierté d’appartenance. Chez FDM, l’accent est davantage mis sur le développement des compétences au service du client, car comme le dit franchement le dirigeant: « Ici, on ne sauve pas le monde, on fait de la pub. » De nombreuses études empiriques indiquent qu’une plus forte implication des salariés contribue à une meilleure performance économique de l’entreprise (Bourdu et al., 2016). L’attention portée par l’entreprise au besoin de reconnaissance et de développement de chacun, l’encouragement de l’initiative, la tolérance aux erreurs nécessaire à l’apprentissage individuel et collectif, l’écoute respectueuse des besoins, la délibération sur ce qui constitue un travail bien fait (Clot, 2010 ; Detchessahar, 2019), agissent sur cette implication, permettant un travail de meilleure qualité et une appropriation par chacun des objectifs de l’entreprise.
Promotion de l’image et de la marque employeur. La promotion de l’autonomie et de la responsabilisation dans le travail ou encore l’esprit start-up appliqué à des secteurs plus traditionnels sont des promesses en phase avec les nouvelles attentes de la société, et particulièrement des jeunes générations5. Horizontalité, individualisation des comportements, rapport modifié à l’autorité, démocratie directe, dessinent les contours d’un nouveau contrat social (Rayssac et al., 2019) dont les entreprises ne peuvent totalement s’extraire et qu’elles doivent nolens volens prendre en compte. Notons cependant que ces engouements ont un caractère cyclique: dans un contexte politico-économique très différent, les slogans de mai 1968 – « il est interdit d’interdire », « ne pas passer sa vie à la gagner » – avaient déjà ouvert la voie aux expériences autogestionnaires et aux équipes semi-autonomes des années 1970, avant d’être balayées par la mondialisation et le primat de la valeur actionnariale.
Aujourd’hui, dans la guerre des talents où de nombreuses entreprises peinent à recruter les compétences dont elles ont besoin, la visibilité que l’entreprise acquiert du fait de sa transformation socialement avancée peut lui conférer un avantage en matière de marque employeur, sans devoir recourir à des investissements directs en matière de communication de recrutement. La modernité revendiquée par le SPF Mobilité et Transports attirerait, par exemple, de plus en plus de jeunes. Quentin Druart, DRH de ce service fédéral au moment de notre enquête, précise que « la génération Y s’approche du ministère pour satisfaire une quête de sens, plutôt que pour s’assurer une bonne retraite. » Le service Personnel & Organisation reçoit désormais plus d’une demande de stage par jour, dont la majorité fait référence à la nouvelle culture de travail.
Il est indéniable que les expériences de libération suscitent une forte couverture médiatique, au point qu’il peut arriver de penser que, pour certaines entreprises, l’une des raisons d’être de la transformation est la communication. Nous verrons cependant que cette surexposition est à double tranchant. Bornons-nous ici à constater que la majorité des témoignages recueillis n’indiquent pas expressément que la nouvelle image de ces entreprises serait directement valorisée par les clients, les fournisseurs ou les partenaires, sans pour autant qu’on puisse exclure que ceux-ci soient séduits par l’engagement des divers interlocuteurs auxquels ils ont affaire.
Chamboule-tout. Une idée latente se retrouve chez plusieurs de nos interlocuteurs : le fait qu’un changement organisationnel, quel qu’il soit, a toujours des vertus positives (Midler, 1986). C’est une opportunité de casser les routines, de lutter contre la sclérose, de revoir certaines habitudes de travail, voire certaines rentes de situation ou privilèges, sans pour autant mettre en cause directement les collaborateurs. Patrick Négaret à la CPAM78 avait la volonté de créer « un choc culturel » pour contrer la verticalité de l’organisation et créer une nouvelle dynamique. Certains mouvements de balancier dans les grandes entreprises (organisation par métiers, par régions, par types de client, centralisation ou décentralisation), s’ils sont officiellement expliqués par la recherche de synergies ou de proximité renforcée avec le client, sont en partie entrepris pour l’occasion qu’ils donnent de remettre en cause les positions acquises sans désavouer le passé.
Facteurs déclencheurs
Les motivations précédemment évoquées sont communes à un très grand nombre d’entreprises. Elles ne suffisent pas à elles seules à expliquer le lancement de la transformation conduite dans les entreprises étudiées. Dans bien des cas, il a existé un facteur spécifique ou une conjonction de facteurs (parmi lesquels, souvent, un changement de dirigeant) déclenchant l’effort de transformation.
Crise économique. Dans une partie de nos cas, les réformes ont été déclenchées dans un contexte d’urgence, car l’entreprise allait dans le mur du fait d’une crise de ses débouchés (Chrono Flex) ou d’une évolution de l’environnement et des technologies face à laquelle ses modes opératoires n’étaient plus adaptés (GEN6). Chez Chrono Flex, la crise de 2009 a conduit à des licenciements afin d’éviter de justesse le dépôt de bilan. Selon l’équipe dirigeante, il aurait suffi de 10 % de productivité en plus pour combler le déficit, mais l’équipe de techniciens restait figée dans une routine malgré un nombre d’heures de travail facturables assez faible. Le PDG fondateur, Alexandre Gérard, se déclare alors doublement traumatisé : par les licenciements auxquels il a dû se résoudre malgré lui, et par la perspective de voir treize années d’efforts réduites à néant si l’entreprise ne remonte pas la
pente. C’est à ce moment-là qu’il rencontre Jean-François Zobrist (Favi), fait lire son livre à toute l’équipe dirigeante et décide d’engager le processus de libération. Chez Lippi, la mutation avait démarré avant la crise économique mais elle a été fortement accélérée par cette dernière. En effet, il était clair que, sans une profonde transformation du modèle managérial, « la question n’était pas de savoir si l’entreprise allait disparaître, mais à quel moment cela se produirait. »
Variations de la taille de l’entreprise. Dans plusieurs cas (A**, FDM, GEN, CPAM), c’est l’évolution du nombre de collaborateurs qui a concrètement déclenché une réflexion organisationnelle.
Dans les deux premiers cas, il s’agissait d’une hausse des effectifs avec un passage d’une vingtaine à une cinquantaine de personnes, liée à la croissance de l’entreprise. Généralement, la croissance engendre plusieurs phénomènes : l’introduction d’un middle management, un sentiment de perte de contrôle par le dirigeant et la crainte, chez lui comme au sein des équipes, de voir disparaître l’esprit start-up des pionniers. La politique d’autonomie permet alors de contourner cette crainte, en évitant le risque de normalisation ou de bureaucratisation de l’organisation.
À l’inverse, dans les deux autres cas, il s’agissait d’une décroissance des effectifs associée à des changements technologiques. Les caisses primaires d’assurance-maladie sont confrontées à de fortes diminutions d’effectifs, justifiées notamment par le fait que le traitement informatisé des actes médicaux requiert moins de travail de saisie et de courrier. L’organisation historique, pensée pour un certain nombre d’employés, devient alors inadaptée et les missions des collaborateurs doivent être repensées et élargies. Pour autant, si toutes les CPAM sont concernées par cette adaptation, seules quelques-unes ont décidé de se réformer en profondeur et celle des Yvelines (CPAM 78) est pionnière dans sa démarche d’autonomie. Chez GEN, un plan social étalé sur une durée d’un an et demi avait précédé la transformation.
Dégradation du climat social. Chez Michelin, la démarche de responsabilisation a répondu à une dégradation de la satisfaction des employés suite aux contraintes engendrées par l’introduction du Michelin Manufacturing Way, système lean de gestion de la production impliquant une rationalisation des processus et la traque des temps morts. Dans d’autres cas, il s’agissait de recréer une dynamique positive chez des personnels secoués par des vagues de licenciements perçues comme annonciatrices d’une spirale de déclin (GEN).
Opportunité. Le facteur déclencheur peut également être l’existence d’une intention qui trouve son opportunité. Le dirigeant attend de trouver le juste moment et le bon prétexte pour engager la transformation qu’il a en tête. Ainsi le dirigeant du SPF a-t-il saisi l’occasion d’une réorganisation des bureaux en flex desk et open space pour promouvoir son projet de libération. L’intention première de cette transformation physique répondait clairement à une logique financière : d’une part, l’État accorde souvent des subsides pour de tels projets, et, d’autre part, la réduction des espaces de travail permet de diminuer les charges. Mais le projet de libération a permis de donner une toute autre justification et portée à cette réorganisation, en lui adjoignant, entre autres, la généralisation du télétravail et la suppression de l’obligation de pointer.
***
On voit donc que les transformations sont dans la plupart des cas décidées par le dirigeant sur la base de motivations liées à ses convictions personnelles et pour satisfaire des mobiles économiques ou utilitaristes assez peu différents de ceux de n’importe quelle entreprise, mais auxquels il a la volonté d’apporter une réponse originale. Le changement peut être déclenché pour répondre à une crise économique majeure mettant en péril la survie de l’entreprise, à un malaise lié à une variation de taille ou de nature de l’activité, à une dégradation du climat social ou encore pour profiter d’une opportunité (déménagement, diversification…).
- 1. Dans le cas de Coreba, le passage en SCOP résulte d’une décision collective d’une partie des employés de l’entreprise en passe d’être vendue (seize sur vingt-cinq). Nous ne savons pas s’il y avait un leader de fait dans le groupe fondateur.
- 2. L’expression est utilisée pour caractériser les pionniers de la réorganisation des processus de production au début des années 1980 (Rigal et Weil, 1984). Ceux-ci venaient souvent d’un milieu différent de celui du grand groupe au sein duquel ils avaient introduit leurs réformes (officier de marine, patron de PME…).
- 3. Comme le remarque Michel Lallement (voir Point de vue p. 136), il aurait été judicieux de s’intéresser au parcours détaillé de ces dirigeants libérateurs pour mieux comprendre les origines de leurs motivations. Notre méthode d’investigation nous ayant conduits à passer beaucoup de temps avec des personnes de statuts divers en évitant d’être sous trop grande influence du dirigeant, nous avons négligé ce point que nous espérons pouvoir approfondir dans une deuxième phase.
- 4. De son côté, le Professeur Christian Defélix de l’IAE de Grenoble met en regard l’entreprise libérée , dont le modèle racine serait l’auto-gestion, et l’entreprise bienveillante , dont le modèle racine serait le paternalisme (intervention du 13 septembre 2017 à l’Université Paris-Dauphine dans le cadre du cycle de séminaires « Innover en management » du Cercle de l’innovation ; voir https://www.franceculture.fr/conferences/universite-paris-dauphine/lentreprise-liberee-nouvelle-intox-manageriale-ou-grand-soir-du-management, et aussi Chabanet et al., 2017).
- 5. Comme le notait déjà le psychanalyste Raymond Cahn dans un article du Nouvel Obs à propos de la génération 1968 : ils sont plus libres que nous ne l’avons jamais été, mais il leur manque l’essentiel, qui est de s’être libérés eux-mêmes. Les Argiens libérés par Oreste dans Les Mouches de Jean-Paul Sartre sauront-ils se gouverner sans maître, simplement parce que celui qui est en position de régner refuse le trône ?
- 6. Les nouvelles technologies rendaient les nombreux points de présence de l’entreprise moins utiles.
Sujets et objets de l’autonomie
Les démarches de montée en autonomie des salariés se fondent sur une réaction aux excès de la division du travail, de la bureaucratie et de la hiérarchie, sur le rejet d’un management étouffant les initiatives sous la multiplicité des contrôles et des instruments de reporting.
Pour autant, elles diffèrent quant aux structures organisationnelles qu’elles modifient ou non, quant à la nature de l’autonomie qu’elles privilégient, quant aux leviers qu’elles mobilisent et aux dispositifs de gestion qu’elles mettent en place.
Évolution des structures organisationnelles
Bien que cela soit quelque peu caricatural, on peut distinguer deux catégories de transformation : les dures, qui apportent des changements concrets à l’organisation, à la hiérarchie, aux processus décisionnels, aux attributions des équipes (design organisationnel) ; les molles, qui ciblent plutôt des changements de l’état d’esprit1. Ces dernières transformations sont par définition plus difficiles à décrire avec précision, et même à saisir. Mais ce « mou » pourrait bien représenter en réalité l’objectif essentiel de la transformation, le « dur » n’étant que la façon de parvenir à le produire (Riveline, 1985).
Lorsque les entreprises s’attaquent au « dur », elles s’intéressent généralement à la constitution d’équipes désormais qualifiées d’autonomes, à une simplification de la ligne hiérarchique et à une redéfinition des compétences ou des modes d’intervention des fonctions support.
Constitution d’équipes autonomes
Les démarches que nous avons observées s’appuient le plus souvent (au moins de façon déclarative) sur le principe de subsidiarité, c’est-à-dire l’idée selon laquelle la responsabilité d’une action, lorsqu’elle est nécessaire, revient à ceux qui sont directement concernés par cette action. Ceux-ci peuvent alors solliciter l’aide du niveau supérieur au besoin. Cela revient à donner plus de latitude de décision aux opérationnels. Pour cristalliser cette idée, beaucoup d’entreprises ont commencé par redéfinir l’unité de travail de base (de 5 à 15 personnes, plus rarement 40) dans laquelle s’inscrira l’autonomie d’action (voir encadré ci-contre). Les pionniers français de l’autonomie au travail (Poult, Favi, Hervé Thermique, SEW USOCOME) avaient déjà procédé ainsi, en mettant en place des miniusines ou des PME autonomes. C’est peu ou prou le modèle généralement suivi, avec toutes sortes de nuances. Les équipes autonomes peuvent également correspondre à des équipes déjà existantes avant la transformation (CPAM 78) ou, plus rarement, à des équipes parallèles à l’ancienne organisation (GEN).
Aplatissement et simplification de la hiérarchie
La réduction du nombre de niveaux hiérarchiques comme facteur d’autonomisation n’est pas une composante systématique des projets d’autonomisation, même si le souci de simplification est généralement présent dans l’esprit des dirigeants transformateurs. Certaines entreprises y ont recours, d’autres pas.
Chrono Flex a adopté une organisation plate. A** ne possède plus officiellement de middle management. Les squads de FDM n’ont pas de manager. Cependant, quand l’organigramme d’une équipe est formellement plat, il n’est pas rare de voir réapparaître une forme de coordination managériale sous des noms renouvelés tels que capitaine, team leader (A**, Chrono Flex) ou animateur (Lippi), dont la caractéristique par rapport à la situation antérieure est qu’ils sont souvent cooptés ou élus par leurs pairs avec ou sans candidature préalable, pour une certaine durée (trois ans par exemple). Notons qu’élection et cooptation peuvent favoriser les salariés les plus consensuels, sans que soient prises en compte leur compétence, pédagogie ou fermeté. Rien ne permet de dire non plus qu’une fois élu, le capitaine ne se comportera pas en petit chef. Chez Chrono Flex, lorsqu’un capitaine est contesté, l’équipe peut lui demander de passer du temps avec des collègues plus expérimentés afin de s’améliorer. Si cela reste insuffisant, il est démis et remplacé pendant quelques temps par un capitaine nommé par la direction pour rétablir la situation.
À l’inverse – seul cas au sein de notre échantillon –, la SCOP Coreba a dû ajouter un échelon hiérarchique à son organigramme, car il était parfois difficile pour le dirigeant de prendre des sanctions à l’égard de ceux qui le nomment (les salariés coopérateurs).
Il apparaît donc que, si la hiérarchie peut être atténuée, voire supprimée, d’autres modalités de coordination seront généralement requises. Autrement dit, le management serait toujours nécessaire, mais il ne devrait plus avoir ni le goût, ni l’odeur du management traditionnel – un management sans managers qui correspond à l’air du temps, comme le Coca Zéro, la viande sans bœuf ou les œufs sans poule.
Par ailleurs, il peut exister des niveaux au sein de l’équipe reflétant l’expérience ou l’ancienneté, sans fonction officielle d’encadrement. C’est le cas chez FDM où il existe cinq positions dans les squads recouvrant un grand nombre de niveaux intermédiaires : junior, entry, senior, lead, director ; une hiérarchie d’autorité et de rémunération qui ne diffère en fait guère de celle d’autres cabinets de conseil. Pour chaque position, il est défini dans le handbook ce que l’agence attend de la personne ainsi que son niveau d’autonomie et de responsabilité. Les juniors que nous avons rencontrés n’ont pas d’objection à cette organisation : ils considèrent ces différences de statut comme une forme de respect.
L’aplatissement complet des hiérarchies est souvent problématique pour les individus les plus carriéristes. Par exemple, chez Lippi, la reconfiguration d’une partie de la hiérarchie a eu pour effet une raréfaction des possibilités de promotions hiérarchiques et, compte tenu des difficultés économiques, les éventuelles cooptations à un poste d’animateur ne se traduisent pas automatiquement par une augmentation du salaire.
En revanche, le SPF, Orange GEN ou Michelin n’ont pas encore supprimé d’échelons hiérarchiques.
En réalité, le poids de la hiérarchie se mesure moins au nombre de strates – même si elles peuvent en représenter un indicateur pertinent – qu’à la distance hiérarchique entre ces strates2. C’est moins la structure hiérarchique formelle qui permet de caractériser une organisation comme plus ou moins « autonomisante » que l’état d’esprit des managers et la manière dont ils exercent leurs fonctions (aidants, bienveillants, coaches). L’atténuation, voire la disparition, de certains marqueurs hiérarchiques distinctifs, tels que les places de parking réservées, les cantines séparées ou les bureaux fermés des chefs à une ou plusieurs fenêtres, sont des indicateurs appréciés par les salariés d’une volonté de réduction de la distance hiérarchique et d’un esprit plus collaboratif.
Des espaces d’échange et de concertation
Sans forcément toucher à la structure hiérarchique, la plupart des entreprises créent des espaces d’expression, d’échanges, de participation, permettant aux salariés de débattre des problèmes, de les résoudre, de proposer de nouvelles solutions ou d’exprimer une volonté collective. Les niveaux de participation sollicités sont variés mais ils dépassent généralement la simple consultation pour couvrir un spectre pouvant aller de la concertation à la codécision, en passant par la délibération, selon les objets traités. Il s’agit dans tous les cas de solliciter une participation directe des salariés qui ne soit pas « intermédiée » par le management, les institutions représentatives du personnel ou les syndicats. Ces espaces deviennent les lieux d’apprentissage de cette intelligence collective à laquelle aspirent les entreprises, sans toujours savoir ce qu’elles peuvent précisément en attendre.
Les exemples de ces espaces sont nombreux et peuvent concerner l’équipe ou le collectif. Il y a d’abord les groupes d’amélioration continue travaillant sur l’optimisation des processus (CPAM 78, Lippi) dans le cadre d’une communication structurée par les méthodes lean (par exemple, les points quotidiens en production, les chantiers kaizen, etc.). Ensuite, on trouve les groupes de travail à géométrie variable (chantiers, cercles, cellules, ateliers, workshops), constitués sur une base volontaire, souvent transfonctionnels et multiniveaux, qui peuvent porter sur des sujets « business » (un nouveau projet à monter), des sujets d’organisation globale (travail à distance, horaires, modes d’attribution des augmentations et primes), des réflexions transverses (projets QVT, passage à un management bienveillant) ou encore sur la définition collective de la vision et des valeurs, etc.
Tout cela dessine des cellules, concentriques, superposées ou connectées, temporaires, évolutives ou permanentes, qui favorisent les appartenances croisées, le cumul de plusieurs fonctions ou rôles pour un même individu, et la construction progressive de relations décloisonnées et plus denses au sein des équipes comme de toute l’organisation. Ce que Frédéric Lippi appelle joliment « l’art de la conversation ». La construction d’une telle dynamique nécessite une certaine tolérance à l’indétermination et peut produire dans un premier temps un sentiment de chaos et de perte de temps (ce qu’illustre le dicton « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »). Les managers peuvent en ressortir particulièrement perturbés, eux qui concevaient leur mission comme consistant à organiser le travail rationnellement et efficacement. Pourtant, insiste Frédéric Lippi, il faut accepter l’idée que « la conversation » ne vient pas en plus du travail mais qu’elle fait partie du travail.
Cette mise en place nécessite un temps de préparation et d’apprentissage. Chrono Flex témoigne qu’au début du processus, les groupes de travail pataugeaient et ne produisaient rien de concret. Il a fallu passer par une étape de formation aux techniques et méthodes de l’intelligence collective, du coaching et de la gestion des tensions. Dans beaucoup d’entreprises, un réseau de facilitateurs ou d’ambassadeurs volontaires a été formé à ces méthodes. Les facilitateurs animent sur les différents sites des réunions de sensibilisation. Au ministère belge des transports, le DRH au moment de notre enquête explique que l’objectif à terme est d’évoluer vers des réunions produisant des décisions concertées. Dans les organisations observées, on reste cependant encore assez loin de la délibération sur le travail, telle qu’elle a été conçue et formalisée par les équipes de psychologie de travail du Cnam (Clot, 2010) et Detchessahar (2019).
La gouvernance adaptative chez GEN (Orange)
Développée par un cabinet de conseil extérieur (Spindle), la gouvernance adaptative est une méthode agile proche de l’holacratie, permettant d’aller vers une gestion de projet plus transversale et collaborative grâce à la création de cercles transfonctionnels. Plus précisément, les cercles correspondent à des équipes virtuelles qui rassemblent les rôles clés pour la réalisation d’un projet transversal (par exemple, le déploiement d’un nouveau partenariat en Argentine). Ils sont généralement constitués de sept à douze personnes, en provenance de différents services de GEN. Ils sont ouverts à tous, pour une durée indéterminée, qui dépendra de l’évolution du projet. Autrement dit, toutes les positions hiérarchiques sont susceptibles d’y être représentées. Il n’est donc pas rare que des exécutants y côtoient des N-1, N-2 ou N-3 de la direction. Les cercles s’imbriquent les uns dans les autres : par exemple, le sous-cercle du projet pilote de déploiement en Argentine s’inscrit dans le cercle regroupant les cinq projets-pilotes (nommé Pilot Launch), qui est lui-même rattaché au super-cercle de GEN englobant tous les cercles.
La transformation des services support
Malgré leur nom, les services support sont devenus des directions fonctionnelles incontournables (achats, RH, informatique, qualité) et souvent des bastions dictant leurs règles aux services opérationnels. Renforcer l’autonomie des unités opérationnelles conduit régulièrement à demander aux unités fonctionnelles de changer de posture pour se mettre au service des opérationnels en les faisant bénéficier du support de leur expertise. Dans certains sites autonomes de Michelin, la direction des ressources humaines est consultée sur les embauches (et éventuellement sollicitée pour aider à trouver des candidats) mais la décision appartient désormais aux unités opérationnelles. C’est pourquoi, on affirme généralement que les fonctions support sont « victimes » des processus de libération.
Dans les faits, de tels constats ont été peu nombreux. Dans certaines entreprises, on assiste plutôt à l’émergence de nouvelles fonctions support destinées à appuyer la transformation, comme le responsable de l’innovation participative à la CPAM 78 ou la responsable de la transformation chez GEN. Dans plusieurs cas, la fonction RH, très sollicitée pour cet accompagnement, s’est renforcée, tout en se déconcentrant avec des correspondants RH dans les différentes unités.
Quand des fonctions support ont été supprimées, il est arrivé qu’il faille les réintroduire. Par exemple, Favi se glorifiait de ne plus avoir de magasinier : chacun allait se servir librement du matériel et des outils dont il avait besoin sans avoir à se justifier, car l’entreprise avait confiance dans son jugement et dans son honnêteté. SEW USOCOME a voulu faire de même et a constaté que cela ne fonctionnait pas bien : non qu’il y ait eu du « coulage » ou des abus, mais parce que lorsqu’un opérateur doit faire face à une panne ou à un dysfonctionnement, sa priorité est d’y remédier. Il ira chercher des pièces ou des outils au magasin, mais remettra à plus tard la tâche de mettre à jour l’inventaire, au risque d’oublier ensuite… Plus tard, un outil ou un matériel indispensable manquera, car personne n’aura suivi les prélèvements et commandé de quoi regarnir le stock de sécurité. L’entreprise a donc remis en place un magasinier en expliquant que ce n’était pas une marque de défiance envers les opérateurs, mais que ceux-ci avaient en effet mieux à faire, lorsqu’ils devaient faire face à un incident sur leur ligne, que de tenir à jour les inventaires.
Qui est autonome ? Sujets de l’autonomie
Lorsque les dirigeants invoquent l’autonomie des personnels, de quelle autonomie parlentils exactement ? Est-ce une caractéristique des individus, des équipes, d’un collectif plus large, voire de l’entreprise tout entière ?
L’autonomie individuelle
La plupart de nos interlocuteurs rappellent à juste titre que l’autonomie en entreprise n’est pas la liberté3. Si chacun pouvait agir à sa guise sans se préoccuper de l’action des autres, sans besoin de coordination avec eux, alors il n’y aurait, selon Coase (1937), aucune raison de constituer une entreprise structurée, si ce n’est une société civile professionnelle comme celles qui rassemblent des professionnels libéraux tels que médecins ou avocats partageant des locaux ou quelques moyens communs. À la question « Qui est autonome au sein de la SCOP Ardelaine ? », une coopératrice répond : « Personne. L’autonomie pure est impossible parce qu’on est en interaction constante les uns avec les autres. Une entreprise, c’est comme un bateau, on ne peut pas faire n’importe quoi, on est interdépendants ».
Un salarié peut se sentir légitime à prendre seul une décision qu’il juge pertinente parce qu’il a parfaitement intégré la mission, les valeurs et les priorités de l’entreprise. Le handbook de FDM précise par exemple : » Chaque membre est libre d’accomplir ses missions comme il le souhaite dans le respect de nos valeurs. »
Le salarié agit ainsi de son propre chef en pleine responsabilité (au sens de empowerment), mais en respectant une norme collective qu’il s’est appropriée, en étant comptable (accountable) de la conformité de son action à cette norme. Il n’est donc pas à proprement parler autonome, puisque la norme a été élaborée et approuvée par ou avec d’autres, mais il n’est pas non plus hétéronome, puisqu’il s’est approprié cette norme d’action qui est donc devenue aussi la sienne. L’autonomie n’est donc encouragée que dans un certain cadre, qui peut être en partie implicite. Les entreprises favorisant l’autonomie préfèrent souvent expliciter celui-ci. Sinon, la peur de franchir des limites trop floues pousse à un conformisme contraire à l’autonomie encouragée. Expliciter et documenter des procédures afin qu’elles soient maîtrisées par ceux qui doivent les mettre en œuvre devient ainsi une façon de cadrer le travail, tout en réduisant le poids du contrôle hiérarchique: des règles au lieu de chefs!
Responsabilité
Responsabilité désigne à la fois, selon l’Encyclopédie Universalis, la capacité de prendre des décisions individuelles et le fait d’être garant de quelque chose, de répondre de ses actions (et en droit, l’obligation de réparer une faute ou de tenir un engagement). L’anglais distingue empowerment et accountability.
Le pouvoir individuel de décider n’est donc accordé par l’organisation qu’à ceux qui partagent ses valeurs et ses règles. Comme le souligne un directeur chez Lippi : « On est libre de faire les choses à notre manière, mais pas de faire ce qu’on veut. » Ceci explique que certaines des entreprises assument de s’être séparées de salariés qui ne partageaient pas les valeurs collectives. Frédéric Lippi témoigne ainsi du fait que : « Certains ont estimé que cet environnement de travail ne leur convenait pas et sont allés s’épanouir ailleurs. D’autres sont partis en nous traitant de salauds. »
Certains salariés ne souhaitent pas l’autonomie et préfèrent qu’on leur dise ce qu’ils doivent faire, parfois parce qu’ils n’ont pas confiance dans leur capacité à faire le bon choix (ou estiment ne pas avoir la formation, l’information ou l’instrumentation qui le leur permettrait), parfois parce qu’ils ne veulent pas supporter l’angoisse de ce choix et la responsabilité d’une erreur (au sens d’accountability), ou qu’ils estiment qu’on veut leur « refiler le travail du chef » dont on supprime le poste sans leur accorder de contrepartie à la mesure de cet effort supplémentaire, ou encore parce qu’ils considèrent qu’en les jugeant au résultat, on leur impose subrepticement et sans compensation une charge de travail et une charge cognitive excessives4, voire parce qu’ils flairent un piège derrière l’injonction contradictoire d’être autonome5.
L’appétence des employés pour l’autonomie est donc variable. De même qu’on ne force pas l’individu à être libre (ou à être heureux !), forcer l’autonomie est contradictoire et dangereux. Le discours adopté par la direction de la CPAM 78 consiste à mettre en avant la possibilité de plus d’autonomie et non son obligation.
L’autonomie des équipes
L’autonomie peut se décliner à l’échelle individuelle ou à l’échelle collective, d’une manière souvent antagoniste. De fait, pour un même objet, accroître l’autonomie du groupe peut revenir à réduire l’autonomie de l’individu – et vice-versa. Par exemple, si une organisation décide d’octroyer une marge de manœuvre plus grande à chaque salarié concernant la gestion de son temps de travail, elle ne prévoira pas de processus de validation collective. Inversement, si elle souhaite insister davantage sur l’autonomie de l’équipe, le salarié ne pourra pas prendre de décisions à son niveau sans vérifier qu’il ne désorganise pas la production et qu’un interlocuteur compétent est disponible pour répondre aux demandes des clients ; le salarié devra consulter le reste de son équipe au préalable ou respecter quelques règles et procédures.
Les entreprises de notre échantillon tendent à mettre en avant le primat du collectif sur l’individu. Dans les tâches quotidiennes relevant de l’exercice routinier du métier, l’individu est certes autonome et responsable. Mais dès lors qu’une action a des conséquences sur le fonctionnement de l’équipe ou de l’entreprise, il se doit a minima d’en informer le collectif, et plus souvent encore, de le consulter pour valider sa démarche.
Les équipes de travail peuvent gérer à leur niveau des tâches de régulation telles que l’organisation des plannings, des congés, des horaires de travail, des achats (dans la limite d’un certain budget et éventuellement le respect de règles générales), les embauches, les promotions, voire les négociations avec le client, la vente de nouvelles prestations ou la prospection de nouveaux clients. Les membres d’un îlot de l’usine Michelin de Roanne résument d’une formule la très large autonomie qu’ils ont acquise : « le chef s’occupe de nous, on s’occupe du reste ».
Si l’organisation de la subsidiarité suppose parfois que la hiérarchie ou les services fonctionnels renoncent à certaines de leurs prérogatives ou à leur pouvoir de contrôle, elle peut ne pas être uniforme. Certaines équipes peuvent revendiquer une forte autonomie, tandis que d’autres resteront dans un mode de fonctionnement plus traditionnel, comme à la CPAM 78 ou chez Michelin.
L’autonomie de départements ou de l’entreprise
Au niveau de collectifs plus étendus, il est difficile de parler de l’autonomie en général, sans savoir sur quoi elle porte : sa nature et ses instruments. Dans les grands groupes, l’autonomie des filiales peut être plus ou moins grande, allant de l’extrême centralisation des procédures, des process et des systèmes d’information jusqu’au laisserfaire local. Chez SEW USOCOME, par exemple, les filiales jouissent d’une grande autonomie d’organisation par rapport à la maison-mère allemande, tant que les résultats sont au rendez-vous : c’est ainsi que l’organisation « en mini-usines » est propre à la France et n’a été adoptée ni en Allemagne ni au Brésil. D’autres autorisent les expérimentations locales sur certains aspects limités, tout en cadrant fortement l’essentiel (Michelin).
Notons que l’autonomie d’un ensemble peut toujours conduire à la diminution de l’autonomie de ses composantes. L’autonomie des universités a, par exemple, réduit celle des universitaires. Alors qu’ils dépendaient jadis d’un pouvoir central lointain qui ignorait les situations particulières et cogérait avec les syndicats des règles nationales de recrutement ou d’avancement à l’ancienneté, les universitaires sont désormais face à un management de proximité doté d’une certaine autonomie stratégique, de ressources et d’un pouvoir de négociation.
Donner plus de liberté à une composante au sein d’une grande organisation peut aussi paradoxalement donner un grand pouvoir aux éléments dominants de cette unité sur les autres participants. À nouveau, rien ne prouve a priori que la délégation de pouvoir entre le sommet de l’organisation et les unités qui la composent se traduise par une plus grande autonomie de tous les individus au sein de chacune6.
Sur quoi porte l’autonomie ? Les champs de l’autonomie
Les trois dimensions de l’autonomie au travail
Selon Emilie Bourdu et al. (2016), il existe trois niveaux d’autonomie.
Le niveau 1 est centré sur la tâche. L’autonomie consiste dans la latitude existant pour le salarié de pouvoir définir sa propre tâche : séquencement, méthode d’exécution, rythme de travail, outils à utiliser, etc.
Le niveau 2 définit le pouvoir pour le salarié ou pour le collectif de travail d’exercer une influence sur l’environnement organisationnel, en participant à l’amélioration de l’organisation du travail, en influençant les décisions qui concernent le travail ou les modes de coopération nécessaires à la bonne exécution du travail.
Le niveau 3, enfin, mesure l’implication des salariés dans la gouvernance de l’entreprise à travers le dialogue social ou la négociation sur les conditions de travail, le partage de la valeur créée, etc.
Les 3 dimensions de l’autonomie au travail
Source : La Fabrique de l’industrie, Anact-Aract, Terra Nova (2016).
Ni le dirigeant, ni la gouvernance
Selon cette segmentation, force est de constater que, dans notre échantillon, l’autonomie porte essentiellement sur la tâche et sur la participation à différents mécanismes de coopération mais jamais sur la gouvernance, à l’exception des SCOP. La personne du dirigeant et la gouvernance font clairement partie des zones rouges (voir encadré ci-après) et ne sont pas un objet de délibération.
Ni les attributions, ni le choix des dirigeants, ni l’arbitrage de répartition des richesses produites entre, d’une part, la croissance de l’entreprise (investissements, y compris en formation) et, d’autre part, le partage de la valeur créée entre les clients (baisses de prix, prestations supplémentaires), les actionnaires (dividendes et plusvalues latentes), les dirigeants et les salariés, voire des tiers (mécénat, mécénat de compétences…), n’ont été mentionnés par les interlocuteurs de notre échantillon, toujours à l’exception des deux SCOP où la répartition des bénéfices est égalitaire et le dirigeant élu par ses pairs. Mais même dans le champ de l’économie sociale et solidaire, le statut formel de l’organisation ne garantit pas toujours la participation des salariés au pouvoir de gouvernance. Par exemple, une mutuelle appartient théoriquement à ses clients et une SCOP à ses salariés. Mais au-delà d’une certaine taille, divers systèmes de corps intermédiaires font que cela ne se traduit pas nécessairement par un exercice réel du pouvoir de gouvernance (Frémeaux, 2014).
La personne du dirigeant fait partie des dimensions hors concertation : il n’est pas désigné par un processus démocratique, ni remis en cause à échéances régulières. Certains l’assument : l’autonomie proposée ne porte pas sur cet aspect de l’organisation. D’autres sont moins à l’aise avec cette restriction et tentent de s’en défendre sans guère convaincre. Cette hypocrisie ne saurait être bénéfique. Le dirigeant, même quand il consulte et accepte de débattre, reste en dernier ressort le décideur et l’arbitre final. En revanche, le dirigeant salarié peut lui-même avoir des marges de manœuvre limitées par son conseil d’administration ou sa tutelle. Le dirigeant du SPF Mobilité et Transport, par exemple, a eu une grosse divergence avec son ministre de tutelle et a été conduit à quitter l’institution.
Zones rouges et bleues
Nous remarquons que le succès d’une démarche de responsabilisation des salariés dépend notamment des efforts de définition et de communication sur le spectre de l’autonomie. Nous distinguons les zones bleues de l’autonomie – ce qui relève de la responsabilité des employés – des zones rouges – ce qui est exclu du champ de l’autonomie. Certaines zones rouges peuvent être imposées par la hiérarchie (par exemple, le choix d’une politique de non transparence sur les salaires), d’autres découlent de la loi (respect du code du travail, contraintes de sécurité, etc.). Libre ensuite à l’entreprise de définir le contenu des zones bleues (télétravail, évaluation par les pairs, prise de décision collective, etc.) qui pourra d’ailleurs s’étendre avec le temps, au fur et à mesure de la réussite des premières expérimentations et de la confiance acquise (y compris par le dirigeant).
Comment, quoi, pourquoi ?
Une autre façon de cerner les champs de l’autonomie, qui ne recoupe pas exactement la première, consiste à segmenter le comment, le quoi et le pourquoi.
Selon cette deuxième grille, nos observations indiquent que l’autonomie est majoritairement cantonnée aux modalités d’exercice du travail, qu’elles soient individuelles (manière d’exercer la tâche) ou collectives (règles de fonctionnement, modalités de la coopération), c’est-à-dire au comment, mais qu’elle porte rarement, ou à la marge, sur le quoi, c’est-à-dire sur l’activité elle-même (business modèle de l’entreprise, stratégie, objectifs), à l’exception peut-être de Chrono Flex où des salariés, représentant leurs collègues, participent aux comités stratégiques. Le processus de production lui-même est souvent cadré par les exigences du client (A**, FDM), par le système de production (lean manufacturing) dans les activités industrielles (Lippi, Michelin) ou encore par la doctrine défendue par l’organisation (cf. le cas des juristes du SPF qui doivent défendre la position de l’institution et non leurs opinions personnelles).
Si l’objet de l’activité n’est pas négociable, la formulation de la raison d’être7 ou de la finalité de l’entreprise (le pourquoi) commence à être ouverte à la discussion ou à la participation des salariés, voire des autres parties prenantes. Il s’agit notamment d’utiliser cette démarche pour construire un récit partagé et des valeurs communes, de sorte que les salariés se sentent davantage en congruence avec ce qu’ils font et d’autant plus concernés par le devenir de l’organisation. Ce que Patrick Négaret (CPAM 78) appelle « fédérer sur le pourquoi ». Nous constatons là une différence majeure avec la pensée de Carney et Getz (2009/2016), pour qui, dans une entreprise libérée, la vision est avant tout celle du leader libérateur, qui doit ensuite veiller à sa bonne appropriation par les collaborateurs (voir encadré, chapitre 1).
Si certaines organisations examinées ont des rituels permettant de mettre en question les règles, nous n’en avons pas vu qui aient explicitement prévu une révision périodique de leur raison d’être. L’idéal proposé par Laloux (2014/2015) d’une raison d’être évolutive semble encore lointain.
Attributs de l’autonomie
Si l’autonomie est l’incorporation d’un pouvoir de décider de l’individu ou de l’entité autonome dans l’acte de travail, que recouvre exactement ce pouvoir ? Quelles sont ses différentes facettes ?
Droit de décider
On pense d’abord au droit de décider, sans demander la permission, ni avoir à se conformer à des prescriptions détaillées sur la manière de réaliser sa tâche. Mais le droit de décider quoi exactement ? Ce peut être, par exemple, la faculté de décider de travailler depuis un autre lieu, d’inviter un client à déjeuner, d’organiser un voyage professionnel, d’acheter des fournitures, etc.
Au SPF Mobilité et Transports, le champ de l’autonomie porte avant tout sur l’organisation personnelle du travail à travers trois mesures : le choix quotidien du bureau où chacun s’installe (flex desk – mais l’application du principe du flex desk ne résulte, lui, pas d’un choix des salariés), la généralisation du télétravail et la suppression de l’obligation de pointer. En matière d’autonomie de la décision, les collaborateurs ne doivent en principe plus faire valider chacune de leurs décisions par leur supérieur hiérarchique mais cela reste variable selon les départements et les chefs de service.
Dans certaines organisations (A**, FDM), les collaborateurs disposent d’un réel accroissement de liberté dans la façon dont ils exercent leurs missions à l’égard du client : ils ont le choix des outils (par exemple, logiciels) et il n’y a pas vraiment de protocoles à suivre. « Dans le cadre de projets informatiques, il y a souvent plusieurs manières d’arriver au résultat souhaité, note un technicien interrogé. En fonction du client, s’il présente un tempérament aventureux ou non, nous disposons d’outils très différents. » Cette réelle liberté peut aussi être source d’angoisse.
Certaines organisations affichent que chacun fait ce qu’il veut mais doit consulter ceux que sa décision affecte (FDM, Lippi, Chrono Flex). Julien Lippi l’explicite ainsi : « Si quelqu’un voit la possibilité d’améliorer quelque chose dans son travail sans que cela ait d’impact sur qui que ce soit, il n’a pas à demander de permission. C’est le principe “je vois, je fais”. » Mais dans tous les autres cas, c’est-à-dire chaque fois qu’une décision peut avoir un impact sur au moins une autre personne, elle est soumise à consultation et doit être prise de façon collective. De même, une décision peut être prise au niveau d’une équipe sans en référer à des échelons supérieurs dans la mesure où elle n’a pas d’impact sur le reste de l’entreprise.
Cette restriction reste cependant assez floue : à partir de quand ma décision de travailler de chez moi affecte-t-elle mes collègues qui, de ce fait, ont moins de facilité à interagir avec moi ? À partir de quel montant le fait d’engager une dépense a-t-il un impact sur les comptes de l’entreprise ?
Droit à l’erreur, droit à l’initiative
Le corollaire du droit de décider est, en bonne logique, le droit de se tromper. Les entreprises parlent beaucoup d’un droit à l’erreur, mais ceux de nos interlocuteurs qui l’évoquent sont parfois en peine de nous en donner des exemples.
Plutôt que de droit à l’erreur, certains dirigeants préfèrent parler du droit d’expérimenter ou du droit à prendre des initiatives, sans crainte de sanction si l’initiative se révèle malheureuse ou si l’expérimentation n’est pas concluante. L’erreur en tant que telle est rarement encouragée ou valorisée. En revanche, il est important que celui qui se rend compte qu’il a fait une erreur pouvant affecter la qualité de la prestation ou compliquer le travail des autres puisse le signaler sans crainte. Il est important aussi que l’organisation apprenne des erreurs de chacun… Une salariée de Lippi se souvient, par exemple, d’une gestionnaire de la flotte téléphonie « qui s’était laissée convaincre par l’argumentaire d’un opérateur et avait changé de contrat pour l’ensemble de l’entreprise, ce qui entraînait un surcoût de 30 %. Au lieu de la sanctionner, nous avons lancé un contentieux contre l’opérateur. C’était inutile de la punir car, quand on a fait une fois une erreur de ce genre, on ne la refait plus pour le reste de sa vie. »
Augmenter la marge de manœuvre de chacun, c’est le laisser apprécier s’il doit solliciter les conseils du management ou des spécialistes fonctionnels, plutôt que de demander des validations a priori. C’est donc accepter des décisions différentes de celles qu’auraient prescrites ou conseillées le management ou le spécialiste.
Droit de donner un avis ou de participer à la délibération
Il est parfois inopportun qu’un agent au savoir limité prenne des libertés avec les procédures, même s’il découvre des imperfections ou imagine des améliorations ou des simplifications. On ne souhaite pas qu’un pilote d’avion de ligne, un conducteur de TGV ou de centrale nucléaire prenne des initiatives contraires aux consignes car il ignore peut-être l’une des raisons de celles-ci. En revanche, il est important qu’il existe des espaces lui permettant de faire des suggestions d’amélioration, y compris d’avouer des erreurs qu’il a faites et qui auraient pu être évitées en changeant l’ergonomie du poste de travail8.
Dans l’expérience faite à Flins (Bonnefond, 2019), les opérateurs de Renault discutent de la manière de réaliser une tâche donnée (par exemple, l’insertion des joints dans les supports des vitres) et se mettent d’accord sur les meilleures manières de faire, qui n’étaient pas toujours celles initialement envisagées ou prescrites par le bureau des méthodes. Leurs discussions peuvent conduire à réviser les gammes d’assemblage, par exemple à utiliser une vis là où les ingénieurs pensaient plus judicieux de prévoir un rivet9.
L’opérateur ne connaît pas tous les éléments et toutes les contraintes qui conduisent à choisir une méthode de production plutôt qu’une autre et cette décision ne lui est donc pas confiée. Mais son expérience permet d’améliorer les méthodes de production en révélant des aspects inconnus de l’ingénieur qui conçoit celles-ci. Lui permettre de participer à la délibération sur les procédures et à la construction de la prescription (Clot, 2019) est une reconnaissance de son savoir. Il n’impose pas sa norme (autonomie), mais il ne subit pas celle d’un autre (hétéronomie), il participe à la construction de la règle qu’il suivra.
C’est ce qui se passe aussi à l’échelon collectif lorsque, dans les organisations sociocratiques ou holacratiques (voir chapitre 1), les employés construisent ensemble – et révisent au besoin – les règles définissant par exemple les obligations de présence (droit au télétravail mais présence à certaines réunions) ou les astreintes et congés pour organiser la continuité de service d’une manière satisfaisante. Par exemple, chez FDM, les règles ont été définies à l’issue d’ateliers de réflexion en 2017, elles sont désormais consignées dans un livret de présentation de l’entreprise – qui sert aussi de livret d’accueil pour les nouveaux arrivants – mais elles sont évolutives. Lors de la réunion générale hebdomadaire, chacun peut présenter des suggestions d’amélioration des procédures et le livret est régulièrement mis à jour, en temps réel, sur l’Intranet et plusieurs fois par an sous sa forme imprimée.
Droit de vote et droit de veto
Un salarié peut être invité à délibérer sur une décision qui affecte le groupe, voire plus rarement à voter si les avis sont partagés. Un pouvoir plus important encore est le droit de veto, c’est-à-dire la capacité d’empêcher qu’une règle qui émerge par consensus de la majorité s’applique si quelqu’un juge qu’elle ne lui convient pas. Ainsi, chez FDM, chaque équipier peut s’opposer à une proposition de règle. Mais s’il s’est abstenu de s’exprimer, il doit alors se soumettre loyalement à la décision prise en groupe selon le principe disagree and commit10. Dans les organisations holacratiques, une tension non réglée dans un cercle est transférée au cercle supérieur (ce qui équivaut à un droit de veto local, déclenchant une procédure d’appel).
En pratique, même lorsque chacun dispose formellement du même droit de délibération et qu’il n’y a pas de chef auquel est reconnu le droit d’arbitrer en cas d’absence de consensus, chacun n’usera pas toujours librement de son droit d’opposition. Certains se sentiront spontanément moins légitimes et n’useront pas de leur droit de veto. « Je sais que je peux théoriquement m’opposer à une décision, mais je n’ai pas la même autorité que les membres les plus expérimentés de l’équipe et je ne veux pas paraître prétentieuse en m’opposant à leur décision », nous a confié une jeune collaboratrice.
Droit de retrait
Certaines organisations offrent à ceux qui souhaitent moins d’autonomie ou de responsabilité la possibilité de ne pas souscrire aux nouvelles règles, de continuer à pointer, de renoncer aux éléments de rémunération liés à la performance collective pour sécuriser une meilleure rémunération garantie ou la reconnaissance de leur ancienneté. Il est souvent instructif de demander comment sont traités ceux que la transformation n’enthousiasme pas. Certaines organisations encouragent ces rabat-joies à quitter l’entreprise, d’autres ont à cœur de leur trouver une affectation compatible avec leurs attentes. Le poids des syndicats et des institutions représentatives du personnel peut être important pour assurer un traitement favorable des objecteurs.
Car c’est une forme d’autonomie que de refuser certaines modalités de l’autonomie et de ne pas partager toutes les préférences des membres du groupe. On risque sinon de se trouver dans la situation de l’abbaye de Thélème de François Rabelais, dénoncée par André Glucksmann (1977). Dans cette entreprise libérée médiévale, la règle « fay ce que vouldras » débouche sur le bonheur commun « parce que les gens libres, bien nés, bien instruits, conversant en compagnie honnête, ont par nature un instinct et un aiguillon, qui toujours les poussent à accomplir des faits vertueux et les éloignent du vice ». Plus précisément, « Grâce à cette liberté, ils entrèrent en louable émulation de faire tous ensemble ce qu’ils voyaient plaire à un seul. Si l’un ou l’une d’entre eux disait : “Buvons”, tous buvaient ; s’il disait : “Jouons”, tous jouaient. S’il disait : “Allons nous ébattre aux champs”, tous y allaient. ». Mais qu’advient-il de ceux qui n’ont nulle envie, en dépit de la « louable émulation », de faire ce qu’ils voient plaire aux autres, qui ne désirent pas boire lorsque des membres influents du groupe ont soif ou jouer en même temps qu’eux au même jeu ? Certains employés parlent des entreprises libérées comme de sectes dans lesquelles on s’engage, en prêtant serment à un patrongourou (#MEcrEants, 2016 et Bourdu et al. (dir), 2019). L’autonomie du groupe ne doit pas se traduire par l’asservissement des individus. « Encourager l’autonomie ne revient pas à contraindre les équipes à devenir autonomes du jour au lendemain », précise Quentin Druart, alors DRH au ministère belge des transports.
Pouvoir de contrôle
Dans l’autonomie, que reste-t-il du contrôle ? La question du pouvoir de contrôle est souvent assez révélatrice de la nature de la transformation et de son niveau de maturité.
Contrôle hiérarchique. Certaines organisations maintiennent le contrôle hiérarchique. Celui-ci peut être une forme de résidu de l’ancienne organisation qui a du mal à disparaître. Par exemple, certains managers n’hésitent pas à présenter le contrôle comme un accompagnement transitoire vers l’autonomie : « Lorsqu’un dossier est traité, il faut instituer […] des validations quand c’est nécessaire. Nous estimons qu’au regard de l’activité, il ne faut pas se tromper et qu’en tant que managers, nous avons un droit de regard. Ce suivi permet aussi la montée en compétences » (CPAM 78). D’autres formes de contrôle peuvent être parfaitement justifiées, par exemple dans les organisations devant faire face à d’importantes contraintes sécuritaires (hôpitaux, produits et métaux dangereux, aviation civile, nucléaire, pharmacie, agroalimentaire)…
D’une façon générale, l’autonomie ne signifie pas l’absence de contrôle, mais un changement dans la nature du contrôle.
Contrôle du travail par les pairs. Certaines organisations ne renoncent pas au contrôle, mais expérimentent le contrôle par les pairs sur une base tournante (CPAM 78) ou par ceux qui jouent le rôle de mentor au sein de l’équipe.
Contrôle par les procédures. Chez Chrono Flex, par exemple, les techniciens doivent suivre toute une panoplie de procédures en amont et en aval, lorsqu’ils procèdent à une intervention chez un client – ces procédures peuvent cependant être révisées périodiquement par les équipes elles-mêmes. À la fin, ils remplissent un rapport d’intervention informatisé qui déclenche la facturation et Chrono Flex demande au client un retour de satisfaction sur l’intervention. Il y a donc une forme de triple contrôle : par les procédures à respecter, par les rapports figurant dans le système d’information et par les clients.
Contrôle par la médiation du collectif. Dans les organisations où il n’y pas de contrôle explicite, il n’y a pas officiellement de régulation de la déviance. Lorsqu’un problème apparaît, la méthode consiste à convoquer un groupe de travail pour redéfinir collectivement les règles (FDM, Lippi). En cas de conflit persistant, il y a une médiation, et en cas d’échec, la question est soumise à l’arbitrage de la direction.
Contrôle social et autocontrôle. Certaines structures comptent sur le contrôle social ou sur l’autocontrôle induit par la pression sociale pour réduire le nombre de «passagers clandestins ». Cet argument a, par exemple, été évoqué par la direction de FDM, qui compte sur la pression du groupe pour qu’un sens de la juste mesure se généralise, par exemple au niveau des prises de congés. Pour une collaboratrice de Lippi, « On est passé d’une hiérarchie verticale à une hiérarchie horizontale. Avant, on rendait compte à notre responsable. Maintenant, on est contrôlé par tout le monde. » Et elle ajoute avec un clin d’œil : « C’est pire, hein ? ». Selon elle, comme tout est transparent et que tout le monde a son mot à dire, chacun est poussé à s’autoréguler, ce qui est bien plus efficace qu’un contrôle par les pairs et, a fortiori, qu’un contrôle hiérarchique. Pour une autre collaboratrice de Lippi, cette forme de contrôle n’est pas une surveillance mais l’expression d’une solidarité, favorisée par l’organisation des bureaux en open space : « Comme on est en open space, on se voit tous, et à la façon de répondre ou à l’attitude, on comprend très vite si quelqu’un ne va pas bien ou rencontre des difficultés. Dans ce cas, on va discuter avec lui. […] Cela nous permet de prendre soin les uns des autres ».
- 1. Le terme d’état d’esprit revient souvent dans les témoignages. On parle ainsi de « l’esprit agile » ou de changement du mindset .
- 2. Voir l’index de distance hiérarchique de Geert Hofstede permettant de classer différents pays (Bourdu et al ., 2016, p. 141).
- 3. Pour Clot, l’autonomie consiste à participer à la construction de la prescription (2019, p. 112).
- 4. Ces motivations ressortent notamment du discours de ceux qui souhaitent continuer à pointer ou ne pas faire usage de leur droit au télétravail. Nous ne citons pas toujours les entreprises pour respecter l’anonymat de nos sources.
- 5. Voir dans le point de vue de Clémentine Marcovici (p. 139) une description de l’aspect manipulatoire de cette injonction paradoxale : « tu n’es pas assez autonome, c’est pourtant simple, fais simplement ce que j’attends de toi, j’attends de toi que tu sois autonome ! ».
- 6. Ce phénomène est d’ailleurs observé dans les tribus primitives, où l’on a mis en évidence une corrélation significative entre l’autonomie d’un groupe et les moyens qu’il a de manipuler les orientations cognitives de ses membres et d’en contrôler les déviances (March, 1953).
- 7. Particulièrement populaire en ces temps de loi PACTE (article 1835 du code civil : « Les statuts peuvent préciser une raison d’être , constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité »). Voir aussi Errol Cohen (2019) et Blanche Segrestin et Stéphane Vernac (2018).
- 8. Des pilotes ont ainsi indiqué avoir confondu deux indicateurs de paramètre de vol à l’aspect trop semblable et trop proches physiquement sur leur tableau de bord. Il a alors été décidé de modifier la couleur d’un des cadrans et l’aspect de l’aiguille pour limiter le risque de confusion. Voir March et al. , 2003.
- 9. Poser un rivet est en général plus facile et rapide que de visser une vis. Un ingénieur de conception aura donc tendance à prévoir des rivets lorsque c’est suffisant. Mais l’ingénieur du bureau d’études n’a lui aussi qu’une vision partielle de la gamme de production mise au point par son collègue du bureau des méthodes. Si un même opérateur doit dans la même séquence d’opérations visser des vis et poser des rivets, le temps perdu à changer d’outil (poser la visseuse, attraper la riveteuse) peut rendre l’opération plus pénible que de tout fixer par vis.
- 10. Principe de management en vogue dans la Silicon Valley, selon lequel chacun donne son avis pendant le processus de prise de décision, mais applique ensuite loyalement la décision prise même s’il s’y était opposé.
Quelques instruments de gestion de l’autonomie
Ce chapitre est consacré à l’instrumentation de l’autonomie, c’est-à-dire aux dispositifs de gestion grâce auxquels des marges de manœuvre sont effectivement concédées aux collaborateurs et/ou aux équipes, tout en répondant aux nécessités de la coordination. C’est surtout la diversité des mécanismes et des objets qui est remarquable, illustrant ainsi la thèse de Laloux selon laquelle les processus d’autonomisation sont profondément contingents : « Chaque entreprise parcourt un chemin qui n’appartient qu’à elle et nécessite une approche qui lui est propre » (2014/2015, p. 383). Une grande place est donnée à l’expérimentation qui permet de découvrir des façons de procéder plus efficaces. Notons que la nature des règles et dispositifs de gestion ne nous dit rien a priori sur la qualité de la concertation. Ceuxci peuvent avoir été décidés et modifiés de façon plus ou moins collective, ou à l’initiative de la direction.
Nous insistons ici sur les pratiques originales ou émergentes.
Gestion du temps et du lieu de travail
Le télétravail ainsi qu’un accroissement de la liberté de gestion des horaires représentent généralement des chantiers phares de la transformation. La plupart des entreprises se concentrent surtout sur la définition des règles de base permettant d’assurer la continuité de service (temps de présence obligatoire, nombre de jours autorisés), puis laissent les équipes s’autoréguler sans procédure de demande d’autorisation préalable. La bonne foi est généralement présumée dans la gestion de ces aspects, les contrôles n’étant réintroduits qu’en cas d’abus manifestes et répétés. Fréquemment, les entreprises témoignent en phase initiale d’une certaine tolérance aux passagers clandestins. Mais quand la confiance est durablement rompue, le retour de bâton peut s’avérer sévère pour les tricheurs. Un salarié de Lippi témoigne : « On fait tellement confiance que, parfois, on a du mal à ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas. Du coup, quand on finit par s’en rendre compte, la déception est très grande et ça peut se terminer par une mise à pied ou même un licenciement. »
Certaines entreprises sont allées plus loin, en réfléchissant aux conditions d’une « déspatialisation» vraiment réussie. Des outils sont alors mis en place pour permettre aux collaborateurs de travailler de la même manière depuis n’importe où : dématérialisation systématique de tous les documents, fourniture d’équipements de qualité à chaque collaborateur (téléphone et ordinateur portables), emplois du temps connectés et plateformes de travail collaboratives (Yammer, Google+, etc.). Une bonne connexion Internet est requise des collaborateurs et des temps de présence et de rassemblement sont obligatoires pour maintenir le lien à l’entreprise et l’esprit d’équipe.
Prospection commerciale et relation client
La prospection commerciale est majoritairement affectée à un service transverse (business développement, direction commerciale, comité stratégique) et donc située hors du champ des équipes autonomes. Mais une fois le client attribué à une équipe, celle-ci pourra être en charge de suivre et d’entretenir la relation avec le client (FDM). Certaines entreprises intègrent davantage à l’équipe tout ou partie de la fonction commerciale. C’est le cas chez Chrono Flex où le poste de technicien itinérant inclut une dimension « prospection de nouveaux clients » et « fidélisation des clients » puisque ces derniers peuvent contacter directement leur technicien sans passer par le standard. 25 équipes de techniciens sur 32 disposent en outre d’un technico-commercial. Le technico-commercial a pour mission d’assurer la prospection de nouveaux clients sur le territoire affecté à l’équipe mais surtout d’accompagner les techniciens dans leurs visites pour les former à cet exercice.
Nous avons eu écho de situations où les objectifs de satisfaction client sont entrés en contradiction avec l’accroissement de l’autonomie des équipes. Par exemple, certains clients réticents au changement d’organisation préfèrent continuer d’interagir avec la hiérarchie et réclament de parler à un « responsable » (A**, FDM). Dans ces cas, la consigne est claire : la satisfaction du client prime sur l’autonomie. Dans ce type de situations, soit le modèle hiérarchique (quand il existe encore) reprend tous ses droits, soit un membre de l’équipe ou de la direction joue ce rôle à l’égard du client – même s’il ne l’exerce pas en interne – plutôt que de perturber celui-ci en lui expliquant qu’il n’y a plus de responsable parce que tout le monde l’est. Ledit responsable n’interviendra pas forcément par la suite sur le processus de production.
Ce cas de figure peut générer quelques incohérences occasionnelles ou être perçu comme un double discours. Mais ce sentiment pourra être contourné si l’entreprise offre d’autres zones de responsabilité ou de prise d’initiatives : « Si un collaborateur se sent fortement contraint face à un client X, il pourra très certainement faire preuve de plus d’autonomie avec un autre client ou s’impliquer dans un groupe de travail » (A**).
Droit d’engager des dépenses courantes
Chez FDM, il est dit dans le handbook que « personne n’a à valider les dépenses professionnelles courantes ». Ce qui comprend les frais d’alimentation, de transport et d’hébergement contractés dans un cadre professionnel. Il n’y a pas de montant de référence mais seulement une invitation à consulter les avis des autres membres de l’agence en cas de doute sur la justification d’une dépense. D’autres entreprises fixent des seuils qui sont connus de tous.
Dans beaucoup d’entreprises, les opérateurs et techniciens ont désormais le droit d’acheter les petites fournitures qu’ils jugent pertinentes. Tel dépanneur pourra aller à la quincaillerie voisine acheter ce dont il a besoin en sachant qu’on le remboursera sans lui faire remarquer que l’entreprise dispose éventuellement de réductions contractuelles chez un fournisseur. Libre à lui de payer plus cher pour disposer immédiatement d’une fourniture sans avoir à constituer un stock de sécurité coûteux ou encombrant. « Depuis la transformation, je peux décider d’acheter du matériel nécessaire à l’accomplissement d’une mission de mon propre chef et sans craindre de ne jamais être remboursé, commente un technicien chez A**. Je me souviens d’un cas où j’hésitais à me procurer des câbles réseaux d’une valeur modique de cinquante euros sans avoir obtenu l’aval de mon manager. Aujourd’hui, je ne fais plus attendre un client si je suis à cours de matériel, car je sais que mes notes de frais seront de toute façon remboursées ». C’est une façon de valoriser l’initiative individuelle dans le service rendu au client.
Conduite de réunions
Y a-t-il plus ou moins de réunions dans une entreprise favorisant l’autonomie ? Si l’autonomie individuelle et des règles claires permettent de décider seul sur certains points, donc d’économiser des interactions, des délibérations collectives plus fréquentes sur ce qui est approprié en suscitent.
Nous avons constaté que l’autonomisation accroît le besoin de concertation des membres de l’entreprise, puisque la coordination n’est plus (ou est moins) assurée par la hiérarchie. En outre, le processus de transformation luimême se veut souvent participatif, ce qui nécessite une multiplication des rencontres et des groupes de travail. Enfin, l’apprentissage des méthodes collaboratives présuppose de se retrouver ensemble. Il y a donc une phase de la transformation dans lesquelles le nombre de réunions augmente considérablement : certains salariés, en particulier l’encadrement, jugent même parfois que trop de temps est dédié à la « parlote » au détriment de la conduite des opérations. Ce n’est que dans un second temps que la « réunionite » institutionnalisée tend à décroître, lorsque les salariés ont appris à se parler et à se coordonner dans cet « espace de la conversation » auquel Frédéric Lippi fait souvent référence. Chrono Flex indique ainsi que plusieurs types de réunions qui avaient initialement été installés se sont révélés inutiles ou inefficaces dans la durée et ont été supprimés au profit d’autres modalités de coordination.
On constate surtout au sein de l’échantillon que les réunions tendent à changer de nature. Il y a davantage de groupes de discussion transversaux (inter-services) et horizontaux (sans considération de hiérarchie) : depuis les cercles de la gouvernance adaptative chez GEN aux cellules projets chez A** (portant sur des thématiques comme le droit à l’erreur, la déspatialisation, etc.), en passant par les groupes d’innovation participative à la CPAM 78.
Cette ouverture s’effectue de deux façons : dans certaines structures, les réunions sont ouvertes à tous sur la base du volontariat, c’est-à-dire en fonction de l’intérêt des collaborateurs pour la thématique couverte ; dans d’autres, la composition du groupe vise à réunir des compétences-clés : chez GEN, toutes les compétences nécessaires à la réalisation d’un projet sont conviées au cercle agile correspondant et les personnes se voient attribuer un rôle dans le cercle en fonction de leur expertise.
Il est important de souligner que la création d’un espace de parole à l’esprit plus ou moins démocratique ne suffit pas à la prise de parole effective de tous. Les organisations que nous avons analysées l’ont bien compris, au vu des efforts qu’elles mènent pour encourager la participation, tout en préservant l’efficacité de la réunion. Deux pratiques ressortent pour favoriser l’équité de la participation : la définition de règles qui cadrent la réunion (par exemple, chez GEN, une tension – au sens de l’holacratie – doit être résumée en deux mots pour être incluse à l’ordre du jour), et la présence d’un facilitateur, figure neutre chargée, entre autres, de garantir une circulation équitable de la parole.
Malgré ces efforts, un certain nombre d’obstacles à la participation persistent. Tout d’abord, l’excès de règles peut venir entraver le flux de parole naturel. Plusieurs collaborateurs chez GEN se sont plaints de la rigidité excessive de la gouvernance adaptative. À tel point que le formalisme des réunions dites de gouvernance1 a tendance à être contourné en pratique : « Nous n’avons pas le temps de potasser les centaines de pages du document [la charte de la gouvernance adaptative rédigée par le cabinet de conseil accompagnant la transformation] et d’appliquer tous les principes prévus pour les réunions de gouvernance », explique un collaborateur de GEN. L’obligation de résumer son sujet en maximum deux mots (par exemple « structure organisationnelle ») pour l’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion tactique a été jugée particulièrement contraignante par une majorité des collaborateurs interrogés, tout comme la difficulté à répondre du tac au tac : la tension est d’abord présentée en détail par celui qui la soulève, avant que celui-ci ne l’adresse à un rôle, c’est-à-dire à un membre précis du cercle, qui est alors libre d’accepter ou non de répondre et de proposer des pistes de solution.
Parmi les autres obstacles récurrents, nous citerons la pression sociale et l’intériorisation de l’autorité. La peur du regard des autres tend en effet à produire de l’autocensure, ce qui entraîne une discussion appauvrie ou hypocrite : « Certains trucs pourris ne sont pas encore mis sur la table En même temps, personne n’a envie de pointer du doigt ses pairs
« dans 5 à 10 % des cas, la présence de la hiérarchie empêche toujours une partie des collaborateurs de faire remonter certaines frustrations ou tensions ». Certains managers ont aussi du mal à adapter leur posture et continuent à donner des ordres au sein des groupes de travail dans lesquels, en principe, la notion de hiérarchie n’a plus sa place.
Le temps peut permettre de résorber ces difficultés initiales, lorsque collaborateurs et managers intériorisent le nouveau mode de fonctionnement plus horizontal. Au vu de la prégnance des schémas mentaux dont chacun hérite malgré soi, les coachings dédiés à la pratique de la concertation et à la gestion des conflits se multiplient : « Que nous devenions plus agiles ou non, il est tout aussi important de cultiver un mode de gestion harmonieux » souligne un manager. Et si c’était justement en cela que résidait la clé de l’agilité !
Pouvoir de recruter
Certaines structures placent le recrutement parmi leurs « zones rouges », celles qui n’entrent pas dans la sphère d’autonomie des équipes. C’est notamment le cas des organisations qui s’insèrent dans un système bureaucratique plus large comme le ministère belge des Transports ou GEN chez Orange. Ces structures ne remettent pas en cause leurs procédures d’embauche qui sont gérées de manière traditionnelle et centralisée. A contrario, on notera le cas de la CPAM 78 qui a promu une expérimentation dans l’un de ses services : les salariés du service réclamations peuvent se porter volontaires pour participer aux entretiens d’embauche ainsi qu’au choix du candidat final.
Dans les autres cas, les RH évoluent vers un rôle de véritable support : le service devient une instance de consultation au cours du processus de recrutement qui est géré par les équipes ou par un collectif de salariés et conserve un rôle d’arbitre ou de codécideur au moment de la décision finale. Un exemple va plus loin : chez Lippi, le dernier mot revient à un comité de recrutement composé de six salariés, issus du service demandeur et d’autres services qui seront amenés à travailler avec la future recrue (dont les RH). Après avoir rencontré trois candidats présélectionnés par les RH et le service demandeur, ce comité débriefe collectivement les points forts et faibles de chaque candidat, avant de prendre une décision commune. Il n’y a pas d’arbitre en cas de désaccord et la décision se prend par consensus et non à la majorité : « Il faut que les autres arrivent à nous convaincre », explique un chargé de mission RH.
Nous ne connaissons qu’un cas où la fonction Recrutement avait été supprimée : chez Favi, les équipes pilotaient le processus et la décision d’embauche de façon parfaitement autonome.
Fixation des objectifs
Si les équipes sont autonomes et sans management, qui fixe alors les objectifs à l’équipe et aux individus au sein de l’équipe ?
Chez FDM, l’agence ne définit pas une liste d’objectifs précis pour chaque squad et n’établit pas de classement entre les squads. Seul un objectif global de croissance et de rentabilité est déterminé annuellement. La direction constate néanmoins un phénomène « d’émulation ou de compétition saine » entre les squads : « Des profils bons élèves ont tendance à se dessiner. Personne n’a envie de faire partie d’une squad moins performante, l’objectif global et les résultats des squads étant connus de tous ». Les squads définissent ainsi leurs propres objectifs, mais sur la base des ambitions générales. Au niveau individuel, chacun est poussé à définir ses propres objectifs à travers des roadmaps, en se fixant des objectifs à court et long terme. Chaque personne peut se faire aider dans ce processus par son mentor, attribué lors de l’arrivée puis choisi annuellement.
Chez A**, les objectifs individuels quantitatifs ont été éradiqués. Les objectifs découlent directement des attentes de la clientèle et sont aujourd’hui de nature plus collective.
La SCOP Ardelaine fonctionne quasiment sans objectifs : « Même les commerciaux n’en ont pas ». Chaque département est libre de définir ses objectifs et en discute collectivement sur la base d’indicateurs tels que le compte de résultat, le chiffre d’affaires de l’année précédente ou l’évolution de la masse salariale. Par allers-retours successifs entre chaque département et l’équipe de gestion, les objectifs de l’organisation émergent sans procédure précise et prennent corps au moment de la préparation de l’assemblée générale. Le seul véritable objectif est manifestement d’arriver à l’équilibre, voire de le dépasser un peu, de façon à offrir à chacun une petite prime d’intéressement qui, certaines années, peut représenter jusqu’à un 13ème mois. En aucun cas, cet objectif général ne se traduit par des objectifs individuels.
Méthodes d’évaluation
Les entretiens d’évaluation classiques persistent dans certaines organisations : par exemple, avec un mentor choisi par le salarié chez FDM ou le manager chez GEN.
Cependant, l’évaluation par les pairs ainsi que l’auto-évaluation prennent une place de plus en plus importante. Un consensus semble émerger en faveur de l’outil connu sous le nom de feedback 360°2 : la performance du salarié est évaluée à 360° dans le cadre d’un questionnaire rempli par des collègues, des supérieurs et des clients3. Parfois les pairs évaluateurs peuvent être librement choisis par le salarié. L’évaluation par les pairs ouvre le risque de favoriser les salariés les plus consensuels. Toutefois, les forces et faiblesses de chacun sont assez honnêtement et efficacement identifiées par les répondants. Cette dérive peut également être contrée par une fréquence élevée d’évaluations : chez FDM par exemple, la distribution est relativement uniforme, puisque chacun évalue une douzaine de personnes par an (trois tous les trimestres). L’absence de feedback pour un collaborateur sera à juste titre perçue comme un signal d’alarme par la direction.
L’auto-évaluation gagne également en popularité, car elle peut servir de vecteur de responsabilisation. Le dirigeant d’A** explique qu’une grille d’autonomie a été définie pour encourager la rétrospection et permettre aux collaborateurs de progresser : pour chacun de leurs rôles (c’est-à-dire aussi bien pour leur activité de base que pour leurs autres rôles, par exemple, de délégué du personnel ou de capitaine d’une cellule, etc.), les collaborateurs sont ainsi invités à déterminer leur niveau d’autonomie4, mais cette auto-évaluation n’a pas d’impact sur la rémunération. Chez Chrono Flex, la grille d’auto-évaluation porte sur le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-voir (regard humain au-delà du masque professionnel, projection à long terme, créativité), ainsi que le savoir-animer pour les team leaders.
Une méthode intéressante consiste à combiner et pondérer l’auto-évaluation par l’évaluation des pairs, ces éléments pouvant in fine servir de supports lors de l’entretien de fin d’année mené classiquement avec un « manager » (quel que soit le nom qu’on lui donne). À condition toutefois que tout le monde sache clairement que ces outils seront transparents et utilisés à des fins d’évaluation. Ces instruments peuvent, en effet, véhiculer des ambiguïtés et engendrer des tensions, s’ils sont présentés comme des outils réflexifs et « désintéressés » au service de la progression personnelle, mais en réalité connus des managers et participant à l’évaluation annuelle et aux décisions d’augmentation.
Rémunérations, augmentations
La plupart des organisations de notre échantillon optent pour une politique de non transparence concernant les salaires au nom de l’intérêt collectif. Le dirigeant d’A** explique avoir fait le choix de la non transparence pour ne pas exacerber la concurrence entre les collaborateurs et préserver l’esprit d’équipe. Dans un cas, la transparence des salaires avait été proposée mais elle semble avoir été refusée par une majorité de salariés (Chrono Flex). Dans notre échantillon, nous n’avons aucun cas où le salaire du dirigeant serait connu, à l’exception des deux SCOP, mais nous savons qu’il en existe.
La participation et l’intéressement sont de règle dans la plupart des entreprises quand les résultats le permettent.
Les augmentations sont dans la plupart des cas décidées de façon traditionnelle (indice d’inflation, résultats de l’entreprise, évolution de poste, résultats de l’évaluation). Quelques pratiques originales existent cependant.
À titre d’exemple, chez FDM, il existe un système de progression automatique d’un rang tous les ans et cette progression entraîne une augmentation d’environ 5 % par an. Le passage de rang est confirmé au moment de l’évaluation annuelle si aucun directeur ne s’y oppose. L’échec à un passage de rang entraîne un programme de soutien personnalisé conduisant à un nouveau passage ou à « l’étude d’autres options ». Ce système évite les tensions à court terme, en supprimant les négociations salariales, mais peut en créer à plus long terme : les hauts potentiels qui progressent vite peuvent avoir le sentiment de ne pas être suffisamment reconnus. Il y a aussi des cas d’abus dont la direction de FDM est parfaitement consciente : il existe quelques passagers clandestins qui profitent du système en sachant que l’augmentation est quasiment garantie à la fin de l’année.
Chez Chrono Flex, la répartition de la part collective des augmentations est décidée par chaque équipe sur la base d’une enveloppe prédéterminée par la direction, dont le montant est proportionnel au nombre d’équipiers. La répartition est décidée collectivement mais pas forcément égalitairement. La répartition est ensuite publique.
Une entreprise a mentionné une expérimentation où chaque membre d’une équipe désigne ou vote, selon certaines règles et critères (par exemple, les collaborateurs les plus engagés au service de la vision de l’entreprise), pour deux candidats aux augmentations au sein de l’équipe. Les noms sont ensuite transmis à un « comité des sages » comprenant la direction des ressources humaines et des membres élus qui statuent sur l’augmentation, en prenant en compte le niveau de salaire, l’historique d’augmentation et les résultats du processus d’évaluation. Cette méthode, qui avait pourtant été co-construite avec les salariés, a été abandonnée, car l’objectivité du « comité des sages » ne paraissait pas garantie.
L’existence de primes individuelles peut susciter des tensions entre la reconnaissance du collectif et la valorisation de l’individu. A** expérimente actuellement une prime d’investissement visant à valoriser l’implication individuelle des salariés. Cette prime s’obtient par une auto-évaluation du salarié pondérée par N avis extérieurs de son choix, qui aboutit à une note correspondant à une grille d’augmentation. Chez Chrono Flex, certains collaborateurs déploraient le climat de concurrence induit par l’existence des primes individuelles : certains avaient tendance à « la jouer perso », en gardant pour soi les clients les plus « juteux » ou en refusant les interventions qui ne rapportent pas grand-chose pour se consacrer à celles qui paient bien. Cela a conduit les équipes, en 2018, à mettre au point un nouveau système de rémunération qui gomme en partie les effets individualistes du système qui avait été décidé en 2013.
Attention cependant à ne pas négliger la dérive inverse : certaines mesures « collectivistes » peuvent aussi peser sur les individualités comme nous l’avons vu avec l’augmentation automatique chez FDM. Notons que les entreprises de l’échantillon utilisent souvent d’autres mécanismes de reconnaissance que la seule rémunération (attribution de points donnant droit à des avantages tels que chèques-vacances, séances de sport, dons à des associations, etc.).
Mobilité horizontale
La mobilité horizontale est une façon de répondre à la faible possibilité de progression hiérarchique, résultant d’organisations aplaties. Dans plusieurs entreprises de notre échantillon, les personnes sont vivement encouragées à changer d’activité ou à occuper de nouveaux rôles dans l’organisation à travers la participation aux nombreux cercles transverses de responsabilité, souvent en plus de leur job de base. Dans ce deuxième cas, il ne s’agit pas vraiment de mobilité, mais d’enrichissement de son travail ou de son rôle au sein de l’entreprise.
Chez Lippi, environ 25 personnes changent de poste chaque année, soit 15 % de l’effectif, ce qui est considérable. Ces mobilités se font souvent sur des fonctions adjacentes mais parfois aussi sur des métiers complètement différents. Ainsi, une ancienne hôtesse d’accueil gère aujourd’hui le service clients. Une autre qui avait été recrutée en tant qu’opératrice dans l’atelier de fabrication a aussi rejoint le service client. Ce qu’elle apprécie chez Lippi, c’est « qu’on ne cloisonne pas les gens dans une case. Alors que je venais de la production, on ne m’a pas empêchée d’aller dans les bureaux. En fin de compte, n’importe qui peut évoluer ». De même, un salarié qui travaillait à la logistique a pu, à l’âge de cinquante ans, rejoindre l’équipe commerciale. Pour lui, c’était un défi : « Je n’ai pas fréquenté longtemps l’école et je n’ai qu’un CAP. Je voulais me prouver à moi-même que j’étais capable de changer de métier ». L’an prochain, cela fera cinq ans qu’il occupe ce poste, et il a prévu de faire le point pour voir s’il continue ou s’il change à nouveau de métier… Aucun salarié de Lippi qui souhaitait changer de poste ne s’est jamais vu opposer une fin de non recevoir.
Dans d’autres entreprises, les perspectives d’évolution et de changement concernent la possibilité de changer d’équipe, mais aussi de prendre une responsabilité au sein d’un cercle ou d’une cellule ad hoc, de participer à des groupes de travail ou encore, d’acquérir de nouvelles compétences (voir ci-dessous) pour devenir capitaine ou team leader (à condition d’être coopté ou élu), formateur ou facilitateur, ou encore référent sur une compétence au sein d’une équipe autonome (référent Commerce, Recrute- ment ou Sécurité chez Chrono Flex). Selon les entreprises, ce type de « mobilité » ne donne pas systématiquement lieu à une augmentation de rémunération. De même, les formations qui permettent d’assurer ces montées en compétences sont parfois présentées en elles-mêmes comme des opportunités ou des témoignages de confiance – « gagnant pour le salarié, gagnant pour l’entreprise » selon un dirigeant – ce qui est loin d’être systématiquement partagé par tous les salariés.
Formation
Les organisations de notre échantillon affirment beaucoup investir dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Le budget formation est en général un indicateur intéressant à prendre en compte pour vérifier cette affirmation : par exemple, chez A**, ce montant s’élève à 7 % de la masse salariale pour une soixantaine de personnes (le taux légal de base étant de 1,6 % pour les entreprises de 20 salariés et plus) ; chez Lippi, les employés ont suivi vingt mille heures de cours sur le numérique entre 2008 et 2010 pour environ 180 personnes – l’équivalent de 750 000 euros, largement pris en charge par la Région et l’État en raison des risques qui pesaient sur l’emploi à l’époque. Nous n’avons pas pu documenter suffisamment l’aspect chiffré pour pouvoir affirmer que toutes les entreprises de notre échantillon forment effectivement davantage que les autres.
Difficile de constater une homogénéité quant à la nature des formations proposées au sein de l’échantillon : le spectre en est très large.
Pour résumer, il existe d’abord des formations métiers liées à l’adaptation des compétences techniques et technologiques, ce qui ne diffère guère de n’importe quelle autre entreprise : chez Coreba, tous les opérationnels de terrain reçoivent des formations obligatoires annuelles en lien avec l’éclairage public, le réseau de gaz, etc. ; chez A**, dans le domaine informatique, tous les collaborateurs qui œuvrent directement auprès du client suivent au moins une formation technique par an.
Une deuxième et vaste catégorie de formations concerne les méthodes collaboratives, la résolution de problèmes, les techniques d’expression, etc., soit des formations comportementales. Ces formations sont particulièrement nombreuses pendant la phase de transformation. Elles sont souvent dispensées à une première couche de collaborateurs volontaires qui deviennent ensuite des formateurs ou des ambassadeurs internes référents dans ces domaines.
Une troisième catégorie comprend les formations en lien avec le bien-être des collaborateurs. Par exemple, le ministère belge des transports propose des séances de coaching ergonomique, de sensibilisation au yoga, au massage, à l’aïkido, etc. A** encourage la création de tribus pour améliorer l’entente entre les collaborateurs : l’entreprise finance des projets extra-professionnels destinés à fédérer les salariés. Grâce à cette démarche, une communauté de nail art est née, des séances de zumba sont offertes tous les lundis, etc. L’épanouissement personnel occupe une place importante chez Ardelaine aussi : « Maïa, qui est potière de formation et qui travaille pour le secteur culturel, a demandé à suivre une formation sur les teintures végétales parce qu’elle est passionnée par la couleur. Cette formation se déroulait dans les Alpes du Sud et coûtait très cher. Il y a eu une négociation pour savoir en quoi cela pourrait être utile à Ardelaine et on a trouvé un accord. Ardelaine a payé la formation et Maïa a pris en charge ses frais de déplacement et son logement là-bas. En contrepartie, elle s’est engagée à mettre en place des ateliers de teinture végétale pour les adultes et les enfants et, peut-être, à développer un kit de teinture végétale à vendre en boutique. Elle était super contente ! » Une façon de joindre l’utile (à l’entreprise) à l’agréable (pour le salarié).
Enfin, certaines formations sont liées aux exigences de la mobilité horizontale (voir ci-dessus) : A** a mis en place des formations spécifiquement destinées aux collaborateurs souhaitant endosser des fonctions annexes (telles que le capitanat d’une cellule, la participation à un groupe de travail) pour mieux contenir les frustrations liées à l’aplatissement de la hiérarchie.
L’investissement en formation s’explique aussi par deux autres variables qui sont davantage liées à l’agilité de l’organisation : la recherche de polyvalence et le maintien de l’employabilité5 des collaborateurs.
Chez Ardelaine, la polyvalence s’est révélée une nécessité économique, dans la mesure où de nombreux métiers sont saisonniers, comme la tonte ou l’accueil des touristes : « Comme on n’avait que des activités qui duraient trois mois dans l’année, il a bien fallu que chacun apprenne tous les métiers », commente un interlocuteur. Un deuxième intervenant ajoute que tout le monde, ou presque, a trois métiers dans la SCOP : « son métier de base, qui correspond le plus possible à ses compétences ; un métier secondaire (par exemple, faire deux ou trois salons dans l’année alors qu’on travaille dans un atelier ou au restaurant, ou tondre les moutons quand c’est la saison et être guide de musée ensuite) ; et un métier “pompier”, que l’on connaît suffisamment pour pouvoir l’exercer en cas d’absence imprévue ou de surchauffe ».
En matière de formation, deux points d’attention méritent d’être relevés :
« Trop d’offre tue l’offre ». Dans les organisations où la formation n’avait rien d’habituel, notamment pour les populations les moins diplômées, certains collaborateurs sont perdus dans cette offre abondante, surtout s’ils doivent choisir par eux-mêmes les formations à suivre. Dès lors, certains préfèrent ignorer les possibilités qui leur sont offertes ou prétendre ne pas avoir été exposés aux sollicitations de formation. Il est donc nécessaire de préparer les personnels et de les accompagner pour leur apprendre à assumer leur propre employabilité.
« Les cadres d’abord ». La démarche d’autonomisation sollicite particulièrement l’encadrement auquel il est demandé de changer de posture. Ce changement est particulièrement délicat à opérer, comme en témoigne un responsable chez A** : « Avant la transformation, nous étions très axés sur le contrôle Apprendre à faire confiance et à déléguer, c’est-à-dire accepter que certaines décisions ne passeraient plus par la hiérarchie n’était pas facile au début. J’ai dû faire un travail sur moi considérable ». C’est pourquoi les managers devraient être les premiers destinataires des formations envisagées, afin de les aider à s’approprier leur nouveau rôle et à devenir porteurs de la transformation – ce qui est loin d’être le cas partout. Plusieurs managers nous ont fait part de leur sentiment de confusion, voire de « délaissement »6 durant la première phase de la transformation. Les organisations qui ont anticipé cette question ont mis en place du coaching individuel ou collectif pour assurer cet accompagnement. Certaines ont même été jusqu’à solliciter les services d’un psychothérapeute mais souvent a posteriori – un dirigeant « regrette de ne pas avoir proposé cette solution aux managers plus tôt, au vu de l’important travail sur soi, parfois douloureux, qu’exige la transformation ».
- 1. Les réunions de gouvernance servent à définir les rôles d’un cercle avant son lancement – ou, au besoin, à les réviser ultérieurement – tandis que les réunions tactiques permettent de suivre l’avancement du projet auquel le cercle est dédié.
- 2. Cette méthode n’est pas récente (London et al., 1993), mais son adoption se développe fortement dans les entreprises qui promeuvent l’autonomie de leurs salariés.
- 3. Il ne s’agit pas uniquement de cocher des cases mais de faire des commentaires détaillés.
- 4. Les quatre catégories, par ordre croissant d’autonomie, sont : « attentiste », « demandeur », « proposeur » et « acteur ».
- 5. Rappelons que le maintien de l’employabilité est une obligation légale mise à la charge de l’employeur : il doit veiller à maintenir la capacité de ses salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (L. 6321-1 et ss. du code du travail). Cette obligation semble prendre une acuité nouvelle aujourd’hui et s’immisce de manière de plus en plus systématique dans le contentieux prud’homal. Si la formation semble être le meilleur dispositif pour l’employeur de remplir son obligation d’employabilité, il n’en reste pas moins que la responsabilité de ce dernier se porte aujourd’hui davantage sur la finalité, à savoir la compétence du salarié, que sur le moyen qui permet de l’acquérir.
- 6. Notamment, un responsable raconte n’avoir pas du tout été accompagné au début de la transformation : « J’ai dû faire face à de nombreuses tensions au sein de mon équipe et me suis retrouvé complètement livré à moi-même pour les gérer. J’ai dû me former moi-même, en entreprenant des démarches personnelles. J’ai notamment lu plusieurs bouquins, demandé conseil à mon partenaire qui est manager et suivi une formation sur le leadership humain […] mais dans une structure externe ». Des mesures d’accompagnement ont certes vu le jour dans un deuxième temps, mais trop tardivement d’après cet interlocuteur. À la CPAM 78, les managers de proximité ont été formés en priorité, provoquant une certaine jalousie de leurs propres responsables (formés depuis).
Dynamique de la transformation
Mobiliser le corps social, construire un récit commun
Pour que l’autonomie des individus ne conduise pas à des initiatives incohérentes, il faut que chacun partage une vision commune des objectifs de l’organisation. Celle-ci peut avoir été imposée par le dirigeant, avoir été construite collectivement ou être en constante évolution à travers des délibérations plus ou moins démocratiques. Dans tous les cas, un travail d’explicitation ou de narration permet le partage de cette vision ainsi que l’acculturation des nouveaux arrivants. Les individus bien intégrés à l’organisation partageront volontiers la grille d’interprétation du monde en cours dans celle-ci. L’inverse est également vrai : le partage d’une grille d’interprétation du monde au sein d’une organisation contribue à la bonne intégration des individus qui la composent. L’importance de créer un récit partagé est largement attestée par la littérature académique (Weick 1995 ; Boudès et Christian, 2000). Des dirigeants documentent ainsi le processus de transformation par des livres de leur crû ou commandés à des auteurs extérieurs, qui serviront de référence à ce récit partagé et permettront la transmission des connaissances à son sujet au sein de l’organisation1.
Une élaboration plus ou moins collective
La première étape de la transformation commence quasi systématiquement par un travail collectif sur la vision commune et les valeurs (cercles de vision, ateliers vision/valeurs, etc.). C’est un passage quasiment obligé, mais il ne semble pas exclu de le questionner : bien que cet exercice ait été conduit au SPF belge des transports, Quentin Druart, alors DRH, affirme être de moins en moins convaincu par l’utilité de la définition de valeurs communes. Il aurait plutôt tendance à privilégier l’élaboration de principes d’action (comme la co-création ou la collaboration), qu’il juge plus simples à faire comprendre aux employés. Selon lui, les valeurs prennent des significations très variées d’un service à l’autre, en fonction de la nature des activités et des personnalités.
Selon que le dirigeant est un extraverti sûr de lui ou un prudent (voir chapitre 2), selon son degré de conviction sur la nature de la transformation qu’il estime souhaitable, selon la situation de l’entreprise ou la facilité plus ou moins grande à mobiliser le corps social mais aussi en fonction de son souci de permettre à chacun de partager la même aspiration collective ou de contribuer à définir celle-ci, les trajectoires suivies en matière de participation et d’association des salariés aux différentes étapes seront assez variées.
Si le dirigeant est convaincu de l’opportunité d’une transformation, cette étape interne aura d’abord pour but de faire partager sa vision (évangélisation). La concertation éventuelle peut être une mise en scène destinée à en permettre l’appropriation, et elle est souvent bien intentionnée : le dirigeant est persuadé que ce qu’il veut faire est dans l’intérêt de l’entreprise et de ses collaborateurs, mais pense que ceux-ci doivent en être eux-mêmes convaincus pour se mobiliser. Il agit comme un parent qui constate que son enfant n’a pas de prédisposition pour préférer le travail à l’oisiveté, l’étude du solfège et des mathématiques au jeu et tente de rendre le comportement souhaité attractif2. De nombreux témoignages recueillis dans les organisations de notre échantillon montrent que les collaborateurs ne sont pas dupes : « [Le dirigeant] nous invite à réfléchir sur plusieurs solutions possibles jusqu’à ce qu’on choisisse celle qu’il voulait nous voir préconiser ». Ils apprécient néanmoins cette concertation. Ce travail de persuasion est d’autant plus nécessaire lorsque les salariés ne sont pas conscients de l’urgence de la transformation, notamment quand l’entreprise a de bons résultats économiques (Michelin, FDM), ou que ses personnels y sont peu sensibles (CPAM 78, SPF), privilégiant par exemple les valeurs du « service public ».
Certains dirigeants prôneront une authentique démarche bottom-up (Chrono Flex), au point d’approuver des propositions qu’ils ne jugent pas optimales parce que « si ça vient d’eux, ils le feront avec beaucoup plus d’entrain [et cela compensera d’éventuelles sources d’inefficacités mineures] » (CPAM 78). Il y a en fait tout un continuum, certains dirigeants pouvant être convaincus par un objectif mais ouverts aux suggestions sur les manières de l’atteindre.
Quelques « révélateurs » de la qualité de la concertation
L’expression de la confiance
Les manifestations de la confiance accordée sont au fondement du processus d’autonomisation qui, dès lors, s’en nourrit et fait tache d’huile. Sans cette confiance a priori manifestée par la direction, il y a peu de chances que les salariés se saisissent des marges de manœuvre qu’on dit vouloir leur accorder mais qui ne sont ni incarnées, ni vécues. Comment exprimer la confiance ?
Libérer la parole critique. La confiance peut être installée en début de processus par une libération de la parole critique qui permet de purger les non-dits. Ainsi, la direction de Chrono Flex a-t-elle initialement lancé deux chantiers: «Petits cailloux» et « Signes de pouvoir ». Le premier consistait à proposer aux salariés de lister les irritants qui les empêchent de travailler convenablement: par exemple, PC ou photocopieuse en mauvais état, manque de licences
de logiciels pour travailler à plusieurs, étagères de rangement « déglinguées », etc. Le second chantier, également individuel, leur demandait d’identifier les signes de pouvoir qui provoquent des nuisances dans le travail. La direction avait promis que toutes ces critiques seraient prises en compte et des mesures correctives installées avec effet rapide (ou des explications données sur pourquoi il n’était pas possible de corriger). Ce qui fut effectivement fait, contribuant ainsi à «embarquer» les salariés dans le mouvement. La CPAM 78 a également travaillé dès l’origine sur les irritants, et plusieurs autres entreprises ont supprimé les marqueurs hiérarchiques les plus évidents (places de parking attitrées, taille des bureaux, information réservée à quelques-uns, etc.).
Diminution des contrôles. La confiance peut aussi se manifester par la diminution des contrôles. Chez A**, des collaborateurs nous ont signalé que l’obligation de procéder à toutes sortes de reporting fastidieux a considérablement diminué, ce qu’ils perçoivent comme une manifestation de confiance. En sens inverse, certaines entreprises déclarent que la confiance est au cœur du système mais mentionnent immédiatement après les risques d’abus, et donc la nécessité de conserver les contrôles, ce qui n’encourage guère la confiance. Souvent, la bonne foi est initialement présumée, puis des contrôles ou des recadrages sont réintroduits lorsque des dérives apparaissent.
Droit à l’initiative. L’expression de la confiance se manifeste également par l’incitation à l’initiative et par l’acceptation de son corollaire le droit à l’erreur (par exemple, le fait, pour un supérieur hiérarchique, de ne pas mettre en cause une décision prise par un collaborateur, même si elle est jugée mauvaise), puisqu’on ne peut encourager l’expérimentation qu’en tolérant le fait que son résultat puisse ne pas être satisfaisant (voir aussi chapitre 3). Le directeur marketing chez Lippi raconte ainsi que dans les débuts, il s’ennuyait tellement à son poste qu’il envisageait de quitter l’entreprise. Il s’en ouvre alors à Julien Lippi à l’occasion de son entretien annuel et, à sa grande surprise, Julien lui demande alors : « Qu’aurais tu envie de faire ? Il explique alors à Julien qu’il voudrait transformer Lippi en «une vraie marque, un IKEA du portail ».
Julien lui demande: « De quoi aurais-tu besoin pour cela ? » et ajoute « si on peut le faire, on le fera. » Quinze jours plus tard, le collaborateur soumet à Julien un dossier détaillant les moyens qu’il lui faudrait pour mener son projet à bien. Nouvelle grosse surprise, Julien lui donne le feu vert. Par la suite, ce collaborateur a reproduit l’attitude qu’avait adoptée Julien à son égard : « Quand certaines assistantes commerciales ont été cooptées cheffes de marché, elles sont venues me voir, paniquées. Je leur ai expliqué que tout l e monde était là pour les aider. Ce n’est pas comme dans certaines entreprises, où on vous confie une mission et où, si vous échouez, on vous montre la porte. Chez Lippi, il n’y a pas de Superman, mais on s’aide les uns les autres et, ensemble, on arrive à faire des choses dont on n’imaginait pas être capables. »
La définition claire des zones bleues et des zones rouges
Tout n’est pas ouvert à la discussion et il est important de clarifier ce qui l’est (zones bleues) et ce qui ne l’est pas (zones rouges). La démarche est jugée plus crédible lorsque le champ de l’autonomie est défini clairement. Dans la plupart des cas documentés, la mission de l’entreprise (le quoi) est définie par le dirigeant. C’est aussi avec son conseil d’administration (dans le cas d’une société)3 ou seul (s’il contrôle l’entreprise) qu’il définit s’il est opportun qu’il reste dirigeant et qu’il fixe sa rémunération. Ainsi, sont généralement exclus du champ de la concertation la stratégie, les niveaux de salaires, la gouvernance.
Ceci n’empêche pas la frontière d’évoluer, soit vers plus de liberté, notamment lorsque l’autonomie s’est développée et a conduit à des évolutions satisfaisantes, soit vers plus de contraintes, lorsque certaines règles apparaissent nécessaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise ou pour que les choix soient ressentis comme équitables (voir l’exemple de la gestion des congés chez FDM4).
La place donnée aux institutions représentatives du personnel
Les institutions représentatives des personnels peuvent être associés à la démarche et se préoccuper de ceux qui ne sont pas enthousiastes mais n’osent pas toujours exprimer leur réticence ou parler des problèmes que l’autonomie leur pose. Elles sont parfois spontanément associées (ainsi, Patrick Négaret, directeur de la CPAM 78, est allé visiter des entreprises libérées avec ses délégués syndicaux) ou sont parfois incontournables (comme chez SPF Mobilité et Transports). Dans d’autres cas, les initiateurs du changement ne cachaient pas leur méfiance vis-à-vis des corps intermédiaires : les syndicats, le management intermédiaire et les spécialistes fonctionnels.
Le traitement réservé aux réticents
Un marqueur du style de la transformation est la place donnée aux réticents : employés qui déclarent ne pas être intéressés par les nouveaux modes de fonctionnement proposés, qui refusent de participer aux groupes de concertation, et notamment – mais pas seulement – les cadres mal à l’aise avec les évolutions de leur rôle et les abandons de souveraineté qu’elles impliquent. Chez GEN par exemple, la directrice s’efforce de trouver une affectation moins exigeante (sur le plan de l’agilité) à ceux qui veulent conserver un fonctionnement traditionnel.
Au SPF, certains employés ont préféré continuer à pointer (15 à 20 % du personnel)5, préférant s’acquitter de leur obligation de présence plutôt que d’être jugés sur des critères de résultat et craignant qu’on leur en demande beaucoup plus ou d’être l’objet d’attentes qu’ils ne jugeaient pas justifiées. Les syndicats veillent à ce que ces « objecteurs » à la transformation ne soient pas inquiétés.
Dans une autre entreprise en revanche, le dirigeant incite à faire « la chasse aux renards », c’est-à-dire aux employés qui ne joueraient pas le jeu et douteraient des valeurs professées par l’entreprise. Nous pointons le danger de ces métaphores animalières simplistes promues par certains consultants ou certaines entreprises (coqs, chiens, renards ; moutons, dauphins, renards) qui sont sources de stigmatisation et d’exclusion.
Périmètre et rythme de la transformation : basculement ou expérimentation ?
On peut caractériser la trajectoire de la transformation selon deux dimensions : spatiale et temporelle.
Spatialement, certaines entreprises lancent des initiatives s’adressant d’emblée à l’ensemble de l’organisation, d’autres préfèrent se concentrer sur un nombre plus restreint de services dans un premier temps (services pilotes). Nous distinguons ainsi les démarches locales des démarches globales.
Relativement au rythme de la transformation, certaines entreprises basculent dans le nouveau fonctionnement, d’autres ménagent une certaine réversibilité, en testant un nouveau fonctionnement assez bien défini mais en prévoyant d’en évaluer les effets. D’autres procèdent même par tâtonnement, laissant les détails du nouveau modèle de fonctionnement émerger ou en encourageant des services pilotes volontaires à proposer et essayer différentes options.
Cette distinction reste évidemment schématique et laisse place à de nombreuses hybridations : une même entreprise peut procéder par basculement sur certains objets de l’autonomie (par exemple en supprimant du jour au lendemain des marques distinctives comme les places de parking réservées à la direction), en tester d’autres (suppression de l’obligation de pointer) et donner par ailleurs carte blanche à certains services (laisser tel département organiser son planning, après avoir rappelé les obligations de service à satisfaire).
Ainsi, la CPAM 78 a encouragé des services pilotes à tester des modes d’organisation plus autonomes, bien qu’elle ait par ailleurs mis en place l’innovation participative dans toute l’organisation (ce qui explique que nous l’ayons mentionnée dans deux des quadrants de la figure). Au SPF, une première phase de la transformation a été globale et dirigiste, tandis qu’une deuxième phase (après le départ du dirigeant initiateur) a laissé davantage de place à la concertation : c’est pourquoi, le classement du SPF dans la matrice est scindé en SPF1 et SPF2.
Le basculement est parfois ressenti comme brutal par les salariés et déstabilisant pour l’encadrement intermédiaire. « [Le dirigeant] était pour la libération, mais seulement si nous allions dans son sens. Il a coupé la tête de nombreux chefs, sans forcément reconstruire de nouvelles bases managériales pérennes ensuite ». Un paradoxe déjà relevé par certains chercheurs entre le projet d’émancipation invoqué par le leader libérateur et la manière de le réaliser, « beaucoup plus proche d’une marche forcée » (Fox et Pichault, 2017, p. 105).
Typologie des trajectoires de transformation
Nous proposons ici une cartographie de huit des neuf trajectoires de transformation ayant fait l’objet de notre enquête6. La typologie est construite selon deux axes : la dimension temporelle (basculement vs expérimentation ou tâtonnement) et la dimension spatiale (local vs global). Le basculement a la volonté d’être irréversible (le projet de transformation ne prévoit pas de retour en arrière), tandis que l’expérimentation tolère la réversibilité. Le tâtonnement est encore plus aléatoire, dans la mesure où il ne suit aucun modèle préétabli (un des consultants intervenus chez Lippi raconte par exemple que les dirigeants « ne pouv[aient] pas prédire ce qui allait se passer, car [eux-mêmes] […] ne sav[aient] pas où [ils] all[aient] », même si Frédéric Lippi souligne qu’ils étaient confiants dans le fait que des choses intéressantes allaient émerger). Une démarche locale implémente des changements dans un nombre restreint de services (services dits pilotes), alors qu’une approche globale concerne l’ensemble de l’organisation. Nous n’avons pas pu observer d’exemple de basculement local. Pour illustrer cette catégorie à des fins pédagogiques, nous avons imaginé un scénario hypothétique issu du monde du sport : imaginons une association sportive déterminée à changer une partie de son règlement. Par exemple, la Fédération Française de Football peut être convaincue de la pertinence d’une nouvelle règle très structurante (telle que l’assistance vidéo à l’arbitrage) qu’elle souhaite imposer sans retour en arrière (ce que nous qualifions de basculement). Il n’est toutefois pas impossible que la FFF préfère d’abord implémenter cette nouvelle règle localement (par exemple dans une ligue amatrice) avant de l’appliquer partout (y compris au niveau professionnel) pour mieux gérer la transition. Ce n’est cependant pas une expérimentation, puisque la FFF n’envisage pas de revenir à la règle qui prévalait précédemment.
A contrario, GEN a mis en place cinq projets pilotes dans son secteur «voix» pour tester le fonctionnement de la gouvernance adaptative. Une entreprise comme Michelin a encouragé des îlots de fabrication à indiquer ce qu’ils se sentaient capables de décider sans demander l’avis de la hiérarchie et sans dépendre des services supports. Trente-huit îlots dans différentes usines de différents pays sont ainsi devenus à leur demande des « laboratoires de l’autonomie» en 2013 (Ballarin, 2019). De manière analogue, trois services de la CPAM 78 ont été autorisés à s’affranchir de certaines règles, gérant eux-mêmes leur planning et adaptant leurs horaires de disponibilité à l’évolution des demandes des assurés. Cet appel à l’expérimentation révèle une attitude prudente, pragmatique et modeste de la direction qui ne prétend pas savoir mieux que les salariés ce qui leur convient.
Nous émettons l’hypothèse que les leaders libérateurs les plus pragmatiques (ou les moins dogmatiques) accorderont de l’importance aux retours d’expérience et préféreront les approches plus réversibles (l’expérimentation ou le tâtonnement). La préférence pour une approche plus réversible peut également provenir d’un souci d’accompagnement des collaborateurs. Bien entendu, l’urgence ressentie compte aussi et pourra pousser les pragmatiques à la prise de risques. Des leaders plus audacieux pourront procéder en une seule fois par ce qu’ils appellent « un saut en parachute », généralement après avoir labouré en silence le terrain pendant plus d’un an (Chrono Flex).
Le choix quant à l’étendue spatiale dépendra, lui aussi, du niveau de prudence affiché par le leader libérateur : un pragmatique prudent encouragera sans doute des expériences restreintes à quelques services pilotes dans un premier temps, pour se convaincre et convaincre les autres de la pertinence de la transformation. Évidemment, la taille de l’entreprise représente aussi un paramètre important. Les expérimentations locales seront plus évidentes dans un grand groupe soucieux de limiter la prise de risques que dans une PME, où l’échelle locale et globale se confondent.
Principales difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées sur le chemin de la transformation sont nombreuses. Elles peuvent représenter d’utiles balises de danger pour les dirigeants qui seraient tentés par une telle démarche.
Le lâcher prise (ou non) du dirigeant
La transformation exige du dirigeant un changement assez radical de son rôle et de ses postures.
Carney et Getz (2009/2016) considèrent que la libération porte avant tout sur le leadership, l’essentiel étant d’aider le leader à lâcher prise et à renoncer au contrôle.
Attention danger !
D’autres introduisent la notion de leader pollinisateur qui ne se contente pas de lâcher prise mais dont le rôle est d’ensemencer l’entreprise d’idées résultant d’une écoute bienveillante (Zarka et al., 2019). Il est en tout cas souvent préférable que le leader ignore le détail de ce qui se passe dans son entreprise (Rigal et Weil, 1986), car la seule conscience que le dirigeant est au courant de tel ou tel aspect des opérations peut affecter les comportements (Riveline, 2018).
Si l’entreprise est en difficulté, il est particulièrement difficile pour le dirigeant de faire confiance et de ne pas chercher à savoir ce qui se passe. Certains utilisent les systèmes d’information de l’entreprise pour se mettre au courant, sans avoir à le demander (par exemple, dans un cas extrême, en surveillant les fils de discussions qui ont lieu sur les outils collaboratifs et les forums). Nous avons entendu dire dans une entreprise que les discussions autour de la machine à café seraient découragées car elles ne laissent pas de trace dans le système d’information. D’autres s’interdisent d’intervenir auprès de leurs collaborateurs sur les choix qui ne sont officiellement plus de leur ressort mais se tiendraient au courant des débats auxquels ils donnent lieu par des « informateurs ». Les salariés sont rarement dupes longtemps de ce double langage.
Certains dirigeants ne cherchent pas à simuler un lâcher-prise qu’ils ne pratiquent pas. Tout en encourageant les initiatives et en veillant à ne pas mettre en difficulté les collaborateurs qui en prennent, ils sont omniprésents. De fait, ils incitent les employés à leur faire des suggestions et des critiques plutôt qu’à prendre des décisions sans leur en avoir parlé, ce qui constitue déjà un changement important dans certaines organisations (comme avec l’innovation participative à la CPAM 78, par exemple).
Le dirigeant doit aussi parfois rassurer des actionnaires ou des banquiers sceptiques sur sa capacité à leur garantir des résultats, alors même qu’il n’exerce plus de contrôle sur certains facteurs déterminants (comme chez Poult7).
Le risque d’en faire trop : communiquer à outrance
Trop s’occuper de la transformation et passer son temps à communiquer sur elle peut avoir des effets négatifs, si la direction donne l’impression de ne plus s’occuper que de cela, alors qu’on attend d’elle des décisions ou des actions dans d’autres domaines stratégiques.
La communication externe varie selon un continuum entre une attitude très extravertie et la plus grande discrétion.
Les dirigeants extravertis communiquent volontiers sur leur expérience de transformation, écrivent ou commandent des livres – Michel Hervé (Hervé et al., 2007 ; Hervé et Brière, 2011 ; Hervé, 2015) pour le groupe Hervé, Jean-François Zobrist (2014) pour Favi, Emmanuel Druon (2015) pour Pocheco, Michel Munzenhuter (2016) pour SEW USOCOME, Alexandre Gérard (2017) pour Chrono Flex, les frères Lippi (2019) pour Lippi –, tiennent un blog (Laurent Ledoux, jadis au SPF Mobilité et Transports), publient sur LinkedIn (Patrick Négaret, CPAM 78) et organisent conférences et visites d’entreprise. Ils s’assurent parfois les services d’un chargé de communication ou d’une agence de communication. Pour certains, le conseil en libération d’entreprises ou le coaching de futurs «libérateurs» devient une activité annexe, pouvant aller jusqu’à être filialisée. Ceux qui commercialisent leur modèle sont souvent plus enclins à défendre celui-ci, estimant que les critiques mettent en jeu leur crédibilité8.
Beaucoup sont animés du désir sincère de témoigner et de faire profiter d’autres entreprises de leur expérience. Certains pensent que l’image de leur entreprise en bénéficiera, qu’elle attirera ainsi plus facilement les talents et contribuera à renforcer le sentiment de fierté des collaborateurs ayant activement participé au changement. Même si certains salariés peuvent ironiser vis-àvis de la nouvelle « doctrine », de sa terminologie parfois excessive ou de ses injonctions intrusives, par exemple lorsqu’on parle trop de bonheur de travail ou qu’on prescrit lourdement un enthousiasme perpétuel (Verrier et Bourgeois, 2016), ils pardonnent volontiers au dirigeant ses « marottes », lorsque les actes suivent et que les déclarations correspondent à peu près au fonctionnement réel de l’entreprise.
Les dirigeants plus discrets le sont pour des raisons diverses. La première est la crainte de susciter des attentes excessives, au risque de décevoir. C’est souvent la raison pour laquelle ils adoptent aussi une démarche de transformation expérimentale et progressive. Ils souhaitent rendre le processus facilement réversible ou le protéger jusqu’à ce qu’il soit devenu irréversible. Si une expérimentation s’avère peu convaincante, ils pourront y mettre fin sans drame. «Pour vivre heureux, vivons cachés», tel est leur devise, au moins en début de processus. Ceux qui communiquent peu évitent ainsi de mettre une pression trop importante sur les collaborateurs réticents à la transformation, surtout s’il a été déclaré au commencement que la démarche se ferait sans contrainte et sur la base du volontariat. En sens inverse, les extravertis voient précisément la communication externe comme une manière d’amener les récalcitrants à changer d’avis face à l’enthousiasme suscité par la transformation.
Les discrets ne sont pas insensibles au discours critique de certains contempteurs des entreprises libérées (parmi lesquels le collectif des #MEcrEants, 2016 déjà évoqué au chapitre 1) et ne souhaiteront pas avoir à se justifier ou à se défendre contre une accusation d’hypocrisie ou de social washing. Une sage position si l’on tient compte du fait que les salariés sont les premiers à pouvoir mesurer le décalage entre certaines déclarations tonitruantes et la réalité de leur quotidien.
La posture de communication peut évoluer au fur et à mesure que la transformation fait consensus et que ses bénéfices deviennent visibles. Ainsi, Patrick Négaret, le directeur de la CPAM 78, d’abord discret, a-t-il commencé à communiquer après avoir reçu plusieurs trophées d’entreprise. Michelin a mis trois ans avant d’évoquer, avec une grande modestie, ses expérimentations en public.
Paradoxalement, la mise en avant médiatique du seul dirigeant libérateur peut créer une dissonance par rapport au message égalitariste (pas de statut privilégié) porté par certaines transformations. Une surexposition médiatique est aussi un facteur d’amplification de crise, lorsque les difficultés s’accumulent et que les comptes de l’entreprise se dégradent.
L’insuffisante prise en compte des managers
La transformation peut être difficile à vivre pour les managers. Le dirigeant a eu le temps de préparer et mûrir sa décision – nous avons vu qu’il la prend souvent solitairement –, alors qu’elle tombe de « nulle part » pour les managers et leur est imposée sans qu’il l’ait sollicitée ou souhaitée.
Certains sont satisfaits de leur nouveau rôle de coach, d’animateur, d’expert référent, de facilitateur ou de mentor, d’autres sont déstabilisés par la perte soudaine de leur rang et de leur autorité hiérarchique. Le changement est encore plus difficile pour ceux qui continuent à avoir des obligations de reporting et à devoir rendre des comptes (accountability) sur des processus ou des résultats sur lesquels ils ont moins (ou plus du tout) de prise.
Parfois, les cadres expriment le sentiment que le dirigeant a eu un comportement bonapartiste privilégiant une connivence avec les exécutants, afin de contourner les corps intermédiaires (management ou syndicats). Certains ont eu le sentiment de faire face à une véritable chasse aux sorcières idéologique. Dans un cas, tous les subordonnés directs du dirigeant ayant entrepris la libération ont été remplacés, sauf celui qu’il avait lui-même recruté.
Certains cadres n’ont pas d’opposition idéologique à la transformation mais souhaitent faire carrière et pouvoir changer d’entreprise. L’absence de reconnaissance claire de leur niveau hiérarchique et de leur progression les gênent donc, même lorsqu’ils sont valorisés autrement.
Dans plusieurs des cas que nous avons examinés, les dirigeants admettent avoir initialement sous-estimé le besoin d’accompagnement de leur encadrement (voir aussi chapitre 4 § Formation).
Le risque de surinvestissement des salariés
Nous avons vu qu’en plus des réticences propres à l’encadrement, il arrive aussi fréquemment que des collaborateurs expriment leur méfiance face à l’autonomie. Cette dernière est parfois perçue comme une manière détournée de demander plus de travail et de prise de responsabilités en échange de moins de contrôle mais sans contrepartie substantielle (augmentations). Les syndicats ont généralement conscience de ce danger. À l’inverse, certains salariés enthousiastes au départ peuvent être déçus, si les promesses tardent à se concrétiser.
Certains salariés peuvent également craindre de ne pas être capables de satisfaire aux nouvelles attentes, ou ne souhaitent pas se surinvestir dans leur vie professionnelle. Le risque de surinvestissement issu de la grande autonomie est, par exemple, pointé chez Lippi : « L’investissement personnel est souvent poussé à l’extrême, explique une salariée, car c’est difficile de savoir si ce qu’on a fait est suffisant par rapport à ce qu’on avait à faire. » Heureusement, chez Lippi, l’attention aux autres et la solidarité font partie de la culture interne et limitent le risque d’épuisement : « On fait attention à la charge de travail de chacun », précise la même salariée.
Certaines entreprises, conscientes de ce risque, surveillent comme le lait sur le feu les effets psychosociaux de la montée en autonomie (voir ci-dessous Mesure des résultats).
Turn-over
Ces craintes et défiances se traduisent fréquemment par un turn-over qui peut être significatif, au moins au moment de la transition. La nouvelle culture ne convient pas à tous et suscite des départs volontaires ou forcés. Le cas des équipes commerciales de Lippi en représente une bonne illustration. Avant la transformation, le travail des commerciaux consistait essentiellement à accorder des remises sans grand discernement. Suite à une restructuration complète de la politique commerciale, les commerciaux « sont devenus des ambassadeurs de la marque et doivent mettre en avant la qualité des produits, les certifications que nous avons obtenues, les nouveaux univers que nous créons, la façon dont notre offre se différencie de ce qu’on trouve ailleurs » explique la directrice commerciale. Ce changement de statut n’a pas été du goût des commerciaux : en moins de deux ans, ils ont tous quitté l’entreprise. « Ils ont sans doute eu l’impression de perdre leur pouvoir. »
Les effets indésirables de la transparence
La transparence a des effets ambigus et pas toujours bien anticipés. Ainsi, un salarié peut comprendre qu’il n’a pas mérité une promotion ou une augmentation mais ne pas souhaiter que la transparence des rémunérations rende publique cette décision. Tel employé qui préfèrerait négocier des souplesses horaires ou des aménagements de son poste plutôt qu’une augmentation de sa rémunération pourrait subitement attacher beaucoup plus d’importance à celle-ci si elle est visible de tous ses collègues, parce qu’il comparera alors leur rémunération à la sienne. On notera que cet effet pervers est bien anticipé par les dirigeants, puisque parmi les entreprises visitées, seule Ardelaine affiche une totale transparence des salaires (mais tous les coopérateurs sont payés au SMIC).
La transparence peut détourner de leur fonction des outils comme l’auto-évaluation ou l’évaluation par les pairs, qui ont normalement vocation à rester confidentiels et à aider le salarié à améliorer sa connaissance de lui-même, et qui sont aujourd’hui, dans certaines entreprises, des outils d’évaluation connus et partagés avec la direction et les managers, permettant de fonder la progression de carrière et de rémunération du salarié.
Enfin, la transparence sur la rémunération des dirigeants est parfois un leurre. Certaines entreprises ont des règles d’affectation des bénéfices très transparentes mais versent des loyers et payent des prestations de gestion à des sociétés appartenant à leurs dirigeants.
Les difficultés instrumentales
La rigidité des outils d’agilité. Divers outils sont mis en place pour favoriser l’agilité, notamment des logiciels de gestion de projets transversaux (outils de Spindle chez GEN, logiciel de transparence financière de Chrono Flex) mais ils ne sont pas toujours bien appropriés ou appréciés. Les formats assez ritualisés des réunions agiles soulèvent des critiques et sont fréquemment contournés par les utilisateurs. Quant aux flex desks ou autres open spaces, ils continuent de susciter la critique d’une partie de ceux qui y sont soumis : soit qu’ils n’apportent pas la fluidité attendue parce que les gens occupent en fait toujours les mêmes places près des collègues avec lesquels ils aiment ou ont l’habitude de travailler, soit qu’ils favorisent la surveillance mutuelle, avec le contrôle social afférant.
L’inadaptation des outils de gestion. Les outils de gestion de l’entreprise ne permettent pas toujours à une équipe autonome d’avoir accès à l’information permettant d’apprécier la pertinence de ses décisions à l’échelle de l’organisation. Ainsi, chez Poult, les miniusines étaient encouragées à prendre des décisions dont elles ne pouvaient apprécier les conséquences économiques9.
La mise en cause des zones rouges
En matière d’autonomie aussi, l’appétit vient en mangeant. Les salariés qui ont pris l’habitude de faire des suggestions reconnues pertinentes sur la nature de leur travail ou sur l’organisation de leur équipe sont tentés de réfléchir à d’autres aspects du partage du pouvoir, des orientations stratégiques et des richesses produites (gouvernance). Dans certains cas, les dirigeants accueillent ces aspirations avec bienveillance et sont enclins à élargir progressivement les domaines de concertation et de codécision. Dans d’autres, un rappel des « zones rouges » peut conduire des salariés à chercher ailleurs encore plus d’autonomie.
Mesure des résultats, bénéfices de la démarche
Plusieurs entreprises ont mis en place divers baromètres pour avoir une indication de la satisfaction des salariés et identifier les points de vigilance (les irritants de l’organisation, les sources de stress). Elles en font un indicateur de gestion ou de mesure des progrès accomplis, en particulier en matière de QVT et de risques psychosociaux avec, en ligne de mire, le risque de sur-engagement. GEN pratique un sondage trimestriel pour mesurer l’impact de la transformation sur les salariés, leurs attentes et taux de satisfaction ; la CPAM 78 a mis en place un baromètre annuel de la QVT, comportant une dizaine de questions, entre autres, sur la motivation, l’autonomie, l’ambiance, l’équité et la reconnaissance ; A** a élaboré deux formulaires mensuels facultatifs, afin d’évaluer, grâce à un continuum allant du soleil à l’orage, la gestion de l’énergie et le bonheur au travail ; A** s’appuie aussi sur l’IBET, l’indice de bien-être au travail pour s’assurer de ne pas basculer vers le sur-engagement10.
Dans le cadre de leur contrôle de gestion sociale, les entreprises mesurent les taux de départs ou d’absentéisme, qu’elles jugent généralement en baisse ou meilleurs que ceux de leur secteur de référence, ou encore leur plus grande facilité à attirer les talents11 grâce à la nouvelle visibilité de leur marque employeur.
D’autres encore mettent en avant les économies produites par l’accroissement de l’autonomie dans les modalités d’exercice du travail. Chez A**, la généralisation du télétravail aurait permis de générer 100 000 euros d’économies, c’est-à-dire 3 200 heures de moins sur la route chaque année pour les collaborateurs, soit l’équivalent de 340 000 kilomètres12.
La transformation des organisations observées se limitant rarement à l’accroissement de l’autonomie et à la libération des énergies, les relations observées avec certains résultats, notamment financiers, sont ambiguës, les causalités incertaines.
Le souci de l’épanouissement de l’individu peut se traduire par une plus grande satisfaction des personnes, mais, là encore, le signal peut être perturbé par d’autres facteurs, par exemple une forte réduction d’effectifs qui est source de tensions dans les services moins dotés (CPAM 78).
L’apprentissage de nouveaux rôles, la valorisation de la mobilité horizontale (nouvelles compétences, polyvalence) plutôt que de la promotion hiérarchique, peuvent ouvrir de nouveaux horizons. L’accompagnement dont bénéficient les managers pour faire face à leur nouveau rôle peut s’avérer bénéfique dans des domaines extraprofessionnels.
Si nous avons souvent senti une satisfaction partagée par rapport à la transformation (nombreux sont les salariés interrogés à déclarer qu’ils seraient désormais incapables de travailler dans une entreprise « non libérée »), si les performances de certaines organisations visitées semblent s’améliorer (mais d’autres pas particulièrement), nous nous garderons cependant bien de conclure à une quelconque causalité entre autonomie et performance économique. Ceux qui aboutissent à une telle conclusion s’appuient souvent sur des exemples significatifs mais pas représentatifs (par exemple, Panigada, 2017) et ont vanté la performance exceptionnelle de Poult ou Favi avant que les actionnaires de ces entreprises ne la jugent décevante et décident de revenir à une organisation plus traditionnelle.
Ajustements et points d’inflexion
Plusieurs organisations ont connu des points d’inflexion dans leur transformation, tandis que d’autres s’ajustent en continu ou à intervalles réguliers.
Ainsi, chez FDM, nous avons vu que tout salarié peut remettre en cause une règle et proposer une adaptation lors de la réunion de toute l’entreprise chaque lundi matin. Le recueil des procédures sera mis à jour dès la décision prise. Dans d’autres entreprises, des cercles réfléchissent en permanence à l’amélioration des procédures.
Parfois, c’est le dirigeant qui, estimant que l’organisation a acquis un certain niveau de maturité, décide d’élargir le champ de l’autonomie et de remettre en cause certaines zones rouges.
D’autres fois encore, un changement de dirigeant ou d’actionnaire conduit à une révision du cadre ou des règles. Lors du changement de président au SPF, certaines contraintes initiées dans la première phase de la transformation ont été assouplies, l’organisation étant devenue plus tolérante au fait que certains salariés ne souhaitaient pas s’engager dans la transformation.
Enfin, un changement d’actionnaire ou de dirigeant peut parfois conduire à remettre complètement en cause la transformation comme chez Favi ou chez Poult, mais il arrive aussi que, dans des circonstances similaires, l’essentiel soit préservé comme chez SEW USOCOME ou au SPF.
- 1. Les principaux ouvrages de ce type sont cités p. 111. Dans cette logique, un bon exemple d’ouvrage est celui écrit par Pascal Croset sur la transformation d’OCP Group au Maroc : ce chercheur a été missionné par le PDG Mostafa Terrab pour documenter la mutation organisationnelle et comportementale à différentes étapes (Croset, 2012, 2017). Les livres issus de cette mission sont largement diffusés au sein de l’organisation.
- 2. Robert-Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois (1987) dans leur Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens , ou March (1978) lorsqu’il explique comment manipuler les préférences et les choix des individus, ne considèrent pas la manipulation comme condamnable, si ses buts ne le sont pas. Les partisans d’une approche déontologique de l’éthique considèrent au contraire que même un objectif vertueux ne justifie pas des moyens condamnables ou infantilisants, ni des comportements paternalistes, voire intrusifs.
- 3. Dans les deux cas de SCOP de notre échantillon, le dirigeant est révocable par les salariés.
- 4. L’entreprise FDM avait décidé que chacun était libre de prendre ses vacances quand il voulait. Puis il est apparu qu’il fallait qu’une permanence soit assurée dans chaque équipe (en charge d’une clientèle donnée) et pour chaque grand type de compétence qui pouvait être requis pour répondre au besoin urgent d’un client. Cette règle posée, un autre problème est apparu : ceux qui ne prenaient pas la précaution de déclarer leurs vacances très en avance pouvaient se retrouver piégés par les choix de leurs collègues, ce qui n’était pas jugé équitable.
- 5. Ce chiffre décroît régulièrement avec le temps : renouvellement des personnes et le fait que certains attentistes finissent par renoncer au pointage. À noter également que le système de pointage ne sera plus ouvert aux nouveaux entrants à compter de la fin 2019.
- 6. Ardelaine ne figure pas sur le schéma car elle n’a pas connu de transformation à proprement parler (l’entreprise a toujours été une SCOP).
- 7. Dans le cas de Poult, il semble que les mini-usines aient été encouragées à prendre de manière autonome des décisions ayant un fort impact économique sur l’exploitation sans avoir tous les moyens d’apprécier celui-ci.
- 8. La transparence dont a fait preuve Alexandre Gérard en acceptant que nous incluions Chrono Flex dans notre échantillon et que nous rendions toutes nos observations publiques n’en est que plus remarquable, montrant que même chez ceux qui accompagnent d’autres organisations en transformation, certains restent à l’affût de regards critiques et d’opportunités de perfectionner leurs pratiques.
- 9. Discussions des auteurs avec d’anciens cadres de l’entreprise.
- 10. Le sur-engagement est défini par le cabinet Mozart qui a mis au point l’indicateur IBET comme un investissement supérieur à 95%, la zone de bien-être au travail se situant entre 85% et 95%.
- 11. Dans les grandes organisations disposant d’un marché interne des postes, on peut regarder si les demandes de mutations vers le service transformé excèdent les demandes de mutations vers d’autres services et comment cet indicateur évolue dans le temps.
- 12. Ce qui, par ailleurs, correspond à 30 tonnes de CO2 en moins dans l’atmosphère (estimation sur la base de la consommation de la nouvelle Peugeot 208).
10 points de vigilance pour ceux qui entreprennent une transformation visant à développer l’autonomie des salariés
L’objectif de cette étude est d’aider ceux qui veulent entreprendre une transformation de leur organisation pour y introduire plus de subsidiarité et développer l’autonomie des collaborateurs qui le souhaitent. Dans ce chapitre conclusif, nous décrivons dix pièges et chausse-trappes courants qu’il sera utile d’anticiper.
1. Il n’y a pas de modèle à imiter mais un principe de cohérence à respecter
Le premier enseignement de notre enquête est l’importance des singularités. Il n’y a pas de formule universelle. Les expériences les plus réussies l’ont été grâce à une bonne compréhension des spécificités de la situation, de l’histoire et de la culture de l’organisation et de ses membres, et grâce à la reconnaissance de leur diversité.
Toutefois, si les réponses sont singulières et les bricolages de modèles fréquents, il est important que les principes retenus soient cohérents entre eux. Par exemple, le primat donné au collectif s’accommodera mal de l’individualisation des rémunérations et des progressions de carrière ; invoquer à tout bout de champ la transparence sera vain si les informations économiques ou de rentabilité ne sont pas accessibles aux salariés qui doivent prendre des décisions ; le droit à l’erreur ne sera jugé crédible que si chacun constate qu’un salarié ayant pris une décision aux conséquences malheureuses ou contraire aux choix de son responsable est traité avec bienveillance ; l’abolition des distinctions peut sembler illusoire si le chef est omniprésent dans les médias ; la gouvernance collective ou répartie ne sera pas jugée crédible si le dirigeant continue à arbitrer des problèmes auxquels le principe de subsidiarité pourrait s’appliquer, etc.
2. La volonté du dirigeant est nécessaire mais non suffisante
Il est impossible d’engager une transformation ambitieuse si le dirigeant et son proche entourage ne sont pas prêts à lâcher prise, à risquer le pari de la confiance et à accepter quelques turbulences et déconvenues. Carney et Getz (2009/2016) ont bien documenté ce premier obstacle psychologique à surmonter.
Mais la bonne volonté du dirigeant ne suffit pas pour installer les conditions d’une organisation capable de fonctionner sans leader héroïque omniprésent. Certains processus de coordination, de développement et de capitalisation des capacités, de sécurité et de fiabilité, d’agilité stratégique, ne sont pas spontanément assurés par les actions autonomes de salariés, aussi responsables et bien intentionnés soient-ils. Il est nécessaire d’identifier – éventuellement par une délibération collective – les besoins de l’organisation et la manière de les prendre en compte. L’autonomie ne se décrète pas, elle s’organise (Ughetto, 2018).
3. Le dirigeant doit être au clair sur ses capacités, ses attentes et l’espace qu’il entend allouer à la concertation
Nous avons vu que les démarches de transformation ne sont pas un long fleuve tranquille et que les motivations du dirigeant peuvent être très diverses. Il importe que celui-ci ait clarifié ce qu’il attend de son entreprise de transformation, sa capacité de tolérance face à l’indétermination et aux turbulences, et ce qu’il pense réellement partager avec ses collaborateurs. Cet exercice de discernement s’appuiera de manière variable sur la réflexion personnelle du dirigeant, sur ses lectures, sur ses discussions avec divers interlocuteurs, parfois sur l’aide d’un coach ou les conseils d’un consultant. Le dirigeant doit avoir conscience que la route est longue et qu’il peut être judicieux de ne pas l’entreprendre seul et sans aide.
En particulier, il doit être au clair sur l’espace qu’il entend accorder à la concertation. Certains ont un modèle précis en tête qu’ils entendent faire adopter et vont utiliser la « concertation » comme un moyen de parvenir à leurs fins. D’autres ont une idée assez floue de ce qu’ils veulent obtenir, et vont effectivement construire le projet à partir d’un dialogue avec leurs collaborateurs. Dans cette catégorie, il y a ceux qui partent d’en haut, interrogeant d’abord leur comité de direction sur ce qui paraît possible et souhaitable, et ceux qui partent d’en bas, en demandant à chaque équipe, voire à chaque individu, dans quel domaine il souhaiterait ou se sentirait capable de prendre plus de responsabilité à son niveau. Dans ces différents cas de figure, la dynamique de la transformation ne sera évidemment pas la même.
4. Expliciter les zones rouges et les zones bleues de la démarche est un facteur de crédibilité de celle-ci
Dans tous les cas, il est important de préciser quels sont les domaines ouverts à la transformation des modes de fonctionnement et quelles sont les zones rouges où les règles restent imposées par la hiérarchie ou la loi. Le dirigeant reste responsable vis-à-vis des tiers de l’application correcte de toutes les contraintes légales et règlementaires. Si la manière de procéder pour s’assurer de leur respect peut être discutée, cet objectif n’est pas négociable. Mais le cadre imposé peut aussi s’étendre à d’autres aspects, par exemple à la détermination de la personne du dirigeant, à sa rémunération et à la stratégie de l’entreprise. Plutôt que de prétendre qu’il n’y a plus de chef mais seulement des conseillers et coaches et que chacun a le même pouvoir de décision, il est important d’être clair sur ces zones rouges, sans quoi un sincère désir d’entreprise plus participative pourrait être considéré comme une manipulation hypocrite.
Ceux qui considéreront ces zones rouges comme des évidences et jugeront contreproductif de les préciser peuvent préférer expliciter les zones bleues : sur quels domaines est-il proposé de pratiquer plus de subsidiarité, d’étendre le pouvoir d’agir ou de délibérer sur l’action opportune de chacun ?
Rien n’empêche l’extension ultérieure du domaine « bleu », lorsque la réussite des premières étapes de la transformation, le développement de la maturité de l’organisation et de ses membres, et la confiance acquise (y compris par le dirigeant lui-même) le permettront.
5. Il peut être préférable de procéder par expérimentation
À moins d’une situation catastrophique appelant des transformations urgentes et radicales, nos observations conduisent plutôt à recommander d’encourag
S’appuyer sur des équipes, des agents et des cadres volontaires et circonscrire l’ambition initiale permet de mener des premières expérimentations dans un contexte favorable. Ensuite, des premiers retours satisfaisants et évalués pourront encourager une généralisation sur certains objets d’autonomie.
6. Le management et les collaborateurs doivent être accompagnés dans la montée en autonomie
Qu’ils aient été ou non associés à la réflexion sur la transformation et ses objectifs, les collaborateurs de tout niveau peuvent être réticents ou inquiets.
Il est indispensable de leur donner l’opportunité d’exprimer leurs appréhensions et leurs objections, de montrer qu’elles sont écoutées, même si l’on ne peut répondre à toutes.
Il est souvent utile de prévoir un accompagnement et d’individualiser celui-ci pour tenir compte de besoins différenciés. Le « débrouille-toi, on te fait confiance » peut être anxiogène si le collaborateur a le sentiment de ne pas disposer des moyens pour réaliser ce que l’on attend de lui. Certains se surpasseront et inventeront des méthodes inédites. D’autres vivront mal l’injonction de peindre un Picasso sans avoir ni peinture, ni pinceaux, ni notion élémentaire d’art pictural. Les inquiétudes seront diminuées si le transfert de responsabilités est précédé d’une évaluation des ressources nécessaires, d’une formation éventuelle aux savoirs et savoir-faire nécessaires, ou d’un soutien tel que l’accès à une personne expérimentée ou experte à contacter si on le souhaite.
7. La tolérance aux objecteurs est un marqueur de la qualité de la transformation
Il est important de réfléchir à la manière dont on traitera les objecteurs. La tolérance à l’égard de ceux qui manquent d’enthousiasme est souvent un marqueur de la qualité de la transformation. Que proposera-t-on aux employés qui, malgré les encouragements, refuseront de prendre plus de responsabilités, refuseront des formations ou échoueront à acquérir les compétences requises ? Que faire des cadres qui refusent les nouveaux rôles qu’on leur assigne ou de laisser plus de marge de manœuvre aux salariés qu’ils commandaient ?
Si on veut éviter le passage en force, il peut être judicieux de prévoir des garants des droits du personnel indépendants de la direction. Ceux-ci peuvent être des facilitateurs ou médiateurs extérieurs ou des représentants institutionnels des salariés. Ils alerteront si les promesses faites au début du processus ne sont pas tenues ou si des personnes sont en souffrance.
8. La transparence est à manier avec précaution
Il est souhaitable de s’interroger en amont sur le niveau de transparence souhaitable. Si certaines délibérations conduisent à des votes, beaucoup se sentiront plus libres de s’exprimer à bulletins secrets : refuser une promotion ou une augmentation à un collègue sous le regard général est délicat. Rendre les conséquences d’une mauvaise initiative trop visibles n’est pas la meilleure manière d’encourager l’autonomie et l’expérimentation.
9. La communication externe est une arme à double tranchant
Faut-il vivre caché ou afficher largement la transformation sociale en cours ? Les bénéfices de la communication existent certes (visibilité, amélioration de la marque employeur, fierté d’appartenance des salariés), mais celle-ci expose l’organisation aux risques de décalage de perception entre celle du dirigeant, telle que véhiculée par la communication, et celle des employés qui savent ce qui se passent à l’intérieur. Il est aussi permis de se demander si l’exposition médiatique « massive » ne satisfait pas avant tout l’ego des dirigeants concernés. Au vu des effets collatéraux de la communication, la discrétion semblerait parfois préférable. Que dire, par exemple, de cette entreprise qui avait réussi une transformation sociale largement médiatisée, mais qui doit aujourd’hui faire face à un plan social douloureux ? Sa situation et celle de ses salariés sont encore plus difficiles à vivre du fait de sa surexposition médiatique.
Un exemple édifiant des effets pervers de la communication est l’histoire de l’hélicoptère de Favi. L’entreprise professait qu’elle mettait tout en œuvre pour satisfaire ses clients et tenir ses promesses. Un jour, la fabrication d’une commande ayant pris du retard, Jean-François Zobrist affréta un hélicoptère afin que les pièces soient malgré tout livrées à la date prévue. Étonnement du client qui n’avait pas un besoin immédiat de ces pièces et qu’une livraison différée de quelques jours n’aurait pas gêné. était-il plus important de montrer (tant au client qu’au personnel de l’entreprise) que Favi livrait toujours à la date prévue à tout prix, ou d’avoir suffisamment d’intimité avec son client pour s’enquérir de ses besoins réels ? Celui-ci aurait peut-être été content qu’on lui accorde une remise bien inférieure au coût de l’hélicoptère, après s’être enquis de ses besoins réels.
10. Il peut être utile d’évaluer les progrès
Plutôt que de devoir improviser face à des résultats décevants ou de découvrir que les convaincus continuent à y croire et les sceptiques à douter, il peut être intéressant de définir en début de transformation quelques objectifs et de réfléchir à la manière d’évaluer les progrès. On peut mettre en place un simple baromètre de la satisfaction des salariés et des clients, ou prévoir des rendez-vous pour délibérer des progrès réalisés (ou non), de ce qui doit être poursuivi, aménagé, remis en cause. Définir a priori le dispositif d’évaluation (recours à des tiers neutres, observateurs extérieurs, comité de pilotage paritaire) peut renforcer la crédibilité du dirigeant et manifester sa bonne foi. C’est d’autant plus nécessaire qu’il faut plusieurs années pour transformer une organisation en profondeur. L’évaluation doit donc être patiente et bienveillante, mettre en valeur les résultats déjà obtenus, mais aussi, comme pour tout projet ambitieux, insister sur ce qui reste à faire, sur ce qui peut encore progresser.
CONCLUSION
Certains de nos lecteurs pourront regretter que nous n’ayons pas mieux mis en évidence les relations positives entre montée en autonomie des salariés et performance économique de l’entreprise. Rappelons que tel n’était pas l’objet de cette étude qualitative qui s’intéresse au « comment » et non au « pourquoi » : comment introduire et pérenniser des démarches favorisant l’autonomie des salariés ? Quelles sont les difficultés rencontrées et comment les surmonter ?
D’ailleurs, même si nous avions voulu nous aventurer dans cette voie, d’évidentes difficultés méthodologiques nous en auraient empêchés. Les transformations observées jouent sur beaucoup de leviers, pas toujours les mêmes d’une expérience à l’autre, et sont survenues dans des contextes variés, parfois une crise mettant en jeu la pérennité de l’entreprise, de sorte qu’il est difficile de séparer l’impact des différents changements intervenus concomitamment, ni de comparer la situation actuelle (en mouvement) à un scénario contrefactuel inobservable1 ou aux performances d’un groupe de référence.
Bien entendu, cela n’empêche pas les entreprises de surveiller des indicateurs spécifiques : baromètre de satisfaction ou de bien-être au travail, absentéisme, turn-over, facilité de recrutement, retours sur la satisfaction des clients, taux de rétention ou d’attrition, évolution des parts de marché, conflictualité sociale, appétence des investisseurs pour continuer à accompagner le projet… Elles peuvent alors constater des inflexions de trajectoire (les clients ou les employés sont plus fidèles, les conflits se règlent par le dialogue, etc.).
Notre sentiment subjectif est que la plupart des personnes que nous avons interrogées approuvent globalement ces transformations. L’adhésion est d’autant plus forte que la démarche paraît sincère, concertée et respectueuse des individus (y compris de ceux qui ne sont pas spontanément à l’aise avec l’autonomie proposée). Le fait que chacun ait voix au chapitre et puisse exprimer son point de vue n’entraîne d’ailleurs pas de revendication d’égalitarisme. Il est important que chacun soit écouté, mais aussi admis que certains ont plus de compétences et d’information, donc pèsent plus dans la décision. Même dans le cas extrême de la SCOP Ardelaine dans laquelle il n’y a aucune différence de statut ni de rémunération, l’autorité morale des fondateurs est très respectée et leur retrait ressenti comme une menace pour la cohésion du collectif.
Nous avons aussi perçu à quel point les salariés étaient sensibles à la sincérité des discours : si un point n’est pas ouvert à la délibération, mieux vaut l’afficher clairement que de prétendre le contraire ou rester dans le flou. De même, les formes de contrôle doivent être assumées : rien de pire que prétendre faire confiance si ce n’est pas le cas. En revanche, chacun admet que le discours puisse parfois être en avance sur les pratiques, si la volonté de s’approcher du fonctionnement affiché est réelle. Chacun peut comprendre que tel cadre intermédiaire ait du mal à s’adapter au nouveau fonctionnement, que la capacité d’une équipe à prendre certaines responsabilités soit encore en construction, que de mauvais réflexes puissent resurgir. Si les procédures de délibération permettent de constater qu’on est sur le bon chemin et qu’il faut progresser, ces écarts seront tolérés. De même, beaucoup acceptent avec bienveillance que le dirigeant « nouveau converti » ritualise parfois les nouvelles règles et comportements ou emploie un vocabulaire excessif : « vous ne vous rendez pas compte des efforts qu’il fait et d’où il vient ! ».
Les plus grandes difficultés proviennent souvent de la hiérarchie intermédiaire. Si certains trouvent un nouveau sens à leur travail dans un rôle de facilitateur et de développeur de talents, beaucoup de cadres n’ont pas choisi cette transformation qui conduit à donner plus de responsabilité aux échelons inférieurs. Leur rôle devient plus ambigu. On les tiendra parfois responsables de points sur lesquels ils n’ont plus de pouvoir de décision ni d’information. Ils n’ont en outre pas toujours été préparés à jouer un rôle de coach. Les privilèges ou signes de distinction auxquels on leur demande de renoncer sont parfois pour eux le symbole longtemps convoité de leur ascension sociale ou d’efforts justement récompensés. Certaines entreprises ont d’ailleurs choisi de faire une pause dans le processus de transformation (ou dans sa généralisation à tous les départements) pour prendre le temps d’accompagner les cadres qui étaient déstabilisés ou pourraient l’être.
Cette difficulté à armer les managers pour un rôle auquel leur expérience et leur formation les ont rarement bien préparés explique peut-être que les transformations couronnées de succès sont aujourd’hui plutôt l’apanage des petites et moyennes entreprises ou de départements ou sites spécifiques de groupes. De plus en plus de grandes entreprises s’y intéressent cependant, ne serait-ce que parce qu’elles ont mené des expériences locales qui se sont déroulées de manière satisfaisante et qu’elles envient l’agilité des start-up et la mobilisation de l’intelligence collective dans les entreprises ayant mis en place des processus efficaces de délibération sur l’organisation du travail.
Après cette première étude dont rend compte ce document, nous pensons poursuivre ce travail dans trois directions :
Premièrement, nous allons maintenir notre plateforme de partage d’expériences sur les entreprises développant l’autonomie. De nombreux chercheurs et praticiens nous ont fait part de leur volonté d’y apporter leur témoignage. Nous allons les aider à mettre celui-ci dans un format qui permette son exploitation par la communauté. La plateforme est construite de telle manière que d’autres institutions peuvent s’y associer, l’étendre ou la récupérer si nous ne disposions plus des ressources nécessaires à son maintien.
Deuxièmement, nous allons désormais étendre nos investigations à de grandes entreprises, souvent multiculturelles, dont la taille et la complexité peuvent ajouter des obstacles à la transformation.
Troisièmement, les entreprises examinées dans le cadre de cette étude se sont surtout intéressées à la manière de donner plus d’autonomie et de responsabilité à chacun pour réaliser un travail dont les objectifs étaient définis (on est libre du « comment » mais le « quoi » est prescrit). Or de plus en plus d’organisations délibèrent collectivement sur leurs finalités et sur leur raison d’être. Ces deux dimensions de la « démocratisation » des entreprises sont aujourd’hui plutôt dissociées : on peut avoir une organisation du travail très classique dans une entreprise à mission ou discuter assez peu de la raison d’être et de la contribution sociétale d’une entreprise pratiquant une grande subsidiarité des décisions. Y a-t-il des synergies entre ces deux démarches, des itinéraires vers une démocratie d’entreprise portant sur les fins comme sur les moyens ?
L’aspiration à l’autonomie, à l’épanouissement au travail, à la participation à un projet socialement utile n’est pas une mode récente, mais elle pèse de plus en plus sur les choix de vie individuels. Les organisations qui y répondent attireront les meilleurs talents et profiteront de leur implication. Cela demande beaucoup d’efforts et de vigilance, d’attention à de multiples détails. Nous espérons que ce recueil d’expériences facilitera la tâche des entreprises qui s’engagent dans cette voie.
- 1. Dans une autre étude en cours que nous menons avec l’université Paris-Saclay, nous étudions l’existence éventuelle de relations causales entre les marqueurs de la Qualité de vie au travail (QVT) et la performance économique des entreprises, en nous appuyant sur deux bases de données (bilans sociaux et liasses fiscales) rassemblant environ 400 entreprises. Si cette étude a donné lieu à des premiers résultats encourageants (Caillou et al. , 2019), elle met aussi en évidence la difficulté à « prouver » des mécanismes causaux entre QVT et résultats économiques, ainsi qu’à éliminer les « effets confondants » pouvant être la cause directe à la fois de la QVT et de la performance (par exemple, le secteur d’activité).
Bibliographie
Arendt, H. (1961). La condition de l’Homme moderne (traduit par G. Fradier). Paris : Calmann-Lévy (Ouvrage original publié en 1958).
Auroux, J. (1982). Les droits des travailleurs : Rapport au Président de la République et au Premier Ministre. Paris : La Documentation française.
Ballarin, B. (2019). La responsabilisation appliquée à Michelin. Dans E. Bourdu, M. Lallement, P. Veltz et T. Weil (dir.), Le travail en mouvement . Paris : Presses des Mines.
Bonnefond, J.-Y. (2019). Agir sur la qualité du travail. L’expérience de Renault Flins. Toulouse : Erès.
Boudès, T. et Christian, D. (2000). Du reporting au raconting dans la conduite de projets. Gérer et comprendre , 59 , 52-63.
Bourdu, E., Péretié, M.-M. et Richer, M. (2016). La qualité de vie au travail : un levier de compétitivité. Refonder les organisations du travail. Paris : Presses des Mines.
Bourdu, E., Lallement, M., Veltz, P. et Weil T. (dir.). (2019). Le travail en mouvement (Colloque de Cerisy). Paris : Presses des Mines.
Bourguinat, E. (2019). De la clôture à l’esprit libre. La transformation de l’entreprise Lippi. Paris : Presse des Mines.
Brière, T. (2017). Les expériences de libération sous contrôle : réflexions sur une nouvelle velléité de démocratie dans l’entreprise. Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels (RIPCO), XXIII (56), 265-279.
Caillou, P., Kalainathan, D., Goudet, O., Guyon, I., Sebag, M., Tubaro, P., Bazet, J.-L. et Bounfour, A. (2019). Qualité de vie au travail et santé économique des entreprises : étude des causalités. Dans E. Bourdu, M. Lallement, P. Veltz et T. Weil (dir.), Le travail en mouvement . Paris : Presses des Mines.
Carney, B. et Getz, I. (2016). Liberté & Cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises (2 e éd., traduit par O. Demange). Paris : Flammarion (Ouvrage original publié en 2009).
Chabanet, D., Colle, R., Corbett-Etchevers, I., Defélix, C., Perea, C. et Richard, D. (2017). Il était une fois les entreprises « libérées » : de la généalogie d’un modèle à l’identification de ses conditions de développement. Question(s) de management, 19 (4), 55-65.
Cohen, E. (2019). La société à mission : la loi PACTE, enjeux pratiques de l’entreprise réinventée. Paris : Hermann.
Coutrot, T. (2018). Libérer le travail. Pourquoi la gauche s’en moque et pourquoi cela doit changer. Paris : Seuil.
Clot, Y. (2010). Le travail à cœur : Pour en finir avec les risques psychosociaux. Paris : La Découverte.
Clot, Y. (2019). Les conflits de la responsabilité. Dans E. Bourdu, M. Lallement, P. Veltz et T. Weil (dir.), Le travail en mouvement. Paris : Presses des Mines.
Coase, R. (1937). The Nature of the Firm. Economica, 4 (16), 386–405.
Coffineau, M. (1993). Les lois Auroux, dix ans après. Paris : La documentation française.
Collectif des # MEcrEants . (2016). Entreprise Libérée #la fin de l’illusion. Une lecture critique de la mode de l’entreprise libérée, un préalable à l’entreprise délibérée (tome 1). Repéré à http://www.e-rh.org/documents/lafindelillusion.pdf
Croset, P. (2012). L’ambition au cœur de la transformation. Paris : Dunod.
Croset, P. (2017). L’entreprise et son mouvement. Acte 1 : « Libérons les énergies » . Paris : Intedyn.
Cyert, R. M. et March, J. G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm . Upper Saddle River : Prentice-Hall.
Detchessahar, M. (dir.). (2019). L’entreprise délibérée : Refonder le management par le dialogue . Bruyères-le-Châtel : Nouvelle cité.
Diamond, J. (2006). Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie (traduit par A. Botz et J-L. Fidel). Paris : Gallimard (Ouvrage original publié en 2004).
Druon, E. (2015). Le syndrome du poisson-lune. Manifeste d’antimanagement. Paris : Actes Sud.
Dubreuil, H. (1929). Standards. Le travail américain vu par un ouvrier français. Paris : Bernard Grasset.
Dubreuil, H. (1948). L’équipe et le ballon : l’ouvrier libre dans l’entreprise organisée. Paris : Le Portulan.
de Duve, C. (2005). Singularités. Jalons sur les chemins de la vie. Paris : Odile Jacob.
Endenburg, G. (1998). Sociocracy as Social Design. Utrecht : Eburon.
Fox, F. et Pichault, F. (2017). Au-delà des success stories , quel processus de libération ? Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels (RIPCO), XXIII (56), 87-107.
Frémeaux, P. (2014). L’économie sociale et solidaire, une alternative ? Dans B. Roger, B. Segrestin et S. Vernac (dir.), L’entreprise. Point aveugle du savoir (Colloque de Cerisy). Auxerre : Sciences Humaines.
Friedmann, G. (1964). Le travail en miettes (2e éd.). Paris : Gallimard.
Gérard, A. (2017). Le patron qui ne voulait plus être chef. Paris : Flammarion.
Getz, I. (2012). La liberté d’action des salariés : une simple théorie, ou un inéluctable destin ? Gérer et Comprendre, 108 , 27-38.
Gilbert, P., Raulet-Croset, N. et Teglborg, A.-C. (2017a). « L’entreprise libérée » : analyse de la diffusion d’un modèle managérial. Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels (RIPCO), XXIII (56), 205-224.
Gilbert, P., Teglborg, A.-C. et Raulet-Croset, N. (2017b). L’entreprise libérée, innovation radicale ou simple avatar du management participatif ? Gérer et comprendre, 127 , 38-49.
Glucksmann, A. (1977). Les maîtres penseurs. Paris : Grasset.
Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology , 91(3), 481-510.
Gréselle-Zaïbet, O. (2007). Vers l’intelligence collective des équipes de travail : une étude de cas. Management & Avenir , 14 , 41-59.
Harari, Y. N. (2012). Sapiens : Une brève histoire de l’humanité (traduit par P.-E. Dauzat). Paris : Albin Michel (Ouvrage original publié en 2011).
Hervé, M., d’Iribarne, A. et Bourguinat, E. (2007). De la pyramide aux réseaux. Récits d’une expérience de démocratie participative. Paris : Autrement.
Hervé, M. et Brière, T. (2011). Le pouvoir au-delà du pouvoir : l’exigence de démocratie dans toute organisation. Paris : Editions François Bourin.
Hervé, M. (2015). Une nouvelle ère, sortir de la culture du chef. Paris : François Bourin.
d’Iribarne, A. (2017). L’entreprise libérée et les talents : un avènement annoncé ? Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels (RIPCO), XXIII (56), 247-260.
Joule, R.-V. et Beauvois, J.-L. (1987). Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens. Grenoble : Presses universitaires de Grenoble.
Lallement, M. (2015). Work and the Challenge of Autonomy. Social Science Information, 54 (2), 229–248.
Laloux, F. (2015). Reinventing Organizations. Vers des communautés de travail inspirées (traduit par P. Blanchard). Paris : Diateino (Ouvrage original publié en 2014).
Lecomte, J. (2016). Les entreprises humanistes. Comment elles vont changer le monde. Paris : Editions des Arènes.
Lévi-Strauss, C. (1962). La pensée sauvage. Paris : Plon.
London, M. et Beatty, R.W. (1993). 360-Degree Feedback as a Competitive Advantage . Human Resource Management, 32 (2-3), 353-372.
Manifeste pour le développement Agile de logiciels. (2001). Repéré à http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
March, J. G. (1978). Bounded Rationality, Ambiguity, and the Engineering of Choice. The Bell Journal of Economics , 9 (2), 587-608.
March, J. G. (1980). Autonomy as a Factor in Group Organization: A Study in Politics . Yale, New York : Arno Press (Thèse de doctorat soutenue en 1953).
March, J. G. (2000). Organisations prosaïques et leaders héroïques (traduit par T. Weil). Gérer et Comprendre, 60, 44-50 (Discours original prononcé à Mexico en 1982).
March, J. G. et Olsen, J. P. (1983). The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life. American Political Science Review , 78(3) , 734-749.
March, J. G. et Simon, H.A. (1958). Organizations. Hoboken : Wiley.
March, J. G., Sproull, L. et Tamuz, M. (2003). Learning from Sample of One and Fewer. Quality and Safety in Healthcare, 12 (6), 465-472.
Marmorat, S. et Nivet, B. (2017). L’entreprise libérée, une cité en quête d’un principe supérieur commun. Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels (RIPCO), XXIII (56), 141-161.
Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50 , 370-396.
McGregor D. (1960). The Human Side of Enterprise . New York : McGraw Hill.
Midler, C., Moire C. et Sardas, J.C. (1984). L’évolution des pratiques de gestion. É tude du développement des Cercles de Qualité dans les entreprises françaises. Économie et Sociétés, Série Sciences de Gestion , 4 , 173-211.
Midler, C. (1986). Logique de la mode managériale. Du groupe semi-autonome au cercle de qualité, des variations aussi rapides que celles de la longueur des jupes. Gérer et Comprendre, 3, 74-85.
Munzenhuter, M. et Lemaire, E. (2016). L’entreprise qui libère les énergies. Le management Perfambiance. Eckbolsheim : Editions du Signe.
Nayar, V. (2011). Les employés d’abord, les clients ensuite : Comment renverser les règles du management (traduit par A. Sécheret). Paris : Diateino (Ouvrage original publié en 2010).
Panigada, M. (2017). L’entreprise libérée, enjeux et bénéfices d’un modèle articulé autour de l’humain [billet de blog]. Repéré le 1 er octobre 2019 à https://blog.blaast.co/lentreprise-libérée-enjeux-et-bénéfices-d-un-modèle-articulé-autour-de-l-humain-3a43231e29aa
Pellerin, F. et Cahier, M.-L. (2019). Organisation et compétences dans l’usine du futur. Vers un design du travail ? Paris : Presse des Mines.
Peters, T. J. (1992). Liberation Management: Necessary Disorganization for the Nanosecond Nineties. New York : Alfred A. Knopf.
Peters, T. J. et Waterman, R. (1983). Le prix de l’excellence : les secrets des meilleures entreprises (traduit par M. Garene et C. Pommier). Paris : InterEditions (Ouvrage original publié en 1982).
Picard, H. (2015). Entreprises libérées, parole libérée ? Lecture critique de la participation comme projet managérial émancipateur (Thèse de doctorat inédite, Université Paris-Dauphine, France).
Powell, W. W. (1990). Neither Markets nor Hierarchy, Networks . Research in Organizational Behavior , 12, 295-336.
Productions Campagne Première (producteurs) et Meissonnier, M. (réalisateur) (2014). Le bonheur au travail [documentaire]. Issy-les-Moulineaux : ARTE France.
Rayssac, G.-L., Kaisergruber D. et Richer M. (2019). Délibérer en politique, participer au travail : répondre à la crise démocratique. Repéré à http://tnova.fr/rapports/deliberer-en-politique-participer-au-travail-repondre-a-la-crise-democratique
Richer, M. (2018). L’Entreprise contributive : 21 propositions pour une gouvernance responsable. Repéré à http://tnova.fr/rapports/l-entreprise-contributive-21- propositions-pour-une-gouvernance-responsable
Rigal, V. et Weil, T. (1986). Les pannes dans l’industrie. Gérer et comprendre, 2-3-4, 5-9 & 16-21 & 16-23.
Riveline, C. (1985, Juin-Juillet). Essai sur le dur et le mou. Dans M. Berry (dir.), La Jaune et la Rouge, numéro spécial « Les sciences de gestion ». Repéré à http://riveline.net/essai.pdf
Riveline, C. (2005). Evaluation des coûts. Paris : Presses des mines.
Riveline, C. (2018). Les mauvaises tonnes avant les bonnes [Vidéo en ligne]. Repéré à http://riveline.net/A2.html
Robertson, B. J. (2016). La révolution Holacracy (traduit par C. Billon), Paris : Alisio (Ouvrage original publié en 2015).
Rousseau, T. et Ruffier, C. (2017). L’entreprise libérée entre libération et délibération. Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels (RIPCO), XXIII(56), 109-123.
Ruiz, D. M. (2005). Les quatre accords toltèques. La voie de la liberté personnelle (traduit par O. Clerc). Thonon : Jouvence (Ouvrage original publié en 1999).
Segrestin, B. et Vernac, S. (2018). Gouvernement, participation et mission de l’entreprise. Paris : Hermann.
Semler R. (1993). A contre-courant : Vivre l’entreprise la plus extraordinaire au monde . Paris : Dunod.
Ughetto, P. (2018). Organiser l’autonomie au travail. Travail collaboratif, entreprise libérée, mode agile… L’activité à l’ère de l’auto-organisation. Paris : FYP.
Verrier, G. et Bourgeois, N. (2016). Faut-il libérer l’entreprise ? Confiance, responsabilité et autonomie au travail. Paris : Dunod.
Weick, K. E. (1995). Sensemaking in Organizations . Thousand Oaks, CA : Sage Publications.
Weil, S. (1951). La condition ouvrière. Paris : Gallimard.
Weil, T. (2000). Invitation à la lecture de James March. Paris : Presses des Mines
Weil, T. (2008). Stratégie d’entreprise. Paris : Presses des Mines.
Wilkinson, R. (2002). L’inégalité nuit gravement à la santé (hiérarchie, santé et évolution) (traduit par O. Bonis). Paris : Cassini (Ouvrage original publié en 2000).
Zarka, M., Kochanovskaya, E. et Pasmor, W. (2019). Braided Organizations . Charlotte: Information Age Publishing.
Zobrist J.-F. (2014). La Belle Histoire de Favi : L’entreprise qui croit que l’homme est bon. Courbevoie : Humanisme et organisations.
Points de vue – De nouvelles pistes de recherche passionnantes à explorer
Par Michel Lallement, professeur au Cnam, Chaire d’Analyse sociologique du travail, de l’emploi et des organisations, Lise-CNRS
Les entreprises « libérées » ont déjà fait couler beaucoup d’encre. À ce jour, nous ne disposons pourtant que de trop peu de travaux de qualité pour appréhender empiriquement comment, en pratique, se déclinent les ambitions d’autonomie et de responsabilité des organisations qui en appellent à la « libération ». Cette recherche conduite sous la responsabilité de T. Weil et d’A.-S. Dubey est donc particulièrement bienvenue. Appuyée sur des cas concrets à l’aide d’une grille d’analyse transversale, elle permet d’entamer une montée en généralité et d’aboutir de façon sérieuse à des conclusions qui méritent réflexion. Comme pour toute étude stimulante, la valeur de ce travail se mesure autant à la solidité et l’originalité des résultats obtenus qu’aux nouvelles questions et pistes de recherche que ceux-ci suscitent immédiatement. Ce commentaire donne la priorité à ce volet. À la lecture, pour être plus exact, trois ensembles de réflexions me sont venus à l’esprit.
Le premier concerne les déterminants sociaux de la propension à l’innovation organisationnelle ainsi que les liens entre action managériale et espace organisationnel. Les auteurs de cette recherche constatent que l’initiative en faveur de la « libération » est le fait d’individus en position de responsabilité, ayant déjà un statut de leader, etc. L’ouvrage fournit quelques éléments pour interpréter un tel état de fait. Mais ce fil ne mériterait-il pas d’être tiré plus fermement, en regardant avec plus d’attention encore les trajectoires sociales des un.e.s et des autres, ainsi que la façon dont les innovations en faveur d’un surplus d’autonomie et de responsabilité s’accordent, ou non, avec des pratiques antérieures informées par ce que J.-D. Reynaud appelait les régulations autonomes ? Dans un esprit similaire, doit-on conclure que l’action dirigeante est la seule à pouvoir déboucher vers plus d’autonomie et de responsabilité, les organisations syndicales de salariés étant condamnées, comme le laissent penser les cas étudiés, à accompagner, de façon plus ou moins critique, l’initiative de l’employeur ? En tentant de répondre à ces questions, on chemine sur une ligne de crête qui peut faire basculer soit du côté de l’optimisme béat soit, à l’inverse, du côté de la dénonciation (celle de l’instrumentalisation par la mobilisation de thèmes et la formalisation de pratiques traditionnellement associées à la régulation autonome). Une des forces de cette recherche est de ne jamais verser dans l’un ou l’autre de ces registres d’interprétation mais d’esquisser une analyse bien plus nuancée de l’action managériale.
Le deuxième ensemble de réflexions a trait aux liens entre profils identitaires, cultures organisationnelles et pérennité des expériences de « libération » analysées. Les auteurs de cet ouvrage remarquent à juste titre que, en situation de travail, certaines personnes n’ont cure de l’autonomie qu’on peut leur proposer. Plus que la contradiction classique qu’une telle option porte avec elle (l’injonction à l’autonomie est par définition un processus hétéronome), cette recherche incite à remettre sur le chantier les travaux déjà anciens de Renault Sainsaulieu, afin de lier plus fermement des configurations identitaires (forgées classiquement à partir des variables comme le genre, l’âge, la génération, la qualification, la carrière, etc.) et l’engagement vers plus d’autonomie, étant entendu que, comme le notent justement les auteurs, les paramètres constitutifs de l’autonomie sont également pluriels. En un mot, il serait passionnant d’évaluer l’implication (et la durabilité de cette dernière) des salariés selon leurs trajectoires et leurs profils. Il découle de ces considérations un deuxième questionnement relatif aux conditions de pérennité de ces expériences, dont on peut faire l’hypothèse qu’elles ont à voir avec les configurations identitaires dont il vient d’être question mais aussi avec l’histoire et la culture des entreprises considérées. Ce type d’innovation est-il condamné à réussir à court terme pour s’essouffler ensuite rapidement ? Et si non, à quelles conditions ? En quoi l’histoire organisationnelle et les ressources symboliques de l’entreprise aident-elles, ou non, à faire vivre un projet « émancipateur » ? Cette recherche ne fournit pas d’éléments de réponse assurés à ces questions, mais ce n’était probablement pas son ambition initiale.
Le dernier ensemble de réflexions s’appuie sur le constat que, pour des raisons méthodologiques aisément compréhensibles, l’enquête a été menée dans un cadre hexagonal. Sans tomber dans le piège d’un culturalisme caricatural, il serait loisible de se questionner sur l’existence, ou non, d’un « effet pays », en confrontant notamment les résultats de cette étude à d’autres comparables, si elles existent, qui ont pu être menées hors de nos frontières. Dans un esprit un peu différent, la question de la circulation des idées et de l’impact de leur importation hors des espaces où elles ont vu le jour mériterait également attention. Pour le dire plus clairement : telles qu’elles sont valorisées dans les pays anglo-saxons ou les pays nordiques, l’autonomie et la responsabilité correspondent-elles à terme aux pratiques et aux orientations latines ? Si non, à quelles conditions peut-on mettre en musique des diagrammes organisationnels innovants qui prétendent le plus souvent à l’universalité ? Enfin, il serait probablement heuristique d’historiciser les discours et les pratiques qui sont ici observés afin de mieux comprendre la portée réelle de ces expériences à l’aune d’une histoire qui a parfois recouvert d’une épaisse couche d’amnésie des innovations comparables. On pourrait probablement, de la sorte, tirer des conclusions utiles pour notre présent et notre futur. Mais cela est déjà, il est vrai, un tout autre programme de recherche encore.
Point de vue – Libérer l’entreprise ? Un regard franco-allemand
Par Clémentine Marcovici, ingénieure au Corps des Mines.
Elle prépare une thèse sur Ingénieurs en France et en Allemagne : formation, missions, rôle dans la transformation de l’industrie.
Les entreprises allemandes évoluent dans le même environnement globalisé que les entreprises françaises, et les aspirations des salariés allemands vont dans le même sens que celles des salariés français. Les éléments d’organisation perçus comme « traditionnels » (structure hiérarchique, silos, etc.) ou « modernes » (réactivité, agilité, digitalisation, etc.) sont comparables dans les deux pays. Cependant, le chemin emprunté par les entreprises de chaque pays pour se transformer puise à des sources culturelles qui demeurent très différentes.
À la lecture de cette étude, deux points m’ont frappée de manière symptomatique.
Premièrement, toute l’approche décrite ici commence par le dirigeant. Il me semble que cela est typiquement français : la transformation part de la volonté du roi. Il s’agit certes d’un roi « moderne », mais les cadres de l’entreprise continuent de se comporter comme les seigneurs de la cour d’antan. Ils cherchent avant tout à comprendre la volonté du roi, à la deviner presque mieux que lui-même : puisque le roi attend de moi une parole libre, je vais avoir la parole libre qu’il attend, jusqu’au point-limite où il ne voudra plus m’entendre, et je m’arrangerai alors avec cela. Tous les regards sont tournés vers le roi pour comprendre sa volonté et ensuite vient l’exécution.
Les entreprises allemandes se transforment aussi, mais en prenant un autre chemin. Par exemple, un ingénieur de R&D va suggérer à l’usine d’utiliser un nouveau logiciel pour améliorer la machine de production de câbles : il y aura moins de pertes, cela est prouvé. Il convainc alors les différents interlocuteurs de l’usine de la pertinence de sa démarche sur un plan technique. Il les connaît d’ailleurs très bien, car il y vient presque tous les jours – différence notable par rapport à la France. À cette occasion, les ouvriers sont formés au nouveau logiciel et ils effectuent désormais un travail un peu plus « haut de gamme » à travers lequel ils acquièrent une nouvelle autonomie. Le contremaître propose aussi d’organiser différemment l’équipe pour s’adapter au nouveau fonctionnement de la machine : dès lors que ces ouvriers effectuent un travail à plus haute valeur ajoutée, on supprime une couche hiérarchique et l’on met en place une réunion périodique, etc. L’ingénieur de R&D propose à une autre usine un projet similaire : il a adapté le logiciel pour une autre machine. Lentement, le changement se propage. Au bout de quelques années, toute l’entreprise fonctionne de manière plus « libérée » que précédemment. Le dirigeant a été tenu informé de ces transformations, ainsi que les syndicats, et leur avis a bien entendu été pris en compte : le dirigeant a voulu savoir si le logiciel était aussi performant à très haute température, afin d’anticiper l’évolution probable du procédé, et les syndicats se sont prononcés sur le lundi plutôt que le vendredi pour la réunion périodique.
Même si mon propos peut paraître quelque peu caricatural, il en ressort cependant que, pour aller d’un point A à un point B, les Français regarderont vers le haut, seront emmenés par la volonté du dirigeant, essaieront de comprendre cette volonté et l’appliqueront comme ils peuvent, tandis que les Allemands regarderont vers le bas, vers la réalité des produits, des clients, du travail dans l’usine, des emplois du temps, et essaieront de modifier ce réel.
Deuxièmement, le langage utilisé au sujet de ces transformations dans l’entreprise est aussi très typique. Dans la présente étude, des mots tels que « liberté », « autonomie », « contrôle » ou « confiance » sont employés d’une manière courante et fluide, sans trop se préoccuper de définition ou de contextualisation, tant celles-ci semblent évidentes et implicites. En allemand, un tel vocabulaire, à savoir « Freiheit », « Autonomie », « Kontrolle », « Vertrauen », est beaucoup plus lourd de sens. Un auteur allemand accorderait probablement beaucoup plus d’espace, d’une part, à la description de la réalité de l’entreprise (à la manière d’un ingénieur technique) et, d’autre part, à la signification de chacun de ces mots pris isolément, pour chercher à en cerner la signification précise (à la manière d’un philosophe) : a contrario, cette étude est très révélatrice d’une culture française de l’implicite versus une culture allemande de l’explicite.
Toujours sur le plan du langage, « sois autonome ! » est en allemand une injonction paradoxale qui peut pousser à la paralysie. Un Allemand est autonome et son autonomie provient par définition de lui-même : elle ne peut pas être ordonnée par un tiers. À l’inverse, « sois autonome ! » prononcé par un Français signifie : « adapte-toi à ma volonté, fais ce que j’attends de toi : dans ce nouveau contexte, je t’expliciterai encore moins précisément que précédemment ce qui est attendu de toi, tout sera encore plus implicite qu’auparavant, les règles du jeu de l’adaptation se sont durcies, il n’y a plus de mode d’emploi et tu dois pourtant t’y adapter car j’ai l’autorité ». La sanction du dirigeant à l’égard de son collaborateur – « je trouve que tu n’es pas assez autonome » – pourra tomber à tout moment, assortie de l’exigence : « tu n’es pas assez autonome, c’est pourtant simple, fais simplement ce que j’attends de toi, j’attends de toi que tu sois plus autonome ! ».
Ces considérations font écho à deux difficultés des processus de changement.
Un grand risque du changement « à la française » est de se noyer dans l’irréalité : les mots sont beaux, la pensée est belle, mais la réalité ne suit pas. Ce sont, par exemple, ces réunions au siège de l’entreprise où le comité exécutif discute de la stratégie de changement à mener au sein de la direction de la stratégie du changement ou des évolutions de l’indicateur sur le nombre d’indicateurs. Le roi et sa cour s’enferment dans leur propre discours : tous racontent la même histoire, mais progressivement les mots se vident de contenu réel. L’entreprise disparaît sans que personne ne s’en rende compte : plus tard, personne ne saura expliquer les mauvaises performances économiques du pays révélées par les chiffres de l’INSEE.
Un grand risque du changement « à l’allemande » est de se paralyser dans la réalité : modifier cette réalité, changer les machines, changer les emplois du temps, etc., semble demander une énergie telle, que plus personne ne sait réellement par où commencer. La machine qui tombe en panne n’est finalement pas réparée, le jeune successeur du responsable de maintenance, parti à la retraite après toute une vie dédiée à l’usine, quitte l’entreprise quelques années après y être entré sans que personne n’essaie de comprendre pourquoi, etc. L’entreprise vieillit, perd son savoir, perd ses machines, meurt lentement et finit sans surprise par disparaître.
Les Français se perçoivent plutôt comme rapides et agiles. En passant par l’« idée » du changement par opposition à sa réalité, ils produisent un effet démultiplicateur qui donne une impression de vitesse. La « libération » est présentée comme possible dans toutes les entités, dans toutes les entreprises, et un nouveau logiciel pour la production de câbles devient le symbole de cette transformation. Mais derrière ce mot de « libération » prononcé par le dirigeant lors de chacune de ses interventions, il ne restera peut-être dans quelques années qu’une instruction digitale qui aura remplacé une instruction papier : l’ouvrier a dorénavant accès au document sur un répertoire partagé et peut le modifier lui-même, mais comme il connaissait déjà très bien ses tâches, cela n’a qu’un impact limité sur la qualité des produits.
À l’inverse, les Allemands se perçoivent plutôt comme lents et à la traîne : ils n’ont pas de grande histoire à raconter ; certes, ce nouveau logiciel passionne l’entreprise, les clients sont intéressés, mais ce n’est qu’un logiciel, on ne va pas parler de Freiheit, on va se contenter de présenter les bienfaits du logiciel à la prochaine Messe (foire) du câble. Lors de cette foire, on discutera avec les fournisseurs spécialisés, on rencontrera les clients fidèles, on aura peut-être, en observant les stands, de nouvelles idées pour de nouveaux investissements, mais malheureusement on ne peut pas tout faire en même temps et tout prend du temps. Bien sûr, on aimerait aller plus vite si seulement on pouvait y arriver !
Mais en dépit de ces chemins dissemblables, l’entreprise allemande, dont la transformation ne fera probablement pas l’objet d’un « cas d’école » pour la littérature académique, sera finalement aussi « libérée » que l’entreprise française.
Point de vue La responsabilisation des salariés est la pierre angulaire de la responsabilité de leur entreprise
Par Thibaut Cournarie, directeur en charge des développements sur les sujets de transformation responsable, et François-Régis de Guenyveau, consultant, Kea & Partners.
L’actualité managériale de ces dernières années produit comme un écho.
D’un côté, auteurs et praticiens remettent sur le devant de la scène les thèses en faveur de la responsabilisation des salariés. Une responsabilisation défendue bien souvent pour des raisons d’efficience, de productivité, ou d’épanouissement professionnel, source de compétitivité, et qui ne peut aboutir sans un gain d’autonomie : marge de manœuvre dans les décisions, prise d’initiatives individuelles et collectives, réalisation des talents.
De l’autre côté, un nombre croissant d’observateurs et d’acteurs économiques appellent à une plus grande responsabilisation des entreprises pour combler les déséquilibres actuels et inventer un autre modèle économique plus respectueux de la société et de l’environnement.
Responsabilisation des salariés ; responsabilité des entreprises. Si ces deux sujets convoquent des stratégies et des transformations organisationnelles différentes, l’engouement dont ils font l’objet n’est pas le fruit du hasard ; tous deux sont en effet inextricablement liés (1). À vrai dire, il semble qu’une démarche d’autonomisation des salariés finit toujours par tirer le fil de la raison d’être de l’entreprise (2). Et réciproquement, un engagement social et environnemental de l’entreprise ne saurait être parfaitement crédible s’il n’est pas incarné à travers la responsabilisation de ses salariés (3).
1. La prise de conscience simultanée de l’autonomie des salariés et de la responsabilité des entreprises n’est pas le fruit du hasard
À l’origine, ces deux champs de pensée ont émergé pour répondre aux dérives sociales et écologiques du capitalisme traditionnel, tel qu’il a été conçu et développé à partir du dix-neuvième siècle. On trouve des échos de cette critique dans le champ académique, notamment à travers l’école des relations humaines (Elton Mayo, Kurt Lewin) à la fin des années vingt. Dans le champ littéraire, avec notamment les romans de Steinbeck (Les raisins de la colère, Des souris et des hommes). Ou encore dans le champ philosophique, avec des figures comme Simone Weil (La condition ouvrière) ou, plus récemment, Hans Jonas (Le principe responsabilité).
De tous ces écrits jaillit le même avertissement : le capitalisme libéral et technoscientifique structurant nos sociétés depuis deux siècles peut certes améliorer nos conditions de vie, mais il peut aussi fragiliser durablement la société et les écosystèmes naturels. Face au mythe d’un Homme devenu « maître et possesseur de la nature » par le secours d’un rationalisme pur, concentré sur la valeur de l’avoir, il s’agit de reconnaître la complexité du réel et de renouer avec la valeur de l’être.
2. Une démarche de responsabilisation des salariés finit toujours par poser la question de la raison d’être de l’entreprise et, in fine, de sa responsabilité
Est-il possible de responsabiliser durablement des équipes sur la manière d’effectuer leur travail sans leur en donner les raisons fondamentales ni leur permettre de contribuer aux orientations prises ?
Récemment, à l’occasion d’une démarche de responsabilisation dans un grand groupe industriel français, le premier souhait exprimé par les salariés a porté sur la maîtrise de l’impact écologique de leurs activités. Si cet exemple est un signe des temps, il illustre aussi le fait que chaque acte d’autonomie, quel que soit le niveau hiérarchique, est porteur d’une intention. L’effort fourni finit par interroger la finalité de l’activité poursuivie. Le « comment » vient questionner le « quoi » et le « pourquoi ». Il est donc illusoire de penser qu’un processus de responsabilisation des équipes puisse s’auto-entretenir durablement sans finir par questionner la raison d’être de l’entreprise.
Voilà pourquoi de nombreuses entreprises qui ont mené des expériences d’autonomisation ont fini par ouvrir le chantier de leur raison d’être ou de leurs valeurs. Voilà aussi pourquoi la loi PACTE introduisant le statut d’entreprise à mission préconise, simultanément, la participation des salariés aux instances de décision.
3. Réciproquement, la responsabilité d’une entreprise ne peut être pleinement exprimée et incarnée sans une démarche de responsabilisation de ses salariés
Deux visions s’opposent pour caractériser la place d’une entreprise dans son écosystème. La première est celle du désencastrement. Elle considère que les sphères sociales, environnementales et économiques sont indépendantes les unes des autres et que chacune possède des contraintes qui lui sont propres. La seconde est celle de l’encastrement. Elle considère que l’activité économique est imbriquée dans la société, que la société est imbriquée dans la biosphère, et que toutes trois sont liées par des interactions complexes.
Jusqu’à présent, le modèle d’entreprise dominant reposait sur la première vision. Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour faire remarquer que cette posture est irresponsable, voire destructrice de valeur, et qu’il est urgent d’adopter une perspective d’encastrement pour répondre aux défis sociaux et environnementaux engendrés.
Nous pouvons appliquer le même raisonnement au niveau du management. La vision de désencastrement a dominé la pensée managériale, en séparant de manière radicale l’institution décisionnaire du terrain exécutoire. Or pour répondre aux défis sociaux et environnementaux, il est urgent d’adopter une vision d’encastrement dans la pratique managériale.
La première raison de ce nouvel impératif est d’ordre pragmatique. Solliciter la contribution des salariés est la seule manière de transformer l’organisation en profondeur. Aucune transformation de cette ampleur ne peut venir d’une seule tête pensante. La seconde raison est éthique. Impliquer les équipes est la seule manière d’avoir une cohérence entre le discours institutionnel et les actes par lesquels on le jugera. Pour le dire autrement, un discours de responsabilité d’un dirigeant soutenu par des actes philanthropiques personnels sera invariablement perçu comme du « mission washing ». Ce qui fait la différence, c’est l’expérience que chacun peut faire de son autonomie de décision et d’action pour contribuer à la responsabilité de son entreprise (c’est l’exemple emblématique de Patagonia). La troisième raison – biomimétique – relève davantage de l’intuition : il est probable qu’une entreprise qui fonctionne comme un organisme vivant et moins comme les rouages d’une machine a plus de chances de se connecter de manière synergique à son environnement. Or l’organisation en réseau de cellules autonomes et interconnectées des entreprises responsabilisantes est, à ce jour, ce que nous avons fait de plus ressemblant au fonctionnement de la nature.
Pour faire face à la complexité croissante du monde, pour ne pas l’occulter et ne pas rester interdit devant elle, Edgar Morin préconise d’user du principe hologrammatique : chaque individu contribue à composer le groupe, et, inversement, l’ensemble des caractéristiques du groupe se retrouve dans chaque individu. Cette dialectique, nous l’avons retranscrite sur le plan organisationnel autour du concept d’holomorphisme, selon lequel la dynamique de transformation d’une organisation vient de la tension entre la force de son unité d’action et les forces des jeux personnels de ses membres.
Il en va de même pour le sujet qui nous intéresse. Pour qu’elle soit effective et réponde de manière tangible aux grands enjeux sociaux et climatiques, la transformation de l’entreprise doit provenir à la fois de l’institution et des individus. En cela, nous pouvons dire qu’il n’y a pas de responsabilité d’entreprise sans autonomie des salariés.
Point de vue Peut-il y avoir un « au-delà » de l’entreprise libérée dans les grands groupes industriels ?
Par Frédéric d’Arrentières, expert leader en management de projet pour le groupe Renault.
Pour un groupe comme Renault, la lecture de cette enquête menée par Thierry Weil et Anne-Sophie Dubey est éclairante. Les analyses des cas d’entreprises de taille moyenne étudiées et les points de vigilance soulevés sur « l’autonomisation du travail » font largement écho aux changements entrepris dans nos organisations. Dès lors, des possibilités d’approfondissement existent dans plusieurs directions pour mieux appréhender cet « au-delà » de l’entreprise libérée, appelé de leurs vœux par certains managers et dirigeants.
La transformation de l’organisation et du travail : un enjeu permanent d’adaptation
Renault entretient depuis des décennies une réflexion permanente sur son organisation pour permettre à l’entreprise de s’adapter aux changements de contexte et aux nouvelles exigences de performance. Aujourd’hui encore, des transformations importantes et coûteuses sont engagées, et malgré les bénéfices incertains, elles sont jugées nécessaires par tous les managers pour préparer l’avenir. Les contours de « l’état final recherché » ne sont pas toujours clairs ni prescrits d’avance. Dans un contexte de ressources limitées, il s’agit de développer de nouveaux modes de fonctionnement et de coopération pour faire face à un environnement technique de plus en plus complexe, interdépendant et partie intégrante d’un écosystème qui dépasse les frontières de l’entreprise. D’aucuns diraient qu’il s’agit de « simplifier »… De ce point de vue, on se rapproche du « bricoleur délibéré », évoqué dans cette étude, qui avance pas à pas. Il s’agit bien d’un cheminement auquel sont appelés tous les managers de l’entreprise.
L’enjeu pour Renault est de durer dans un marché automobile en mutation et dont certains estiment qu’il est entré dans une phase « darwinienne ». Même si les managers appellent de leurs vœux des évolutions en termes de management, de méthodes de travail et d’organisation, l’implication efficace de la majorité des salariés dans cette dynamique est indispensable pour réussir ces changements. Il s’agit donc d’un projet collectif.
Renault a certainement été parmi les entreprises pionnières dans la mise en œuvre de petites équipes autonomes et transversales par le passé. C’est toujours vrai dans les usines de production qui appliquent de longue date le lean manufacturing. Cela a été vrai aussi dans l’amont des développements, avec par exemple des projets composés de petites équipes centrées sur un objectif commun de pièces à développer pour un véhicule. Avec une large autonomie de pilotage et de décision en coût, qualité et délai, proches de leurs fournisseurs, ces équipes qui rassemblaient des compétences d’ingénierie, d’achat, de logistique, de fabrication et de qualité… étaient collectivement responsables du « end-to-end » pour le client au sein de leur « petite entreprise ». Malgré les succès enregistrés, ces organisations se sont étiolées au fil des ans face aux nouvelles contraintes. Celles-ci ont non seulement pour origine la complexité toujours croissante des exigences et des dépendances techniques, mais aussi les choix stratégiques de ressources guidés par des enjeux de performance économique de plus en plus globaux. Aujourd’hui encore, l’entreprise se doit de réinventer son organisation sur la base de principes parfois anciens, mais aussi à partir de modèles venant d’autres horizons pour lesquels l’autonomie a été un facteur de succès (modèle agile issu des industries du logiciel par exemple). Des évolutions similaires sont d’ailleurs en cours dans de nombreux groupes industriels.
Les valeurs collectives de l’entreprise comme terreau de la transformation
Le hasard a voulu que la lecture de cet ouvrage arrive le lendemain d’une visite saisissante d’une entreprise d’ATD Quart Monde mettant en pratique l’autonomie dans le travail et le fonctionnement agile, sans qu’aucun cadre conceptuel n’ait été déployé pour ce faire. Le moteur de cette transformation s’est, de mon point de vue, forgé sur l’instinct de survie des employés, dont le parcours était jonché d’échecs ou d’expériences professionnelles et familiales douloureuses. Leur « au-delà », qui passait par un CDI, était la simple survie par l’adhésion à une charte de valeurs communes, la mise en commun permanente de leurs savoir-faire et le soutien sans faille du collectif face aux fragilités exacerbées de chacun.
À l’heure du « machine learning », de la digitalisation, de l’automatisation et des nouveaux « modèles » recommandés par tel ou tel cabinet de conseil ayant l’écoute des dirigeants, la première clé de réussite d’une transformation semble être la résilience des valeurs portées par la culture d’entreprise qui transcendent souvent les postures ou les injonctions managériales. C’est une bonne nouvelle. Ce terreau culturel est à mon avis un élément d’étude à approfondir, car c’est peut-être et avant tout ce qui relie les individus et les managers travaillant ensemble, génération après génération. Combiné aux savoirs et aux talents, c’est une vraie richesse de l’entreprise qui réapparaît ainsi au grand jour (parfois tardivement). Sur ces bases, l’initiative managériale d’autonomisation pourrait alors aussi être vue comme une opportunité enfin saisie par le management intermédiaire, pour enclencher des changements identifiés de longue date et souhaités par des opérationnels parfois trop longtemps restés le « nez dans le guidon » ou pas toujours entendus. Cette dynamique portée par une culture d’entreprise commune est vitale dans l’économie de la transformation et conduit à des solutions forcément spécifiques et contextualisées. Tel ou tel modèle ne s’applique pas à la lettre, loin s’en faut, comme le relève l’étude.
La question des compétences dans un écosystème étendu
Les groupes automobiles jouent leur survie sur le long terme. Ils se regroupent, doivent relever en même temps de nombreux défis technologiques (connectivités, électrification, conduite autonome…), accroître leur capacité d’innovation tout en standardisant à grande échelle, s’intégrer dans des écosystèmes de mobilité en pleine mutation et faire face à de nouveaux concurrents, en matière de services notamment. Ils doivent développer une grande « ambidextrie », devant maintenir d’une main les produits d’hier qui font le succès d’aujourd’hui et créer de l’autre les produits de demain dont l’horizon technologique ne cesse de s’étendre et de se complexifier à grand coût, compte tenu des exigences des marchés et des nouvelles réglementations…
À l’échelle de tels groupes, il est nécessaire d’étudier la problématique des compétences et des multiples champs d’expertise qui sont à couvrir pour atteindre tous les objectifs stratégiques. Sans remise en question du statu quo, c’est une équation impossible. L’autonomisation au travail s’appuie souvent sur le travail en équipe. Comment assurer le niveau de compétences collectives et d’expertise nécessaires à une équipe autonome pour garantir ses livrables ? Et pour aller encore un peu plus loin, comment peut-on éviter un changement radical des cadres contractuels nécessaires au développement d’un écosystème de compétences plus ouvert et plus fluide, qui dépasse les frontières de l’entreprise ? Quelles sont les contraintes et les opportunités de l’autonomisation au travail dans l’entreprise étendue ou dans le cadre d’une Alliance à plus grande échelle comme celle de RenaultNissan ?
La digestion du mille-feuille
Nos grands groupes industriels ont tous développé des « systèmes » internes de management de la qualité et de la performance, notamment pour assurer la pérennité du savoir-faire indépendamment des talents individuels. Culture des processus et audit, procédures de contrôle, règles qualité, KPI de tête… peu de place est laissée à l’autonomie et à l’adaptation des équipes dans ce cadre très (trop ?) rationnalisé. Ainsi, la structuration excessive de l’organisation ou des processus de coopération peut-elle freiner la capacité d’adaptation et les possibilités de changement qui s’avèrent pourtant nécessaires.
S’il faut changer son fusil d’épaule pour préparer l’avenir, comment avaler et digérer certaines couches du « mille-feuille » ainsi constitué, sans lâcher la proie pour l’ombre ? La réduction du nombre de contrôleurs et le développement de l’autonomie des équipes sont-ils un facteur de risque supplémentaire pour l’organisation ou au contraire une opportunité de réduire des erreurs qu’une organisation très programmée peine à détecter ? Une telle démarche a fait ses preuves en production, mais dans la R&D, les risques sont tout autres… Au-delà même du droit à l’erreur, voilà encore un point à objectiver, compte tenu des changements induits par l’autonomisation avec, par exemple, la mise en place d’équipes agiles coordonnées à grande échelle.
Finalement, c’est un florilège de questions qui se sont ouvertes à la lecture de cette enquête, laissant le champ libre pour emprunter de nouvelles pistes vers cet « au-delà » de l’entreprise libérée qui est loin d’être certain.
Annexe : Résumés des cas d’entreprise1, 2
Ardelaine
Caractéristiques
Ardelaine existe depuis 37 ans (après 7 ans de préparation du projet) et emploie 47 équivalents temps plein (pour 58 salariés, dont 80 % en CDI, et 2,4 M€ de chiffre d’affaires). La plupart des salariés sont coopérateurs et tous sont payés au SMIC (sauf les dirigeants qui ont 20 % de plus, en partie pour compenser des charges supérieures). Les résultats sont partagés entre 45 % mis en réserve, 45 % partagés à égalité entre les salariés, 10 % de dividendes aux coopérateurs. Environ les deux-tiers des employés ont fait le choix de ce modèle coopératif et pourraient prétendre à une rémunération plus élevée ailleurs, un tiers a trouvé une opportunité d’emploi local.
La SCOP fait partie de la filière de la laine, de la tonte des moutons au filage, à la fabrication de matelas et de vêtements et à leur distribution. Elle a créé deux musées (sur l’élevage du mouton et sur l’industrialisation de la filière) avec boutique, restaurant et café-librairie. Elle offre à près de 200 éleveurs locaux un débouché supplémentaire en valorisant la laine, et des emplois dans une région rurale montagneuse de l’Ardèche.
Ardelaine se veut une entreprise apprenante et éducative, qui encourage la formation, la polyvalence et le partage des connaissances et des responsabilités.
Dynamique
L’entreprise ayant été créée comme SCOP, le problème est ici plutôt d’entretenir la flamme dans la durée, de faire que ce projet coopératif, qui demande une discipline personnelle et des sacrifices importants, notamment aux plus qualifiés, en raison de la faible marge des métiers exercés (textile, artisanat, médiation culturelle) ne soit pas remplacé par une culture du salariat.
Cadre
Un comité de direction de 7 personnes gère le quotidien, un conseil d’administration bimestriel de 16 personnes prend les décisions importantes ; une réunion de tous les salariés est l’occasion de partager toutes les informations trimestriellement et de faire une fois par an le bilan de chaque secteur et d’étudier les pistes d’amélioration ; des chantiers biannuels permettent d’avancer sur des projets spécifiques. L’AG annuelle des coopérateurs élit le CA.
Même dans une entreprise aussi soucieuse de transparence, les séances du CA ne sont pas publiques, car on peut y évoquer des situations personnelles délicates. Par ailleurs, certains votes d’AG se font désormais à bulletins secrets, ce qui est jugé plus démocratique par les nouveaux dirigeants, car devoir se positionner publiquement, éventuellement contre l’avis ou la demande d’un collègue, peut freiner l’expression sincère de son opinion.
Autonomie
L’entreprise se revendique comme autonome car libre vis-à-vis de la distribution qui souvent accapare les marges, et vis-à-vis d’actionnaires extérieurs (les salariés coopérateurs conservent au moins 51 % des droits de vote). Ils ne prétendent pas que les individus sont autonomes comme des artisans. Il n’y a pas vraiment d’objectif défini, si ce n’est la survie de l’entreprise et la vitalité du collectif. Le fonctionnement repose sur beaucoup d’ajustements mutuels.
Processus, instrumentation de gestion
Les employés sont embauchés un an en CDD, avant confirmation éventuelle en CDI. Ils ont deux ans pour devenir coopérateurs (avec un prélèvement sur salaire qui vient augmenter le capital de la SCOP).
Beaucoup admettent qu’il est difficile d’intervenir lorsqu’un collègue a un comportement inadapté (retards systématiques, négligences diverses). Des primes de séparation à l’amiable ont parfois été versées à des salariés qui souhaitaient partir et profiter d’indemnités de chômage, ce qui a pu agacer ceux qui restaient. Le manque de reconnaissance personnelle, y compris dans les intitulés de postes (car la convention collective imposerait de mieux les rémunérer), peut poser problème à certains.
Chrono Flex
Caractéristiques
Forte de 320 salariés (et quelques sociétés sœurs regroupées dans la holding Inov’On), Chrono Flex est une ETI spécialisée en dépannage rapide de flexibles de machines de chantier, sur le site du client. Créée en 1995 à Nantes, elle adhère aux principes de l’entreprise libérée depuis 2010. Sa réorganisation progressive en équipes autonomes, dépourvues de cadres intermédiaires et connues sous le nom de speed boats, constitue l’exemple par excellence d’une transformation avant tout motivée par des objectifs de productivité. Elle est l’un des exemples les plus connus d’« entreprise libérée ».
Dynamique de la transformation
En 2009, après la crise financière et pour la première fois depuis sa création, l’entreprise nantaise a connu des pertes considérables, dues au déclin rapide de son chiffre d’affaires. Pour combler ce trou, un regain en productivité à hauteur de 10 % s’avérait indispensable. Malheureusement, l’auto-motivation des salariés n’a pas suffi pour acquérir un nombre suffisant de clients à temps et l’entreprise a dû se séparer d’une partie de ses collaborateurs.
Une année après, en 2010, le PDG fondateur de Chrono Flex a décidé de basculer vers un nouveau mode de gestion, comme dernier recours. Après s’être concerté avec le comité de direction, il s’appuie sur les idées de l’ancien PDG de Favi pour réorganiser Chrono Flex selon les principes de l’intelligence collective et de la subsidiarité. La stratégie adoptée : agir sans rien dire aux salariés dans un premier temps. Ainsi, la libération n’a été officialisée que deux ans après son lancement (en janvier 2012).
Cadre de la transformation
Il existe un parti pris clair chez Chrono Flex : le groupe prime sur l’individu. Ce qui explique la réorganisation en équipes autonomes et le nouveau processus décisionnel par consultation. De fait, pour les dossiers courants (par exemple, pour les absences, dépenses ou remises), aussitôt qu’une action a des conséquences sur le fonctionnement de l’équipe, ou de l’entreprise, le collectif doit être au moins informé a posteriori, au mieux consulté a priori. Toutefois, cette frontière entre l’initiative libre (l’information) et la validation (la consultation) semble parfois floue pour les collaborateurs.
Un processus différent prévaut pour la stratégie (décidée annuellement par les capitaines des speed boats, les team leaders des services supports et le comité de direction renommé TIO, pour Team Inov’On), ainsi que pour les dossiers importants comme la rémunération ou la réorganisation (traités par les capitaines ou des élus pour le sujet).
Autonomie
L’autonomie se joue avant tout au niveau des équipes, les speed boats regroupant six à dix techniciens chacun. Le management intermédiaire a été supprimé et remplacé par des capitaines, figures de leaders élus pour une durée de trois ans par leurs coéquipiers et chargés d’épauler plutôt que d’encadrer les collaborateurs (par exemple en mettant à profit leur expérience pour les aider à résoudre des problèmes). En outre, chaque speed boat est libre de se doter ou non d’un technico-commercial (décision prise collégialement par 25 équipes sur 32), pouvant servir d’appui aux techniciens dans leur mission de prospection de nouveaux clients.
Les collaborateurs jouissent d’une certaine marge de manœuvre au niveau individuel : ils sont notamment très libres quant à l’exercice routinier de leur métier (libres à eux notamment d’organiser leur planning de dépannages) et peuvent, s’ils le désirent, assumer l’une des cinq fonctions annexes prévues par la nouvelle organisation au sein de chaque équipe (chargé de recrutement, de la concurrence, de la sécurité, du commerce ou de la formation des nouveaux arrivants).
Processus, instrumentation de gestion
Chaque équipe définit son projet pour l’année suivante. Le capitaine et le DAF traduisent ce projet en chiffres pour permettre ensuite les ajustements finaux avec l’équipe. C’est ainsi que se définissent les objectifs financiers annuels et mensuels pour chaque équipe et pour chaque technicien.
En 2018, les équipes ont repensé le système de rémunération qui avait été imaginé en 2013. Désormais la part individuelle et la part collective d’une prime sont de valeur égale.
Notons également la grande souplesse en matière de recrutement. En effet, les RH n’ont plus la mainmise sur le processus d’embauche. Leur rôle se cantonne à une sélection préliminaire sur compétences. Le choix final revient aux équipes, qui, à l’issue d’une période d’observation, avalisent ou non la candidature retenue par leur chargé de recrutement.
Coreba
Caractéristiques
Basée dans le Pays basque, Coreba est une entreprise de travaux publics orientée sur l’installation de réseaux d’électricité, de téléphonie, d’éclairage public, de gaz et d’eau potable. Elle compte 98 permanents et recourt régulièrement à l’intérim pour répondre à des appels d’offres directement ou assumer des missions de sous-traitance (de rang 1 ou 2). Son statut de SCOP entraîne deux spécificités : la totalité du capital est détenue par les salariés-coopérateurs (tous ayant l’obligation d’acheter des parts dans les trois ans suivant leur embauche) et le conseil d’administration est élu par l’ensemble des coopérateurs, selon le fameux principe « un homme, une voix ».
Dynamique de la transformation
Coreba est devenue une coopérative ouvrière en 1983, lors du départ en retraite de l’ancien patron. Celui-ci envisageait alors de vendre l’entreprise à un groupe du BTP. Proposition à laquelle seize des vingt-cinq salariés de l’époque se sont opposés par crainte d’être envoyés loin de chez eux par le siège du groupe, en cas de pénurie de travail. Les salariés ont finalement convaincu le patron de leur revendre l’entreprise. Ils se sont ensuite inspirés du modèle de Mondragon (groupe industriel coopératif du Pays basque) pour refonder le mode de gouvernance.
Cadre de la transformation
Les changements de stratégie se décident au niveau du conseil d’administration, pas au niveau de l’assemblée générale. Le CA dispose d’ailleurs d’une marge de manœuvre importante sur la stratégie – le président devant tenir compte de l’avis du CA avant de prendre une décision quelconque. Les statuts réservent toutefois quelques prérogatives mineures au président, dont, par exemple, la possibilité de faire auditer l’entreprise sans obtenir l’aval du CA. Enfin, les écarts de salaire vont de 1 à un peu moins de 3, limite fixée par les statuts également.
Autonomie
Les coopérateurs jouissent d’une vaste autonomie pour plusieurs raisons : tout d’abord, en tant que membres de l’assemblée générale, ils élisent le CA – lui-même très influent, comme nous venons de le voir – et ont la possibilité de révoquer le président à tout moment (ce qui est déjà arrivé une fois, en 1996) ; les conducteurs des travaux sont certes responsables du planning des chantiers, mais les collaborateurs peuvent proposer des solutions alternatives, considérées avec attention par l’encadrement ; enfin, si les opérateurs sont peu autonomes au niveau de la prescription du travail (dans le sens où ils sont tenus de faire ce que leur impose le chef d’équipe), ils jouissent d’une grande liberté quant à l’exécution de leurs tâches, en raison de la confiance importante qui leur est accordée (très peu de contrôles et de sanctions sont opérés).
Processus, instrumentation de gestion
De manière un peu surprenante pour une organisation égalitariste, une nouvelle couche hiérarchique a vu le jour : des chefs de chantiers, qui n’existaient pas auparavant, ont été nommés pour décharger les conducteurs de travaux, trop souvent débordés. Par ailleurs, un comité de direction, dont les membres ne font pas partie du CA, a été créé, notamment pour mieux gérer les aspects disciplinaires (les directeurs servent de « fusibles » et permettent d’éviter que la sanction d’un coopérateur ne conduise à l’éviction du président). L’excès de confiance, ou la difficulté à ramener à l’ordre celui qui est perçu comme un égal, peut également se lire dans la récente demande de la part des collaborateurs d’un système d’avertissements et d’une grille de sanctions.
Notons également la décision prise en 2018 de réévaluer les salaires un par un tous les ans, en fonction des compétences spécifiques. Ainsi, la nouvelle grille assouplit le principe égalitariste puisque des collaborateurs occupant le même poste pourront désormais être rémunérés différemment.
CPAM 78
Caractéristiques
La CPAM 78 (1 300 collaborateurs répartis sur une quinzaine de sites) dépend du ministère des Solidarités et de la Santé et assure diverses missions de service public : elle s’occupe des prestations liées à la santé (p. ex. le remboursement des soins), de la relation avec les assurés (accueil, plateforme téléphonique, réclamations) et de multiples tâches de régulation (p. ex. la relation avec les professionnels de santé et la mise en œuvre de politiques sanitaires).
Sa « libération » a démarré il y a bientôt dix ans, sous l’impulsion du nouveau directeur de l’époque. La réduction continue des effectifs (à hauteur de 4,5 % par an depuis 2011, en partie due à la politique nationale qui impose de ne remplacer qu’un départ sur trois) pose évidemment des défis (en matière de transmission des compétences notamment). Ces challenges ne remettent pas en cause les principes de l’organisation pour autant. Ainsi, la transformation se justifie davantage par le goût marqué du directeur pour le pragmatisme et l’innovation que par l’urgence.
Dynamique de la transformation
Certaines actions ont été mises en place dans l’ensemble de la caisse dès l’arrivée du directeur en 2011 (introduction du lean management, innovation participative, dix projets QVT, facilitation). À partir de 2016, le directeur (avec l’aide du DRH, de la responsable de l’innovation participative et du directeur de la stratégie) a ensuite assuré le pilotage de diverses expérimentations (telles que l’autogestion des plannings et des horaires ou la supervision de l’activité par les agents, par roulement) au sein de trois services. Une phase de généralisation vient de démarrer (fin 2018), tous les services étant encouragés (mais pas contraints) à se libérer selon la méthode Colibri (Confiant, Libre, Innovant) résumée dans un livre.
Cadre de la transformation
Cinq cadres s’appliquent à l’activité de la caisse des Yvelines : la convention collective prévoit un certain nombre de règles incontournables ; une série d’objectifs non dérogatoires sont imposés par l’État ; la direction élabore des processus destinés à tous les collaborateurs (p. ex. la mise en place de la facilitation ou de l’intelligence collective) ; la vision et les valeurs ont été définies collectivement lors d’ateliers ouverts à tous et s’appliquent à l’ensemble des services ; enfin, les services peuvent définir des règles de fonctionnement locales. Nous soulignons également la volonté de simplification de la ligne hiérarchique, comprenant aujourd’hui cinq couches (contre huit par le passé) entre la direction et les agents.
Autonomie
Au niveau individuel, l’autonomie concerne avant tout la manière de faire son travail (télétravail, flexibilité des horaires et, dans certains services, possibilité de participer à l’organisation du planning). Les collaborateurs disposent également d’une marge de manœuvre sur l’évolution de la transformation par le biais de l’innovation participative (boîtes à idées, challenges d’innovation, etc.).
Au niveau collectif, les services peuvent engager, à leur niveau, une réflexion sur leurs règles de fonctionnement. Deux limites persistent toutefois : la démarche dépend du bon vouloir de chaque manager et les propositions de modification doivent être soumises à la direction pour validation.
Processus, instrumentation de gestion
Plusieurs fonctions support ont été créées pour assurer le bon déroulement du projet de libération et son appropriation par les salariés : un réseau de facilitateurs a notamment vu le jour et une responsable de l’innovation participative a été nommée. En outre, le DRH et le directeur de la stratégie consacrent désormais 20 à 30 % de leur temps à la transformation.
Dix projets ont été mis en place pour améliorer la qualité de vie au travail. Quatre d’entre eux portent sur la formation (p. ex. « Vis mon Job » ou « MOOCs »). Les autres couvrent des thématiques aussi variées que le parrainage des nouvelles recrues ou le renforcement de l’esprit d’équipe par l’organisation d’activités extraprofessionnelles.
À noter également l’émergence d’un baromètre annuel de la QVT, qui consiste en un questionnaire anonyme comportant une dizaine de questions (sur la motivation, l’autonomie, l’ambiance, l’équité, la reconnaissance, etc.). Les résultats de ce sondage sont discutés par chaque service, pour réajuster au besoin les objectifs en matière de QVT, collectivement.
Enfin, dans l’un des services pilotes, plusieurs indicateurs suggèrent un effet positif de la transformation : en neuf mois, le taux d’absentéisme a diminué de 30 %, le turnover a été divisé par deux et le taux d’appels décrochés est passé de 75 % à 90 %.
Fabernovel Data & Media
Caractéristiques
Fondée en 2013 par deux employés de Google France, Fabernovel Data & Media (FDM) est une filiale du groupe Fabernovel, spécialisée dans le conseil digital. L’agence compte une cinquantaine de collaborateurs, répartis en squads, mini-agences travaillant de manière très autonome, depuis l’automne 2017. Cette nouvelle organisation se démarque par son fonctionnement d’inspiration holacratique : un handbook compile les nouvelles règles de fonctionnement communes (par exemple, en matière de gestion des congés et de télétravail) et leurs mises à jour régulières, tirées des discussions plénières hebdomadaires.
Dynamique de la transformation
Fin 2017, l’un des cofondateurs de l’agence s’est inquiété que la forte croissance des effectifs de l’agence ne se fasse au détriment de son agilité. Il a organisé divers ateliers en lien avec la culture d’entreprise, la structure, les processus et l’humain. Sont alors nées les squads, des équipes autonomes stables, sans manager, comptant entre quatre et huit personnes et rassemblant chacune les quatre compétences métiers clés (data specialist, media specialist, search engine optimisation et marketing strategist). Pour le cofondateur, il s’agissait à la fois de mieux gérer l’activité (l’ancienne organisation par métiers pouvait être source d’inefficience) et de conserver l’esprit start-up malgré l’accroissement rapide des effectifs.
Cadre de la transformation
A côté des squads, il existe cinq unités transverses (administratif, ventes, marketingcommunication, tech et direction) ainsi qu’une unité « nouvelles offres » (TV, influence), qui représentent ensemble près de 30 % de l’effectif total. La prospection commerciale est majoritairement affectée à l’un des services transverses, mais ce sont les squads qui se portent volontaires pour gérer un client.
Autonomie
Les squads jouissent d’une grande autonomie. Elles sont libres d’organiser leur activité comme bon leur semble, dans le respect des règles de fonctionnement général résumées dans le handbook. Elles décident de se porter volontaires pour suivre un nouveau client, puis entretiennent la relation et lui proposent les prestations qu’elles jugent utiles. Les membres d’une squad peuvent exercer un droit de veto sur les décisions qui les concernent directement (par exemple, refuser de se positionner sur un nouveau contrat entrant ou s’opposer à un recrutement). Ils peuvent aussi demander à changer de squad.
Processus, instrumentation de gestion
Parmi les instruments de gestion, nous citerons : l’émergence du « feedback 360° », un outil d’évaluation plus inclusive (chacun devant évaluer trois destinataires de son choix par trimestre) ; l’attribution d’un mentor aux nouvelles recrues (qui peuvent en choisir un nouveau chaque année) et la discussion d’objectifs personnels à court et long terme (les roadmaps) avec celui-ci ; le système de promotion d’un échelon chaque année (impliquant environ 5% d’augmentation) ; ou encore la révision continuelle des règles de fonctionnement général selon un processus collectif.
Global Enterprise Networks (GEN) chez Orange
Caractéristiques
GEN est une entité du groupe Orange qui gère la planification et le déploiement des réseaux voix et data à l’international. Elle compte 400 collaborateurs à travers le monde répartis sur quatre niveaux hiérarchiques. Elle comprend quatre départements centraux et quatre interfaces régionales : la périphérie s’occupe de l’optimisation des coûts par pays, du déploiement des infrastructures physiques et des interactions avec les équipes locales de vente ; le centre apporte son soutien aux régions en matière d’expertise technique (voix et données).
Dynamique de la transformation
La transformation a démarré par une première phase de réorganisation étalée sur six mois. Ont suivi diverses expérimentations en lien avec l’agilité : au vu des résultats positifs des cinq projets pilotes, la gouvernance adaptative est en cours de généralisation. Nous soulignons le caractère non contraignant de la démarche. Un réseau d’ambassadeurs agiles a été mis sur pied pour enseigner les bases de l’agilité aux collaborateurs (lors de sessions d’acculturation) mais aucune équipe ne sera forcée à adopter la gouvernance adaptative contre son gré. La nouvelle directrice assure le pilotage de la transformation (avec l’aide d’une ancienne RH au départ, et, plus récemment, avec l’aide du cabinet de conseil externe Spindle et de la responsable agile embauchée pour l’occasion).
Cadre de la transformation
Trois objets sont clairement exclus du champ de l’autonomie : le processus de recrutement est toujours géré exclusivement par les managers ; la stratégie globale relève de l’autorité de l’exécutif ; enfin, d’importantes contraintes sont imposées par la direction des ressources humaines en matière de salaires, d’augmentations et de promotions.
Autonomie
GEN suit une trajectoire de transformation par le haut. Bien que l’accroissement de l’autonomie des exécutants demeure l’un des objectifs à plus long terme, les efforts menés jusqu’à présent se concentrent avant tout sur l’évolution des méthodes de management : d’une part, l’amélioration de la subsidiarité se joue pour l’instant au niveau des N-1 de la directrice (ceux-ci sont désormais responsables de l’engagement des dépenses et des choix stratégiques propres à leur zone géographique) et, d’autre part, la posture managériale est la plus touchée par la transformation (puisque les rapports de subordination sont remplacés par des rapports horizontaux dans les cercles agiles).
Processus, instrumentation de gestion
La transformation chez GEN s’accompagne d’une instrumentation de gestion importante : outre le réseau d’ambassadeurs mentionné plus haut, un sondage trimestriel a été mis en place pour suivre de près les effets de la transformation ; l’offre d’outils collaboratifs et de formations (techniques et humaines) ne cesse d’augmenter ; un réseau de coaches est en train de voir le jour pour assurer une appropriation durable des principes agiles par les collaborateurs. Trois problèmes restent à résoudre : les règles d’encadrement des réunions agiles sont jugées excessivement rigides par les salariés ; les « vrais problèmes » ne sont pas abordés en leur sein ; et la nouvelle organisation en cercles entre parfois en tension avec la ligne hiérarchique (certains managers ne pouvant s’empêcher de donner des ordres dans un cercle).
Lippi
Caractéristiques
Lippi (180 salariés, 24 millions de chiffre d’affaires en 2018) est une entreprise familiale (les frères Lippi et leur oncle détiennent chacun un tiers du capital) spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de clôtures, grillages et portails. Elle est en train de se doter d’un réseau de concessionnaires (14 boutiques déjà ouvertes) et a profondément changé son mode de gestion lorsque les frères Lippi ont pris la direction de l’entreprise en 2007 (passage d’un management par l’injonction, orienté sur le résultat, à un management par la résultante, orienté sur les processus).
Dynamique de la transformation
La transformation s’explique par deux grands facteurs : la transmission de l’entreprise en 2007 et la crise de 2008. Succédant à leur père et oncle, les frères Lippi ont été confrontés à deux problèmes : ils ont rapidement compris qu’il était indispensable, d’une part, de s’adapter à la mutation de l’environnement engendrée par la crise financière (chute du chiffre d’affaires et montée en flèche du prix de la matière première) et, d’autre part, de rendre le fonctionnement de l’entreprise plus lisible (leurs aînés s’occupaient de tout, de la stratégie aux plans d’action, avec pour seul outil de pilotage la publication des comptes annuels, tandis que les opérateurs se contenaient d’obéir).
Après la mise en place d’un ERP et la réorganisation des ateliers selon les principes du lean, les frères Lippi ont fait appel à un consultant externe pour digitaliser leur entreprise – collaboration qui a notamment donné lieu à la création d’une web-school, pour faciliter l’apprentissage d’Internet et des outils numériques par les salariés.
Cadre de la transformation
Deux grands objets sont exclus du champ de l’autonomie : la gouvernance et les contraintes légales en matière de sécurité. Par ailleurs, l’activité doit se dérouler en adéquation avec la nouvelle vision stratégique (en cinq « étoiles ») et la nouvelle marque (l’ADN , le « pourquoi »), qui, néanmoins, sont le fruit de réflexions collectives.
Autonomie
Si, comme nous venons de le voir, les salariés jouissent d’une autonomie partielle sur le « pourquoi », la subsidiarité porte surtout sur le « comment » : tout d’abord, le service commercial doit être assuré en continu de 8h à 19h, mais les collaborateurs coordonnent le planning entre eux et peuvent prévoir des demi-journées de travail ; tout le monde est invité à participer aux réunions mensuelles portant sur les questions d’organisation du travail ; enfin, le droit à l’erreur est institutionnalisé, puisqu’il existe des mécanismes de remontée des erreurs (sur Google+ ou lors des réunions ad hoc hebdomadaires) qui ne donnent pas lieu à des sanctions.
Processus, instrumentation de gestion
Lippi a consacré une énergie considérable à l’appropriation des outils numériques par ses salariés (20 000 heures de cours entre 2008 et 2010, pour un montant de 750 000 euros, pris en charge par la Région et l’État).
Des indicateurs (de qualité, de coût, de délai, de motivation) visuels, faciles à comprendre pour tous, ont été installés suite à la réorganisation des ateliers selon les principes du lean : le résultat quotidien est affiché avec un code couleur (vert quand l’objectif a été atteint, rouge dans le cas contraire) pour mieux rendre compte des écarts et organiser aussitôt une réunion de courte durée afin d’y remédier.
Pour chaque indicateur, les objectifs sont codéfinis avec les opérateurs, selon les principes d’un management par la résultante. Autrement dit, les objectifs sont révisés en fonction de la discussion croisée et continue entre les responsables d’équipe et les opérateurs. Ce processus se déroule en trois temps : après l’identification des contraintes et des possibilités, des objectifs intermédiaires sont définis en commun (tels que l’amélioration de la qualité ou la réduction des délais) puis les actions concrètes d’amélioration sont réparties selon les compétences de chacun.
SPF Mobilité et Transports
Caractéristiques
Le ministère belge des Transports compte 1 300 employés à son actif. Le ministère emploie une majorité de statutaires ou fonctionnaires (90 % du personnel). Les 10 % restants sont embauchés sur une base contractuelle. Le SPF Mobilité et Transports joue le rôle d’intégrateur entre les différences compétences régionales en matière de politique des transports.
Dynamique de la transformation
La transformation a eu lieu en deux temps. La première étape (SPF1) correspond aux changements mis en place par l’ancien président (avec l’aide du DRH d’alors) entre 2013 et 2016. Plusieurs de nos interlocuteurs parlent d’une « période de terreur ». La deuxième phase (SPF2), décrite comme une « contre-réforme » durant notre enquête, correspond aux efforts menés par ce même DRH et son équipe (le département P&O, pour « Personnel & Organisation ») pour assouplir certains principes de la transformation depuis le départ de l’ancien président en 2016.
Cadre de la transformation
Au vu du caractère public de l’organisation, nous avons relevé d’importantes contraintes budgétaires et légales sur le recrutement (encadré par une autorité externe, le Selor), les procédures d’évaluation (entretiens de suivi obligatoires avec le chef d’équipe), la rémunération (grille fixe, calquée sur les niveaux hiérarchiques de la fonction publique) et le financement (par exemple, le principe d’annualité budgétaire prévaut).
Autonomie
SPF1 : L’accroissement de l’autonomie s’est d’abord joué à l’échelle individuelle, avec trois chantiers phares : la suppression de l’obligation de pointer (environ 85 % des employés préfèrent ne plus pointer aujourd’hui), la réorganisation des espaces en flex desk (prévu pour 85 % de l’effectif total au maximum) et la généralisation du télétravail (adopté par 70 à 80 % du personnel aujourd’hui).
SPF2 : Les efforts plus récents portent davantage sur l’organisation en équipes. Le service P&O encourage notamment l’adoption de nouveaux outils collaboratifs et l’intelligence collective (une vingtaine de facilitateurs ayant déjà été formés).
Processus, instrumentation de gestion
Au vu du caractère hautement bureaucratique de cette organisation, nous n’avons constaté que peu d’effets sur l’instrumentation de gestion. Nous soulignons tout de même l’apparition du « feedback 360°» (pratique consistant à effectuer un tour d’horizon, à 360°, en sollicitant l’avis des pairs) à côté de la procédure officielle d’évaluation, ainsi que les efforts menés pour accompagner le middle management (multiplication et diversification de l’offre de formations).
- 1. Les cas sont classés par ordre alphabétique.
- 2. Lorsqu’il est mentionné, le calcul du nombre de couches hiérarchiques ne se limite pas au management intermédiaire. Il prend également en compte les opérateurs et la direction.
Thierry Weil et Anne-Sophie Dubey, Au-delà de l’entreprise libérée, Enquête sur l’autonomie et ses contraintes, Paris, Presses des Mines, 2020.
ISBN : 978-2-35671-592-0
ISSN : 2495-1706
© Presses des Mines – Transvalor, 2020
60, boulevard Saint-Michel – 75272 Paris Cedex 06 – France presses@mines-paristech.fr
www.pressesdesmines.com
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel -75005 Paris – France info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr