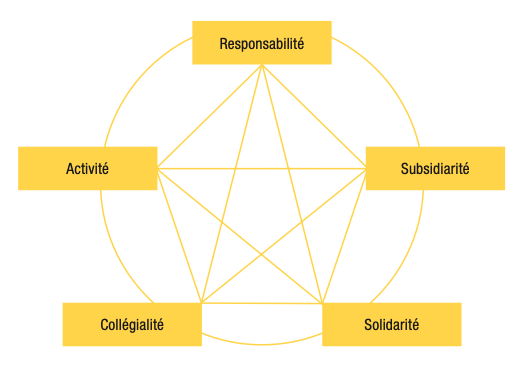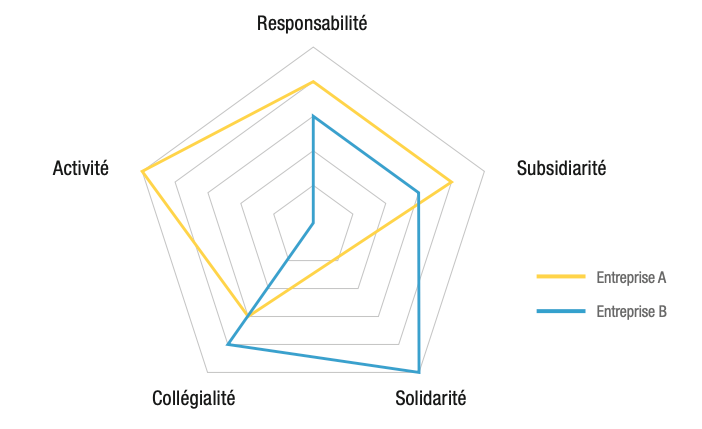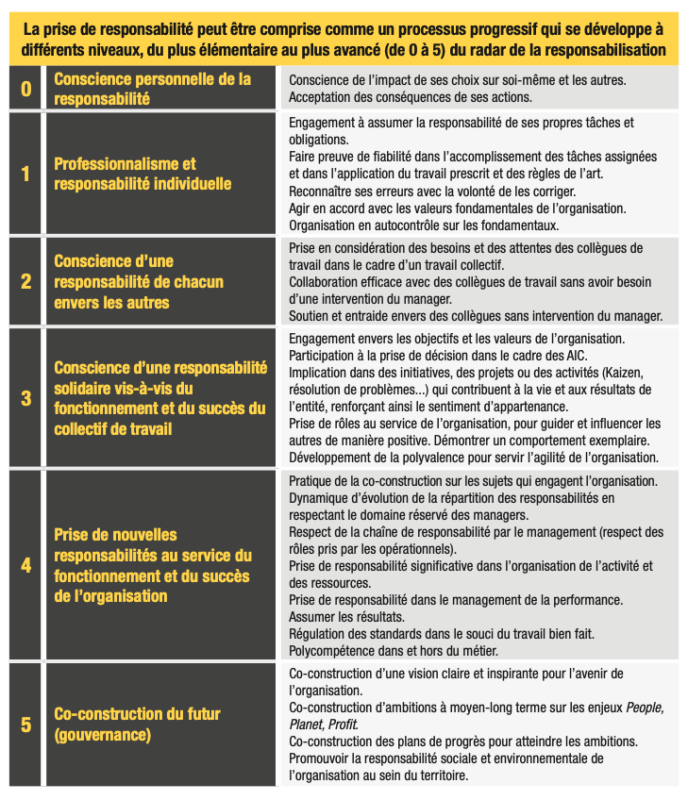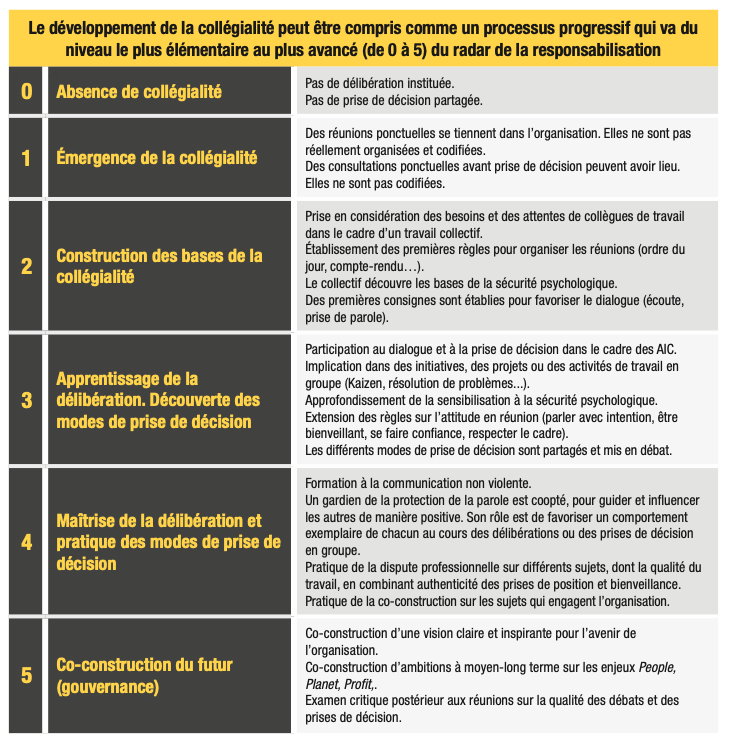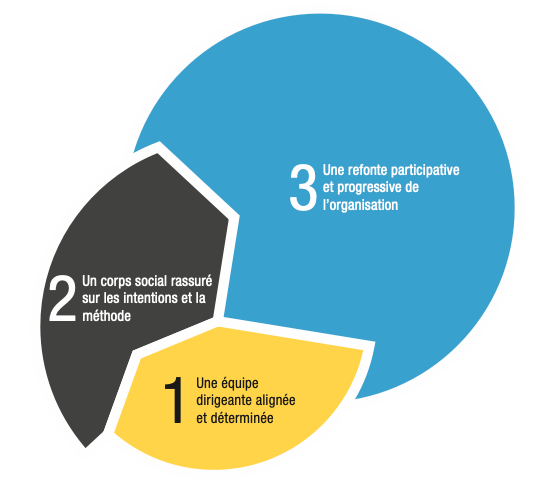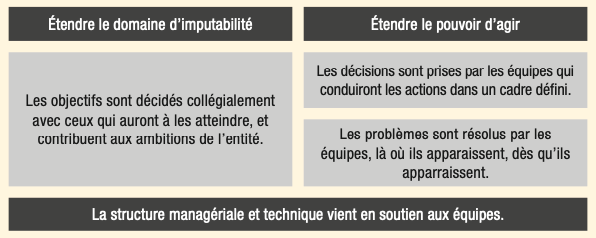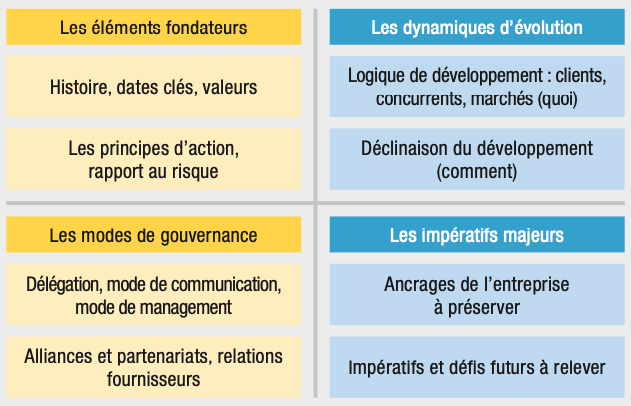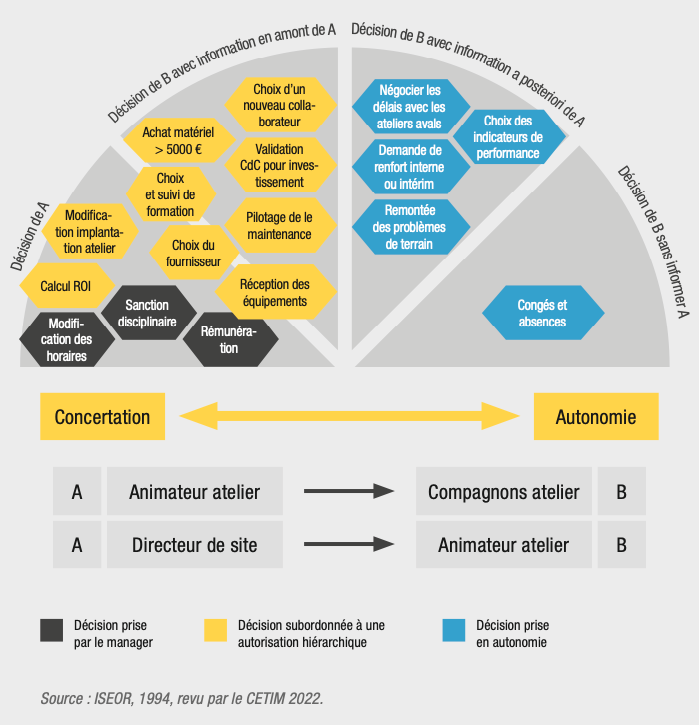Organisation responsabilisante : de l’idée à la réalisation

Sextant, Hartley Marsden (1877-1943) Localisation : États-Unis, Philadelphie (Pa.), Philadelphia Museum of Art © The Philadelphia Museum of Art. Dist. GrandPalaisRmn / image Philadelphia Museum of Art
Préface
Ces dernières années, l’entreprise responsable a beaucoup progressé, et l’on ne peut que se féliciter de la montée en puissance des politiques de RSE, qui ont atteint un stade de maturité encourageant. Un nombre croissant d’entreprises ont compris la force qu’elles peuvent puiser d’une RSE pensée comme une stratégie issue de leur Raison d’être, et pas seulement comme un corpus de discours imposés par l’air du temps et la réglementation.
Si l’entreprise responsable a beaucoup progressé, il reste cependant du chemin à parcourir. Et pour aller au bout de la recherche de performance soutenable, nous devons désormais faire un pas de géant vers l’entreprise… responsabilisante. Cet ouvrage Organisation responsabilisante : de l’idée à la réalisation arrive à point nommé, et va contribuer à cet indispensable pas de géant. Je suis heureux et honoré de le préfacer, afin de partager quelques convictions sur l’urgente nécessité de conduire nos entreprises vers la responsabilisation.
S’il y a urgence, c’est que nous sommes aujourd’hui confrontés à une tension de plus en plus vive entre l’entreprise et le travail. Alors que toutes les études montrent que nos concitoyens croient en l’entreprise, des chiffres préoccupants indiquent qu’ils se détournent du travail. Ainsi, une grande majorité sont convaincus que ce sont les entreprises – grâce à leurs investissements, leurs innovations, leur capacité d’organisation – qui peuvent répondre le plus efficacement aux grands défis de la planète – nourrir, soigner et loger huit milliards d’habitants, lutter contre le dérèglement climatique, développer la mobilité ; mais dans le même temps, seulement 24 % des Français disent que le travail est aujourd’hui important dans leur vie (ils étaient 60 % à le penser dans les années 1980) et 54 % pensent que le travail est plus une contrainte qu’un épanouissement (5 points de plus qu’en 2006).
Faut-il alors s’étonner de l’essor inquiétant du désengagement, voire de la souffrance au travail, sous diverses formes – absentéisme, démissions, ennui, risques psychosociaux ? Pour expliquer cette désaffection, différentes raisons peuvent être avancées : la dégradation des conditions de travail dans certains environnements, le mauvais équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la fracture digitale, l’isolement dû au télétravail etc. Mais il y a une explication plus importante : le sentiment d’une véritable perte de sens !
R. Gary rapporte ce mot de de Gaulle, qui illustre ce besoin de sens : « Il se peut bien que nous allions sur la lune, et cela n’est pas très éloigné de nous. La plus grande distance qu’il nous reste à couvrir gît cependant au fond de nous-mêmes. » Ce besoin de sens, il est à la fois collectif et individuel – et l’un ne peut aller sans l’autre : ce qui produit du sens collectif, c’est la Raison d’être, qui a fini par s’installer dans les entreprises. Ce qui produit du sens individuel, c’est la responsabilisation.
Si l’on considère que les trois leviers du sens au travail sont la finalité du travail, le contenu du travail et la qualité au travail, alors, on mesure mieux le rôle clé de la raison d’être et de la responsabilisation : la raison d’être nourrit la finalité et le contenu du travail ; la responsabilisation nourrit le contenu et les conditions d’exercice du travail. Dans une entreprise sans raison d’être, mais où le management essaye de donner du sens individuel aux équipes, les salariés avancent, mais ils ne savent pas où ils vont ! Dans une entreprise où il y a une raison d’être, mais pas de sens individuel, l’entreprise avance, mais sans les salariés : l’équation gagnante, c’est donc la raison d’être et la responsabilisation !
Alors, comment faire de nos entreprises des organisations responsabilisantes ? Pour y répondre, cet ouvrage explore avec finesse les différentes dimensions de ce qui est appelé fort justement « la boussole de la responsabilisation ». Le mot est bien choisi. La responsabilisation est bien une boussole, que les dirigeants et les managers doivent toujours avoir en poche pour mieux surmonter les détours, les fausses pistes et les impasses qui ne manquent pas de ralentir et parfois décourager la route vers la responsabilisation.
Pour avoir expérimenté le processus de responsabilisation chez Michelin, sous l’impulsion de la direction industrielle, et avec des équipes exceptionnelles menées par Jean-Michel Guillon (DRH) et Bertrand Ballarin (directeur d’usine, puis responsable des relations sociales), je peux témoigner de la difficulté de la tâche. Nous avons plus d’une fois failli perdre le nord ! Je me réjouis que le livre consacre un chapitre entier à cette magnifique entreprise qui m’a tant appris, et qui résume bien la complexité d’une démarche de responsabilisation, au sein d’un leader industriel mondial à l’histoire emblématique et à la culture extrêmement forte. Le processus de responsabilisation chez Michelin a pris près de dix ans. Il nous a appris qu’il est bien plus difficile de conduire une transformation de la manière d’être d’une entreprise que de modifier sa manière de faire, alors que les deux sont nécessaires. Il nous a également appris que la nature humaine a de formidables capacités de résistance, reposant sur l’aversion au risque, sur la crainte, sur la paresse, sur l’esprit d’inertie, ou sur l’incapacité… Enfin, mener Michelin vers la responsabilisation nous a également enseigné qu’un tel processus repose sur deux conditions sine qua non : l’exemplarité des dirigeants, et l’accent mis sur le management intermédiaire.
Car dans une entreprise, les opérateurs, les ouvriers, mesurent en général rapidement ce qu’ils ont à gagner d’un processus de responsabilisation – autonomie accrue, plus grande motivation, capacité de mieux progresser. Mais l’encadrement intermédiaire, les agents de maîtrise doivent accepter de changer profondément de mission, de posture, de culture. Pour eux, il s’agit de renoncer à un rôle simplifié d’autorité verticale – commander le matin, superviser l’après-midi, contrôler le soir –, pour passer à un rôle plus incertain, mais beaucoup plus noble et épanouissant, de développement horizontal – accompagner, soutenir, motiver, développer les talents. C’est pourquoi aller vers une organisation responsabilisante passe à mes yeux par une véritable révolution managériale, reposant sur l’écoute, la considération, l’éthique – conditions de succès du processus de responsabilisation.
Le chemin vers l’organisation responsabilisante est ardu, mais le jeu en vaut la chandelle, car les fruits de la responsabilisation sont tout à fait exceptionnels, et se mesurent sur le long terme en performance économique et financière, en capacité d’innovation, en fidélisation et motivation des équipes. Et la responsabilisation est déjà, en elle-même et à travers la confiance qu’elle nécessite et manifeste, un geste fondamental de respect et de reconnaissance. Je l’ai constaté chez Michelin, mais aussi chez Saint-Gobain, et je le mesure en ce moment chez Renault Group, où notre réorganisation, menée par Luca de Meo, s’est opérée autour d’entités plus autonomes et responsabilisantes, chacune étant tournée vers une chaîne de valeur spécifique (la vente de véhicules électriques et de logiciels, la vente de véhicules thermiques, l’économie circulaire ou les services de mobilité), les équipes étant désormais plus agiles, spécialisés et responsabilisées…
Ce livre est une formidable source d’inspiration. La démarche de responsabilisation qui s’y trouve explicitée, avec ses difficultés conceptuelles et managériales, ses principes, ses points de passage obligés, est un extraordinaire amplificateur d’énergie et une intarissable source d’espoir. Il s’adresse aux dirigeants et managers de tous les secteurs, qui savent que l’entreprise responsable, c’est aussi l’entreprise qui responsabilise, car l’organisation responsabilisante est le seul chemin possible de la performance durable.
Jean-Dominique Senard,
Président du conseil d’administration de Renault Group.
Résumé
Les entreprises contemporaines sont souvent attirées par les modèles d’organisation responsabilisante (OR), mais ceux-ci se révèlent complexes à mettre en place et parfois décevants sur le plan de leurs résultats. C’est qu’en effet une transformation de ce type ne peut pas être abordée avec des idées simples : elle suppose une acceptation de la complexité et du temps long. Parce qu’elle agit en profondeur sur la culture d’entreprise, ses effets se mesurent plutôt en une dizaine d’années qu’en résultats trimestriels.
Cet avertissement à nos lecteurs étant posé, cette étude cherche à répondre à deux questions récurrentes chez les dirigeantes et les dirigeants : « Quand on parle d’organisation responsabilisante, de quoi parle-t-on exactement ? » et « Par quoi dois-je commencer pour mettre mon entreprise en mouvement ? ». Pour répondre à ces deux questions, l’ouvrage s’attache à décrire les grands principes qui gouvernent une OR (de quoi on parle ?) et à proposer une grille de conception et de mise en œuvre (sur quoi et comment agir ?) permettant de tendre vers ce système en évitant les impasses les plus fréquentes.
L’étude s’intéresse particulièrement, mais sans exclusive, à l’extension du pouvoir d’agir chez ceux qui en ont le moins. C’est cette population, notamment en production industrielle et en logistique, qui subit un travail routinier, répétitif, souvent pénible et faiblement reconnu, et c’est elle qui dispose de perspectives moindres en matière d’évolution professionnelle. Pour toutes ces personnes, travailler dans une OR peut représenter une avancée personnelle, professionnelle et sociale. En dépit de ce tropisme industriel, la démarche proposée est applicable à tout type d’organisation, moyennant adaptations.
L’OR, pourquoi ?
Du point de vue de l’entreprise, il ne manque pas de bonnes raisons pour enclencher une telle évolution. L’OR soutient l’avènement d’une entreprise responsable (une option de moins en moins optionnelle en raison, entre autres, du renforcement des contraintes réglementaires) qui doit réussir à concilier dans le travail réel des objectifs multiples et rarement alignés (personnes, planète, profit). L’OR répond à des objectifs d’agilité, de flexibilité et de rapidité, par la déconcentration du pouvoir de décision au plus près du niveau où les problèmes apparaissent. Là où elle existait, elle a notamment permis de surmonter plus aisément une pandémie comme celle du Covid-19, quand les équipes opérationnelles de production se trouvaient sur le terrain et que le management était confiné et à distance. Elle correspond aussi à une évolution des attentes des salariés qui aspirent depuis longtemps à davantage de confiance de la part de leur hiérarchie et de marges de manœuvre dans leur travail. Elle fournit des arguments d’attractivité à des secteurs où le travail est traditionnellement très prescrit et où les conditions de travail sont jugées difficiles, en développant les compétences de ceux qui y travaillent, en rendant le travail moins répétitif et plus intéressant et en leur ouvrant des perspectives accrues d’employabilité et d’ascension sociale (à la condition que les systèmes RH s’adaptent). Elle agit sur l’engagement des personnes pour juguler les difficultés de recrutement, le turn-over et l’absentéisme. Enfin, la responsabilisation se révèle une ressource tant pour la santé des salariés que pour l’efficacité du travail, quand les collaborateurs disposent de latitude pour proposer des améliorations et participer à la régulation de leur activité. En définitive, l’organisation responsabilisante paraît bien adaptée à notre monde complexe.
Ces arguments sont connus et reconnus, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. La transformation vers une organisation responsabilisante s’apparente davantage à une exploration dirigée qu’à une ligne droite entre un point A et un point B. Pour conduire cette exploration, les organisations ont besoin d’une boussole.
L’OR, sur quoi agir ?
La boussole de la responsabilisation est constituée de cinq dimensions qui font système : responsabilité, subsidiarité, solidarité, collégialité et activité. Ces dimensions forment un système dans la mesure où agir sur l’une provoque une évolution des autres.
La responsabilité est le principe selon lequel chacun doit rendre des comptes à la mesure de son pouvoir d’agir. L’objectif de la responsabilisation est d’élargir et d’enrichir progressivement le niveau de redevabilité de chacun (et donc d’accroître le pouvoir d’agir de chacun). Le pouvoir d’agir suppose le droit d’agir et la compétence pour agir à son niveau, au sein d’une chaîne de responsabilité.
La subsidiarité est le principe selon lequel les échelons supérieurs s’interdisent de s’approprier les attributions dont les échelons inférieurs sont capables de s’acquitter à leur seule initiative et par leurs propres moyens. Il tient son nom du latin subsidium (réserve, soutien), marquant par là que le rôle des échelons supérieurs est d’apporter leur aide et leur soutien si le besoin en est exprimé par un échelon subordonné, jamais de se substituer à lui.
La solidarité se traduit par l’assistance et la coopération qui se développent entre les personnes d’un groupe ou d’une communauté, du fait du lien qui les unit au service d’un objectif commun. Dans les organisations, elle s’exerce prioritairement au sein de la communauté de travail.
La collégialité renvoie à la pratique de la délibération en groupe, dans un esprit d’intelligence collective et d’enrichissement des décisions à prendre. Elle renvoie également au principe de construction collective des solutions, ce qui évite de se retrouver seul face à une décision difficile ou à une responsabilité potentiellement anxiogène, préservant ainsi le bien-être et la santé mentale des salariés.
L’activité se concentre sur la différence entre le travail prescrit et le travail réel, et sur les solutions que les personnes mettent en œuvre pour résoudre cette discontinuité. L’analyse de l’activité a pour objectif de favoriser la contribution des travailleurs à la (re)conception des règles qui leur permettront de faire du « bon travail », source de leur santé physique et mentale.
Le but de cette boussole est de faire réfléchir l’équipe dirigeante, et par la suite toute l’organisation, sur ces cinq dimensions avant et pendant la transformation. Chacune va être « dépliée » afin qu’en soient compris la portée, les interactions, les limites et les risques. Ce cadre de pensée peut paraître théorique, mais son appropriation est en réalité indispensable pour définir l’ambition qu’on veut se donner et les modes d’action concrets pour y parvenir. Cette réflexion permet de bâtir une première vision du système cible que le dirigeant et sa « coalition » cherchent à faire émerger, en s’appuyant sur les forces existantes de l’organisation. Cette vision sera remise sur le métier et ajustée au fur et à mesure des enseignements tirés des premières expérimentations. La boussole permet aussi de construire des échelles de progrès sur les cinq dimensions, afin d’évaluer la maturation progressive de la transformation vers l’OR (le radar de la responsabilisation).
Guidée par les dimensions de la boussole, la conception de la nouvelle organisation devra suivre quelques principes de construction : i) constituer des équipes de travail sur de nouveaux territoires, généralement plus petits que dans l’organisation précédente, pour favoriser la solidarité et la collégialité ; ii) répartir de nouvelles responsabilités (les « rôles ») sur le plus grand nombre possible d’équipiers pour favoriser la responsabilisation et la subsidiarité ; iii) refonder le système de management, incluant : la réorientation des comportements et des priorités des managers et des fonctions support, le système de remontée aux niveaux supérieurs des sujets qui ne peuvent pas être traités au niveau inférieur et de redescente rapide des solutions, le système de reconnaissance et de gestion des carrières. Cette conception va permettre d’aller beaucoup plus loin dans la responsabilisation et le pouvoir d’agir des collaborateurs que ne le permet l’application des principes du lean management, en élargissant progressivement les champs de responsabilité des acteurs.
L’OR, comment agir ?
Trois exemples de transformation (deux PME et un grand groupe) vont nous permettre de constater que les chemins vers l’OR peuvent être très divers. Pour autant, cette diversité n’exclut pas de proposer un itinéraire conseillé pour conduire une telle transformation. Ce vade-mecum comprend trois grandes phases : i) l’impulsion donnée par une équipe dirigeante alignée et déterminée ; ii) l’embarquement du corps social ; iii) la refonte participative et progressive de l’organisation. Cette apparence séquentielle ne doit cependant pas dissimuler qu’en pratique, ces phases se chevaucheront souvent, surtout si l’organisation est grande. Elles devront en outre être répétées à chaque cycle de transformation.
La phase 3 doit permettre de faire évoluer les éléments tangibles de l’organisation selon un enchaînement logique et un processus assez largement ouvert à la délibération avec les salariés : i) définir initialement les missions et les responsabilités qui leur sont associées ; ii) au sein d’un « territoire » donné (équipe) où s’exercera la responsabilité solidaire et le sentiment d’appartenance ; iii) installer les communautés sur ces territoires en leur permettant de définir leurs modes de fonctionnement ; iv) fournir les ressources nécessaires à l’autonomisation des communautés (montée en compétences, information, équipements…) ; v) mettre en place les instances de délibération et de décision qui permettront les interactions et les coopérations ; vi) anticiper les changements RH que le nouveau système implique (formation, coaching, système de reconnaissance…).
Pour que ce nouveau système émerge, l’exploration aura besoin de managers « jardiniers » capables de défricher de nouveaux territoires, de développer les personnes et d’ouvrir progressivement de nouveaux champs de responsabilité aux équipes, sans prendre de risques inconsidérés pour les personnes comme pour l’organisation. On constate cependant que, trop souvent, l’accompagnement des managers se limite à des injonctions de changement de posture sans prise en compte ni analyse de l’activité managériale elle-même, notamment de la disponibilité du manager pour superviser activement son équipe.
Enfin, la pérennisation du système fait partie des points les plus délicats. Parce que le modèle responsabilisant s’inscrit dans un temps long, il va se heurter à de multiples facteurs perturbateurs, parmi lesquels figurent les changements de gouvernance, l’instabilité du management et du personnel, ou encore la volonté de standardisation maximale des opérations. La persistance et la cohérence du soutien du Comex à l’OR demeurent donc une condition sine qua non de sa pérennité, mais un tel soutien dans la durée est naturellement impossible à garantir, faisant des OR un modèle hautement réversible.
Introduction
Les « organisations responsabilisantes » (OR) sont un serpent de mer de la théorie et de la pratique des organisations. Un ouvrage récent (Canivenc, 2022) a décrit les origines historiques et les formes diverses prises par cette aspiration toujours renouvelée à des modalités de pilotage qui rompraient avec le modèle d’organisation pyramidal et hiérarchique, et avec sa dérive bureaucratique. Il paraît de mieux en mieux admis que des équipes responsabilisées sont adaptées à un monde complexe et instable, et devraient en principe obtenir de meilleurs résultats que des individus ou des groupes à qui l’on demande d’exécuter scrupuleusement des consignes. Cette idée ancienne a fait son chemin et été expérimentée par un nombre significatif d’entreprises avec des niveaux variés d’ambition, d’objectifs et surtout… de résultats. Thierry Weil et Anne-Sophie Dubey (2020) ont ainsi documenté et comparé par questionnaire systématique une dizaine de cas de transformation responsabilisante, constituant une plateforme de cas qui permet à chacun de comprendre les ressorts, les contraintes et les difficultés que rencontre ce type de transformation.
Force est de constater qu’en dépit d’une littérature pléthorique, les entreprises tournent en rond sur ces sujets. Elles bloquent, elles titubent, elles tâtonnent, elles freinent, elles renoncent, elles recommencent. Une démarche de responsabilisation, selon la manière dont elle aura été conçue et conduite mais aussi selon le moment où sera prise la « photographie » de cette évolution, peut donner à voir des effets très variables : amélioration des résultats économiques et bonne ambiance de travail, agilité renforcée et meilleure attractivité, ou désorganisation de la production et déstabilisation du corps social, assortie d’une dégradation de l’ambiance de travail et de l’émergence de risques psychosociaux, à rebours des effets qu’elle était censée soutenir (Picard, 2015 ; Weil et Dubey, 2020 ; Canivenc, 2022). Dans d’autres cas encore, les résultats seront cosmétiques et peu pérennes, soumis aux aléas des changements de gouvernance.
Qu’est-ce qui rend les transformations responsabilisantes si difficiles ? Plusieurs raisons expliquent les difficultés rencontrées.
D’abord, ces transformations sont systémiques. Si l’on tente de libérer les énergies humaines tout en maintenant en place le reste du système que l’on cherche à transformer, on aboutit à… l’homéostasie1, et l’on blâmera alors la transformation de n’avoir pas réussi. C’est plutôt le contraire qui serait étonnant ! Les collaborateurs, individus adultes qui assument dans leur vie personnelle un grand nombre de responsabilités et ne s’en sortent pas si mal (un foyer, une famille, une maison, un budget, des dépenses, des emprunts), entrent, dès qu’ils franchissent la porte de l’entreprise, « dans un univers rempli de normes, modes opératoires, procédures, KPI, tableaux de gestion, tableaux de reporting, entretiens annuels, objectifs annuels, référentiels managériaux, plans d’action, manuels Qualité, SI, démarches et déclaratifs de toutes sortes… qui les obligent à dire ce qu’ils font, comment ils le font, avec qui ils le font, avec quel budget, ce qu’ils ont fait, les résultats obtenus, ce qu’ils vont faire, les résultats attendus, les écarts aux résultats, les plans d’action correctifs, les projections, les prévisions, etc. » (Tonnelé, 2023). Face à cette « hyper-rationalisation » des organisations, comment les collaborateurs auraient-ils le temps et l’envie d’engager leur tête et leur cœur dans le travail, d’avoir des idées, de la créativité, de prendre des initiatives et de trouver du sens à leur travail ? La simplification des processus et du reporting sera donc systématiquement au menu de la transformation vers une organisation responsabilisante. Mais selon un adage bien connu et ô combien pertinent, « faire simple, c’est très compliqué ».
Ce qui nous amène à une deuxième idée concernant la difficulté des transformations responsabilisantes : elles ne peuvent pas être abordées avec des idées simples. Elles reposent tout au contraire sur la pensée complexe au sens d’Edgar Morin (1980) : « Le complexe ‒ ce qui est tressé ensemble − constitue un tissu étroitement uni bien que les fils qui le constituent soient extrêmement divers. » Ainsi que l’explique Bertrand Ballarin, ancien directeur des relations sociales chez Michelin, qui participa à une transformation de ce type : « Pour être capable de porter une telle transformation dans la durée, il faut avoir beaucoup de convictions et, pour avoir beaucoup de convictions, il faut avoir beaucoup de réflexion et, pour avoir beaucoup de réflexion, il faut avoir beaucoup de culture, et une culture qui plonge ses racines dans des registres différents et variés. »
On peut déduire de ces prémices trois grandes caractéristiques de la conduite de ces transformations, qui ajoutent autant de difficultés au chemin.
Premièrement, une transformation de ce type prend du temps. Parce qu’elle vise un changement profond de la culture et de la structure organisationnelles, il ne s’agit pas d’une transformation « presse-bouton » dont les résultats seront visibles et mesurables immédiatement. Il y faut de la persévérance et de la tolérance à l’incertitude. Ces conditions nécessitent à leur tour une stabilité de la gouvernance ou, du moins, une inscription dans une vision de long terme incompatible avec des changements de direction fréquents ou la focalisation sur des résultats trimestriels. C’est ce qui explique que ces transformations soient plus « faciles » (mais ce n’est guère facile !) à réussir dans des entreprises à gouvernance familiale ou à actionnariat très stable. À la stabilité de la gouvernance doit aussi répondre une certaine stabilité du corps social. En effet, devenir « responsable » requiert un temps d’apprentissage assez long. L’organisation responsabilisante (OR) chemine en capitalisant sur le développement de compétences professionnelles et comportementales. Le turn-over subi (démissions) ou organisé (contrats temporaires) représente donc un frein considérable à l’enracinement de l’OR.
Deuxièmement, ces transformations ont pour particularité de reposer, dans la durée, sur l’adhésion et la participation de l’essentiel du corps social de l’entreprise. Même si l’initiative repose quasiment toujours sur la volonté et la conviction d’un dirigeant ou d’une équipe dirigeante, la transformation vers l’OR ne peut pas être opérée de manière top-down. Elle ne peut être ni décrétée, ni imposée, mais seulement impulsée et « organisée ». Autrement dit, l’équipe dirigeante devra résister en permanence à la tentation de passer en mode top-down pour accélérer le processus et obtenir des « résultats » – ce qui équivaudrait à signer la fin et l’échec de la transformation. Et, en même temps, elle devra continuer à soutenir et à communiquer les intentions, et rester une force d’impulsion. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que doit affronter un dirigeant qui entre dans un tel processus : autolimiter son pouvoir d’intervention et continuer à impulser de l’énergie en continu.
Troisièmement, ces transformations relèvent de l’ordre de l’exploration-itération. Elles n’obéissent pas à une planification rigoureuse, ni ne suivent un chemin balisé par des étapes précises et successives. Une transformation consiste traditionnellement à aller d’un état A connu vers un état B plus ou moins connu et défini, d’une manière qui tend à être rigoureusement pilotée. Dans le changement vers une OR, en revanche, la cible et les moyens pour l’atteindre restent mouvants et se précisent au fur et à mesure de l’avancement, en gardant un esprit très ouvert aux opportunités et aux corrections.
Au vu de l’indétermination qu’implique cette démarche, le projet même de cet ouvrage peut sembler paradoxal. Peut-on enserrer dans une méthode de « transformation » ce qui relève pour chaque entreprise d’une exploration particulière liée à un nombre important de paramètres qui lui sont propres ? Peut-on enfermer dans un cadre séquentiel ce qui n’est que boucles d’apprentissage et itérations ? Notre position, nourrie par les observations et les témoignages, est que ce type de transformation s’apparente à une exploration dirigée : pas vraiment linéaire, ouverte à la surprise et à l’inattendu, mais nécessitant un cadrage solide. Ce livre, qui est lui-même une proposition exploratoire, vous propose donc une randonnée en montagne avec une boussole, un itinéraire conseillé, et tout l’équipement nécessaire à votre aventure.
Il tente ainsi de répondre à deux questions récurrentes chez les dirigeantes et les dirigeants : « Quand on parle d’organisation responsabilisante, de quoi parle-t-on ? » et « Par quoi dois-je commencer pour mettre mon entreprise en mouvement ? ». Son objectif est à la fois de décrire les principes qui gouvernent une organisation responsabilisante (de quoi parle-t-on ?) et de proposer une grille de conception permettant de commencer à avancer vers ce système (par quoi dois-je commencer ? sur quoi dois-je agir ?). La finalité est d’encourager les dirigeants à passer de la conviction à l’action, en évitant les impasses les plus fréquentes, en minimisant les conséquences les plus néfastes et en améliorant la cohérence de l’action envisagée.
Nous avons constitué, dans ce but, un groupe de travail autour des mécènes2 de la chaire Futurs de l’industrie et du travail – Formation, innovation, territoires (FIT²)3 qui s’interrogeaient eux-mêmes sur ce sujet. Nous avons auditionné non seulement des chefs d’entreprise, mais aussi des consultants expérimentés sur ces questions. Nous avons beaucoup échangé, sans tomber toujours parfaitement d’accord tant les entreprises sont diverses (taille, secteur d’activité, enjeux, culture, gouvernance). En dépit de ces différences, nous avons abouti à des éléments de convergence qui constituent les briques de la démarche que nous vous présentons ici.
Vous constaterez que notre démarche révèle un certain tropisme industriel. Elle accorde en effet une place importante à l’émancipation du travail en usine, notamment celui des opérateurs et des opératrices de production. Il y a plusieurs raisons à cela.
D’abord, notre profil : nous sommes tous deux des enfants de l’industrie et de l’usine, et nous parlons inévitablement de ce que nous connaissons le mieux. Ensuite, le travail de production industrielle est traditionnellement fondé sur une extrême prescription des tâches. C’est donc un terrain particulièrement fécond pour comprendre ce que peut représenter l’extension du pouvoir d’agir des salariés dans des systèmes contraints. Enfin, alors qu’on ne parle quasiment plus d’ouvriers, vestiges d’une ère industrielle perçue comme révolue4, ils sont encore 5 millions dans notre pays, soit 20 % de l’emploi total tous secteurs confondus (Forment et Vidalenc, 2020). Si, selon l’Insee, leur part dans l’emploi est passée pour la première fois en 2020 au-dessous de celle des cadres, les ouvriers sont loin d’avoir disparu du paysage, même si leur répartition a changé : la part des ouvriers qualifiés de type industriel (production et maintenance) n’a que faiblement reculé depuis les années 1980 (ils représentent 20 % des ouvriers), alors que les ouvriers non qualifiés sont en fort repli dans l’industrie, mais très présents dans les transports, la logistique ainsi que dans le bâtiment et les travaux publics. Certaines catégories d’ouvriers (de type artisanal) bénéficient d’une forte autonomie, quand d’autres continuent de travailler dans des systèmes extrêmement prescrits.
D’une manière générale, l’organisation responsabilisante devrait s’attacher prioritairement à donner des marges de manœuvre à ceux qui en disposent le moins. C’est cette population qui subit un travail routinier, répétitif, souvent pénible et faiblement reconnu, et c’est elle qui dispose de perspectives moindres en matière d’évolution professionnelle. Pour toutes ces personnes, travailler dans une OR peut représenter une avancée personnelle, professionnelle et sociale. En dépit de son tropisme industriel, la démarche proposée est applicable à tout type d’organisation, moyennant adaptations.
Méthode de l’étude
L’analyse et la démarche proposées dans cet ouvrage reposent sur les auditions et les échanges menés au sein d’un groupe de travail qui s’est réuni une dizaine de fois au cours de l’année 2023.
Animateurs du groupe de travail : François Pellerin et Pierre Bocquet (Chaire FIT2).
Membres du groupe de travail : Pierre-Marie Gaillot (Cetim) ; François Maisonneuve (Kéa) ; François Levert (Michelin) ; Valérie Duburcq et Christophe Roblin (Orange) ; Frédéric d’Arrentières (Renault Group) ; Suzy Canivenc (Chaire FIT2) ; Thierry Weil (Chaire FIT2).
Ont également participé : Laurence Thouveny (Orange), Bénédicte Ménard (Renault Group).
Séances et auditions
• Réunion de lancement, 11 janvier 2023
• Témoignage Cetim, 26 janvier : Pierre-Marie Gaillot et Vincent Nourrisson
• Témoignage Michelin (Manufacturing), 27 février : Pierre Bocquet et François Levert
• Témoignage Kéa, 21 mars : Thibaut Cournarie et Claire de Colombel
• Témoignage Meliae Consulting/Groupe Citwell, 22 mars : Stéphane Lescure
• Témoignage Martin Technologies, 24 avril : Laurent Bizien
• Témoignage Renault Group (Ingénierie), 25 avril : Frédéric d’Arrentières, Olivier Pareja et Sylvain Gelfi
• Témoignage Lippi, 26 mai : Frédéric Lippi • Réunion de synthèse, 23 mai
• Réunion de synthèse, 14 juin
Rapporteur des synthèses : Élisabeth Bourguinat.
N.B. Les propos des participants ont été tenus à titre personnel et n’engagent pas leurs organisations d’appartenance. Les verbatim figurant dans le présent ouvrage ont été soumis à leurs émetteurs pour validation.
- 1. Homéostasie (Larousse) : caractéristique d’un écosystème qui résiste aux changements et conserve son état d’équilibre antérieur.
- 2. À la date de l’étude : Cetim, Kéa, La Fabrique de l’industrie, Michelin, Orange et Renault Group.
- 3. La chaire FIT2 produit des études sur les futurs possibles de l’industrie et du travail, ainsi que sur les politiques d’accompagnement de ces transformations. Elle analyse notamment des pratiques d’innovation, de formation, d’amélioration de la qualité du travail et d’organisation de l’action collective.
- 4. Voir le documentaire Nous les ouvriers, france.tv (Béziat et Nancy, 2023).
Qu’entend-on par organisation responsabilisante ?
La première idée que véhicule le concept d’organisation responsabilisante (OR) est de faire du fonctionnement de l’entreprise un facteur de différenciation et de compétitivité, en s’intéressant aux aspects managériaux et humains de l’organisation, alors que durant plusieurs décennies, du fait d’un niveau de chômage élevé, ce facteur humain a été relégué au rang de « commodité ».
Une OR considère l’élargissement et l’enrichissement de la responsabilité de chacun comme un moteur indispensable de l’engagement de ses membres, qui conditionne in fine la performance durable de l’organisation. Elle vise à créer un environnement de travail propice au renforcement de la motivation intrinsèque des employés (voir encadré en page suivante). Stéphane Lescure du cabinet de conseil Meliae Consulting/Groupe Citwell utilise l’expression d’« environnement de travail automotivant ». Une autre manière de la définir serait de dire que l’OR accorde plus d’importance (ou une importance au moins égale) à la ressource que représentent les hommes et les femmes (connaissance, intelligence, savoir-faire, expérience, intuition, sensibilité) qu’aux systèmes (structures, process, technologies).
Une des principales caractéristiques de l’OR est qu’elle transforme la manière de conduire les opérations, en passant progressivement d’un modèle traditionnel de commandement fondé sur l’obéissance et la conformité, à un système dit responsabilisant, fondé sur la capacité des personnes à prendre des initiatives, à s’adapter rapidement aux aléas, voire à faire preuve de créativité, sans pour autant abandonner l’idée de cadrage.
La satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux : à la source de la motivation intrinsèque et du bien-être au travail
La théorie de l’autodétermination, associée aux travaux de Ryan et Deci (1996), est un modèle de la motivation humaine qui met en lumière notre aspiration naturelle à l’autodétermination et à l’épanouissement personnel. Elle suggère que les êtres humains cherchent à satisfaire un certain nombre de besoins psychologiques fondamentaux qui, lorsqu’ils sont comblés, peuvent conduire à une plus grande motivation intrinsèque et à un bien-être psychologique accru.
La théorie de l’autodétermination distingue deux types de motivations : intrinsèque et extrinsèque.
Dans le cadre de la motivation intrinsèque, l’action est conduite uniquement par l’intérêt et le plaisir que l’individu y trouve, sans attente de récompense externe. Les individus s’engagent dans des activités parce qu’ils les trouvent gratifiantes, plaisantes et stimulantes en elles-mêmes. La motivation intrinsèque provient de la passion, du désir de maîtrise et de la recherche de sens dans ce que nous faisons.
Dans le cadre de la motivation extrinsèque, l’action est provoquée par une circonstance extérieure à l’individu (punition, récompense, pression sociale, obtention de l’approbation d’une personne tierce, salaire, primes…). Les facteurs de motivation extrinsèque sont à manier avec beaucoup de précaution, car ils peuvent venir affaiblir la motivation intrinsèque.
Les trois besoins psychologiques fondamentaux, piliers de la motivation intrinsèque, sont : l’autonomie, la compétence et la relation.
L’autonomie concerne le sentiment de maîtriser ses propres actions et décisions, sans forcément aspirer à une indépendance complète vis-à-vis d’autrui. Elle est liée au sentiment d’être l’acteur principal de sa vie, de ses actions et de ses choix, plutôt que de se sentir contraint par des facteurs externes. Dans un contexte de travail, par exemple, un employé peut se sentir autonome s’il a la possibilité de prendre des décisions sur la manière dont il accomplit ses tâches.
La compétence se réfère au besoin de maîtriser notre environnement et de nous sentir efficace dans les interactions avec celui-ci. C’est le sentiment d’être « capable » dans les activités que nous entreprenons. Pour satisfaire ce besoin, il faut avoir des occasions de renforcer ses compétences et de surmonter des défis.
La relation (relatedness) renvoie au désir d’être connecté aux autres, d’appartenir à un groupe et de se sentir apprécié et compris. Les relations positives avec les autres contribuent à notre sentiment de sécurité, à notre estime de soi et à notre capacité à nous épanouir.
En comprenant ces besoins et en travaillant à leur satisfaction, il est possible de créer des environnements de travail qui favorisent l’épanouissement personnel et le bien-être psychologique.
Le mode de management dit de commandement et contrôle5 tente traditionnellement de régler en détail les comportements et les gestes des employés, de manière qu’ils ne puissent pas s’écarter de la ligne fixée par les managers et les services support. Les managers sont choisis pour leur capacité à faire « tourner » le système, à éteindre les feux, à décider de tout et à faire appliquer leurs décisions et méthodes. Et in fine à reconnaître la loyauté de leurs équipiers dans l’exécution.
Dans ce modèle, la responsabilité des employés qui exécutent le travail est limitée à la conformité d’application de normes, de règles et de modes opératoires. La performance globale du collectif est exclusivement du ressort des managers et de quelques activités support, en capacité d’exercer une supervision du travail de nature à enrayer les dérives, à obtenir la performance souhaitée et à trouver des voies de progrès.
Ce modèle a évidemment évolué depuis l’avènement du taylorisme. Les organisations contemporaines sont toujours convaincues, à juste titre, que les règles, les normes et les standards de qualité sont indispensables pour faire du bon travail. Mais elles se sont aussi rendu compte que la nature du travail s’est complexifiée, du fait de la diversité et de la personnalisation des produits et des services, mais aussi du fait de la fragmentation des chaînes de valeur et de leurs multiples interfaces. Les situations de travail présentent ainsi de plus en plus de singularités, que les prescriptions, aussi précises soient-elles, ne parviennent plus à décrire de manière exhaustive. En définitive, l’OR peut être vue comme une réponse à la complexité. Les théoriciens des organisations ont en effet identifié depuis longtemps que l’organisation directive et pyramidale est pertinente dans des cas de relative simplicité des objectifs, mais qu’elle l’est beaucoup moins dans des situations complexes caractérisées par un haut niveau d’incertitude et d’instabilité (Burns et Stalker, 1961).
Comme l’expliquent respectivement Yves Clot (2021) et Mathieu Detchessahar (2019), la complexité entraîne le besoin d’un recours accru à la délibération et aux arbitrages sur la manière de faire un « bon » travail, car il n’y a généralement pas qu’une seule bonne manière d’opérer. Ces auteurs recommandent de sortir du « délire » techniciste consistant à vouloir « capturer » la totalité du contenu du travail par la multiplication des prescriptions et des contrôles. Tout au contraire, dans ce monde complexe de l’interdépendance assumée, chacun doit pouvoir disposer d’une latitude pour construire de manière coopérative les normes auxquelles il sera soumis, à travers un dialogue entre ceux qui prescrivent le travail, ceux qui le gèrent et ceux qui l’exécutent. En fait, chacune de ces catégories doit faire bouger son rôle et son cadre, en acceptant de se nourrir des savoirs et des besoins des autres catégories.
Le « modèle » responsabilisant fait partager à tous les membres la vision de ce qui est bon pour l’entité, puis il déplace progressivement les frontières des responsabilités et des compétences, pose des principes généraux de comportement et d’action, et laisse les employés trouver par eux-mêmes le chemin et la manière qui vont leur permettre de contribuer efficacement aux objectifs définis par les niveaux hiérarchiques supérieurs. On cherche alors des managers servant leaders6 qui auront la capacité d’orienter et de faire progresser leurs équipiers, de partager des défis et de développer l’amélioration continue, de faire confiance (lâcher prise) et d’encourager et de reconnaître les initiatives et l’engagement.
L’OR est donc une organisation dans laquelle faire gagner l’entité n’est plus uniquement le souci de certains, mais devient celui de tous. C’est toute l’équipe qui se sent maintenant responsable de la performance du collectif, et qui va commencer à voir comment sa propre performance contribue aux résultats plus globaux de l’entité… Prenons l’exemple d’une équipe dans l’industrie qui fait face à un retard de production qu’elle doit rattraper. Dans une organisation traditionnelle, c’est au responsable de l’équipe de décider la mise en œuvre des moyens pour rattraper le retard (demande d’heures supplémentaires aux équipiers ou sollicitation d’une ressource externe), et aux services support d’organiser ces moyens. Dans une organisation responsabilisée, c’est le collectif de travail qui décide des moyens de rattraper son retard et qui mobilise ses ressources pour le faire. Mais pour cela, encore faut-il, d’une part, que les individus comme les équipes aient compris les enjeux dudit retard de production et aient envie de s’engager à le rattraper et, d’autre part, qu’ils aient accès à des ressources externes si elles s’avèrent nécessaires.
La démarche de responsabilisation parie sur l’intelligence des acteurs, en mobilisant l’ensemble de leurs capacités, ce qui permet d’insuffler aux méthodes de travail un dynamisme dont elles manquent trop souvent. Les processus s’accélèrent, l’organisation devient plus agile et les personnes s’investissent davantage pour résoudre les problèmes qui correspondent à leur niveau d’expertise.
Les gains attendus pour l’entreprise portent en général sur l’amélioration de la santé et du bien-être au travail, du time-to-market, de la qualité des produits et des services, de la flexibilité des opérations et de la réactivité. S’y ajoute aussi une dimension d’attractivité, car disposer d’une certaine liberté d’action répond à une attente des employés, notamment des plus jeunes. En élargissant et en enrichissant les tâches, en créant un fort esprit d’équipe et un vrai sentiment d’appartenance, en utilisant pleinement les compétences de tous, l’OR permet aux personnes de trouver davantage de sens à ce qu’elles font quotidiennement. Le fonctionnement en OR est donc un des leviers qui permet de donner aux employés l’envie de venir et de rester dans l’entreprise.
- 5. Traduction de command and control. Notons que contrairement à la traduction courante qui fait de to control l’équivalent de « contrôler » en français, to control signifie en réalité « maîtriser » (avoir la maîtrise d’une situation, de ses émotions, etc.), c’est-à-dire « avoir une situation sous contrôle » plutôt qu’avoir un comportement de manager « contrôlant ». Dans son sens originel, le mode command and control reste tout à fait d’actualité, car garder la maîtrise des situations est à l’évidence la mission centrale des managers.
- 6. On doit cette expression à Robert K. Greenleaf (1904-1990), fondateur du Greenleaf Center for Servant Leadership (initialement appelé Center for Applied Ethics).
Les trois « pourquoi » d’une transformation responsabilisante
Si, comme nous l’avons évoqué en introduction, les transformations responsabilisantes sont complexes à mener, prennent du temps et ne produisent pas forcément les résultats escomptés, qu’est-ce qui peut bien pousser les organisations à tenter encore et toujours d’y revenir ? C’est qu’il existe évidemment une foule de bonnes raisons qui se conjuguent pour inciter les entreprises à entreprendre cette démarche. Nous les avons rassemblées selon trois « pourquoi » qui sont aussi autant de « pour quoi ».
Le « pourquoi » de l’entreprise
Pendant longtemps, le but de l’entreprise a été peu questionné car il était considéré comme évident. Le développement de l’entreprise et la création de valeur pour ses actionnaires représentaient les finalités principales, voire uniques, de son action. La richesse ainsi créée était supposée « ruisseler » sur la société dans son ensemble (salariés, territoires, sous-traitants, État) via les salaires, la fiscalité, les achats, etc. – ce qui pouvait justifier, même au regard des autres parties prenantes, que son existence et son rôle soient décrits en des termes aussi étroits.
Mais la situation s’est progressivement compliquée. La conception friedmanienne7 de l’entreprise (en particulier de la grande entreprise multinationale) a été de plus en plus mise en cause, notamment à partir de la crise financière de 2008, en raison, entre autres, de la montée en puissance des préoccupations climatiques. Les conséquences de la focalisation de l’entreprise sur la seule création de valeur pour les actionnaires apparaissent désormais comme trop lourdes à supporter sur un plan macroéconomique, social et environnemental. L’entreprise va devoir reconstruire l’acceptabilité sociétale de son action et poser à nouveau les bases de sa légitimité, dans l’intérêt même de ses actionnaires. Quelques dirigeants commencent alors à tenir compte de ces évolutions et à entériner l’idée que les actionnaires ne sont pas les seuls détenteurs de l’entreprise, ils sont seulement les propriétaires des actions (Baudoin et al., 2012). Il paraît de plus en plus nécessaire de penser ce corps organique qu’est l’entreprise en articulant de manière plus pertinente et juste les pouvoirs et les responsabilités qui lui sont associés. La théorie des parties prenantes (Freeman, 1984) (salariés, clients, fournisseurs, territoires, environnement, pouvoirs publics, etc.) ainsi que la vocation de création-innovation de l’entreprise pour résoudre les problèmes du monde (entreprise contributive) vont fournir un cadre intellectuel à cette refondation (Segrestin et Hatchuel, 2012). S’ensuivra en France un intense débat intellectuel et politique qui débouchera en 2019 sur l’adoption de certaines dispositions de la loi PACTE8.
Cette dernière prévoit une progressivité dans la responsabilité sociétale des entreprises. Elles ont désormais l’obligation de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités (clause « de considération »). Elles peuvent en outre se doter d’une « raison d’être » dans leurs statuts. Elles peuvent enfin s’engager dans une démarche de « société à mission », en se donnant des finalités sociales ou environnementales précises, dont la réalisation sera suivie par un comité de mission et sera auditée par un organisme tiers indépendant.
La raison d’être de l’entreprise fait référence à sa mission fondamentale ou à la vision qu’elle a de son rôle dans la société. L’idée est qu’une assise solide permettra d’inscrire l’action de l’entreprise dans une vision de long terme partagée par toutes les parties prenantes, capable de guider ses choix stratégiques au-delà des aléas de gouvernance et des exigences financières des actionnaires. En allant au-delà de la simple réalisation de profits (sans y renoncer), ce nouveau cap assigne généralement à l’entreprise la poursuite d’une pluralité d’objectifs (création de richesses, progrès social, préservation de l’environnement), souvent résumés par l’expression « People, Planet, Profit ». Lors de son audition par la commission sénatoriale sur la transformation des entreprises (25 octobre 2018), Jean-Dominique Senard, alors président du groupe Michelin, précisait ainsi : « Cette raison d’être est un peu comme un fil directeur [qui] relie le passé de l’entreprise à son avenir, mais elle dit également à chacun la raison pour laquelle il se lève le matin pour aller travailler dans l’entreprise. […] C’est un sujet extrêmement porteur, fédérateur, créateur d’engagement et finalement de compétitivité. Il n’y a pas de compétitivité sans engagement. »
La raison d’être de l’entreprise a connu, depuis 2019, un certain succès d’adoption, notamment à travers des exercices de consultation massive auprès des parties prenantes. Mais quel est l’impact de cette raison d’être sur les réalités du travail au sein des équipes ? Selon le Baromètre 2023 de l’Institut de l’Entreprise sur la relation des Français à l’entreprise9, seuls 12 % des sondés savent en définir le concept, et 63 % d’entre eux considèrent que les entreprises qui expriment leur raison d’être le font par opportunisme, contre 36 % qui voient cette démarche comme étant sincère. Pour que la raison d’être ne reste pas une déclaration incantatoire déconnectée des pratiques, les entreprises et leurs dirigeants vont devoir mettre en musique des objectifs pluriels, qui sont loin d’être spontanément alignés, et les équilibrer. Bienvenus dans un monde complexe ! Des débats et des arbitrages seront nécessaires à chaque niveau de l’entreprise pour s’approprier cette raison d’être et la décliner en objectifs opérationnels. L’organisation responsabilisante (OR) apparaît, dès lors, comme une voie pour donner de la substance à la raison d’être et l’inscrire en profondeur dans la réalité des pratiques de travail. Comme le souligne Valérie Duburcq (Orange), « recourir à la co-construction pour définir la vision ou le rêve, c’est bien, mais si cela ne va pas de pair avec le développement de l’autonomie et de la responsabilité dans les actions du quotidien, cela risque de ne convaincre personne ».
Les « pourquoi » du dirigeant ou de l’équipe dirigeante
La décision d’engager une transformation responsabilisante sera généralement le fait d’un dirigeant d’entreprise ou d’une équipe dirigeante.
Conviction intime du dirigeant
Elle peut répondre à une conviction intime du dirigeant fondée sur son histoire personnelle, sa sensibilité ou ses principes moraux.
Le repreneur de l’entreprise Fayolle, spécialisée en chaudronnerie et tôlerie, dit ainsi : « Je crois énormément aux vertus du développement de l’autonomie et de la responsabilité dans les équipes, pour être capable de m’adapter au temps long et à tout ce que je veux vivre dans ma boîte. » Certains dirigeants n’aiment pas particulièrement contrôler et rêvent d’une organisation où ils auraient le moins possible à intervenir dans le fonctionnement quotidien : « Je n’aime pas contrôler les autres, dit Frédéric Lippi, et par conséquent, j’essaie de faire en sorte qu’ils se contrôlent eux-mêmes » (Pellerin et Cahier, 2019).
Certains réagissent aussi à des expériences professionnelles passées, comme Laurent Bizien, directeur général de Martin Technologies : « J’ai vécu la différence entre ce que c’était que de bénéficier de la confiance de mes dirigeants ou de ne pas l’avoir. Si je vis une période où on ne me fait pas confiance et où je dois tout faire valider, c’est une véritable descente aux enfers pour moi. Je trouvais profondément injuste que l’ensemble des collaborateurs ne bénéficie pas de la confiance, qui donne l’énergie et l’envie de faire les choses. »
Ces trois exemples sont issus d’entreprises assez petites et à gouvernance familiale, où le dirigeant dispose d’une large autonomie d’action, mais le même type de conviction peut s’exprimer dans de très grandes structures. Citons notamment Jean-Dominique Senard, alors président du groupe Michelin (120 000 salariés) : « On n’avancera pas dans les années qui viennent si nous ne faisons pas attention au développement des personnes, à leur devenir, leur bien-être social autant qu’à l’innovation, à la compétitivité, dans un monde qui devient de plus en plus difficile. […] Si nous ne faisons pas attention aux deux en même temps, nous allons dans un mur et à relativement brève échéance. La prise en compte des questions humaines est pour moi – et je ne suis pas le seul à le penser – au cœur de l’avenir de nos entreprises.10 » Cette approche ambidextre (attention au client et au développement des personnes) est parfois appelée symétrie des attentions©11 (Meyronin, Ditandy, 2007) ou encore éthique du care12 (Zielinski, 2010).
Considérations de croissance, de résilience, de pérennité, d’agilité
La conviction intime des dirigeants est cependant rarement déconnectée de considérations stratégiques pour l’entreprise. Considérations de survie parfois, de performance le plus souvent.
« Le pourquoi, c’est la survie, la pérennité de l’entreprise, garantir des emplois pour une centaine de personnes pour plusieurs décennies », précise Laurent Bizien (Martin Technologies). Et pour Florent Menegaux, président de Michelin depuis 2019 : « Dans un monde qui se transforme à une vitesse incroyable, l’entreprise doit s’adapter, évoluer et agir. Et pour cela, il faut d’abord que chacun comprenne pourquoi et pour quoi on est ensemble. Si votre corps social, votre communauté humaine, n’adhère pas et ne se mobilise pas, vous n’arriverez à rien » (Chaire FIT2, 2021).
Le dirigeant aura, par exemple, pu constater les limites d’un management vertical en matière d’adaptabilité, de souplesse, de rapidité, de capacité d’initiative et d’engagement des salariés. Il souhaite donner davantage d’agilité à l’organisation en déconcentrant les capacités de décision au plus près du niveau où elles peuvent être prises. Ainsi, témoigne un dirigeant, « on recrute des gens créatifs et, quelques années après, ils ne le sont plus. On demande aux entités d’être agiles, mais on demande aux personnes de passer la moitié de leur temps à obtenir des décisions et des validations ». Chez Renault Group (environ 105 000 salariés en 2022), par exemple, la responsabilisation des équipes a été évoquée dès 2018 en lien avec un ambitieux plan de transformation « agile » du groupe, pour répondre à des enjeux assez génériques : mieux aligner les objectifs, réduire le time-to-market, accroître l’engagement des collaborateurs et mieux répondre aux attentes du marché. Ce projet de transformation a été mis en œuvre depuis quatre ans avec un certain succès sur les plateaux de développement produit, mais, par suite de l’arrivée de nouvelles équipes dirigeantes, il a pris d’autres formes dans le reste du groupe13.
Verticalement, la transformation vise souvent à réduire le nombre de strates hiérarchiques pour gagner du temps et de la pertinence dans les prises de décision (et parfois pour réduire la masse salariale). Horizontalement, elle a pour but de réussir à « désiloter » pour fluidifier les processus aux interfaces et améliorer les collaborations interservices. Les silos sont en effet de grands « protecteurs » de l’autonomie organisationnelle, ce qui explique leur prégnance au sein des organisations. Ils s’opposent toutefois à l’agilité d’ensemble, qui passe par une meilleure coopération entre les entités. L’OR est supposée agir sur les silos, mais les effets réels de la responsabilisation sur les coopérations transverses ont été jusqu’ici peu analysés. Dans la pratique, on observe souvent que des équipes même responsabilisées n’ont pas toujours la capacité de peser sur les coopérations transversales, qui restent dans l’immense majorité des cas l’apanage des managers et continuent de passer par la voie hiérarchique.
Enfin, selon Valérie Duburcq (Orange), l’amélioration de la performance n’est pas le premier objectif de ce type de transformation. Cette dernière vise avant tout à permettre aux entreprises de s’adapter plus rapidement à un environnement durablement incertain (succession de crises de diverses natures). Pendant la pandémie du Covid-19, l’efficacité des opérations sur certains sites industriels où tout l’encadrement était confiné et les opérateurs se rendaient physiquement à leur poste a pu être maintenue grâce à ce travail préalable de responsabilisation. Pour Frédéric d’Arrentières (Renault Group), « la transformation permet de franchir un cap que l’on ne pourrait pas atteindre en misant seulement sur le progrès continu. L’enjeu pour l’entreprise est de franchir des seuils de performance, en introduisant une rupture dans l’efficience collective sur le long terme et en activant les leviers de motivation associés. »
Selon les types d’entreprises, de dirigeants, de menaces pesant sur l’activité, la responsabilisation des personnes pourra être vue comme un but en soi ou seulement comme un levier, modulant ainsi l’ambition poursuivie.
Attractivité, difficultés de recrutement et de fidélisation
Ces transformations répondent aussi au constat que le niveau d’information et de formation des salariés a considérablement augmenté au fil du temps. Avec 80 % d’une génération dotée du baccalauréat en 2021 contre 29 % en 1985, il devient quasiment impossible de manager uniquement par le commandement et le contrôle. Comme l’indique encore Florent Menegaux (Michelin) : « Si vous vous adressez aux jeunes générations sur un mode pyramidal, elles vous regardent comme un OVNI. Les jeunes vérifient tout ce que vous leur dites sur leur téléphone et ils vous interpellent en permanence avec ces arguments. Ils ne veulent pas des instructions, ils veulent comprendre le pourquoi des choses et participer à les construire. Il y a un changement très profond des mentalités. Chez Michelin, nous avons plus de 50 % de nos effectifs qui sont des millenials14 et, donc, nous sommes confrontés à cette situation en permanence » (Chaire FIT2, 2021).
Une plus forte latitude d’action et de décision donnée aux salariés peut être considérée comme un facteur d’attractivité pour l’entreprise, permettant de lutter contre les difficultés de recrutement ou de fidélisation (turn-over, absentéisme), notamment dans des secteurs où les conditions de travail sont déjà jugées difficiles ou fortement prescrites, tels que les ateliers de production, le BTP, l’hôtellerie-restauration, la santé, etc. (Canivenc, 2024). Dans le secteur industriel, par exemple, les difficultés de recrutement demeurent vives : en avril 2023, 65 % des chefs d’entreprise déclaraient en rencontrer, une proportion légèrement plus élevée qu’en janvier 2023 et proche du niveau le plus élevé jamais atteint, en juillet 2022 (67 %) (Insee, 2023).
Enfin, les enquêtes annuelles auprès des salariés, lorsqu’elles révèlent un niveau de désengagement en hausse, peuvent aussi être un facteur amenant un dirigeant à s’intéresser au sujet de la responsabilisation.
Santé au travail et performance
Il existe une convergence entre l’analyse psychosociologique du travail et la quête de performance des organisations. La santé des travailleurs et la performance se rejoignent pour deux raisons.
Tout d’abord, préserver la santé des collaborateurs est une ressource pour la performance durable des organisations. Si l’on n’en tient pas compte, les problèmes de santé reviennent en boomerang dans l’entreprise sous la forme de turn-over, d’absentéisme, de désengagement et de démobilisation, affectant la performance. Quand ces indicateurs se dégradent, la perspective d’une organisation responsabilisante suscite soudain un nouvel intérêt.
Mais inversement – et cette seconde idée est sans doute moins intuitive – la performance du travail est aussi une ressource pour la santé. Selon le psychologue du travail Yves Clot, la majorité des individus aspire à faire du bon travail, ce qui représente un facteur de fierté et d’engagement : « L’homme possède le goût du travail efficace et déteste les efforts inutiles » (Clot, 2019). Pourtant, dans une majorité d’organisations, le « bon travail » est en réalité « empêché » par toutes sortes d’objectifs irréalisables, de règles absurdes, d’inefficiences et de gaspillages. Comme en témoigne un salarié : « J’ai bien envie d’atteindre les objectifs, mais j’aimerais surtout être un peu moins “emmerdé” quand je fais mon boulot. » Les premiers à en être conscients sont les travailleurs en prise avec le travail réel, mais personne ne se préoccupe de leur demander leur avis. Dans le meilleur des cas, c’est seulement la passivité qui gagne ; dans le pire, le sentiment d’inutilité et d’efforts gaspillés se retourne contre la santé mentale du travailleur. L’un des premiers moteurs de la santé au travail consiste à réussir à bien faire dans de bonnes conditions d’efficacité et de satisfaction le travail qui est demandé, « un travail dans lequel je puisse me contempler », nous dit Mathieu Detchessahar15, citant la philosophe Simone Weil.
Le double souci d’efficacité du travail et de santé au travail appelle ainsi à appliquer autant que possible le principe de subsidiarité, en transformant les instances de niveau supérieur en instances supplétives. « Sans se sentir, au moins de temps en temps, peser dans les situations, celles et ceux qui travaillent sont exposés à un sentiment d’inutilité associée à cette irresponsabilité subie », souligne encore Clot (2019).
Le « pourquoi » des salariés
La crise sanitaire du Covid-19 a joué un rôle d’accélérateur de tendances pour ce qui concerne les attentes des salariés. Les confinements stricts qui ont conduit à une certaine démocratisation du télétravail ont interrogé le modèle de management qui reposait largement sur le contrôle et la présence physique. Avec le télétravail, il est devenu plus difficile non seulement de surveiller la façon dont les salariés s’organisent et occupent leur temps, mais aussi de coordonner les tâches et de faire valider les décisions. Ces circonstances ont fait bouger les esprits à la fois chez les salariés et chez certains managers, qui ont dû, dans l’urgence, accepter de faire confiance. Cette demande de confiance était exprimée à bas bruit depuis longtemps sans grands effets, suscitant une relative résignation (Canivenc, 2024). Les directions des ressources humaines avaient conscience de cette attente qui se traduisait par un désengagement croissant, mais la jugeaient suffisamment modérée pour ne pas avoir à changer de modèle.
Désormais, il ne suffit plus à une entreprise d’afficher une raison d’être. C’est sa manière d’agir envers les salariés qui suscitera leur envie de venir, de produire et de rester (Serre, 2021). C’est pour des raisons plus globales que l’obtention d’un revenu ou l’exercice d’un métier que les salariés décideront de rejoindre une organisation et surtout d’y rester. Dans des univers comme l’hôpital ou l’éducation, la raison d’être de leur travail est évidente aux yeux de ceux qui s’y engagent mais, pour autant, les conditions de travail dégradées dans ces secteurs ont conduit à une crise aiguë des vocations et à une cascade de démissions.
Le sens du travail a souvent été évoqué comme une nouvelle attente importante des salariés, particulièrement des jeunes. Mais ce sens n’est pas seulement lié à l’impact qu’une organisation exerce sur le monde et la société. Il repose certes sur l’utilité sociale perçue du travail, mais tout autant sur les moyens de bien travailler (conditions de travail, ressources, qualité de la relation avec la hiérarchie, ambiance de travail, reconnaissance) et sur la possibilité de développer ses compétences (Coutrot et Perez, 2022). Selon une enquête récente conduite par OpinionWay pour le cabinet de conseil Kéa (2023), les moins de 45 ans citent parmi les trois premiers critères de réussite professionnelle sur onze, dans l’ordre : le salaire, l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle et la liberté d’action et de décision. C’est désormais la question de la qualité du travail lui-même qui est posée aux organisations. À certaines conditions, l’organisation responsabilisante peut répondre à cette attente.
Enfin, il existe une catégorie de salariés particulière, les managers, notamment les managers de proximité. L’organisation responsabilisante a souvent été vue comme un facteur de déstabilisation des managers, qui ne savent plus s’ils doivent « commander » pour faire respecter les règles et les objectifs ou s’ils doivent être bienveillants et venir en appui du développement des personnes, ou encore faire les deux en même temps au risque de devenir schizophrènes (Nivet, 2019). En réalité, l’organisation responsabilisante peut représenter une bouffée d’oxygène pour les managers. Ils disposent ainsi, dans les équipes, de relais leur permettant de ressentir moins de stress dans la marche des affaires courantes, et peuvent s’appuyer sur des équipes support qui soient réellement facilitantes, plutôt que d’être en permanence sollicités par elles ou de se sentir redevables pour la moindre de leur intervention. Ils peuvent aussi puiser énormément d’énergie et de sens dans la transformation de leur rôle, à travers les relations qu’ils nouent avec les membres de leur équipe et par le fait d’inspirer des personnes et de les voir s’épanouir. Tout dépendra bien entendu de l’accompagnement qu’ils recevront pour parvenir à ce changement de posture, et de la valorisation qui leur sera accordée tout au long de la transformation.
Prendre le chemin de l’organisation responsabilisante répond, par conséquent, à une série de « pourquoi ». Il sera très important de clarifier dans chaque entreprise les attentes qui président à la démarche, afin de valider leur cohérence, et d’aligner ces différents « pourquoi ». Cette clarification permettra aussi de cerner ce qu’on attend de la transformation. Cela peut influencer l’ambition de la démarche, le chemin qui sera suivi, ainsi que les échéances qu’on se donne et les critères à partir desquels elle sera évaluée. François Levert, ancien responsable Manufacturing Way & Empowerment pour les sites industriels de Michelin, fait d’ailleurs remarquer que, dans les expériences de transformation qui échouent, la réflexion sur les objectifs poursuivis a souvent été bâclée et que l’on a donné plus d’importance à la méthode qu’à la définition du but à atteindre. Un élément ressort clairement de l’ensemble des témoignages : il faut que la transformation proposée ait du sens pour chaque catégorie des parties prenantes, dirigeants, actionnaires, managers et salariés.
- 7. Fondateur de l’École de Chicago, Milton Friedman (1912-2006) est souvent considéré comme le père de la « valeur actionnariale de l’entreprise ».
- 8. Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises.
- 9. Baromètre 2023 de l’Institut de l’Entreprise sur la relation des Français à l’entreprise (3e vague), réalisé avec le cabinet d’études et de conseil ELABE et en partenariat avec Malakoff Humanis et Veolia, auprès d’un échantillon de 1 320 Français dont 769 salariés. L’enquête a été complétée par un volet qualitatif donnant la parole à 11 dirigeants de grandes entreprises issus de secteurs et de modèles économiques diversifiés.
- 10. Audition de Jean-Dominique Senard à la Commission sénatoriale sur la transformation des entreprises. 25 octobre 2018.
- 11. Théorie décrite initialement dans l’ouvrage de Benoît Meyronin et Charles Ditandy (2007). Aujourd’hui, marque déposée par l’Académie du Service.
- 12. Prendre soin.
- 13. Témoignage de Frédéric d’Arrentières, d’Olivier Pareja et de Sylvain Gelfi (Renault Group), 25 avril 2023.
- 14. Terme désignant des personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. On parle aussi de génération Y.
- 15. Conférence de Mathieu Detchessahar à la Carsat (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) Auvergne, 2016, en replay sur YouTube.
La boussole de la responsabilisation : cinq dimensions qui font système
Nous appelons « boussole de la responsabilisation » une grille d’analyse du système que représente une organisation responsabilisante (OR). Elle a été initialement inspirée par un texte de Pierre-Yves Gomez16 publié sur son site, portant sur la mise en place de la subsidiarité dans les organisations (Gomez, 2023).
Le but de la boussole est de faire réfléchir l’équipe dirigeante et, par la suite, toute l’organisation, sur chacune des cinq dimensions qui la constituent avant et pendant la transformation.
Les cinq points cardinaux de la boussole de la responsabilisation
Les cinq « points cardinaux » de cette boussole forment un « système17 », et décrivent ce qui est « juste nécessaire » au développement d’une OR (voir figure 3.1). Chacun constitue un repère pour une « intelligence » de la transformation à opérer, dont nous avons dit en introduction qu’elle nécessite beaucoup de réflexion en amont.
Figure 3.1 – La boussole de la responsabilisation : les cinq dimensions d’une organisation responsabilisante
Le premier point, la responsabilité, est le principe selon lequel chacun doit rendre des comptes au prorata de son pouvoir d’agir. L’objectif de la responsabilisation est d’élargir et d’enrichir progressivement le niveau de redevabilité de chacun (et donc du pouvoir d’agir de chacun).
Le deuxième, la subsidiarité, est le principe selon lequel les échelons supérieurs s’interdisent de s’approprier les attributions dont les échelons inférieurs sont capables de s’acquitter à leur seule initiative et par leurs propres moyens. Il tient son nom du latin subsidium (réserve, soutien), marquant par là que le rôle des échelons supérieurs est d’apporter leur aide et leur soutien si le besoin en est exprimé par un échelon subordonné, jamais de se substituer à lui.
Le troisième, la solidarité, se traduit par l’assistance et la coopération qui se développent entre les personnes d’un groupe ou d’une communauté, du fait du lien qui les unit. Dans les organisations, elle s’exerce prioritairement à l’intérieur de la communauté de travail.
Le quatrième, la collégialité, renvoie à la pratique de la délibération en groupe, dans un esprit d’intelligence collective et d’enrichissement des décisions à prendre. Elle peut également renvoyer au principe de construction collective des solutions. La collégialité implique le développement de compétences spécifiques (capacité à s’exprimer, communication non violente, gestion des conflits, etc.) et l’installation d’instances organisées pour délibérer.
Enfin, le cinquième, l’activité, se concentre sur la différence entre le travail prescrit et le travail réel, et sur les solutions que les personnes mettent en œuvre pour résoudre cette discontinuité. L’analyse de l’activité a pour but de favoriser la contribution des travailleurs à la conception des règles qui leur permettront de faire du « bon travail », source de leur santé physique et mentale.
Chacun de ces principes devra être « déplié » pour en comprendre la portée et les interactions. Ce cadre de pensée peut apparaître comme théorique, mais son appropriation est en réalité indispensable pour construire des modes d’action concrets. « Rien n’est plus pratique qu’une bonne théorie18. »
La nature systémique de cette boussole sera bien illustrée dans l’exposé qui suit par le fait qu’il est très difficile d’expliquer l’une de ses dimensions sans faire immédiatement référence aux autres.
Responsabilité
La notion de responsabilité est première et fondamentale. Une personne devient responsable lorsqu’il est possible de lui imputer les effets de ses actes, que ces effets soient positifs ou négatifs, au prorata de son pouvoir d’agir. Autrement dit, on ne peut être tenu pour responsable que de ce dont on est la cause.
Responsabilité et pouvoir d’agir
Responsabilité et pouvoir d’agir (souvent appelé « autonomie ») sont donc les deux faces d’une même médaille. La responsabilité implique de l’autonomie, c’est-à-dire de disposer d’un pouvoir d’action. Disposer d’un pouvoir d’action signifie, d’une part, de disposer du droit d’agir et, d’autre part, d’avoir la compétence pour agir.
L’exemple de la conduite automobile (voir encadré) éclaire le fait qu’une organisation responsabilisante s’assure du bon équilibre entre la reddition des comptes (accountability) et le pouvoir d’agir (empowerment). Si je peux faire ce que je veux comme je veux, sans jamais risquer de me voir imputer les conséquences de mes actes, je suis ce qu’on appelle un « irresponsable ». À l’inverse, si je ne suis qu’un « instrument passif » dans l’exécution, appliquant à la lettre des instructions et des consignes qui me sont données, je ne peux être réellement considéré ni comme la cause de ce qui arrive de bon, ni comme la cause de ce qui arrive de fâcheux. Je ne peux donc pas être considéré comme responsable.
Responsabilité et pouvoir d’agir : l’exemple de la conduite automobile
Prenons un exemple tiré de la vie courante, la conduite d’un véhicule automobile. À l’issue d’un apprentissage théorique et pratique avec un moniteur certifié, l’examen a permis de qualifier notre aptitude à la conduite d’un véhicule. Nous détenons un « permis » de conduire. Ce permis nous donne une grande liberté grâce à la possibilité de nous déplacer selon notre bon vouloir, en autonomie. Le permis de conduire augmente notre « pouvoir d’agir », tout en garantissant que nous connaissons le code de la route, que nous devons respecter. Nous pouvons alors agir en conducteur responsable. Responsable, en premier lieu, parce que lorsqu’un conducteur provoque un accident, il aura à en assumer les conséquences et sera tenu de réparer l’éventuel préjudice causé à autrui. Responsable, également, parce que l’événement sur lequel le conducteur aura à rendre des comptes est considéré comme la conséquence de ses décisions et de ses actes. Le code de la route est le cadre dans lequel s’inscrit le pouvoir d’agir mais également la responsabilité du conducteur. En principe, tout se passe bien à trois conditions : i) respecter le code de la route (le cadre de la responsabilité) ; ii) avoir la maîtrise de son véhicule (la compétence) ; iii) faire preuve d’anticipation et de prudence (le comportement).
En tant que conducteurs, nous avons rarement été impliqués dans une réflexion sur la définition de ce qu’est « un conducteur responsable », sauf peut-être pour quelques- uns à l’occasion d’un stage forcé de rattrapage des points perdus et donc sous la menace d’une suspension du permis. Faire réfléchir chaque membre du collectif sur ce que veut dire être responsable apparaît ainsi comme un préalable nécessaire sur le chemin de l’organisation responsabilisante.
Développer la responsabilité implique que deux processus puissent se déployer : un premier ouvrant des droits pour agir et un second permettant de développer des compétences pour agir. La responsabilisation consistera à étendre progressivement le domaine de redevabilité (et le pouvoir d’agir qui y est associé) attribué à chacun en fonction de sa montée en compétences.
La complémentarité entre reddition des comptes et pouvoir d’agir n’est pas une aspiration « naturelle » chez les travailleurs. Si nous sommes nombreux à vouloir renforcer notre pouvoir d’agir, il en va différemment dès lors que nous devenons redevables de nos décisions et actions. Certaines personnes ont envie de prendre des responsabilités, d’autres beaucoup moins. Ainsi, rapporte Pierre-Marie Gaillot, du Cetim, les témoignages recueillis lors d’une mission de transformation responsabilisante dans une PME attestent du passage difficile entre autonomie et responsabilité : « Les opérateurs ne voulaient pas prendre de décision. En revanche, ils voulaient que le patron prenne la décision qu’ils proposaient. »
En réalité, la question pour une direction n’est pas tant de savoir si les salariés ont initialement « envie » ou « pas envie » de prendre des responsabilités que de créer un contexte et des conditions de sécurité psychologique (Edmondson, 2018 ; Laborde, 2023) conduisant les personnes à prendre de plus en plus de décisions, puis à les assumer. Autrement dit, il s’agit de construire par la pratique un nouveau cadre de travail. La responsabilisation se fait généralement sur la base du volontariat, avec l’espoir que l’expérience des premiers volontaires permettra d’entraîner les autres. Tant qu’ils ne se transforment pas en saboteurs, les réfractaires doivent être respectés, car ils éclairent sur les risques portés par la transformation. Quelques dirigeants ont témoigné que les réfractaires du début deviennent souvent les meilleurs soutiens de l’OR quand ils commencent à en voir les effets. Enfin, le système de reconnaissance doit permettre aux personnes hésitantes de franchir le cap parce qu’elles y trouvent un intérêt.
La chaîne de responsabilité
La responsabilité de chacun s’inscrit dans une chaîne de responsabilité, chaque niveau de responsabilité correspondant à l’étendue de son pouvoir d’agir. Toutefois, il importe de souligner que, dans une organisation responsabilisée, avoir demandé et obtenu l’aval de sa hiérarchie dans le cadre de la chaîne de responsabilité ne dédouane pas de sa responsabilité propre. Par exemple, ce n’est pas parce qu’un comité de validation a approuvé une solution technique que la responsabilité de l’ingénieur qui l’a conçue et proposée sera dédouanée si la solution présente des failles ou donne de mauvais résultats. La notion de chaîne de responsabilité est souvent illustrée par l’exemple de la grue de Toul concernant la responsabilité juridique dans le champ des accidents du travail (voir encadré ci-dessous).
La grue de Toul
Un grutier intérimaire refuse par trois fois de continuer son travail en raison de ce qu’il considère comme un danger grave et imminent. Le vent est trop fort : l’anémomètre (appareil permettant de mesurer la vitesse ou la pression du vent) indique un danger. Le chef de chantier décide de lui faire continuer le travail, et l’oblige à remonter dans sa grue en le menaçant de licenciement. Le chantier reprend. La grue tombe. Plusieurs élèves du lycée voisin du chantier décèdent. Le grutier doit être amputé d’une jambe.
Le grutier a été condamné en appel, décision confirmée en cassation, pour n’avoir pas utilisé son droit de retrait. Il a été condamné avec sursis à 10 000 francs d’amende (à l’époque). Le chef de chantier a, lui, été condamné à 2 ans de prison ferme, le conducteur de travaux à 18 mois de prison ferme, le chef d’établissement de l’entreprise de bâtiment à 18 mois de prison ferme.
L’ensemble de la chaîne hiérarchique a ainsi été condamné. La condamnation du grutier est symbolique mais réelle. Le fait d’être victime soi-même d’un accident du travail n’exonère pas de sa responsabilité éventuelle envers les autres victimes.
Source : Légifrance, Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 mars 1999, 98- 82.594, inédit.
Même dans des cas moins dramatiques, la question de la chaîne de responsabilité est souvent ambiguë, et bien des organisations responsabilisantes achoppent sur ce point. Prenons un exemple non imaginaire de ces situations ambiguës.
Dans une usine, un responsable qualité expérimenté a certifié un lot présentant des non-conformités. Le directeur industriel du groupe le découvre et licencie le responsable. En réalité, l’enquête interne montre que ce responsable subit régulièrement des pressions de la part du directeur du site industriel (qui a aussi la charge de l’avancement du responsable qualité) pour livrer les lots dans les temps impartis au reste de la chaîne de production. Le responsable qualité est évidemment comptable de sa décision. Mais est-il cependant le seul responsable de la situation ? Le directeur du site n’aurait-il pas dû être licencié également au nom de la chaîne de responsabilité ? Peut-être même le directeur industriel aurait-il dû s’interroger sur les objectifs de performance assignés aux directeurs de site, pouvant les conduire à adopter des comportements non éthiques19 – en l’occurrence faire pression sur un collaborateur ? Que vous inspire cette histoire si vous l’appliquez à votre organisation ?
Cette histoire nous paraît nourrir l’idée que des groupes de discussion transversaux entre pairs20 peuvent venir soutenir l’éthique « métier » et la responsabilité individuelle, en amont de toute défaillance de responsabilité. Dans un groupe de discussion, les responsables qualité entre eux auraient probablement identifié que ce type de configuration existait ailleurs dans le groupe et ils auraient pu le faire savoir. Ils auraient pu débattre des principes de comportement à adopter dans de telles circonstances ; le soutien indirect du collectif aurait renforcé la posture du responsable qualité au moment d’être confronté à un tel arbitrage. Il appartient donc à une organisation responsabilisante de favoriser la constitution de ces groupes de pairs en cohérence avec la responsabilité qu’elle accorde à ses membres, afin de lutter contre la solitude que génère la responsabilisation (voir plus loin solidarité et collégialité). Le franchissement des lignes éthiques mettant en jeu la responsabilité individuelle ou la chaîne de responsabilité est bien souvent directement lié aux contradictions de l’organisation. L’OR doit viser à réduire ces contradictions.
Dans le tertiaire industriel (ex. l’ingénierie produit), où les organisations sont souvent matricielles et le travail organisé en mode projet, il peut exister une tension entre les responsabilités individuelle et collective au sein d’une équipe projet. Les orientations prises par le collectif pour atteindre l’objectif commun vont pouvoir s’appuyer sur le pouvoir d’agir et la compétence de chaque collaborateur qui le compose, chacun apportant son « mandat » (ingénieur produit, ingénieur process, acheteur, financier…). Mais a contrario le collectif « projet » ne peut s’arroger un pouvoir d’agir qui dépasserait le cadre de délégation de chaque collaborateur qui le compose, sous peine de mettre celui-ci en porte-à-faux vis-à-vis du « mandat » qui lui a été attribué par sa propre hiérarchie. Le pouvoir d’agir du collectif peut ainsi être bridé par la responsabilité individuelle de chacun de ses membres.
Subsidiarité
Le Robert donne de la subsidiarité la dé- finition suivante : principe « selon lequel une autorité centrale ne peut effectuer que les tâches qui ne peuvent pas être réalisées à l’échelon inférieur ». La subsidiarité est le principe qui permet au pouvoir d’agir de s’exercer à chaque niveau.
Délégation et subsidiarité
La notion de délégation est bien connue des entreprises : elle revient pour une autorité (un dirigeant, un manager) à transférer à un collaborateur une partie bien délimitée de ses responsabilités, et notamment de ses capacités d’action et de décision. Elle est, en règle générale, accompagnée d’une limite (ex. le pouvoir de signer des contrats jusqu’à un montant défini) et d’un contrôle a posteriori. Notons qu’en droit la délégation implique la conservation de la responsabilité entre les mains de celui qui délègue.
La subsidiarité part d’une prémisse différente : elle consiste à considérer que, par principe, la responsabilité de l’action appartient au niveau directement capable de s’en saisir, les échelons supérieurs n’intervenant que si le niveau inférieur leur demande de l’aide. Par exemple, un commercial est celui qui a la meilleure connaissance de son client et qui sait ce qu’il faut lui accorder pour le garder.
À l’inverse de la délégation, qui se conçoit du haut vers le bas, la subsidiarité se conçoit du bas vers le haut. Mais – et ce point est capital – « comme les collaborateurs ne peuvent pas détenir toutes les compétences permettant de réaliser un “bon travail”, ils concèdent une partie de leur pouvoir d’agir à une instance ayant une vision plus large des conséquences de leur activité, en la chargeant de proposer des outils ou des méthodes pour compléter et enrichir leur propre travail » (Gomez, 2023). Poursuivons avec notre exemple du commercial : le directeur commercial sait par expérience que les concessions que pourrait faire son vendeur pour fidéliser tel ou tel client entament la marge de l’entreprise ; pour que le commercial acquière une autonomie en la matière, c’est-à-dire un niveau de discernement lui permettant d’agir dans l’intérêt de l’entreprise, le directeur commercial devra lui fournir des outils lui permettant de calculer le niveau de remise possible en fonction du contexte. C’est en enrichissant le pouvoir d’agir du vendeur dans le cadre fixé par l’entreprise que le directeur commercial appliquera bien le principe de subsidiarité. Dans le cas contraire, le vendeur devrait systématiquement demander au directeur commercial l’autorisation d’accorder une remise ; la prise de décision serait ralentie et nous ne serions pas dans une OR.
Dans la pratique, délégation et subsidiarité coexistent dans certaines organisations. Dans le premier cas, le manager décide ce qu’il veut déléguer à son ou ses collaborateurs ; dans le deuxième cas, le manager annonce (ou négocie) ce qui appartient à son domaine réservé, tout le reste revenant à ses collaborateurs s’ils souhaitent s’en saisir.
Que devient le management avec la subsidiarité ?
Le principe de subsidiarité construit ainsi une logique de pyramide inversée dans laquelle la hiérarchie, à chaque niveau, vient en aide aux collaborateurs et aux collaboratrices pour qu’ils réussissent leur travail, mais sans faire ni décider à leur place (posture dite du servant leader). Cette philosophie du management a été joliment résumée par des opérateurs d’un îlot de Michelin à l’usine de Roanne : « Notre manager s’occupe de nous et nous, on s’occupe du reste. »
Le principe de management par non-substitution (corollaire de la subsidiarité) consiste à ne pas faire ni décider à la place de celui qui est responsable, mais à l’épauler dans son action ou sa prise de décision. Ce changement de posture est extraordinairement difficile pour les managers qui ont été formés à prendre des décisions et qui pensent généralement savoir mieux que leurs subordonnés ce qu’il convient de faire. Même quand c’est effectivement le cas, l’apprentissage de la responsabilisation nécessite de ne pas donner la réponse. C’est la posture décrite par Frédéric Lippi lorsqu’un collaborateur lui demande : « Comment dois-je faire ? », il répond : « Toi, tu ferais comment ? » Autrement dit, le manager doit désapprendre à faire ce qu’on lui a toujours appris et demandé de faire, et évacuer le territoire de la décision.
On peut, en travaillant sur le contexte, créer des opportunités pour que les équipiers puissent faire l’apprentissage de décider en autonomie. Dans l’univers de l’usine, par exemple, cela peut consister à trouver un nouvel équilibre dans le temps de présence de l’encadrement et des services support, et dans la posture qu’ils adopteront. Ainsi, chez Michelin, les managers et les services support ne sont présents que huit heures par jour, cinq jours par semaine (c’est-à-dire environ 25 % du temps sur la totalité de la semaine de production 24 h/7 j), de manière que des marges d’autonomie puissent être testées et expérimentées par les équipiers, construisant progressivement leur propre confiance en leurs capacités.
En mesurant le flux des décisions qui remontent au niveau supérieur et en analysant leur nature, le manager peut vérifier si la subsidiarité fonctionne. Si trop de problèmes à trancher remontent au niveau supérieur, par exemple dans le cadre des animations à intervalle court, c’est que le fonctionnement en subsidiarité n’est pas encore parvenu à maturité. Au manager alors de chercher ce qu’il manque à l’équipe de terrain pour résoudre ces problèmes et ce qui explique le volume des remontées. Michelin avait notamment mis au point un petit outil d’autoévaluation appelé « le carnet du leader ». Chaque semaine, le manager devait faire le point, dans ce carnet, sur les décisions qu’il avait prises, en se demandant si c’était bien à lui de les prendre. Si tel n’était pas le cas, il devait se demander pour quelle raison il avait été amené à prendre ces décisions : par exemple parce qu’il n’avait pas eu confiance dans ses équipiers, ou parce que, faute de certaines informations, ceux-ci n’avaient pas été en mesure de les prendre. Ce travail d’autoévaluation devait aider le manager à faire en sorte que, la fois suivante, ses équipiers soient effectivement en mesure de prendre le type de décision en question.
Le changement de posture des managers : l’exemple de la conduite accompagnée
Reprenons notre exemple de la conduite automobile.
Une partie d’entre nous a vécu l’expérience de la conduite accompagnée, c’est-à-dire encadrer l’apprentissage à la conduite d’un proche. Contrairement à un moniteur d’auto- école, un accompagnateur a peu de moyens pour intervenir directement sur l’action ; il est mis en situation de devoir faire confiance a priori à l’apprenant, de laisser l’action se dérouler, d’en évaluer les résultats et de s’en servir comme base de l’apprentissage. L’accompagnateur sait qu’il y aura des erreurs commises par l’apprenant et que cela fait partie de son apprentissage. L’accompagnateur doit donc lâcher prise, car il ne peut se substituer à l’apprenti conducteur. Il sait cependant qu’en cas d’accident, il ne pourra pas se dédouaner de sa responsabilité, alors même qu’il n’est pas au volant. Si l’on attend donc de l’accompagnateur qu’il puisse conseiller en direct l’apprenti et lui faire un retour pour qu’il progresse, on attend aussi et surtout de sa part qu’il sache adapter la situation de conduite au niveau de l’apprenant pour éviter de mettre le binôme en danger.
Le conflit intérieur pouvant résulter de la conjonction paradoxale entre lâcher-prise et responsabilité est si inconfortable que certains parents ne se sentent pas capables de s’engager dans la conduite accompagnée et préfèrent y renoncer. C’est exactement la même chose pour les managers. On comprend, dès lors, que le sujet est un peu plus compliqué pour eux que les simples injonctions qui leur sont faites de « faire confiance » et de « lâcher prise ».
Le management par non-substitution modifie du tout au tout la responsabilité du manager. Il est toujours responsable du résultat de l’équipe, non plus au titre de sa capacité à faire exécuter les ordres mais au titre de sa capacité à créer les conditions et à apporter son appui pour que les équipiers réussissent leur mission en autonomie (à la manière de l’entraîneur d’une équipe sportive). C’est le principe d’aide.
L’exemple de la conduite accompagnée (voir encadré ci-contre) nous permet de comprendre qu’il existe une condition indispensable à la mise en place d’une OR : que les managers osent faire confiance à leurs équipiers et qu’aucune des deux parties prenantes ne se sente mise en danger.
Dans les OR, on entend souvent parler de « droit à l’erreur ». Mais faire des erreurs n’est pas un droit. Il existe en effet des erreurs bénignes aux faibles conséquences et d’autres qui peuvent avoir des effets considérables. Pour mieux comprendre la différence, convoquons ici une image, celle de la ligne de flottaison d’un bateau. De la coque d’un bateau, il y a ce que l’on voit et ce qui est sous l’eau. La séparation entre ces deux zones, c’est la ligne de flottaison. Si quelqu’un fait un trou dans la coque au-dessus de cette ligne, c’est certes ennuyeux, mais le bateau ne coulera pas. En revanche, un trou au-dessous de la ligne de flottaison est inacceptable, car une telle erreur met en péril tout l’équipage, et le navire avec. La responsabilité du manager est de gérer la ligne de flottaison. À mesure que ses équipiers apprendront de nouvelles choses, les mettront en pratique et démontreront qu’elles sont bien acquises, le chef va atteindre un niveau de confiance suffisant pour élargir leur domaine de responsabilité.
Quand certaines circonstances l’exigent, le principe de subsidiarité peut céder la place au principe de suppléance. Face à des circonstances sortant de l’ordinaire (risque majeur ou urgence), le manager (ou une autorité supérieure) va reprendre la main et exercer un pouvoir pour le compte des personnes ou des groupes qui n’en ont pas la capacité. La difficulté réside toujours dans le fait de savoir qui appréciera les circonstances en question. On connaît les risques de ce principe de suppléance au niveau politique (coup d’État ou remise du pouvoir par le « peuple » à un homme « providentiel » qui devient un dictateur). L’autorité se doit ensuite de rendre leur autonomie aux acteurs, quand les circonstances qui justifiaient ce transfert de pouvoir ont cessé d’exister.
Au terme de ce développement, on voit que la subsidiarité n’implique pas une absence de manager, mais suppose une façon de manager qui change considérablement de nature. Si le manager doit faire confiance au salarié et encourager son pouvoir d’agir (le pari de la confiance ou confiance postulée), il faut toutefois qu’il se soit d’abord attaché à développer chez le salarié le niveau de compétences qui viendra soutenir cette confiance (confiance construite21). Les compétences représentent le filet de sécurité indispensable autant pour le salarié lui-même que pour le manager et pour l’organisation. Comme le dit avec humour Thierry Weil, il ne s’agit pas « de demander à quelqu’un de peindre un Picasso, sans couleurs, ni toile, ni la moindre connaissance en art pictural » (Weil et Dubey, 2020). La responsabilisation est donc un processus qui nécessite d’être accompagné de manière soutenue, tant du côté des managers (pour le changement de posture) que du côté des employés (pour l’acquisition de compétences).
Considéré par tous les experts comme l’un des points les plus délicats des transformations responsabilisantes, le repositionnement des managers est en fait souvent gêné ou empêché par les strates supérieures de l’organisation qui continuent à leur demander des comptes, alors même que ceux-ci ont accepté de mettre en œuvre le principe de subsidiarité : « Comment ça, tu ne sais pas ce qui a été décidé sur tel sujet ? Tu ne suis pas tes affaires ou quoi ? ». La réponse du manager du type « Non, il faut maintenant que tu demandes à X » n’est pas toujours bien acceptée par les strates supérieures. La question de l’exemplarité au plus haut niveau et de la cohérence des messages tout au long de la chaîne hiérarchique est donc primordiale.
Quand les managers ont pu bénéficier d’un véritable soutien et que l’intégration des principes de la responsabilisation est réussie, la conception qu’ils ont de leur rôle peut devenir extrêmement valorisante. En témoigne ce manager d’un atelier de 250 personnes ; quand on lui demande quel est son métier, il répond : « Rendre 250 personnes heureuses à leur travail. » On note cependant une dérive possible sur ce point : des servant leaders convaincus peuvent finir par s’occuper davantage du développement de leur équipe que de la performance des opérations. La juste combinaison de bienveillance et d’exigence du manager représente, par conséquent, un sentier particulièrement étroit. D’où une idée à explorer, qui a déjà été mise en œuvre dans certaines entreprises, consistant à dissocier le rôle de servant leader et celui de manager opérationnel en les confiant à deux personnes différentes.
Solidarité
La solidarité au sein du collectif de travail est l’un des effets majeurs qui résulte d’une transformation responsabilisante, quand elle réussit. Par solidarité, nous entendons ici que chacun se sente responsable du résultat collectif et veuille y apporter son concours (responsabilité solidaire). Nous nous référons aussi à l’entraide et à la coopération qui résultent de cette responsabilité collective.
Dans l’archétype d’une hiérarchie classique, chacun est comptable de ce qu’il a à réaliser à son poste, le reste étant l’affaire de ses collègues et de son manager. Chacun accomplit donc son travail sans prendre en compte l’effet que celui-ci produit sur ses collègues ni, plus généralement, sur la chaîne de production de l’entreprise. Autrement dit, la personne est responsabilisée sur la réalisation de sa tâche et non sur l’ensemble d’un processus, sur lequel elle ne dispose pas toujours d’une visibilité suffisante. C’est un des résultats non seulement de la parcellisation du travail mais aussi des systèmes d’incitation fondés uniquement sur des résultats individuels.
Dans une organisation responsabilisée en revanche, tous les équipiers vont se sentir comptables des résultats du groupe – à la manière de ce qui se passe dans un sport collectif. Ils seront donc incités à s’entraider et à coopérer pour atteindre les objectifs. Un opérateur en difficulté sur le critère « qualité » (savoir détecter des non-conformités) verra ses collègues lui venir en aide pour mieux maîtriser le mode opératoire et comprendre l’origine de son problème, dans la mesure où la qualité est un des objectifs de l’équipe. Cela n’enlève rien à la responsabilité personnelle de chacun (assumer les conséquences de ses actes), mais ajoute de l’entraide et de la coopération, en raison d’un sentiment collectif partagé dans la réussite comme dans l’échec.
Un tel résultat s’obtient si chaque membre d’une équipe et chaque équipe comprend le rôle qu’il ou elle joue dans le jeu collectif et comment sa contribution concourt aux résultats de l’équipe, du collectif élargi, voire de l’entreprise dans son ensemble. La compréhension par tout un chacun des objectifs globaux de l’entité est donc très importante. Mais ce qui change radicalement dans l’organisation responsabilisante, c’est le fait de donner à chaque équipe des marges de manœuvre pour définir comment elle peut, à son niveau, contribuer à la réalisation des objectifs de l’entité. Par exemple, au lieu de dire aux opérationnels : « Il faut faire progresser tel critère, voici donc ce que vous allez faire… », on leur demande : « On a un problème de time-to-market, sur quoi pourriez-vous travailler, à votre niveau, pour améliorer ce point ? » La codétermination des objectifs intermédiaires qui seront portés par l’équipe (et plus seulement par le manager) crée ensuite une responsabilité solidaire autour de l’obtention des résultats que l’équipe a elle-même définis. Le système de rémunération devra bien entendu évoluer pour accompagner la dimension collective de l’effort (prime collective notamment), ce qui renforcera la solidarité.
Arriver à cette situation « idéale » n’a rien de spontané et ne se construit pas en un jour. Le processus suppose de passer d’un simple collectif de travail à une communauté de travail (voir encadré ci-dessous).
Communauté de travail
Comme l’explique Pierre-Yves Gomez dans son blog, « l’entreprise vue comme une communauté suppose qu’il existe une culture, une histoire partagée et une solidarité entre les collaborateurs telles que l’identité du travailleur est nourrie par le “collectif de travail”. Celui-ci constitue pour lui une ressource essentielle pour définir sa place, ses savoir-faire ou pour déployer son chemin d’apprentissage personnel dans la durée. Dans l’entreprise-communauté, la division du travail se voit comme une hiérarchie de compétences interconnectées (l’apprenti débutant, le compagnon expérimenté, le maître confirmé) et elle nécessite des investissements de long terme pour acquérir les exigences communes du “travail bien fait” propre à la communauté. »
Une communauté de travail résulte d’une construction. Dix individus qui travaillent dans un même service, en ayant vaguement conscience d’un objectif commun, ne forment pas une communauté de travail. Pour n’en donner qu’un exemple, pensons à dix enseignants universitaires (une profession qui se caractérise par un haut niveau d’indépendance individuelle) rassemblés dans un même département d’enseignement et de recherche : font-ils « communauté » ? L’existence d’une communauté de travail implique l’émergence d’un « nous » : des relations interpersonnelles fondées sur la confiance, une intensité de la collaboration entre les membres, le partage de valeurs et d’objectifs communs. Autrement dit, la communauté de travail va se construire socialement via des routines, des événements, des épreuves traversées ensemble, qui déboucheront sur un sentiment d’appartenance, de confiance et de soutien entre les membres. L’accent mis sur la communauté de travail permet de comprendre que la responsabilisation n’est pas seulement un fait individuel qu’il s’agirait de soutenir et de développer, c’est une construction autour d’une aspiration qui doit devenir collective et partagée. Sans la conscience et la volonté de participer à ce « devenir commun », il sera très difficile à l’organisation responsabilisante de prendre corps et de s’ancrer.
La responsabilité de chacun va s’exercer dans le cadre de ce « territoire » qu’est la communauté de travail, qui s’entend à plusieurs échelles, depuis l’unité élémentaire de travail (l’équipe) jusqu’à l’entité globale. La difficulté réside souvent dans le passage de la communauté « équipe », dans laquelle la solidarité peut être très forte, à la communauté « entreprise » qui, selon la taille de cette dernière, peut rendre la solidarité et la coopération très abstraites.
En définitive, la solidarité est l’une des réponses au sentiment de solitude que la responsabilité fait naître chez un individu, sentiment qui peut s’avérer inhibant, voire délétère, et peut aboutir à un rejet de la responsabilisation. Inversement, elle lui permet aussi de ne pas tomber dans le travers de l’excès d’indépendance (ou vertige du pouvoir de décision). L’existence même du collectif va rappeler à l’individu qu’il n’est pas un atome flottant dans l’éther, mais que son action est interdépendante de celle des autres.
Collégialité
La pratique de la délibération collective est l’une des caractéristiques essentielles des OR. C’est un filet de sécurité face à la responsabilité de chaque membre du groupe, et c’est aussi une manière de construire des apprentissages collectifs, permettant de bâtir la communauté de travail via des routines et le partage progressif d’un langage commun, d’objectifs et de réflexes partagés. Nous appelons le développement de ces capacités « la collégialité », qui peut s’entendre de diverses manières.
Co-construction des décisions
La co-construction désigne un processus délibératif encadré par un dispositif formel et par l’intervention d’un tiers régulateur et médiateur. Dans une équipe de travail, ce dernier est le plus souvent le manager. Pour lui, se référer à la co-construction consiste à la fois à définir et à être garant d’un espace délibératif particulier qui introduit d’autres formes d’interactions entre les subordonnés entre eux et entre ces derniers et lui- même. La co-construction ouvre ainsi sur une option managériale nouvelle, en rupture avec les autres pratiques traditionnellement utilisées (la consultation, la communication d’une décision prise sans concertation avec les subordonnés).
La mise en œuvre de la co-construction doit chercher à équilibrer la participation et l’efficacité décisionnelle pour éviter les délais et la paralysie d’analyse. Il est essentiel de structurer cette participation et de clarifier les rôles dans la prise de décision elle-même.
Source : Foudriat M. (2014). La co-construction, Une option managériale pour les chefs de service. In Le management des chefs de service dans le secteur social et médico- social, Dunod, pp. 229-250.
La procédure collégiale dans le contexte de la fin de vie
« La procédure collégiale est une modalité de concertation imposée par la loi dans des situations spécifiques de fin de vie. Elle précède la prise de décision du médecin responsable du patient. La procédure collégiale permet de mener une réflexion collective, réunissant plusieurs professionnels de disciplines différentes […]. Elle permet d’éviter toute décision médicale solitaire ou arbitraire, c’est-à-dire dépendante du jugement d’un seul professionnel. […] La décision finale appartient au médecin qui prend actuellement soin du patient : s’il se nourrit des différents avis émis, sa décision ne s’y résume pas nécessairement. C’est le processus de réflexion qui est collectif, et non la décision : le médecin référent reste l’unique décideur et responsable. »
Source : site parlons-fin-de-vie.fr
Procédure collégiale et décision collective
La collégialité prend le plus souvent la forme d’une réflexion collective visant d’une part à enrichir l’éventail des solutions à considérer (délibération), et d’autre part à prendre en compte l’avis des personnes qui seront affectées par une décision (concertation). Il s’agit d’une procédure collégiale dont la visée n’est pas nécessairement d’obtenir une décision commune et partagée (même si cela serait préférable), mais de prendre la décision la plus avisée possible. La procédure collégiale va cependant plus loin qu’une simple consultation (ou sollicitation d’avis) dans la mesure où le processus de réflexion est collectif et vise à construire ensemble la décision à prendre (co-construction, voir encadré en page précédente). La procédure collégiale précède donc une décision mais elle ne se confond pas systématiquement avec une décision collective. Pour mieux comprendre la différence, prenons l’exemple très parlant de la procédure qui précède la décision du médecin dans le contexte de la fin de vie (voir encadré ci-dessus). Dans ce cas, la procédure collégiale vise à éclairer celui qui doit prendre une décision, sans pour autant le dédouaner de sa responsabilité personnelle quant à cette décision.
La délibération collégiale peut cependant aussi déboucher sur une décision prise collectivement. Il existe différents types de procédure de décision collective (vote, consensus, consentement, veto, compromis), présentant chacun des avantages et des inconvénients (voir encadré ci-dessous).
Différents types de décision collective
Le vote est un procédé rapide permettant l’expression de chacun. Les règles du vote peuvent prévoir une décision à la majorité ou à l’unanimité. Quand la légitimité de la décision repose sur le choix du plus grand nombre, rien ne prouve que la majorité soit porteuse de la « bonne » décision.
Dans le consensus, le groupe construit et façonne progressivement des propositions – en tenant compte des apports et des points de vue de chacun –, qui finissent par converger et emporter l’adhésion, sans qu’il soit nécessaire à chacun de se prononcer. Désavantage majeur : le consensus est un processus très consommateur de temps.
Assez proche du consensus, une décision par consentement est adoptée si personne ne s’exprime pour s’y opposer. Dans le cas contraire, la discussion est réouverte.
Le droit de veto s’entend généralement dans le cadre d’un vote exprimé (à la différence du consentement). Il implique le droit pour une personne de s’opposer à une décision, même si tout le groupe vote en faveur de la décision. C’est le corollaire d’une procédure de vote à l’unanimité (par exemple au Conseil de sécurité des Nations unies). Selon les règles adoptées, le droit de veto peut appartenir à tous ou au contraire être réservé à quelques personnes (par exemple, le manager, le dirigeant).
Enfin, avec le compromis, il s’agit de rechercher une position médiane entre des divergences exprimées, en faisant des concessions réciproques (habituellement par la négociation). Le compromis permet de rendre une décision acceptable, mais rarement d’aboutir à la « meilleure » décision.
Dans le contexte professionnel, la délibération collective est soumise le plus souvent à des contraintes de temps et d’efficacité. Elle a pour objectif de parvenir à des décisions aussi informées et pertinentes que possible dans un laps de temps donné. Collégialité n’est donc pas forcément synonyme de consensus. La plupart du temps, une personne a été désignée par la hiérarchie ou par la base pour prendre une décision dans un champ de responsabilité donné. L’important est que cette personne réunisse trois caractéristiques : elle a reçu le pouvoir de décider, elle a la compétence pour le faire, la communauté de travail lui reconnaît la légitimité de pouvoir décider sur ce champ de responsabilité.
La notion de domaine réservé
En droit constitutionnel français, on désigne par « domaine réservé » certains secteurs de la politique nationale (la défense nationale et la politique étrangère notamment) dans lesquels la compétence particulière du président de la République, reconnue par l’usage, s’exerce. Cette expression a été inventée par Jacques Chaban-Delmas en 1959.
Cela n’empêche pas qu’il y ait un ministre des Armées et un ministre des Affaires étrangères, et que les administrations de la défense et des affaires étrangères dépendent exclusivement de ces ministres. En bref, le domaine réservé ne doit pas être compris comme un domaine exclusif.
Dans une équipe, c’est la même chose. Très rares sont les domaines qui ne relèvent pas de la compétence d’au moins un des équipiers. Le domaine réservé du manager est donc plutôt un ensemble de sujets qu’un domaine entier, et le mot « réservé » n’implique pas qu’il soit seul à l’instruire. Ce qui caractérise ces sujets-là, c’est qu’il existe de bonnes raisons pour que le manager s’implique en détail dans leur suivi parce qu’in fine la décision lui reviendra. En fait, c’est la décision qu’il faut considérer comme réservée. C’est pourquoi l’existence d’un domaine réservé n’exclut pas la délibération sur les sujets qui le constituent.
Toutefois, rien n’empêche une organisation responsabilisante d’instituer d’autres règles en matière de prise de décision en fonction de l’objet de la décision, du contexte, de la culture, des spécificités du groupe, du temps disponible, etc. L’important sera d’être transparent sur les règles selon lesquelles se prendront les différents types de décision, voire d’en faire le sujet de la première décision collective.
La clarification du qui décide quoi est une condition fondamentale du bon fonctionnement des OR. Elle nécessitera de définir avec précision ce qui relève du « domaine réservé » du manager (voir encadré ci-dessus), ou encore les zones rouges (celles qui ne sont pas ouvertes à la collégialité) et les zones bleues (celles qui le sont) (Weil et Dubey, 2020).
Une dernière question se pose encore : une décision quand elle est collective entraîne-t-elle une responsabilité collective ? Sans nous lancer dans une discussion philosophique sur cette question complexe, rappelons seulement qu’en droit (pénal ou civil) la responsabilité est personnelle (Lebrun, 2015). On pourrait toutefois distinguer, comme le propose Bertrand Ballarin, l’état et le sentiment de responsabilité. L’état de responsabilité induit l’imputabilité personnelle des actions. Le sentiment de responsabilité, conséquence de la solidarité et de la collégialité, correspond davantage à l’idée de « se sentir concerné » sans imputabilité.
Le dialogue professionnel collectif s’exerce généralement dans des instances organisées ayant, chacune, une finalité distincte (opérationnelle, organisationnelle, stratégique) et des fréquences adaptées à leur but (journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle).
Mettre en place ces instances de délibération nécessite tout un apprentissage. Le manager doit désapprendre à donner des ordres, et apprendre à écouter, questionner, relancer, distribuer la parole à chacun et respecter le timing ; les équipiers doivent apprendre à s’exprimer, ne pas se couper la parole, s’écouter entre eux, etc. Pour certaines populations, ces situations nouvelles peuvent être déstabilisantes. Un agent de fabrication peut mettre jusqu’à un an pour acquérir assez de confiance en soi et réussir à exprimer les difficultés qu’il ressent dans son travail. Cet apprentissage fait directement référence au concept de « sécurité psychologique » d’une équipe (Edmondson, 2018) : il se définit comme la conviction partagée par ses membres qu’il est acceptable et reconnu d’exprimer ses idées et ses préoccupations, de poser des questions et d’admettre ses erreurs, le tout sans craindre de conséquences négatives. Comme le dit Amy Edmondson, « c’est une permission de franchise » ressentie par chaque membre.
Décider si la délibération professionnelle doit se faire avec le manager ou hors de sa présence dépendra de la philosophie de l’entreprise considérée. Il existe une divergence académique sur ce plan entre les professeurs Mathieu Detchessahar, qui vient du courant de la gestion des ressources humaines (GRH) et des sciences de gestion, et Yves Clot, qui représente le courant de la psychologie du travail et de l’ergonomie. Selon ce dernier, seule l’absence du manager à certaines étapes de la délibération sur le travail peut permettre une réelle liberté de parole chez les opérationnels ; selon le premier en revanche, la présence du manager permet de garantir une rapidité dans la remontée des informations utiles vers les niveaux supérieurs. Au-delà de cette raison pratique, l’idée est que le manager de proximité fait partie de l’équipe, et qu’il n’y a donc pas de raison qu’il se considère (ou soit considéré) comme extérieur à l’équipe au moment d’une délibération.
Instances de délibération et de décision dans le lean
En usine, le dialogue professionnel joue un rôle essentiel dans les pratiques du lean management. Le lean est une approche de gestion axée sur l’efficacité opérationnelle et la réduction des gaspillages via l’amélioration continue. Dans ce contexte, le processus de discussion et de prise de décision au sein d’une équipe a pour but d’identifier des problèmes et des écarts de production, d’en cerner les causes, de produire des idées et de parvenir à des solutions. Le lean multiplie ainsi les occasions d’apprentissage pour développer les personnes, et la délibération est en elle-même un puissant stimulant de l’apprentissage. Deux types d’instances sont particulièrement importantes : les animations à intervalle court (AIC) et les chantiers Kaizen.
Animations à intervalle court (AIC)
La première brique de l’apprentissage du dialogue et de la délibération se fait le plus souvent à travers la mise en place de réunions brèves à différents niveaux de l’entreprise : par exemple, point journalier de cinq minutes au niveau de l’équipe, point de quinze minutes à l’échelon intermédiaire, point de trente minutes au niveau du site ou de l’entité. On y traite de la situation de l’équipe en matière de sécurité, de qualité, de délais, de coût. Les problèmes à traiter sont identifiés au plus près du terrain et débattus en réunion dans une escalade de subsidiarité. L’équipe décide des actions qu’elle peut mener à son niveau, et de remonter éventuellement au niveau supérieur les sujets sur lesquels elle ne dispose pas des compétences, ni des ressources nécessaires, ou qui relèvent du domaine réservé du manager. Les instances de niveau supérieur ont pour rôle essentiel d’aider à résoudre les sujets identifiés par la base. Elles doivent être exemplaires, trouver les solutions, prendre les décisions demandées et les faire redescendre rapidement. Frédéric d’Arrentières souligne d’ailleurs que ses observations au sein de l’ingénierie véhicules de Renault lui ont montré que les équipes ne revendiquent pas forcément de prendre directement les décisions, notamment lorsque celles-ci sont liées à de fortes interdépendances avec des tiers, mais que leur attente est de disposer de mécanismes efficaces de synchronisation entre équipes et de s’assurer de la disponibilité des niveaux supérieurs pour que les décisions soient prises rapidement. La métamorphose vers l’OR vise toutefois à changer cette disposition d’esprit un peu frileuse qui provient souvent d’années d’absence de pratique de la décision.
Amélioration continue (Kaizen)
La délibération est aussi un élément clé du processus d’amélioration continue dans le lean. Les équipes se réunissent régulièrement pour discuter des problèmes opérationnels, des obstacles et des opportunités d’amélioration. Les membres de l’équipe, le manager et les fonctions support partagent leurs observations, échangent des idées et travaillent ensemble pour trouver des solutions innovantes.
Trois boucles de rituels mis en œuvre au sein du groupe Michelin
La boucle annuelle permet de codéterminer les ambitions et les objectifs à l’horizon d’une année glissante. Elle permet aux équipes de définir leur quoi, c’est-à-dire la contribution que chaque collectif pourra apporter à la réalisation des grands enjeux définis par l’entité de tête qui fixe les objectifs globaux à atteindre. Il est nécessaire que chaque collectif s’approprie ces grands enjeux (le pourquoi), et soit conscient de ses forces et de ses faiblesses pour débattre et proposer sa meilleure contribution. Les équipiers qui ont joué un rôle actif dans la définition du quoi seront beaucoup plus pertinents dans la définition du comment et beaucoup plus motivés dans sa mise en œuvre. Ce rituel mobilise les employés durant une journée chaque année.
La boucle mensuelle de pilotage et de priorisation permet de décider collégialement la manière de progresser dans le cadre des ambitions définies lors de la boucle annuelle. Chaque collectif fait un retour d’expérience (retex) sur la période qui vient de s’écouler et, en fonction du progrès réalisé, décide de faire évoluer ses priorités d’action et de planifier une nouvelle étape de progrès pour la période à venir. La périodicité mensuelle permet de s’adapter aux évolutions du contexte à court terme. Cette boucle réunit chaque collectif de travail entre une heure et une heure trente chaque mois.
La boucle quotidienne de management de la performance et de réponse rapide (MQP/ RR) permet de réagir aux dérives les plus importantes de la marche courante, et permet également d’allouer des ressources à la résolution de problèmes concrets qui freinent le progrès. Les équipes se doivent de réagir le plus rapidement possible aux dérives. Pour autant, elles ne pourront pas traiter en profondeur et éradiquer l’ensemble des problèmes qui peuvent se présenter au jour le jour. La boucle quotidienne comporte donc des rituels qui mobilisent aussi les équipes de niveau supérieur.
Les pratiques de dialogue et de délibération du lean sont une manière d’avancer vers la responsabilisation non pas d’une façon abstraite, mais au quotidien, autour du travail réel. Elles permettent d’entraîner les opérationnels à s’exprimer, puis à participer à la prise de décision collective. Elles sont le terrain de jeu sur lequel se développe la compétence à savoir décider en équipe, qui pourra progressivement s’exercer dans des champs de responsabilité de plus en plus larges.
Toutefois, la seule pratique des animations à intervalle court et des réunions Kaizen, qui ne représentent à elles deux qu’un pourcentage très limité du temps de travail, ne peut suffire à développer chez les opérationnels la pratique de la délibération. Chez Michelin (voir encadré en page précédente), comme chez Lippi et Martin Technologies, plusieurs types de rituels ont été installés avec différentes fréquences selon leur finalité : annuelle, mensuelle, hebdomadaire et journalière.
Dans d’autres modèles organisationnels comme l’holacratie22, on trouvera les réunions de triage et les réunions de gouvernance, deux instances distinctes dont le rituel est adapté à la nature de la discussion.La mise en place d’instances structurées et régulières de délibération et de décision, et la capacité des membres à y participer au bon niveau, en comprenant la finalité de chacune, sont des marqueurs distinctifs des organisations responsabilisantes.
Activité
Au cœur des travaux de l’école française d’ergonomie se trouve la question de l’activité. La différence entre le travail prescrit par l’organisation et le travail réel accompli par le travailleur ouvre la voie à l’analyse des compromis opératoires mis en œuvre par les travailleurs pour réduire cet écart (et, en fait, le révéler au grand jour). Ces solutions actionnées par les travailleurs représentent ce que les ergonomes appellent « l’activité ».
Prenons l’exemple d’une règle de sécurité jugée inefficace par les travailleurs. Trois cas de figure sont possibles. Le premier est le contournement de la règle (ex. ne pas mettre hors tension une machine avant de la réparer pour qu’elle démarre plus rapidement), ce qui peut aboutir à des résultats catastrophiques (ex. accident grave). Le deuxième est qu’une discussion soit ouverte sur l’utilité et le sens de la règle, permettant de réaffirmer la raison pour laquelle elle doit être effectivement respectée. Le troisième est une discussion permettant de creuser les raisons pour lesquelles la règle n’est pas respectée (ex. la coexistence avec un objectif de cadence contradictoire), conduisant à faire émerger une meilleure règle que la règle existante, tout en tenant compte de l’ensemble des données du problème. Une des premières étapes vers l’organisation responsabilisante consiste précisément à permettre à ceux qui effectuent le travail de discuter des conditions de réalisation de ce travail. Cette possibilité est ce qui permettra d’éviter le contournement des règles. Tout l’enjeu est de créer un espace dans lequel les personnes se sentent habilitées à lever la main pour s’exprimer, lorsqu’elles considèrent qu’elles font quelque chose d’inutile ou d’inefficace, et où elles peuvent échanger avec le détenteur de la règle pour décider s’il faut continuer à l’appliquer ou la repenser.
Une des fonctions essentielles de l’analyse de l’activité, c’est de favoriser une autre conception de la prescription, plus favorable au respect de la personne mais aussi à l’efficacité du travail. La définition de la prescription ayant historiquement été confiée presque exclusivement à des experts, c’est notamment sur ce point que se joue le défi de tempérer le taylorisme : dans l’élaboration d’un nouveau modèle d’activité qui donnerait aux collaborateurs un rôle plus actif dans la construction de la prescription de travail, du fait de leur connaissance du travail réel – ce que nous avons appelé dans d’autres ouvrages le « design du travail » (Pellerin et Cahier, 2019, 2021).
Une transformation responsabilisante entretient des liens étroits avec l’activité. Généralement, elle affiche comme objectif de donner davantage d’autonomie aux collaborateurs, c’est-à-dire davantage de marges de manœuvre dans la régulation de leur activité. Cette absence de marges de manœuvre est précisément dénoncée depuis longtemps par les ergonomes, les psychologues et les sociologues du travail comme un facteur affectant négativement la santé au travail (voir chapitre 2). Les projets de responsabilisation qui visent en principe l’articulation de la santé des travailleurs et de la performance du travail (efficacité des processus de décision, subsidiarité et coopération) devraient donc être accueillis favorablement par les spécialistes du travail.
Mais il existe deux pierres d’achoppement majeures dans ces projets, selon ces professionnels.
La première est que prescrire l’autonomie peut paraître un projet paradoxal (« Sois autonome » est une injonction paradoxale). Cette objection ne nous paraît pas entièrement fondée. Certes, la décision de fonctionner différemment viendra forcément du dirigeant, mais cela ne signifie pas qu’il devra en prescrire toutes les modalités. Son rôle consistera précisément à créer les conditions pour qu’émerge la responsabilisation, c’est-à-dire poser des principes, puis laisser les échelons subordonnés les traduire en règles détaillées. Mais expliciter les principes est souvent beaucoup plus difficile que de fabriquer de la règle de détail.
La seconde pierre d’achoppement est que la responsabilisation comporte des risques importants d’atteinte à l’équilibre psychique et physique des salariés, comme cela a été souligné par plusieurs travaux (Picard, 2015 ; Canivenc, 2022). En effet, la responsabilisation est loin de n’entretenir que des rapports positifs avec la santé au travail. Dans certains exemples d’entreprises cheminant vers l’OR, l’intensité et le temps de travail s’accroissent, les coopérations se révèlent souvent insuffisantes et les opérationnels n’ont pas forcément la capacité à peser sur la coopération interservices (qui reste le plus souvent l’apanage des managers), la qualité des relations est susceptible de se dégrader, et tout s’accomplit souvent sans qu’aucune compensation salariale pour ces efforts supplémentaires ne soit mise en place.
Plus encore, la transition vers la responsabilisation (la transformation elle-même) est vécue par les personnes comme un accroissement de la charge d’activité, parce qu’on leur maintient le même objectif personnel de production sans prendre en compte la charge additionnelle induite par la transformation et, demain, par le nouveau mode de fonctionnement stabilisé (ex. les services rendus à l’équipe, la participation aux délibérations). L’aggravation des risques psychosociaux (RPS) qui en découle est souvent le révélateur d’un manque de ressources pour répondre aux exigences de l’activité et pour réaliser un travail de qualité.
Les critères définissant ce qu’est un « bon travail » peuvent en outre être assez différents entre la hiérarchie et les opérationnels. Par exemple, un opérateur d’un centre d’appels de service après-vente considérera comme un travail de qualité le fait d’avoir réussi à résoudre le problème du client, alors que la hiérarchie retiendra le nombre d’appels traités et le temps passé sur chaque appel. Une infirmière considérera comme du bon travail le temps passé à échanger avec son patient, à le rassurer et à lui procurer du bien-être, alors que la hiérarchie prendra en compte le nombre d’actes de soin et le temps passé auprès de chaque patient.
Il existe donc des conflits de critères sur ce qu’est un travail bien fait. Ces conflits de critères peuvent d’ailleurs exister entre opérationnels eux-mêmes. C’est ce qui rend indispensable d’institutionnaliser des espaces de délibération sur le travail pour traiter ces conflits de critères et organiser ce qu’Yves Clot (2021) appelle la « dispute professionnelle ». L’organisation de ces espaces de délibération sur les critères d’un bon travail sera souvent un marqueur de l’organisation responsabilisante.
- 16. Pierre-Yves Gomez est professeur à l’EM Lyon Business School et fondateur de l’Institut français de gouvernement des entreprises (IFGE).
- 17. Rappelons que, selon Jacques Ellul (2012), un système est « un ensemble d’éléments en relation les uns avec les autres de telle façon que toute évolution de l’un provoque une évolution de l’ensemble, toute modification de l’ensemble se répercutant sur chaque élément ».
- 18. Expression célèbre attribuée à Kurt Lewin, acteur majeur de l’école des relations humaines.
- 19. Voir aussi sur ces sujets, les films Corporate (Nicolas Silhol, 2017) et Ceux qui travaillent (Antoine Russbach, 2019).
- 20. Pour les désigner, on utilise des termes comme groupes de codéveloppement, groupes d’analyse des pratiques ou encore groupes de coprofessionnalisation.
- 21. Pour une analyse des trois formes possibles de la confiance (confiance calculée, confiance construite, confiance postulée), voir Weil (2008).
- 22. Auto-organisation d’équipes interconnectées où les décisions se prennent au consentement et les managers sont choisis par élection sans candidat.
La boussole de la responsabilisation en action
Comprendre en profondeur les principes essentiels de l’organisation responsabilisante et leurs interactions systémiques, s’accorder sur les définitions qu’on veut leur donner collectivement (de façon plus ou moins ambitieuse), rédiger le cas échéant un livre blanc permettant d’objectiver les intentions que l’on poursuit pour pouvoir à tout moment revenir à ces fondamentaux, apparaissent comme des prérequis à la transformation. Ce n’est pas encore de la mise en œuvre, mais c’est un préalable indispensable à celle-ci.
La boussole de la responsabilisation ne se résume donc pas à une approche conceptuelle. Elle permet de s’engager dans la démarche de transformation en sachant de quoi on parle, et elle est activable dès la phase de réflexion amont. Elle sert de grille de conception pour : i) élaborer une vision du système cible que l’on souhaiterait faire émerger (et qui n’est pas un simple référentiel de bonnes pratiques) ; ii) déterminer sur quoi agir prioritairement ; et iii) évaluer le degré de maturité de l’organisation sur les différentes dimensions.
Construire une vision de la transformation
Pour s’approprier les cinq dimensions et se référer à un langage commun, il sera utile de commencer par construire une vision du système cible tel qu’on se l’imagine.
La vision est souvent un exercice que l’on peut qualifier de from → to appliqué à la responsabilisation : que sommes-nous aujourd’hui ? que voudrions-nous être demain ? Cette vision peut elle-même être construite avec une méthode d’exploration. Le principe de ce type de méthode est de poser une question principale et d’apporter des éléments de réponse à cette question, éléments qui vont eux-mêmes provoquer d’autres questions auxquelles il faudra continuer de répondre, et ainsi de suite.
Chaque dimension de la boussole ouvre donc un questionnement.
Responsabilité : Comment s’exerce la res- ponsabilité aujourd’hui ? Qui est respon- sable de quoi et devant qui ? → Quelle chaîne de responsabilité voudrions-nous demain dans notre entité responsabilisée ? Quelles sont les responsabilités qui s’at- tachent naturellement à tel ou tel niveau, compte tenu des aptitudes qui s’y trouvent par la connaissance et l’expérience ?
Subsidiarité : Par qui et comment les problèmes et les aléas sont-ils traités au- jourd’hui ? → Comment voudrions-nous qu’ils le soient demain ? (par exemple, pro- blèmes traités là où ils apparaissent).
Comment les opérations sont-elles gérées aujourd’hui ? → Comment voudrions-nous qu’elles le soient demain ? (par exemple, prise de décision par ceux qui font les opérations).
Comment sont définis les objectifs aujourd’hui ? → Comment voudrions-nous qu’ils soient définis demain, et par qui ? (par exemple, co-construction des objectifs).
Solidarité : Comment considérons-nous au- jourd’hui le niveau de solidarité, d’entraide et de coopération au sein des équipes ? → Comment développer une culture de la coopération et de la confiance dans la com- munauté de travail demain ? Ce qui exige, de s’interroger sur les pratiques propices à la solidarité.
Collégialité : Comment et dans quelles enceintes sont prises les décisions au- jourd’hui ? → Comment voudrions-nous qu’elles soient prises demain ?
Activité : Quelle est notre évaluation de la qualité du travail tel qu’il est pratiqué dans notre organisation ? Sur quels critères nous appuyons-nous pour faire cette éva- luation ? → Quel est notre objectif pour demain dans ce domaine ?
Les dimensions de la boussole sont donc, dans un premier temps, un moyen de provoquer un questionnement destiné à faire réfléchir ceux qui porteront la transformation, en les aidant à se projeter.
Cette vision n’est pas figée, ce n’est pas un point B à atteindre. C’est une esquisse, mais une esquisse capable de donner une indication suffisamment claire des principes constitutifs du modèle visé. Elle devra ensuite être remise sur le métier au fil de l’avancement de la transformation et des remontées du corps social.
Déterminer sur quoi agir
Pour que les cinq principes de la boussole puissent prendre corps et se déployer, il va falloir déterminer sur quels premiers éléments tangibles de l’organisation agir, de manière à faire bouger le système et créer un nouveau « terrain de jeu ».
Taille et stabilité des équipes sur des « territoires »
Les finalités de responsabilisation, solidarité et collégialité nécessitent le plus souvent de passer par une réflexion sur la taille des équipes et leur stabilité relative sur un territoire donné.
Divers travaux, notamment en psychologie sociale, ont investigué le lien entre la performance des équipes et leur taille. L’effet Ringelmann explique la relation inverse entre la taille d’une équipe et la contribution individuelle à la réalisation de ses activités. Ringelmann (1913) a montré qu’à mesure que des personnes sont ajoutées à un groupe, le groupe devient de plus en plus inefficace. Deux processus ont été identifiés pour expliquer cette baisse de productivité. D’une part, la perte de motivation individuelle, et d’autre part la diminution de la coordination. Parmi les facteurs de perte de motivation des grandes équipes, Forsyth (2006) a identifié le phénomène de « paresse sociale » : chaque personne déploie moins d’efforts parce qu’elle pense que sa contribution individuelle devient moins identifiable et que d’autres prendront le relais. Il a ensuite montré que cette paresse sociale peut être contrée autrement que par la pression d’un chef, à travers la fixation d’objectifs clairs et ambitieux (exigence), et également via la perception par chacun qu’il est indispensable au fonctionnement et à la performance de l’équipe (solidarité).
La conclusion générale que l’on peut tirer de ces travaux est que la taille optimale d’une équipe se situerait à peu près entre sept et onze personnes (Katzenbach et Smith, 1993), ce que Jeff Bezos a résumé par l’expression « two-pizza team23 ». Le chiffre peut bien entendu être discuté, mais l’idée fondamentale est de trouver un juste équilibre entre une équipe avec trop peu de personnes pour assurer la diversité des profils et des compétences, et trop nombreuse pour obtenir une pleine participation, une bonne communication et une coordination aisée. Lorsque la taille des équipes dépasse un certain seuil, il leur devient plus difficile de parvenir à une compréhension commune des problèmes et des situations ; les réunions deviennent trop longues, et la délibération ainsi que la prise de décision nettement plus compliquées. Dans les grandes équipes, les personnes se connaissent moins, la confiance mutuelle est donc moins évidente. Elles ont également moins conscience du travail des autres membres et du niveau de leur contribution au succès de l’équipe. Katzenbach et Smith (1993) ont noté que les équipes hautement performantes sont constituées de membres ayant un fort intérêt personnel pour les autres, ainsi que pour le respect et la collaboration professionnels.
On comprend aisément que ces conditions de fonctionnement, et surtout les liens interpersonnels, nécessitent une certaine stabilité des équipes. D’un côté, le fonctionnement peut être mis à mal par des changements trop fréquents ou trop nombreux : les nouveaux mettent du temps à intégrer les principes de fonctionnement, ils n’ont pas exactement les mêmes compétences que les personnes qu’ils remplacent, et certains « rôles » (voir plus loin) doivent, en conséquence, être repensés ou redistribués. Inversement, le turn-over – qui fait partie de la vie des organisations – ne présente pas que des aspects négatifs. Il permet d’éviter à une équipe de se scléroser, en la revivifiant. Les nouveaux arrivants représentent une opportunité « réflexive » d’apprentissage pour le groupe, qui est obligé de réexpliciter ses modes de fonctionnement, voire de les questionner.
D’ailleurs, pour maintenir la solidarité dans l’équipe, celle-ci demandera souvent à s’approprier le champ d’autonomie et de responsabilité qui concerne l’intégration des nouveaux membres, voire leur recrutement, et le fait de décider de les garder ou non après une période d’essai. Une équipe responsabilisée comprendra vite qu’elle n’a pas intérêt à se laisser imposer ses nouveaux membres.
Ces considérations sur la taille et le fonctionnement des équipes conduiront souvent à initier la transformation par un redécoupage des activités et par un redesign organisationnel des équipes.
La définition et l’attribution d’un « territoire » à une équipe permettent non seulement d’ancrer le sentiment d’appartenance de chacun au sein d’un champ d’activité cohérent (par client, métier, technologie, complexité, volumes, etc.), mais aussi de définir le cadre initial dans lequel s’exercera la responsabilité solidaire. Nombre d’expériences se sont attaquées à ce design organisationnel à travers une recomposition des territoires et des équipes qui y sont affectées (Weil et Dubey, 2020). Qu’on les nomme mini-usines, îlots, squads, tribus…, il s’agit de créer des collectifs qui savent pourquoi ils sont ensemble. Il peut être nécessaire d’aller jusqu’à matérialiser les nouveaux territoires par des aménagements des espaces de travail.
Ces nouveaux territoires peuvent être définis par la direction de l’entité ou au contraire résulter d’une construction par la base – par exemple chez Martin Technologies, l’équipe chargée du projet de mini-usines a été constituée d’une large variété de profils, et chaque membre a pu choisir la mini-usine à laquelle il voulait être rattaché. Le principe d’adhésion du corps social à la transformation invite à considérer plutôt cette deuxième voie quand elle est possible.
Répartition de responsabilités support dans des « rôles »
Dans les entreprises, l’expertise est souvent concentrée dans des fonctions que l’on appelle communément les fonctions support.
Les organisations classiques sont ralenties par cette concentration de l’expertise. Des experts en nombre limité doivent répondre à des besoins multiples des équipes opérationnelles. Ces fonctions expertes disposent en outre de leurs propres règles métier et d’enjeux qui leur sont spécifiques, engendrant fréquemment une bureaucratie paperassière. Elles finissent par représenter un goulot d’étranglement pour le fonctionnement de l’organisation. Pensons aux techniciens de maintenance dans l’industrie, et plus généralement aux services informatiques et numériques, aux ressources humaines ou encore aux achats de prestations de service ou de fournitures. Les fonctions support sont en outre souvent sollicitées pour des interventions récurrentes d’un niveau bien inférieur à leur expertise, ce qui représente une forme de gaspillage.
Le raisonnement est identique en ce qui concerne le management. Les managers peuvent être des goulots du processus de décision dans le fonctionnement de l’organisation classique, alors que beaucoup de décisions ne nécessiteraient pas d’être prises à leur niveau.
L’organisation responsabilisante doit permettre de sortir de ces situations à travers la mise en place de la subsidiarité. Elle va donc se donner pour objectif de déconcentrer certaines compétences, en créant de nouveaux « rôles » et de nouvelles missions (et non des fonctions) en lien avec les appétences et les possibilités des équipiers. Un équipier passionné de mécanique qui démonte et remonte tous les week-ends le moteur de sa BMW de collection pourrait devenir le référent en maintenance de l’équipe. Un autre qui est dirigeant du club de rugby ou conseiller municipal de sa commune pourrait prendre un rôle « RH » dans l’équipe, etc.
Toutes les équipes n’auront pas les mêmes besoins compte tenu des procédés qu’elles mettent en œuvre, des matériaux qu’elles utilisent, des problèmes récurrents qu’elles rencontrent, des interactions qu’elles ont avec les autres services. Il s’agira, dans un premier temps, de déterminer les domaines dans lesquels il y a un intérêt à ce que les services support transfèrent aux opérationnels des compétences nouvelles. Dans cette phase, une coopération très forte doit être installée entre les équipes opérationnelles qui s’autonomisent et les équipes support dans chacun des domaines d’expertise considérés, pour clarifier les degrés de technicité à développer chez les opérationnels. S’ensuivra la mise en œuvre de formations et de qualifications pour ces nouveaux rôles, en tout point identiques à ce qui se pratique pour les compétences liées au poste. Pas de subsidiarité, ni de responsabilisation, sans élargissement et enrichissement des compétences. Cette dotation de l’équipe en nouvelles compétences « support » est nécessaire à l’élargissement du pouvoir d’agir de chaque équipe. Cette montée en compétences des opérationnels, associée à leurs nouvelles responsabilités, devra aussi être pensée en termes de reconnaissance, et il conviendra d’impliquer les RH pour adapter le système de reconnaissance (augmentation du fixe en fonction du franchissement de niveaux de responsabilité, prime collective…) à la nouvelle organisation.
Un point de vigilance doit être gardé à l’esprit : il faudra éviter de récréer des « petits chefs » en concentrant trop de responsabilités nouvelles sur une même personne au sein d’une équipe. En effet, ce type de situation risque de réduire la solidarité entre les membres (« ça, c’est son problème »), de rendre l’équipe trop dépendante d’un individu particulier et de freiner le cheminement des autres équipiers vers l’acquisition de plus de responsabilités. Pour contrer ce risque, il est important que les rôles ne soient pas figés : qu’ils soient tournants dans le temps et que plusieurs personnes soient préparées à endosser un même rôle.
Système de management
Un système de management décrit la manière dont les entreprises s’organisent afin d’agir de manière standardisée, d’assurer le bon déroulement des opérations et d’atteindre les résultats prévus. Dans cette section, nous nous limiterons à examiner les questions nouvelles que pose l’OR au système de management et auxquelles celui-ci doit chercher à répondre, dans le respect des principes de subsidiarité et de collégialité. Concrètement, le système de management d’une OR doit permettre à l’équipe de direction de répondre facilement aux questions qu’elle se pose : nos équipes sont-elles en autocontrôle des principes d’action, des règles et des procédures qui conditionnent la qualité de leur travail ? Nos équipes ont-elles bien intégré les enjeux globaux de l’entité pour orienter leur action ? Nos équipes sont-elles capables de maintenir le bon niveau de réactivité face aux dérives de performance et aux problèmes importants dans le déroulement des opérations ? Les problèmes sont-ils traités avec la profondeur nécessaire ? Nos équipes appellent-elles à l’aide lorsqu’elles n’ont pas la capacité de traiter un problème, et cette aide leur est-elle fournie sans délai ?
Pour les membres des équipes opérationnelles, le système de management mis en place devra leur apporter de nouveaux éclairages propres à soutenir leur responsabilisation pour les amener à : i) se sentir solidaires des enjeux globaux de l’entité ; ii) comprendre la contribution que leur équipe peut apporter au succès de l’entité ; iii) participer aux décisions du collectif et surmonter leur frustration quand le collectif ne priorise pas les problèmes qui les touchent directement.
Chaque équipier doit trouver dans le système de management des réponses aux questions qu’il se pose : qu’essaie-t-on de réussir ensemble à moyen terme ? Quelles sont les priorités sur lesquelles nous avons décidé de travailler à court terme pour y arriver ? En quoi le travail réalisé est-il réussi ou non ? Faisons-nous avancer les choses ? Quels sont les problèmes particuliers sur lesquels nous sommes mobilisés ? Comment sommes-nous organisés pour faire face aux problèmes récurrents et les résoudre ? De quelle aide avons-nous besoin de la part du management et de la part des fonctions support ?
Les rituels de délibération de même que le management visuel (destiné à faciliter la transmission d’informations par des supports visuels) font partie intégrante d’un système de management qui met en œuvre les principes de subsidiarité et de collégialité.
Les indicateurs retenus pour piloter l’activité en sont également une composante importante. Ils doivent pouvoir être discutés et compris par les équipiers, donner la meilleure mesure possible de la notion de travail bien fait et ouvrir l’opportunité aux équipiers de réguler les standards de travail et de réduire la variabilité de la production, en coopération avec les fonctions support.
La troisième population concernée par la réflexion sur le système de management, ce sont les managers de proximité. Dans les contextes responsabilisants, les directions parlent beaucoup de changement de la posture managériale (aide, bienveillance, exigence, art du feed-back, etc.) sous la forme d’injonctions, mais elles ne s’occupent guère de l’activité managériale elle-même. Or c’est bien à travers l’analyse de l’activité des managers que de vraies transformations pourront être obtenues : comment les mettre eux-mêmes en condition de réussir leur nouvelle mission ? De quelles ressources vont-ils disposer ? Notamment, de quelle disponibilité personnelle le manager jouira-t-il pour exercer une supervision active des opérations et faire progresser le fonctionnement de son équipe ? De quelle aide bénéficiera-t-il de la part de son supérieur hiérarchique dont il est lui-même un équipier ? Quel soutien lui sera fourni par les services support ? Enfin, comment les managers seront-ils évalués ?
Bien entendu, les éléments tangibles cités ici à titre d’exemples ne prétendent pas épuiser le sujet. Il reste parfaitement possible d’en imaginer d’autres. Dans la pratique cependant, les témoignages indiquent que les transformations se saisissent le plus souvent de ces trois sujets (design organisationnel, création de rôles support, système de management).
Évaluer la maturité de la transformation
Enfin, les axes de la boussole permettent de construire cinq échelles qualifiant les progrès de la transformation dans la durée. Les échelles sont adaptables à l’ambition que l’entreprise s’est donnée et elles pourront en outre évoluer au cours du temps. Elles doivent être considérées comme une illustration, et non comme une prescription qui exigerait de gravir tous les barreaux de l’échelle pour devenir une organisation responsabilisante.
Il n’y a pas de référentiel de certification pour devenir une OR, et heureusement ! Ce serait une aberration conceptuelle.
Cette méthode de mesure est directement inspirée du « radar de l’autonomie » (Chaire FIT2, 2022b) mais les sept dimensions du radar d’origine ont été remplacées ici par les cinq axes de la boussole de la responsabilisation. On se reportera à ce document cité en bibliographie pour comprendre les différents usages que l’on peut faire du radar individuellement et collectivement.
Figure 4.1 – Le radar de la responsabilisation
Mode de lecture : L’entreprise A a un niveau 4 sur l’axe Responsabilité, un niveau 4 sur l’axe Subsidiarité, un niveau 3 sur l’axe Collégialité, etc.
Illustration de l’échelle sur l’axe Responsabilité
Illustration de l’échelle sur l’axe Collégialité
- 23. Selon Jeff Bezos, une équipe a la bonne taille quand elle peut être nourrie par deux pizzas king size.
Deux exemples de transformation responsabilisante dans des PME
Nous l’avons dit, une transformation responsabilisante est une exploration qui prend la forme d’une aventure et celle-ci se révèle assez variée d’une entreprise à l’autre. Pour prendre la mesure des différences et des convergences qui peuvent exister dans ce type de démarche, nous allons raconter ici deux itinéraires de transformation à travers l’histoire de deux PME industrielles familiales : Lippi et Martin Technologies.
Plusieurs publications ont déjà rendu compte du parcours de ces deux entreprises (Bourguinat, 2019 ; Weil et Dubey, 2020 ; Pellerin et Cahier, 2019, 2021). Pour préparer cet ouvrage, nous avons à nouveau recueilli les témoignages des deux dirigeants, Frédéric Lippi et Laurent Bizien, pour leur demander quelles leçons ils avaient tirées de leur transformation, respectivement quinze ans et dix ans après son début.
Un peu d’histoire
Julien et Frédéric Lippi, deux frères, prennent les rênes de l’entreprise familiale spécialisée dans les clôtures en 2007. Ils sont décidés à gérer l’entreprise différemment de ce que faisaient leur père et leur oncle, sans avoir pour autant des idées déterminées sur la question. La crise de 2008 va avoir un impact majeur sur l’entreprise avec une baisse du chiffre d’affaires de près de 30 % mettant en péril sa survie. De 2008 à 2010, un énorme effort de formation des salariés au numérique est entrepris. Il s’agit d’abord d’une acculturation au numérique avec des outils qui sont mis à la disposition des salariés pour leurs besoins personnels : modifier des images avec Photoshop, créer un blog pour l’anniversaire de sa grand-mère, etc. Cette phase de découverte ouvrira la voie ensuite à des applications professionnelles. Ainsi, par exemple, une petite équipe a été formée à SketchUp, un logiciel de modélisation 3D, d’animation et de cartographie orienté vers l’architecture. L’idée, au départ, était de permettre aux salariés de représenter leur propre maison ou leur projet de maison. Chemin faisant, certains s’en sont saisi pour améliorer le remplissage des camions de livraison de l’entreprise.
Parallèlement, un chantier important autour du lean est entamé dès 2008. Il durera six ans. L’objectif est l’amélioration de la réactivité de l’entreprise au service des clients, ainsi que la maîtrise des coûts et des stocks.
Le début de la mise en place du lean a été décevant. Il semble manquer quelque chose. En 2011, les dirigeants de Lippi initient la construction de la vision de l’entreprise, qu’ils qualifient de construction du « désir commun ». L’élaboration de cette vision est réalisée par groupes de dix salariés, impliquant la quasi-totalité de l’entreprise. Pour Frédéric Lippi, la construction de ce désir commun a fortement contribué à pérenniser le lean dans l’entreprise. Depuis cette première expérience, la co-construction est pratiquée régulièrement et fait partie de l’ADN de l’entreprise.
Les apprentissages à intervalle rapproché sont mis en place dans le cadre du lean sur quatre niveaux (AIR 1 à 4, de l’équipe de travail jusqu’à la direction de l’entreprise) dans une escalade de subsidiarité. L’ensemble de la démarche lean est mise au service du flux tiré. Elle est clairement vue comme un système d’apprentissage pour développer les personnes.
Progressivement, la cooptation des responsables par les équipes a remplacé leur nomination par la direction de l’entreprise. Enfin, le processus de recrutement implique désormais l’équipe d’accueil de la personne à recruter ainsi que les autres services concernés, avec l’appui des RH mais sans intervention directe de la direction de l’entreprise. Sans jamais revendiquer son appartenance au mouvement des entreprises libérées, Lippi en applique néanmoins les principaux ressorts.
De son côté, Martin Technologies est une entreprise familiale qui compte aujourd’hui environ 100 salariés. Elle est spécialisée dans la fabrication de plaques de métal, d’étiquettes en plastique, de claviers à membranes et de tôlerie fine décorée. L’entreprise a subi, elle aussi, de plein fouet la crise de 2008. Elle a fait un certain nombre de tentatives de déploiement du lean dans les années 2009 à 2011, mais sans grand succès. Laurent Bizien, l’actuel directeur général de l’entreprise, est recruté par le président en 2013.
Le premier tournant pour l’entreprise se produit en 2015 avec le déploiement du management visuel de la performance, associé à des rituels d’échange (AIC). Le projet de management visuel est co-construit et mené par une équipe de douze personnes, sans représentant du comité de direction. Après une révision en 2016 de ce management visuel de la performance, un deuxième tournant survient en 2017 avec la mise en place de mini-usines par typologie de client, intégrant l’ensemble des fonctions de l’entreprise – méthode inspirée de Jean-François Zobrist (2020) chez Favi. Si la dynamique collective a beaucoup progressé, elle ne concerne toutefois encore qu’environ 50 % des effectifs. Un troisième tournant est donc pris en 2018 consistant à accompagner progressivement l’ensemble des salariés de l’entreprise vers une meilleure connaissance de soi et des autres pour favoriser la transformation collective.
Des points communs structurels
Des entreprises patrimoniales
Nous avons affaire ici à deux PME patrimoniales, avec respectivement 250 (Lippi) et 100 salariés (Martin Technologies). Le capital de l’entreprise est détenu dans les deux cas par une famille, ce qui assure une certaine stabilité dans la conduite des affaires, avec une vision de pérennité à long terme de l’entreprise, et des bénéfices entièrement réinvestis dans celle-ci.
Une transmission générationnelle a eu lieu dans les deux cas, aboutissant à une refondation de l’approche managériale, qui passe d’une approche « commandement et contrôle » initiale à une approche responsabilisante développée sur une longue durée (quinze ans pour Lippi, dix ans pour Martin Technologies).
Une question de survie
Les deux entreprises ont pris le choc de la crise de 2008 de plein fouet, avec une baisse du chiffre d’affaires occasionnant des plans sociaux. Cette crise a été fondatrice. Le « pourquoi » de la transformation était, dans les deux cas, lié à la survie de l’entreprise. Mais c’est l’appétence personnelle de ces dirigeants pour la construction d’une entreprise plus humaine qui les a conduits à choisir la voie de la responsabilisation plutôt qu’une autre. Les deux entreprises étaient très fragiles au sortir de la crise, et ce n’est que plusieurs années après le début de leur transformation (entre cinq et dix ans) qu’elles se sont considérées comme tirées d’affaire.
Des chemins différenciés avec des composantes communes
D’abord, le lean
S’agissant de deux entreprises industrielles, la transformation a démarré par le lean, qui est apparu comme un support indispensable à un meilleur service rendu au client, à la réduction des stocks, à la fiabilisation des délais de livraison, et finalement à la performance économique de l’entreprise. Les débuts ont été difficiles. Des tentatives de mise en place des 5S (une pratique d’optimisation des conditions et de l’environnement de travail, en veillant notamment à ce qu’il reste bien rangé, nettoyé, sécurisé), du SMED (single-minute exchange of die24), des chantiers Kaizen ont eu lieu. Après quelques succès initiaux, le soufflé est vite retombé, de même que la mobilisation autour du projet. Laurent Bizien le résume d’une phrase : « À l’époque, on espérait vraiment un sursaut, et ça avait finalement du mal à prendre : le 5S mobilisait énormément d’énergie, et, dès qu’on arrêtait le suivi, les chantiers s’arrêtaient. D’où un fort questionnement. » Pour Frédéric Lippi : « On a bien essayé de faire du lean au départ, ça a été exceptionnel sur trois mois mais ça n’a pas duré, c’est retombé ! »
Avec le recul, et dans les deux cas, c’est la mise en place du management visuel et des animations à intervalle court qui a déclenché la transformation. Le management visuel a servi de support commun de compréhension des enjeux de l’entreprise et des équipes ; les animations à intervalle court ont non seulement été la première instance de dialogue professionnel, mais aussi un puissant support pour la mise en place de la subsidiarité. Lorsqu’ils sont bien mis en place, ces rituels de terrain permettent en effet une escalade de subsidiarité. Frédéric Lippi le résume ainsi : « Nous utilisons du SIM [AIC], Short Interval Management : nous sommes attentifs à ce que ces routines soient appliquées à la bonne fréquence et avec le bon objectif, pour que toutes celles et ceux qui sont autour des problèmes puissent les résoudre sans faire appel à la hiérarchie. C’est une subsidiarité complète. »
AIC et management visuel représentent donc deux étapes essentielles pour une organisation industrielle souhaitant mettre l’autonomie et la responsabilité au cœur de son projet.
Co-construction à tous les étages
Chez Martin Technologies, dès le début, le management visuel a été co-construit : « Avec le recul, c’est le point de départ de notre transformation culturelle, pour la raison forte que l’équipe projet à qui on a confié ce travail d’imagination du management visuel était composée d’environ douze personnes, et c’était la première fois qu’il n’y avait, délibérément, aucun membre du Codir dans l’équipe projet », explique Laurent Bizien. Par la suite, l’entreprise se mettra d’ailleurs à fabriquer des outils de management visuel pour les tiers, créant ainsi une nouvelle ligne de produits.
Puis, est intervenue la co-construction du projet d’organisation en mini-usines : « On a mené cette transformation entre octobre 2016 et juillet-août 2017. On nous avait dit qu’il fallait en moyenne 12 à 18 mois pour procéder à une transformation de ce type, on n’y croyait pas trop, on pensait qu’il nous faudrait plutôt 24 mois ; et en fait on l’a fait en moins de 10 mois. L’enseignement qu’on en a tiré, c’est que le projet avait du sens pour tout le monde. Dès lors que le projet a eu du sens, et que la première mini-usine s’est mise en mouvement, toutes les équipes ont suivi et ont voulu accélérer le mouvement : c’est vraiment devenu le projet de l’organisation dans sa globalité, et pas seulement de la direction ou du management. D’ailleurs, pour mener cette réflexion-là, on a fait une équipe projet de quatorze personnes avec seulement quatre membres du comité de direction : c’était plus que la dernière fois, parce qu’on changeait vraiment l’organisation dans sa globalité. Il y avait même des opérateurs de production parmi les membres. De toute façon, à partir de 2015, tous nos projets incluent systématiquement les équipes dans toutes les étapes, de la réflexion à la mise en œuvre. »
Chez Lippi, la co-construction a commencé par la définition d’un désir commun : « Le lean est seulement une boîte à outils nécessaire et utile mais pas suffisante, il faut y adosser un désir commun. » La construction de ce désir commun est partie d’un questionnement initial : « Vous pensez quoi de l’entreprise, vous aimez quoi, vous avez peur de quoi, qu’est-ce que vous voulez pour l’entreprise dans cinq ans ? Qu’est-ce qu’il faut pour y arriver, et vous vous engagez comment pour y parvenir ? » En deux ans, entre 2011 et 2013, dix-sept « cercles de vision » ont permis à une dizaine de salariés par cercle (soit presque la totalité de l’effectif) de travailler sur les « étoiles de Lippi ». Ce terme d’étoiles faisait référence à la formule de Ralph Waldo Emerson : « Les grands hommes, les génies, les saints, n’ont fait de grandes choses que parce qu’ils étaient inspirés par un grand idéal. On a besoin d’accrocher sa charrue aux étoiles. » Au terme de ce processus, cinq étoiles ont été identifiées : i) s’accomplir ensemble et être heureux ; ii) une organisation qui libère et qui nous rend autonomes grâce au partage de l’information ; iii) travailler en business unit orientée vers les clients ; iv) développer la vente multicanal : apporter une solution adaptée à notre clientèle par tout mode de diffusion ; v) liberté, innovation, participation, partage, intelligence.
Frédéric Lippi souligne toutefois les limites de la co-construction. « Un des grands avantages de la co-construction, c’est d’emmener beaucoup de gens et de permettre une appropriation plus rapide. Mais elle entraîne un certain nombre de risques : la médiocratie ou encore le refus de rentrer dans les processus de deuil quand l’environnement réel n’est pas conforme à celui qui a présidé à l’élaboration du futur. On avait, par exemple, coélaboré une stratégie assez sophistiquée, qui descendait dans le détail de l’exécution, et qui s’est heurtée au Covid. On a réussi à traiter la période Covid, mais le corps social a eu énormément de mal à accepter que le futur qu’on avait coélaboré ensemble n’adviendrait pas. […] C’est donc une des limites de la coélaboration ou de la co-construction. On en revient à se mordre la queue : pour aller vers l’émancipation, il faut des gens déjà émancipés qui aient de la distance avec leur propre contribution. »
Frédéric Lippi pose également la nécessité du principe de suppléance : « Les leaders doivent bien comprendre que, dans la subsidiarité, il y a aussi la suppléance, et que la suppléance n’est pas un viol : à un moment donné, le leader reprend les manettes pour X ou Y raison, c’est explicite, temporaire et limité dans le temps. […] C’est le job du leader de reprendre la main à un moment donné, et donc de forcer le chemin de deuil que le corps social n’arrive pas à emprunter de lui-même. »
Une transformation personnelle pour une transformation collective
Chez Martin Technologies, en 2016, après avoir mis en place le management visuel puis les mini-usines, Laurent Bizien et Stéphane Cazoulat, coanimateurs de l’évolution culturelle et organisationnelle de l’entreprise, constatent que seulement 50 % des effectifs de l’entreprise sont embarqués dans la transformation. « C’est à cette occasion-là qu’on rencontre une personne d’un cabinet d’accompagnement, spécialisé en transformation individuelle et collective, qui va nous faire comprendre les différents territoires de communication qui existent chez l’être humain. On peut communiquer avec la tête, avec le cœur et avec les tripes. Pour embarquer nos équipes, il fallait qu’on aille de plus en plus communiquer avec le cœur et les tripes, faire rentrer les émotions et le champ des ressentis dans l’entreprise, et ainsi interagir avec nos équipes autour des valeurs, des croyances, des convictions, et même de la foi : qu’est-ce qui nous touche vraiment, qu’est-ce qui est important pour chacun, qu’est-ce qui nous met en mouvement, individuellement ou collectivement ? » Des promotions de quinze à vingt-quatre personnes sont alors accompagnées par un ou deux coaches, suivant le nombre.
La première session porte sur « moi » : l’estime de soi, la confiance en soi, apprendre à écouter, la notion de résonance, etc. La deuxième session, sur « moi et l’autre » : les formes d’interaction, la communication non violente, etc. La troisième session porte sur « moi et les autres » : les méthodes d’animation collective et les techniques de codéveloppement. La quatrième session permet de revenir sur soi et d’identifier le style de leadership de chacun. « Le cabinet n’avait jamais proposé ce type de parcours à tous les salariés d’une entreprise, explique Laurent Bizien. Historiquement, c’est une formule qui est conçue pour les managers. » Cette formule standard, le dirigeant n’en voulait pas, il voulait pouvoir toucher tout le personnel, quel que soit le métier ou la fonction : « On a donc invité le cabinet à nous proposer quelque chose qui puisse toucher tout le monde. Finalement, ils n’ont rien changé, ils ont tenté leur parcours appelé “l’école du leadership” en l’appliquant à tout le monde. On a donc fait des promotions où tout le monde était mélangé : dans la mienne, j’avais des opérateurs de production, des chefs de projet, des commerciaux ; dans la deuxième promotion, il y avait notre président avec des opérateurs aussi… »
Selon le cabinet d’accompagnement, Martin Technologies aurait fait les choses à l’envers : l’entreprise aurait dû commencer par le coaching collectif, et, après, changer l’organisation. Laurent Bizien ne voit pas du tout les choses comme ça. Pour lui, il n’y a pas un « bon ordre » pour faire les choses : « On a suivi les étapes qui avaient du sens pour nous, et qu’on se sentait en capacité de porter pour engager les équipes à nous suivre. Je pense que cette notion de sens, elle est importante pour le collectif, mais elle est aussi très importante pour les porteurs de la transformation. Si on n’est pas à 100 % convaincu que c’est une étape qui a du sens, on ne sait pas le donner. » Chez Martin Technologies, le travail sur la vision n’a été fait que tout récemment : « On a attendu que ça émerge du collectif pour engager cette étape-là. »
Avec le recul, Laurent Bizien constate que les deux premières étapes (management visuel et mini-usines) étaient indispensables pour préparer l’étape suivante (coaching collectif). La mise en œuvre de pratiques transformatrices a permis la maturation collective du projet et lui a donné sa crédibilité. La formation a alors eu du sens pour tous. Commencer par de la formation aux concepts n’aurait probablement pas permis d’embarquer tout le monde : personne n’aurait saisi la portée de ce qui était enseigné.
Pour Frédéric Lippi, la transformation personnelle passe par une phase d’émancipation puis par une phase d’individuation. L’émancipation consiste à renégocier ses propres croyances, elle précède l’individuation, qui permet ensuite d’assumer pleinement qui on est, sans être sous le joug des croyances, des peurs, et sans détruire les autres dans la relation.
Ce double mouvement permet à l’individu d’être juste dans sa communication. « Or, explique Frédéric Lippi, la communication est centrale dans un système complexe, où il va falloir intensifier la communication pour se faire une bonne idée du réel, s’assurer qu’on a levé l’ensemble des malentendus, que notre perception du réel n’entame pas notre lucidité. L’organisation doit non seulement accueillir mais permettre que les émotions, qui vont être finalement le socle du travail d’émancipation et de responsabilisation, aient leur place. »
L’idée de système complexe est fondamentale dans la responsabilisation selon Lippi : « J’ai constaté à quel point les individus, devant la complexité, ont tendance à vouloir simplifier les choses. Or la simplification amène la superstructure qui, elle-même, génère de la bureaucratie. Donc, alors qu’on a une volonté d’aller dans la complexité de façon sereine, on finit par des complications. Je l’ai vu mille fois : c’est un tropisme naturel des systèmes. Tant qu’on n’a pas passé le gué de : “Je suis OK avec moi et dans mes relations, je dis mes peurs et donc mes peurs ne sont pas un obstacle à faire ce qui est bien”, l’organisation connaît toujours des retours en arrière, essaie de mettre de la superstructure ici, essaie de simplifier le réel là, essaie de faire rentrer des ronds dans des carrés. Elle ne prend pas encore possession de la complexité. »
Bilan de l’organisation responsabilisante
Le bilan, c’est aussi et surtout celui d’une aventure humaine personnelle pour le dirigeant qui élève ainsi son niveau de conscience. Car sur ce chemin d’émancipation, le dirigeant lui-même n’est pas exempt de craintes, de frustrations, de mécompréhensions, de malentendus. Ainsi que le souligne Frédéric Lippi, le dirigeant est naturellement porteur de tous les travers des autres, mais exacerbés.
Selon lui, la question des organisations responsabilisantes a été très à la mode, il y a une dizaine d’années. À cette époque, les dirigeants étaient partagés entre une aspiration éthérée pour les modèles de ce type et un doute prononcé. Il constate avec le recul que ceux qui étaient dans le doute y sont restés et que ceux qui avaient une aspiration éthérée ont rejoint le camp du doute. Ce doute apparaît comme une réaction à l’emballement médiatique autour de l’entreprise libérée, présentée abusivement comme un processus simple, que le dirigeant pouvait déclencher en se contentant de lâcher prise. Ce doute est salutaire s’il ne conduit pas à abandonner ce type de transformation, mais à en affronter la complexité. Or, celle-ci peut rebuter, ce qui explique sans doute le haut degré de réversibilité du côté des dirigeants : « Si l’on n’accepte pas de partir pour dix ans, on abandonnera. Comme c’est complexe, ça n’est absolument pas déterministe : or les dirigeants aiment le déterminisme. Il y a une grosse aversion pour l’émergence, et donc beaucoup de retours en arrière », conclut Frédéric Lippi.
- 24. Temps de changement d’outillage entre deux séries de production.
La transformation du groupe Michelin
Nous passons à présent de la PME au grand groupe, avec la transformation de Michelin25, illustrant l’idée d’exploration dirigée.
La logique suivie par Michelin repose sur une prémisse : selon la conception du travail industriel et de la performance dans ce groupe, la responsabilisation (terme qui est préféré à celui d’autonomisation) ne saurait résulter spontanément ni d’une « libération » désordonnée des énergies, ni de la seule exemplarité du dirigeant, mais d’une maturation dans le temps qui s’obtient par un processus structuré d’explorations successives.
L’idée d’une certaine autonomie de l’opérateur dans sa tâche est inscrite dans l’histoire du groupe. Cofondateur de l’entreprise en 1889 avec son frère André, Édouard Michelin a été un dirigeant visionnaire sur le plan du management. Il déclarait ainsi dès 1928 : « Un de nos principes est de donner la responsabilité à celui qui accomplit la tâche car il sait beaucoup de choses sur la question et cela lui révèle souvent des capacités dont il ne se doutait pas et qui le font avancer. » Prononcée à l’époque du taylorisme triomphant, une telle phrase apparaît comme révolutionnaire.
Michelin et le taylorisme
Michelin a été une entreprise pionnière dans l’introduction du taylorisme en France (Tesi, 2008). Les raisons qui ont conduit le groupe à modifier l’organisation de ses ateliers sont de plusieurs ordres : accroître la production, baisser les prix de revient et garantir un haut niveau de qualité de ses produits. La méthode est efficace, au point qu’elle sera même utilisée dans la construction des cités ouvrières de Clermont-Ferrand. L’entreprise ira même jusqu’à créer une école d’ingénieurs en organisation. Dans le même temps, elle introduit la participation des ouvriers dans les choix d’organisation du travail. L’objectif est de démontrer que l’adoption des principes tayloriens permet d’attacher le personnel au destin de l’entreprise et de le convaincre de s’identifier à elle.
La manufacture organise un véritable service de suggestions qui mène une double activité : former des contremaîtres capables d’encourager les suggestions des ouvriers, et étudier l’application des idées émises par le personnel. Ce service organise les choses de façon que l’auteur de la suggestion soit informé du résultat qui en est sorti. Un aspect décisif du service des suggestions réside dans sa fonction pédagogique : les ingénieurs font prendre conscience aux ouvriers de l’utilité des suggestions et des économies qu’elles engendrent en éliminant des gaspillages. Par exemple, les ingénieurs indiquent aux opérationnels les prix des matières premières qu’ils utilisent. Il s’agit principalement de convaincre le personnel qu’il n’existe aucune barrière entre les différents services de l’usine, ni aucune opposition entre la création d’un esprit de collaboration et les intérêts de l’entreprise qui se réalisent par une recherche continue d’économies. Afin d’augmenter le niveau d’échange entre les cadres, Michelin organise chaque année deux semaines consacrées aux suggestions. Une semaine est dédiée aux idées permettant de réaliser des économies, l’autre permet de rechercher des solutions aux dysfonctionnements au sein des ateliers. Les propositions sont encouragées par des primes remises par le contremaître lorsque le progrès préconisé par l’idée de l’ouvrier a été mis en œuvre. C’est l’ingénieur du service des suggestions qui fixe le montant des gratifications, mais c’est le contremaître qui les donne aux ouvriers. Cette stratégie conduit à renforcer les liens entre les niveaux hiérarchiques, et la société pousse les employés à participer aux réformes désirées.
Cependant, le pouvoir de décision demeure entre les mains des contremaîtres et des ingénieurs en organisation. On demande certes à l’ouvrier d’émettre des suggestions, mais il n’est pas autorisé à prendre l’initiative de les appliquer seul ; elles doivent être étudiées et la décision de les mettre en œuvre appartient à la hiérarchie. L’ouvrier ne doit pas pouvoir compromettre l’efficacité du système.
Des High-Performance Teams aux organisations responsabilisantes du futur
Sautons quelques générations. Au milieu des années 1990, les filiales américaine et allemande du groupe décident d’octroyer plus d’autonomie à leurs agents de production. Des initiatives locales voient le jour dans certaines usines de ces pays, sans concertation entre elles. Aux États-Unis, l’inspiration de cette idée provient des High-Performance Teams, alors qu’en Allemagne elle naît du modèle des groupes autonomes de production de Toyota. Mais ces deux initiatives ne trouveront pas leur voie.
Les organisations responsabilisantes
À partir de 2004, sous la direction de Jean-Christophe Guérin, alors directeur du manufacturing mondial de Michelin, un ancien directeur industriel de Michelin aux États-Unis, Gordon Huntington, bâtit ce qui va devenir le Michelin Manufacturing Way (MMW), un système de production « maison » fondé sur des méthodes de progrès propres au groupe et sur des benchmarks externes, dont, évidemment, le Toyota Production System. Le MMW s’appuie sur la valeur de respect portée par l’entreprise, et place l’opérateur au centre du système. L’organisation responsabilisante (OR) en sera la colonne vertébrale.
Michelin a, cette fois, retenu les leçons des initiatives précédentes avortées : l’OR dispose d’un cadre bienveillant mais exigeant. Bienveillant, parce que l’OR permet à tous les opérateurs d’apporter leur contribution et d’être reconnus au sein de nouveaux collectifs de travail solidaires qui traitent les problèmes et les irritants au fil de leur apparition. Exigeant, parce que l’OR se traduit par une prise de responsabilité des collectifs de fabrication sur trois enjeux majeurs : la performance des activités, le développement des personnes et le bien-être au travail. Dès le début, Michelin a choisi de miser sur une démarche qui ne cantonnerait pas les opérateurs à la seule maîtrise des savoir-faire techniques liés à leur poste de travail, ni même à plusieurs postes via la polyvalence. Le groupe entend favoriser une répartition des responsabilités et des compétences sur des opérateurs qui prendront en charge des rôles additionnels au service de leur équipe. Ils sont appelés « correspondants ».
Pour créer l’organisation responsabilisante dans ses usines, Michelin définit un nouveau territoire d’activité et de responsabilité appelé « îlot de fabrication » : 1 500 îlots de fabrication sont créés sur la totalité du périmètre industriel du groupe. La communauté de travail qui porte la mission de l’îlot représente une population de trente-cinq personnes environ, réparties en quatre équipes de moins de dix personnes (rotation de 4 équipes sur l’îlot pour un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7). Les fonctions support sont parties prenantes des réflexions de l’îlot et intègrent la communauté de travail sans avoir pour autant de lien hiérarchique avec le manager, leader de la communauté.
Cette organisation laisse beaucoup de place à la responsabilisation des opérateurs, puisque les deux tiers du temps d’ouverture, ceux-ci fonctionnent sans manager et sans support. Les correspondants peuvent s’approprier le management de domaines tels que la sécurité, la qualité, le pilotage de l’activité, la gestion des ressources et du budget, la gestion du présentéisme, la gestion du plan de polyvalence et de la formation… Les correspondants sont des ouvriers comme les autres, travaillant aux mêmes tâches, mais ils passent en moyenne 10 % de leur temps sur une mission « hors poste ». La mission de correspondant n’est pas rémunérée et elle est basée sur le volontariat. Michelin a opté pour une reconnaissance principalement collective, en introduisant la rémunération variable pour les agents de fabrication, indexée sur les résultats trimestriels des collectifs de travail.
Si les sites industriels de Michelin sont tenus de s’approprier le modèle OR, ils sont en revanche libres de développer comme ils l’entendent les rôles des correspondants. Environ 30% des opérateurs de site endossent un rôle au service de l’équipe. Les interventions de premier niveau sont effectuées en autonomie, les services experts traitant les demandes plus pointues.
L’OR a eu un effet très bénéfique sur le désilotage de l’organisation et le développement de la solidarité sur tous les plans. Au sein des équipes, les correspondants connaissent la réalité du travail. Entre les opérateurs et les fonctions support, les correspondants sont des relais efficaces et de nouvelles relations se sont ainsi créées. Situés entre la base et le corps managérial, les correspondants comprennent désormais la difficulté d’être « chef ». Pour les correspondants, le travail est plus varié, plus valorisant, avec de réelles responsabilités.
La transformation OR, qui vient renforcer le MMW, concrétise le professionnalisme et la redevabilité, et se révèle, cette fois, un succès, avec des effets visibles sur la performance et l’engagement. Entre 2005 et 2012, le taux de fréquence des accidents26 passe ainsi de 10 à 1 sur l’ensemble du manufacturing Michelin (70 usines).
Le déploiement des OR a pris deux à trois ans en moyenne pour un site de 1 000 personnes. À l’échelle du manufacturing monde, cela a pris environ huit ans : d’abord avec des pilotes par métier (complexité, spécificité organisationnelle), puis par région (spécificité culturelle), enfin, par un déploiement plus intense à l’échelle.
Élargissement de la responsabilité : les OR du futur
Au début de 2012, la direction industrielle du groupe et la direction du personnel décident de concert de lancer une nouvelle exploration sur les OR du futur. Les objectifs sont à la fois d’explorer le niveau d’autonomie maximal que les agents de fabrication pourraient atteindre, de trouver des solutions aux limites de l’OR déjà installée (en particulier en matière de reconnaissance) et d’élargir la transformation jusqu’à inclure les équipes de direction des usines.
Une des explorations remarquables de cette nouvelle phase a été de tester les limites de trente-huit îlots de production volontaires répartis dans dix-huit usines de dix-sept pays. Cette exploration a consisté à consulter les ouvriers de ces îlots démonstrateurs, en leur demandant de répondre à une question : « De quoi seriez-vous capables en termes de décision sans intervention des agents de maîtrise, en termes de résolution de problèmes sans dépendre des maintenanciers ni des régleurs, techniciens et autres organisateurs industriels ? Et à quelles conditions ?27 » Pendant deux ans, 1 500 personnes s’investissent dans cette démarche, pour laquelle elles auront carte blanche. Le but n’est pas de dresser un catalogue de « bonnes pratiques », mais d’évaluer le niveau de pouvoir d’agir auquel peut parvenir un îlot de fabrication ordinaire. Cette phase produit des résultats si convaincants que cinq usines deviennent alors pilotes des OR du futur. Charge à elles d’imaginer de nouveaux principes directeurs, mais avec la consigne de ne pas en faire un « projet » au déploiement jalonné et piloté par un sentiment d’urgence. L’idée est que, au regard de ce que ces cinq usines auront réussi à obtenir, la transformation se développera ensuite par propagation naturelle – ce qui ne s’est que partiellement réalisé.
Que faut-il retenir de la démarche Michelin ?
Le premier principe à retenir est que l’autonomie est étroitement associée à la responsabilité, ce qui se réfère directement à deux termes, empowerment (développement du pouvoir d’agir) et accountability (obligation de rendre des comptes sur la performance).
Deuxième principe : pour libérer, il faut un cadre compris et partagé. L’OR se construit en faisant évoluer des éléments tangibles de l’organisation, en créant de nouveaux contextes de travail qui favorisent une nouvelle répartition des responsabilités.
Enfin, troisième principe : il est primordial de réimpulser périodiquement le processus, en donnant aux équipes de plus en plus de possibilités de décider des champs d’autonomie dont elles veulent se saisir. En effet, une fois installée, l’OR Michelin n’a pas naturellement engendré une dynamique d’élargissement continu de la responsabilisation. Elle n’était pas autoporteuse, et ce pour au moins trois raisons. La première est liée au turn-over des directions de site et du corps managérial. Ceux qui avaient vécu le déploiement des OR ont fini avec le temps par sortir des opérations ; ceux qui les ont remplacés manquaient d’expérience pour poursuivre la manœuvre. La deuxième raison tient au manque de vision sur le potentiel des OR. Enfin, la troisième raison est une conséquence de la deuxième : l’OR s’est avérée bridée par un principe limitant qui consistait à attribuer par délégation des rôles préalablement « dimensionnés » à une frange d’opérateurs volontaires.
Deux points d’attention ont été identifiés par Michelin en tant que freins. En premier lieu, l’instabilité du modèle là où il a été mis en œuvre. En France, l’une des usines pilotes les plus avancées dans le développement de la démarche responsabilisante, dans les années 2016-2017, a été confrontée au départ à la retraite de 60 à 70 % de son personnel qui avait globalement été recruté à la même époque. Cela a remis en cause l’ensemble des progrès accomplis. Il a fallu repartir de zéro. Le deuxième point d’attention qui peut favoriser ou entraver la démarche est le leadership des managers. Nous avons dit qu’au-delà des usines pilotes l’hypothèse retenue était que la transformation se propagerait par « contagion » naturelle, ce qui ne s’est pas produit. Il n’est en effet pas facile de trouver des personnes talentueuses et motivées pour porter cette démarche. Le manque de leadership adapté s’est révélé un frein important à la transformation dans le contexte d’un grand groupe.
I Care : transformer l’attitude des managers
En 2019, Florent Menegaux, le nouveau président de Michelin, a décidé de promouvoir un nouveau modèle de leadership28 au sein du groupe. L’entreprise a lancé dans ce but un processus de consultation extrêmement large impliquant des dizaines de milliers de salariés à travers le monde autour des questions : quel est notre modèle de leadership actuel ? Quel est celui que voulons mettre en place ?
De cette co-construction est né le modèle I Care (voir encadré ci-contre). L’impact de I Care reste encore à évaluer.
La capacité à se remettre en cause
Jean-Michel Frixon (2021) a raconté dans un livre sa longue expérience d’ouvrier chez Michelin. L’expérience de l’homme est douloureuse, et l’image du management qui en ressort, très contrastée : parfois bienveillante mais plus souvent brutale et toxique. Jean-Christophe Guérin, alors VP Manufacturing du groupe Michelin, veut nourrir la démarche I Care en cours de déploiement et demande alors à Jean-Michel Frixon de venir témoigner, d’abord au niveau du groupe puis dans les différents sites français, de ce qu’a pu ressentir un ouvrier au cours de sa vie professionnelle. L’objectif est de faire prendre conscience aux managers de l’impact de leurs comportements sur l’engagement des hommes et des femmes de Michelin. De nombreux managers ont exprimé le caractère bouleversant qu’a eu pour eux ce témoignage29. Cette démarche donnera lieu à une nouvelle publication de Jean-Michel Frixon (2023). Ce tour de France a ouvert la voie à une inflexion des formations au management chez Michelin. Désormais, chaque formation au leadership fera intervenir un binôme de managés : une personne jeune et une autre plus expérimentée. Tellement simple mais il fallait y penser !
Le modèle de leadership de Michelin : I Care
I pour Inspiring. Être exemplaire et permettre à chacun de comprendre dans quel chemin il s’inscrit.
C pour Create trust. Créer la confiance dans un monde volatile, incertain, en mutation permanente.
A pour Awareness. Favoriser l’intelligence collective, c’est commencer par comprendre que nous sommes tous reliés.
R pour Results. Une large part de l’impact positif de l’entreprise sur les personnes et sur la société vient de sa capacité à générer des résultats.
E pour Empowerment. Comprendre que chacun a du talent et qu’il y a du talent dans chacun.
Un processus de nomination des dirigeants qui assure la continuité de l’action
La vie des grandes organisations est ponctuée de changements de dirigeants. Malheureusement, lorsqu’une transformation vers la responsabilisation est en cours, elle figure rarement parmi les critères de recrutement du futur dirigeant. Cela entraîne des ruptures, et très souvent un abandon de la transformation.
Si la transformation vers la responsabilisation dans le groupe Michelin perdure depuis plus de vingt ans maintenant, cela est probablement dû en grande partie à la façon dont les dirigeants sont nommés. Chez Michelin, la sélection et la nomination des dirigeants sont à la main de la Sages (Société auxiliaire de gestion), une instance composée essentiellement d’anciens dirigeants de l’entreprise, qui assure la continuité de la vision, ainsi que la préservation de la culture du groupe. Si, comme partout, le nouveau dirigeant cherche à imprimer sa marque, il le fait dans une ligne et une continuité qu’on trouve assez rarement ailleurs. C’est ainsi qu’après une lignée de dirigeants familiaux qui avaient hérité de la philosophie d’Édouard Michelin, les dirigeants plus récents extérieurs à la dynastie familiale, Jean-Dominique Senard puis Florent Menegaux, ont poursuivi à leur tour l’exploration vers la responsabilisation.
Avec le recul, la démarche de Michelin apparaît bien comme une exploration dirigée. Le terme « exploration » implique un inconnu, des bifurcations, un retour d’expérience, des remises en cause, mais cette démarche reste active du fait d’impulsions régulières données par la direction du groupe (« dirigée »). La contradiction entre exploration et direction n’est qu’apparente. Elle est le signe de la complexité de la transformation responsabilisante et du système qui la soutient.
- 25. Témoignage de Pierre Bocquet et de François Levert (Michelin), 27 février 2023.
- 26. Ce taux de fréquence correspond au nombre d’accidents par heure travaillée multiplié par 1 million.
- 27. Bertrand Ballarin, CR séminaire Vie des affaires de l’École de Paris du management, 3 février 2017, et « La responsabilisation appliquée à Michelin », in Bourdu et al., Le travail en mouvement, Colloque de Cerisy, Presses des Mines, 2019, pp. 127-135.
- 28. Attendus comportementaux des managers du groupe.
- 29. Compte-rendu du séminaire Autonomie et responsabilité dans les organisations de la chaire FIT2 : « Quand les managés forment les managers : l’ouvrier qui murmurait à l’oreille des cadres ». Témoignages de Jean-Christophe Guérin et de Jean- Michel Frixon, 31 mai 2023.
Vade-mecum – Itinéraire conseillé pour une transformation responsabilisante
Avec, en tête, les exemples de Lippi, de Martin Technologies, de Michelin et la sinuosité de leurs transformations, il paraîtrait bien présomptueux de prétendre avoir découvert une méthode pour conduire une transformation responsabilisante.
Il s’agit plutôt, grâce à ces éclairages, de proposer un itinéraire conseillé avec quelques balises et points de repère. À chacun ensuite d’adapter cet itinéraire, de prendre des chemins de traverse ou d’explorer de petites routes ne figurant pas sur la carte.
En préambule : diagnostic ou non ?
Les avis sont partagés30 quant à savoir s’il faut recourir ou non à un diagnostic de la culture d’entreprise avant de se lancer dans une transformation vers une organisation responsabilisante (OR).
Un diagnostic peut aider à prendre conscience qu’il faut tirer parti de l’existant pour transformer une organisation. Il permet de repérer les points d’appui et les freins de la culture d’entreprise à l’égard de la transformation (Jochem et al., 2014). La culture d’entreprise n’est pas un outil de gestion : on ne la gère pas, on gère avec elle, mais certainement pas contre elle. Ce diagnostic devrait inclure l’analyse de l’écosystème et du modèle économique de l’entreprise car ils peuvent ou non favoriser la transformation. Si par exemple le modèle économique de l’entreprise est trop contraint par des donneurs d’ordre qui fixent les marges et les délais de production, le dirigeant devra d’abord regagner des marges de manœuvre au cœur même de son modèle avant d’envisager la responsabilisation de ses équipes.
De son côté, Pierre-Marie Gaillot, du Cetim, n’est pas favorable à un diagnostic de ce type, du moins dans les PME où le temps et les ressources sont toujours contraints. Selon lui, les enquêtes menées sur le terrain auprès des dirigeants font apparaître une demande récurrente : « S’il vous plaît, arrêtez avec les diagnostics. » Les petites entreprises ont été, pendant des années, abreuvées de diagnostics dans le cadre de divers programmes de modernisation subventionnés par les pouvoirs publics. Désormais le mot « diagnostic » constitue en lui-même un repoussoir. Il vaudrait mieux parler de « compréhension du contexte » ou d’« écoute du terrain » afin de pouvoir personnaliser la démarche. Cette écoute du terrain peut prendre la forme d’entretiens permettant à des opérateurs, des encadrants, des dirigeants, des membres des institutions représentatives du personnel, d’exprimer leur ressenti sur l’organisation telle qu’elle fonctionne, sur les irritants et sur les traits majeurs de la culture d’entreprise. On pourra aussi s’appuyer sur les enquêtes d’engagement et les baromètres sociaux auprès des salariés.
Le diagnostic n’est pas forcément une étape. Au fil du processus, les acteurs vont en effet affiner en continu leur compréhension du système. Dans la plupart des cas, ce diagnostic ne dira pas son nom, mais il sera de facto inclus dans la préparation ou la mise en condition du dirigeant.
Trois séquences de transformation
Kéa et Melia Consulting, des cabinets de conseil expérimentés ayant conduit plusieurs dizaines de transformations de ce type, ont témoigné qu’ils les abordent en trois phases : une phase d’impulsion qui concerne l’alignement de l’équipe dirigeante, une phase d’embarquement du corps social, et une phase de refonte participative et progressive de l’organisation.
Cette manière de conduire la transformation a également été mise en œuvre chez Michelin. La concordance des approches invite à la considérer empiriquement comme assez solide. Toutefois, en dépit de son apparence ordonnée en phases, il convient de souligner que les éléments d’une transformation responsabilisante sont rarement séquentiels, et tendent souvent à se chevaucher. Rappelons-le, il s’agit d’un processus qui relève plutôt de l’exploration.
C’est pourquoi une transformation de ce type gagnera à être présentée sous la forme d’un cercle. De plus, plusieurs cycles de transformation seront souvent nécessaires, au cours desquels les trois phases devront être répétées.
Figure a – Les trois grandes étapes de la transformation
Source : Kéa, témoignage de Thibaut Cournarie et de Claire de Colombel, 21 mars 2023, et Meliae Consulting/Groupe Citwell, témoignage de Stéphane Lescure, 22 mars 2023.
Phase 1 – Impulsion d’une équipe dirigeante alignée et déterminée
La personne « source »
À l’origine de ce type de transformation, nous l’avons dit, il y a le plus souvent un dirigeant. Occasionnellement, ce peut être aussi une personne qui murmure à l’oreille du dirigeant et emporte sa conviction. Mais ce dirigeant, quel que soit son niveau de conviction et de courage personnel, ne peut pas décréter une telle transformation, il ne peut que l’impulser. Le dirigeant doit être considéré ici comme la personne « source » (voir encadré ci-dessous).
La coalition
Seule, la personne source ne pourra pas grand-chose. La dynamique s’enclenche à partir du moment où le dirigeant réunit autour de lui un groupe de personnes à qui il va demander si elles partagent sa conviction et si elles ont envie de la mettre en œuvre. La notion de coalition semble préférable à celle d’équipe de direction, car la coalition peut englober des personnes qui n’en font pas partie. C’est au leader qu’il appartient de construire sa coalition par affinités et expériences, en faisant appel à des personnes qu’il connaît dans l’organisation et dont il sait qu’elles pourront jouer un rôle pour faire advenir la transformation. C’est à partir de cette coalition que vont naître les premiers éléments de diagnostic permettant d’explorer le champ des possibles. Plusieurs grands groupes comme Michelin ou EDF ont ainsi créé un board « responsabilisation » visant à bien comprendre le mix organisationnel de départ pour éviter de greffer des modes de fonctionnement qui seraient incompatibles avec ce qui fait la force initiale du système. La construction d’une entité plus responsabilisante devra au contraire s’appuyer sur ces forces pour faire évoluer le système.
Ce temps de compréhension et de réflexion peut être assez long ; il va permettre à ce board de s’approprier les dimensions développées dans la boussole de la responsabilisation et de s’aligner pour bâtir une première vision de l’organisation cible.
Un outil d’alignement de l’équipe de direction dans les PME
Pour accompagner les équipes de direction dans les PME, le Cetim a mis au point un outil simple et opérationnel, baptisé IMT pour indice de maturité Tech’Care*. Il s’agit d’un court questionnaire que chacun peut s’auto-administrer en une dizaine de minutes en mode asynchrone, par exemple sur son téléphone portable. Les questions peuvent paraître étranges ou décalées, mais elles permettent in fine d’appréhender les perceptions du chef d’entreprise et des principaux managers sur des sujets tels que la délégation, l’autonomie, la responsabilité et la confiance. Comme l’explique Pierre-Marie Gaillot, responsable du plateau Industrie du futur au Cetim, « on peut ainsi découvrir que l’encadrement n’est pas aligné sur des questions aussi simples que : “Lorsqu’il y a une décision technique à prendre, qui doit la prendre, le terrain ou le chef ?” ». Nommer les éventuelles divergences, les débriefer collectivement, permet des discussions très enrichissantes autour de la table. Cet outil de support au débat a vocation à aider à l’alignement des points de vue avant d’engager une transformation.
* Tech’Care est le nom donné par le Cetim à son programme d’accompagnement des PME vers une organisation faisant place à l’autonomie (Care), généralement en lien ou autour de l’introduction d’un projet de modernisation technologique (Tech’). Ce programme a été inspiré en partie par les travaux de la chaire FIT2 sur le design du travail.
Cette première étape est déterminante : elle permet à la coalition de renforcer (ou non) sa conviction et de s’armer pour passer à la deuxième phase consistant à embarquer le corps social. La phase d’embarquement conduira presque systématiquement à réviser et à adapter la vision d’origine.
Il faut noter que, dans le cas d’un grand groupe avec de multiples sites ou entités, cette phase d’impulsion devra être reproduite avec le dirigeant de chaque site (le leader). Ce dernier doit s’approprier le changement et constituer à son tour son équipe de tête. Des accompagnateurs peuvent être formés pour aider le dirigeant à se questionner, par exemple pour l’aider à prendre conscience qu’il peut constituer un frein à la responsabilisation des salariés. Est-ce qu’il est capable d’exprimer pourquoi la responsabilité est importante dans son contexte et de faire le lien avec ses enjeux business ? Est-ce qu’il a une conscience des limites actuelles de son entité, et sinon, est-il prêt à aller chercher des exemples concrets sur le terrain ? L’accompagnateur devra faire émerger par le questionnement les paradoxes entre les attitudes du quotidien et les intentions.
Phase 2 – Embarquement du corps social
Cette phase a pour but de mobiliser le corps social, et aussi de le rassurer sur les intentions et la méthode. Elle va laisser une grande place à la notion de co-construction, afin de favoriser l’appropriation. C’est aussi une phase itérative : on pose des questions, le corps social y apporte des réponses, on rebondit sur les réponses trouvées, on en teste certaines, puis on se requestionne et ainsi de suite. L’erreur magistrale serait de considérer l’embarquement uniquement comme une question de communication de la direction vers les équipes. L’embarquement est déjà une phase d’action sur les pratiques, et ce sont les changements de pratiques qui « embarquent ». « Le concret est la matière première de la transformation », souligne Frédéric d’Arrentières (Renault Group).
Décliner une vision « entreprise » ou « entité » imaginée par un board risque de ne pas parler aux opérateurs, parce que trop théorique, abstraite, lointaine. L’embarquement est une cascade du haut vers le bas de la pyramide, qui s’accompagne à chaque fois d’une reformulation plus concrète de la vision afin que le niveau inférieur puisse se l’approprier. Par exemple, les directions industrielles construisent avec les directions de site la vision d’un site responsabilisé. Les directions de site construisent avec les équipes d’atelier la vision d’un atelier responsabilisé. Les équipes d’atelier construisent avec les opérateurs la vision de leurs nouvelles responsabilités et activités. Pour chaque niveau, l’embarquement sera généralement organisé en deux temps forts : une réflexion collective et un débat autour de la vision proposée ; une première mise en mouvement très concrète au niveau de l’équipe. Le point clé est que ces deux temps soient enchaînés dans un espace-temps le plus rapide possible.
Équipe support centrale d’appui à la responsabilisation
C’est en vue de cette phase d’embarquement qu’est souvent constituée dans les grandes organisations une équipe support centrale. Mais attention ! Celle-ci n’est pas une équipe de pilotage du projet de transformation puisque, comme nous l’avons souligné à maintes reprises, une transformation responsabilisante n’est pas un projet mais une exploration. Il s’agit d’une équipe qui va consacrer du temps et de l’énergie à la création puis au soutien de la dynamique de transformation. Son rôle est d’aider et d’accompagner – tout à fait à l’image de ce qui sera attendu des fonctions support dans le cadre de la future organisation cible. Autrement dit, elle ne se présente pas comme le porte-voix de la direction, elle n’a pas de calendrier précis, elle propose mais n’impose rien.
Cette cellule support fournit une bibliothèque de ressources (documentation, vidéos) et produit tout au long du cheminement des outils d’autoformation et de formation destinés aux différentes cibles, particulièrement aux managers d’entité et aux managers de proximité pour les aider à s’en approprier les principes.
Elle a aussi un rôle de capteur des idées du terrain : elle peut mettre en place un réseau d’ambassadeurs « responsabilisation » pour prendre le pouls du corps social, ou encore recueillir des idées.
Elle va également identifier les terrains favorables pour mettre en place des expérimentations sur de petits périmètres, et en tirer des enseignements.
Travailler sur les irritants
Une des façons les plus courantes de susciter l’embarquement consiste à faire travailler les équipes sur les irritants qu’elles rencontrent au quotidien. Ces irritants peuvent concerner des symboles (places de parking réservées à la hiérarchie, taille statutaire des bureaux, restaurant réservé aux cadres supérieurs…), des manques de coopération entre services, des carences répétées de moyens pour effectuer un travail de qualité, la lourdeur des validations et la lenteur des décisions, etc. Si les irritants les plus faciles à résoudre sont rapidement pris en compte par la direction, les équipes, voyant que la démarche produit des effets concrets qui améliorent leur situation, auront davantage tendance à y croire et à s’y impliquer.
Notons que l’embarquement est une phase qui n’est jamais achevée. Quand l’organisation est grande, il doit être régulièrement recommencé, du fait du turn-over des managers et des personnels. En outre, dans les grandes organisations, l’embarquement n’est jamais général. À chaque élargissement de la responsabilisation à un nouveau périmètre organisationnel, la phase d’embarquement devra être recommencée et adaptée au type de métier, de population, etc.
Quels que soient les efforts mis en œuvre dans la phase d’embarquement, il convient de souligner que les équipes ne suivront le mouvement que si elles y trouvent un sens pour elles-mêmes, si elles voient ce qu’elles ont à y gagner. En particulier, il faudra tenir compte de l’histoire et du contexte de l’entreprise, c’est-à-dire de tout ce qui a pu se passer avant la présente transformation. En effet, des changements permanents, des annonces de transformation à répétition, notamment à chaque changement de direction générale, auront pu miner la crédibilité même de l’idée de transformation et créer un climat de méfiance ou de lassitude peu propice à l’embarquement.
L’embarquement chez Michelin
Nous avons vu au chapitre 6 que la transformation chez Michelin a connu deux grands cycles. Pour chacun d’eux, le mode d’embarquement n’a pas été le même.
Lors du premier cycle de transformation, qui consistait à construire l’organisation responsabilisante (OR) dans les usines, la cascade d’embarquement jusqu’au niveau des opérateurs s’est appuyée sur un préalable qui était la conception des nouveaux territoires de responsabilité : les îlots de fabrication.
La première mise en mouvement concrète s’est focalisée sur les dimensions de responsabilité et de solidarité. Elle a consisté à donner aux agents des ressources (le temps) pour les aider à identifier leur nouvelle mission d’équipe associée à des valeurs, à engager des discussions sur des ambitions partagées, à clarifier la relation de client et de fournisseur en interne, et à décrire la manière dont l’équipe fonctionnait, avec ses propres mots, dans un livret d’équipe. Ce livret d’équipe est devenu la référence de la situation de départ.
C’est sur cette base que les équipiers ont pu commencer à identifier puis à supprimer des irritants qui existaient entre eux, avec leur hiérarchie, avec les supports, à évacuer des frustrations et à installer un début de dialogue professionnel pour améliorer leur fonctionnement collectif. Ce temps a représenté un premier signal fort, orientant les équipes vers le développement d’une capacité à s’autoréguler.
Dans le même temps, un deuxième signal fort leur a été donné par les équipes d’atelier qui ont mis en place des rituels au cours desquels les fonctions support sont devenues solidaires du collectif de travail dans chaque territoire et se sont mises à écouter les opérateurs en vue de traiter véritablement leurs problèmes.
Lors du deuxième cycle de transformation, les bénéfices de la responsabilisation, issus des OR, étaient déjà tangibles au sein des équipes. Cette fois, l’embarquement s’est fait en se focalisant sur les dimensions de subsidiarité et de collégialité. Ces principes ont été formulés et articulés avec clarté et simplicité.
Chaque leader (directeur de site) a été chargé d’animer l’embarquement de ses équipiers. Dans ce but, il a été coaché afin de se préparer à présenter à son équipe la vision de son « domaine réservé ». Le domaine réservé représente les décisions du leader qui échappent au principe de subsidiarité. A contrario, tout ce qui n’appartient pas au domaine réservé est un champ d’opportunité ouvert à l’élargissement du pouvoir d’agir des équipiers. Pendant le chantier d’embarquement, le leader devait présenter les raisons pour lesquelles il voulait conserver certaines décisions, puis une « dispute professionnelle » s’engageait pour que ses N-1 puissent le challenger. À l’issue de la discussion, le leader révisait son domaine réservé en fonction des éventuelles concessions qu’il avait accordées à son équipe. Ces « négociations » sur le domaine réservé du leader ont été souvent très intenses, preuve que la mayonnaise de la responsabilisation avait pris.
Charge ensuite aux équipiers de se saisir des champs libérés en définissant comment ils pourront devenir responsables et autonomes sur chaque sujet. Encore faut-il qu’ils le veuillent ! « Ce n’est pas parce que le cadre est clair que les gens prennent le pouvoir », souligne François Levert (Michelin). Cette discussion sur le domaine réservé pouvait ensuite être déclinée tout le long de la ligne hiérarchique au titre de l’embarquement progressif de toute l’organisation.
Phase 3 – Refonte participative et progressive de l’organisation
Cette phase nous met au cœur de l’action. Nous proposons ici les grandes lignes d’une carte de transformation vers la responsabilisation selon trois axes : i) l’ingénierie de mise en œuvre de l’OR ; ii) la transformation des styles et des pratiques de management ; et iii) les conditions de pérennisation du modèle responsabilisant.
Premier axe : l’ingénierie de mise en œuvre de l’OR
Il s’agit d’une ingénierie progressive et participative qui s’appuiera sur de l’expérimentation. L’idée est d’être pragmatique pour réussir à trouver des solutions organisationnelles accessibles, probablement imparfaites, mais qui permettront de concrétiser les premiers pas vers le changement. La grille de mise en œuvre que nous proposons s’inspire de la rosace du cabinet de conseil Meliae Consulting/Groupe Citwell, légèrement adaptée. Le cœur de la rosace (voir figure b) – « Définir les missions et les responsabilités » – est à traiter en premier car il va conditionner la mise en œuvre des éléments situés en périphérie. Puis il y a une logique d’enchaînement des réflexions qui démarre du « territoire » et s’opère en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
Appliquons la grille à un environnement de production (usine).
Figure b – La rosace de mise en œuvre de la transformation responsabilisante
1. Définir et expliciter sans ambiguïté les nouvelles missions et responsabilités
C’est la première clé de la conception d’un environnement de travail responsabilisant et donc automotivant. Cette transformation est fondamentalement centrée sur la symétrie des attentions. Les nouvelles missions et les nouvelles responsabilités devront clairement concrétiser cette intention. Elles doivent permettre la prise en main des activités quotidiennes par ceux qui créent la valeur. Mais elles doivent également ouvrir de nouveaux champs de responsabilité à un horizon moyen-long terme pour permettre aux équipes de s’engager dans un projet qui les concerne directement.
Cas d’application
Au lancement des OR, Michelin a voulu que les équipes de fabrication prennent la responsabilité de : i) piloter le progrès de la performance des activités ; ii) faire évoluer l’environnement de travail sous l’angle du bien-être ; iii) prendre en charge leur propre développement. Charge à elles de décider sur quoi il fallait agir pour y parvenir.
L’intention était claire, mais pas suffisamment explicite et concrète pour que les équipes puissent se mettre en mouvement. Dans un guide de l’OR destiné à aider les équipes à construire leur OR et à s’approprier de nouveaux champs de responsabilité, Michelin a explicité ce qu’il convenait de comprendre par « performance des activités » et ce qu’impliquait devenir responsable de cette performance en termes d’activités.
La performance des activités a donc été définie par des indicateurs dans cinq domaines : santé-machine-qualité-délai-coûts (SMQDC). L’ordre dans lequel sont positionnés les domaines SMQDC délivre un message. Pour faire du bon travail, la priorité absolue est de protéger la santé des personnes et la qualité de l’environnement de travail (S), puis de disposer d’un outil de travail performant, ergonomique, flexible et entretenu (M), de maîtriser la variabilité des procédés pour faire bien du premier coup et satisfaire les clients (Q), moyennant quoi les équipes sauront s’adapter à la demande et respecter les engagements vis-à-vis des clients (D), en réduisant continuellement les gaspillages et en atteignant la performance économique du produit livré (C).
Confier la responsabilité aux opérateurs de manager au quotidien la performance SMQDC, c’est leur faire passer le message que l’entreprise leur fait confiance pour déterminer ce dont ils ont besoin pour y arriver et ce qui les empêche d’y arriver.
2. Définir les territoires
Le redécoupage de l’organisation en mini-territoires est fréquemment l’une des grandes étapes de la transformation. Rappelons brièvement (voir chapitre 4) que ces territoires devront faire sens en termes d’activités. Il conviendra de veiller à limiter la diversité des clients, des technologies ou la complexité des activités. Le dimensionnement tiendra compte d’une certaine stabilité des effectifs et de la proximité entre les membres. Il est souhaitable de pouvoir reconnaître facilement ces territoires, en leur donnant un nom, voire un logo, ou en les matérialisant physiquement.
L’exercice est loin d’être facile. Il y a beaucoup de bonnes raisons opérationnelles dans une organisation industrielle classique pour avoir des territoires assez grands : la taille des installations, la rationalisation des ressources par la mutualisation, des arbitrages plus faciles dans l’allocation de ressources. Déconstruire pour reconstruire en territoires plus petits peut susciter des résistances, quand ça n’est pas physiquement très compliqué. La co-construction est absolument nécessaire pour trouver des compromis acceptables et ne pas susciter le rejet.
La division en plus petits territoires a des incidences qui peuvent rendre plus difficile leur gestion : il faudra par exemple modifier l’architecture du système de gestion en créant de nouvelles sections budgétaires. Les nouveaux territoires risquent aussi, dans un premier temps, de ne pas disposer de tous les outils informatiques dont ils auront besoin pour devenir autonomes.
Dans le cas d’un redesign organisationnel sous forme de mini-usine, on aura besoin de disposer d’un lieu de vie dédié à l’équipe – l’obeya31 pour reprendre le vocabulaire du lean, qui permettra de s’isoler de l’environnement de fabrication sans trop s’en éloigner, afin de se réunir, d’installer le management visuel (et de disposer des moyens collaboratifs digitaux permettant l’accès et la transmission d’information) et d’utiliser des outils performants de gestion (dès qu’on les aura adaptés). Mais, dans de nombreux cas, ceux qui ont implanté les ateliers ne visaient qu’à optimiser la surface occupée et il n’est donc pas toujours facile d’aménager cette obeya, pourtant indispensable.
Une autre difficulté peut provenir également de la méthode qu’utilise l’entreprise pour « peser » les postes. En effet, du niveau de responsabilité reconnu d’un poste découle sa rémunération. Or la taille du territoire est souvent l’un des critères de la rémunération des managers. En réduisant le territoire, on peut réduire l’attractivité du poste de manager. Si les critères de gestion des carrières demeurent les mêmes qu’antérieurement, les meilleurs managers vont se retrouver tiraillés entre l’envie de franchir des étapes personnelles dans leur parcours professionnel et l’envie de rester au service de la responsabilisation de leur équipe – sujet qui va leur réclamer beaucoup d’énergie et qui ne sera pas forcément reconnu. D’où la nécessité d’associer les équipes RH en tant que partie prenante de la transformation pour tenter de résoudre ce type de contradiction.
3. Installer un collectif solidaire sur son territoire
Une communauté de travail n’est pas un donné mais un construit (voir chapitre 3). Cette construction demande un accompagnement de qualité – ce que le manager n’a souvent pas appris à faire. Elle nécessite aussi du temps : d’une part, elle s’inscrit dans la durée, et d’autre part, elle demande d’investir du temps, notamment sous forme de séminaires suffisamment longs pour qu’il en ressorte quelque chose de significatif. Non seulement il faut budgéter ce temps, mais il faut aussi réussir à l’organiser. En production, par exemple, ce temps est très difficile à trouver, surtout quand on fonctionne 24 heures sur 24. Il est encore plus difficile de libérer les opérateurs de leur tâche première, qui est de produire, lorsque la configuration physique du travail est « la chaîne » comme dans l’automobile. Cette étape est ainsi souvent survolée, parce que difficile à organiser. Sans compter qu’il faut créer des supports qui permettront à la communauté de pouvoir s’y référer facilement.
Cas d’application
Dans une usine de Michelin, un chef d’atelier a fait travailler ses équipiers pendant plusieurs mois à raison de trois séminaires d’une demi-journée, sur la question « Que fait une personne responsable et solidaire dans notre communauté de travail ? ».
Ils ont cherché des cas de figure concrets et se sont mis à s’autoévaluer. Le manager s’est d’abord appuyé sur ces autoévaluations pour conduire des feed-back individuels fréquents. Par la suite, les équipiers sont passés au feed-back collégial sans le manager. Cette démarche les a conduits sur le chemin de l’autonomie pour intégrer les nouveaux équipiers (décider de garder ou non un nouvel équipier dans la communauté après une période probante d’intégration). Désormais, lorsque cette communauté décide de créer un nouveau rôle au service de l’équipe, la décision relative à la personne qui tiendra ce rôle est collégiale. Enfin, les équipiers sont devenus capables de décider en autonomie la répartition de leurs augmentations de salaire en fonction de ce que chacun apporte à la communauté. Dans cette communauté de travail, il y a deux slogans affichés en grand sur les murs de l’atelier : « Le chef s’occupe de nous et nous, on s’occupe du reste », et « Ici on se parle ».
4. Définir les ressources pour développer l’autonomie dans les missions
Quatre ensembles de ressources seront nécessaires à une transformation responsabilisante.
La première ressource est celle des compétences. La montée en compétences au service de la transformation a déjà été largement évoquée aux chapitres 3 et 4 : pour les managers, formation et coaching, groupes de codéveloppement ou d’analyse des pratiques ; pour les opérationnels, détection des appétences et des compétences pour les nouveaux rôles, puis apprentissage des compétences techniques nécessaires à l’exercice de ces nouveaux rôles, etc.
La deuxième est la reconnaissance de ceux qui œuvrent à la transformation. Elle peut s’exprimer de plusieurs manières. L’expression orale ou écrite de la reconnaissance par la direction et les managers à l’égard des efforts engagés et des avancées obtenues a une forte valeur symbolique, mais, seule, elle sera insuffisante. Elle devrait s’accompagner d’une forme ou une autre de partage de la valeur (primes, augmentations, intéressement et participation, actionnariat salarié). La reconnaissance des compétences additionnelles acquises par les opérationnels devrait aussi pouvoir ouvrir la voie à une évolution de carrière en matière de statut et de rétribution. À défaut de pouvoir assurer les évolutions internes à tous, l’entreprise qui a investi dans la formation de ses personnels pourra attester des compétences acquises et ainsi favoriser leur employabilité externe. Sans système de reconnaissance institué, l’OR, après une période d’enthousiasme, risque de perdre de son attractivité.
La troisième ressource concerne les effectifs. Au-delà des méthodes de calcul de charge/capacité qui permettent de déterminer le niveau adéquat d’équipiers pour ce qui concerne l’exploitation courante, il faudra prendre en compte le temps dont auront besoin les équipes pour développer le projet de responsabilisation et assumer leurs nouvelles responsabilités dans le mode d’exploitation future. Cela peut nécessiter des ajustements d’effectifs à la hausse, sachant cependant que les équipes autonomes devront être capables de se réguler elles-mêmes pour ce qui concerne la variation de la charge d’exploitation, les absences liées aux formations, aux congés ou autres imprévus.
Enfin, la quatrième est l’information. C’est une ressource immatérielle à laquelle on ne pense pas suffisamment dans les démarches de responsabilisation. Quand on passe d’un mode directif à un mode responsabilisant, on oublie souvent de se poser une question toute simple : quand un équipier ou une équipe doit décider quelque chose, sur quelles informations peut-il ou peut-elle s’appuyer ? où les trouver ? Comment mettre à la disposition des équipiers une information compréhensible pour qu’ils puissent décider par eux-mêmes avec un niveau d’information homogène ? Généralement, la réponse n’est pas compliquée à mettre en œuvre, mais parfois elle peut conduire à repenser la structure et les outils de communication à disposition des équipes. Un participant au groupe de travail faisait remarquer, à titre d’exemple, que le fonctionnement en autonomie des équipes les amenait à utiliser WhatsApp, un outil numérique proscrit par l’entreprise, parce que l’outil proposé en interne pour le même usage était jugé insatisfaisant et était donc peu adopté.
In fine, l’entreprise doit avoir conscience que toutes les dimensions évoquées (montée en compétences, formations, ac- quisition des nouvelles pratiques, aména- gement des espaces, nouveaux systèmes d’information) requièrent soit du temps, soit des investissements financiers, et souvent les deux simultanément. Il est donc important d’anticiper ces moyens et de les budgéter.
5. Définir les instances de délibération et de décision
Ces dispositifs doivent être cohérents avec les missions et les responsabilités, impliquant par là même plusieurs fréquences de rituels. Il sera très important de définir un dispositif particulier permettant la remontée des problèmes journaliers vers le niveau supérieur dans le respect de la subsidiarité, et la redescente rapide des décisions prises (voir encadré ci-contre).
6. Impliquer les RH dans la transformation
En ce qui concerne la plupart des aspects évoqués de la transformation, les RH ont un rôle fondamental à jouer. Toutefois, la conception que cette fonction aura de son rôle pourra varier selon les organisations : simple rôle d’accompagnement (niveau 1) ; veille et stimulation du processus (niveau 2) ; pilotage et inspiration (niveau 3).
Au niveau 1, les RH s’occuperont principalement des types de formations à dispenser, de l’ingénierie pédagogique et du choix des prestataires. Elles pourront aider à identifier les compétences et les appétences des collaborateurs pour proposer les nouveaux « rôles ». Elles apporteront aux managers et aux équipes l’appui nécessaire pour recruter progressivement en autonomie. Elles mèneront les enquêtes d’engagement et de satisfaction des collaborateurs, et veilleront au climat social via les indicateurs agrégés de démissions et d’absences pour maladie.
Si elles s’engagent sur les niveaux 2 et 3, les RH travailleront en étroite liaison avec la cellule support centrale d’appui à la transformation responsabilisante (quand elle existe) à la fois dans la conception et dans la production des outils de la transformation. Elles conseilleront la direction pour éviter les changements trop brutaux et perturbateurs, en fonction de leur connaissance de l’historique de l’entreprise. Elles seront aussi gardiennes de la cohérence des pratiques. Par ailleurs, elles auront à s’attaquer, à un moment ou un autre, à la refonte du système RH en matière d’adaptation éventuelle des statuts, de la gestion des carrières, des systèmes d’évaluation et de rémunération ou d’ajustement des effectifs.
Cas d’application
Michelin a développé un processus très simple pour la remontée d’information au niveau supérieur à fréquence journalière. Un support visuel appelé carte WIN (What is Important Now) est rempli par le collectif de niveau N à l’issue de sa réunion journalière. Ce document résume les principaux problèmes du jour à traiter. Si la carte WIN est verte, le collectif N se déclare en capacité de traiter les sujets qui posent un problème et cette information remonte en N+1. Si la carte WIN est rouge, le collectif N demande explicitement qu’un ou plusieurs des sujets soient pris en compte au niveau N+1. Le niveau N+1 se mobilisera alors sur ce sujet.
Mais le processus ne s’arrête pas là. Le collectif N+1 devra s’interroger sur ce qui manque au collectif N pour être autonome dans le traitement du sujet. Les problèmes qui remontent deviennent ainsi une occasion de réfléchir à la manière d’élargir le pouvoir d’agir des équipes opérationnelles.
Pour que cela fonctionne, deux conditions sont à respecter. Premièrement, le temps des rituels collectifs doit être sanctuarisé pour que tous les membres soient disponibles et présents. Deuxièmement, la planification du rituel quotidien de l’équipe la plus élevée dans la hiérarchie (équipe de direction du site) ne doit pas arriver trop tôt dans la journée. Il faut laisser le temps aux équipes de niveau inférieur d’effectuer leur travail et de prendre leurs responsabilités (principe d’escalade de la subsidiarité).
Certaines de ces questions devront passer par le dialogue social. Une partie du travail des RH consistera donc à réussir à embarquer les instances représentatives du personnel (IRP). Valérie Duburcq chez Orange témoigne : « Lorsque j’étais DRH d’entité, j’ai pu mesurer que consulter les partenaires sociaux et associer un groupe de prévention pluridisciplinaire dès le début d’un projet, au lieu de le leur soumettre une fois qu’il était ficelé, se révélait facilitant pour la phase de mise en œuvre. »
Toutefois, la démarche de responsabilisation aura souvent intérêt à se développer d’abord en mode protégé pour ne pas être déstabilisée dès le départ par des revendications multiples et pour valider qu’elle produit de l’engagement sans détériorer les résultats économiques. Sous réserve d’un climat social initial très dégradé dans l’entreprise, la transformation responsabilisante fera rarement l’objet d’une opposition de principe de la part des IRP, parce qu’elle est souvent considérée comme un « bon combat » qui porte sur la qualité du travail. Elle sera donc accueillie de façon neutre, parfois même avec intérêt par les instances de type CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), qui suivront de près ses effets sur la santé des personnes. Le directeur des relations sociales d’un grand groupe indique même que la démarche de responsabilisation a pu représenter l’occasion de relancer un dialogue social en panne dans certains pays. La démarche pourra en revanche être critiquée sur certains de ses aspects, au fur et à mesure de son avancement. Ces critiques porteront le plus souvent sur la non-reconnaissance (ou une reconnaissance jugée insuffisante) en termes de rémunération du travail additionnel fourni par les équipes, ainsi que sur l’absence de compensation pécuniaire directe pour ceux qui assument des « rôles » supplémentaires. Les organisations syndicales pourront aussi interpeller l’entreprise sur la traduction qu’elle entend donner à la polyvalence et aux compétences ainsi acquises dans les grilles de qualification et de rémunération. Enfin, les méfiances exprimées pourront porter sur l’absence de formations adaptées et de perspectives de carrière pour les opérateurs ou encore sur la réduction des effectifs de managers par suite de la responsabilisation des équipes. L’une des conditions de réussite du dialogue social sur ce sujet est la sincérité du projet : les IRP doivent être convaincues qu’il n’y a pas d’agenda caché de la direction derrière ce projet (de type allègement de la structure, par exemple).
Le Référentiel d’Orientation, un outil pour prendre des décisions dans l’incertain
Le concept de Référentiel d’Orientation (RFO) a été créé par Joseph Lusteau, dirigeant de Diagonart Conseil, et expliqué dans son ouvrage Donnez du sens à vos décisions (Mardaga, 2021). Il s’agit d’un outil pour gagner en cohérence dans les choix stratégiques, dans un univers caractérisé par l’incertitude, les mutations et les ruptures. La démarche de mise en œuvre du RFO a été adaptée par le Cetim pour les PME/PMI au travers de son produit Strat’eMove®.
Le RFO propose un processus décisionnel stable qui permet d’aborder la prise de décision de la même manière partout dans l’entreprise. Il est constitué de quatre cadrans :
Les éléments fondateurs, le cœur de l’entité, sa raison d’exister, définissent les missions, la vocation, ainsi que les principes et les valeurs communes à partir desquels l’essence même de l’entité peut être comprise.
Les dynamiques d’évolution, les axes de développement prioritaires, font référence aux logiques principales de développement et aux leviers privilégiés qui vont caractériser globalement son parcours dans le temps et ses manœuvres stratégiques.
Les modes de gouvernance, le style de management, décrivent le type de fonctionnement des acteurs en interne ainsi que les relations et les comportements de l’entité vis-à-vis de ses partenaires extérieurs et de ses écosystèmes.
Les impératifs ou perspectives majeurs sont les quelques axes et positionnements politiques clés précisés par les ancrages à préserver et les défis à relever à moyen terme.
Les principaux usages du RFO sont :
• exprimer et communiquer simplement ce qu’est l’entreprise et ce qu’elle souhaite devenir ;
• être en mesure de décider rapidement sur les alternatives stratégiques les plus en conformité et en cohérence avec l’ADN et les ambitions de l’entreprise dans un environnement bousculé par l’incertitude (investissement, acquisition externe, changement du système de management, etc.). Chaque alternative est alors cotée à l’aide de cette grille ;
• pouvoir communiquer facilement pourquoi et comment la décision a été prise ;
• être en mesure de tracer et de justifier dans le temps les raisons des décisions précédentes et des éventuelles prises de risque associées.
Une fois construit et validé, le RFO est un puissant outil de prise de décision, à tous les niveaux de l’entreprise, individuellement ou en groupe. À ce titre, il permet de développer la responsabilisation dans toute l’entreprise.
Comme le souligne Frédéric d’Arrentières (Renault Group), il serait vain d’espérer transformer une grande structure sans le soutien de la fonction RH. Il est indispensable que celle-ci s’engage au côté de l’équipe d’accompagnement pour donner à l’entreprise toutes les chances de réussir. Toutefois, il faudra tenir compte du fait que la fonction RH n’aime pas trop être bousculée : sa mission s’inscrit dans la durée, elle gère des pyramides des âges qu’elle cherche à équilibrer, elle est encadrée par de très nombreuses règles contraignantes qu’elle a vocation à rappeler à toutes les parties prenantes.
Deuxième axe : transformer les styles et les pratiques de management
La démarche de responsabilisation transforme le rôle du manager. Le cabinet de conseil Kéa nous propose une métaphore : « Faire de ses managers des jardiniers ».
Beaucoup d’entreprises, en particulier les grands groupes, travaillent à faire évoluer leurs managers. Elles définissent un profil type qu’elles associent à des compétences comportementales et à des postures, et tentent de les développer en créant, par exemple, des « universités » ou des « académies ».
Pourtant, même quand les managers sont accompagnés sur le thème du changement de styles et de pratiques managériales, un point clé reste à interroger : le temps réel qu’ils peuvent effectivement consacrer à la supervision active de leur équipe. Or ce temps est souvent réduit à la portion congrue. Il y a au moins trois raisons pour que ce temps soit aussi limité : l’étendue de la responsabilité du manager (span of control) ; les autres tâches que son N+1 ou les supports lui demandent d’effectuer (reporting, réunions diverses, tâches administratives) et qui le détournent de sa mission principale ; la compréhension que le manager a de son propre rôle.
Avec un accompagnement approprié, le temps de présence des managers auprès de leur équipe peut considérablement augmenter. Cet accompagnement peut prendre la forme d’un coaching sur le terrain en situation réelle d’encadrement afin d’éviter de consommer un temps additionnel du manager par une formation hors terrain. Qualité et fréquence de l’accompagnement sont les points déterminants de l’efficacité de ce type d’apprentissage. Pour y parvenir, il faut un ratio de l’ordre de un coach pour quinze managers en processus d’apprentissage. Chaque accompagnement se termine par un feed-back, à l’issue duquel le manager prend un engagement sur l’évolution de son style de management, un petit pas qu’il devra mettre en œuvre immédiatement et qui fera l’objet d’un débrief lors du prochain accompagnement.
Par ailleurs, la pratique du « domaine réservé » est très utile pour ouvrir la voie à de nouvelles répartitions des responsabilités entre un manager et ses équipiers. Le manager commence par se livrer à une réflexion personnelle de manière à clarifier ce qu’il considère comme son pré carré en matière de prise de décision. Lorsque cet exercice de réflexion est terminé, le manager présente son domaine réservé à son équipe et en justifie les raisons, tout en acceptant le principe d’une « dispute professionnelle » à ce sujet. En creux, il affiche clairement qu’il est prêt à lâcher prise sur ce qui ne figure pas dans son domaine réservé. Si les équipes revendiquent l’accès à une dimension supplémentaire du domaine réservé, le manager peut décider d’étudier cette requête, en la partageant le cas échéant avec d’autres services : dans quelles conditions serait-ce faisable (ressources) ? À quel horizon (délai) ? Comment pourrons-nous sécuriser le résultat (efficacité) ? La pratique du domaine réservé permet au manager d’apprendre à gérer le cadre de l’autonomie de son équipe et à lâcher progressivement du lest de manière dynamique, comme dans l’encadré en page suivante.
Enfin, pour libérer les énergies, il faut un cadre. C’est au manager de gérer le cadre de son équipe en concertation avec elle. La finalité du cadre est de sécuriser la dynamique continue d’élargissement des espaces de responsabilité, alimentée par la dispute professionnelle sur le domaine réservé du manager. Le cadre est constitué de points de repère et de ressources.
Imaginons un joueur de foot qui devrait demander à son entraîneur s’il a le droit de tirer au but. C’est une situation aberrante pourtant rencontrée fréquemment en entreprise. Au foot comme ailleurs, celui qui a la responsabilité à l’instant t est celui qui détient le ballon, pour autant qu’il agisse en coopération avec les autres. Parce que les équipiers ont une ambition à l’égard de laquelle ils sont solidairement responsables, qu’ils connaissent les règles du jeu, ainsi que les qualités et les faiblesses de chacun et leur rôle sur le terrain, parce qu’ils sont solidaires dans l’effort, qu’ils ont des aptitudes personnelles, qu’ils ont défini collégialement des plans de jeu, qu’ils reconnaissent un des plans de jeu possibles à partir de la position des équipiers et des adversaires, ils vont décider de dérouler tel plan de jeu qui leur permettra de marquer un but sans aucune intervention du coach.
Le domaine réservé du manager et son extension
Imaginons un manager qui s’interroge sur son domaine réservé et sa justification.
Décider de l’embauche en CDI d’un nouvel équipier : je garde cette décision dans mon domaine réservé, parce que je pense que mes équipiers risqueraient de recruter quelqu’un uniquement en jugeant de l’adéquation de son expertise au regard de leurs besoins actuels. Ils ne prendraient pas en compte d’autres critères permettant de juger de la capacité de cette personne à développer une carrière dans l’entreprise. Du reste, je ne suis pas moi-même en position de décider seul, c’est une décision concertée avec un membre du service RH.
Décider de l’embauche d’un intérimaire en renfort ponctuel de l’équipe : actuellement, c’est moi qui décide, mais je considère que cela n’appartient pas forcément à mon domaine réservé. Mes équipiers sont capables de juger de la nécessité d’avoir un renfort et sont maîtres de leur budget sur ce plan. En outre, il n’y a pas de forte prise de risque au cas où la personne recrutée ne correspondrait pas au profil recherché. Je suis donc prêt à lâcher prise sur cette décision. Mes équipiers pourraient être autonomes et ne plus me solliciter pour cette décision.
Étendre le champ d’autonomie de l’équipe : mes équipiers recrutent désormais les intérimaires. Cela fonctionne très bien. Nous pourrions maintenant envisager de les faire participer au recrutement des CDI, ce que d’ailleurs ils réclament. Je vais consulter les RH pour voir à quelles conditions et dans quelles limites cela pourrait devenir possible et avec quelles ressources.
Quand les managers ne sont plus en permanence sur le terrain de jeu, comment l’équipe va-t-elle décider ce qu’elle doit faire, sans se mettre en danger ni faire courir des risques inacceptables à l’entreprise (rappelez-vous la ligne de flottaison du chapitre 3) ? Réponse : comme au foot !
Les équipiers disposent de points de repère mis en place lors de la création du territoire de responsabilité et de la construction de la communauté de travail, qui peuvent aussi provenir directement du système de production. On trouvera des repères qui orientent l’action (la mission de l’équipe et l’ambition qu’elle s’est construite), des repères qui assurent la prévisibilité de l’action (les règles du métier, les séquences de production, les indicateurs) et des règles sur la manière de faire ensemble du bon travail (les règles que la communauté se donne).
Les équipiers disposent aussi de ressources, notamment de formation et d’information, comme nous l’avons indiqué sur l’axe ingénierie de l’OR. La communauté est déjà dotée de ressources pour exercer son autonomie dans ses missions et responsabilités établies. Mais le manager a gardé le contrôle de certaines situations de jeu. Lorsque l’équipe décide d’explorer un nouveau champ d’autonomie, la responsabilité du manager est d’instruire avec les équipiers et les fonctions support associées l’évolution des points de repère et des ressources du cadre d’autonomie pour réussir à lâcher prise effectivement.
Un outil pour l’élargissement progressif des zones de responsabilité : l’éventail de délégation concertée d’ISEOR Cetim
Note : l’éventail de délégation concertée a été créé par l’Institut de socio-économie des entreprises et des organisations (ISEOR), dirigé par Henri Savall de l’IAE de Lyon (université Jean-Moulin). Cet outil, utilisé par le Cetim pour l’accompagnement de PME vers une organisation plus responsabilisante dans le cadre de son programme Tech’Care, permet de discuter des zones d’autonomie d’une personne, et par extension d’une équipe (B), avec son manager (A).
L’analyse est réalisée entre deux niveaux hiérarchiques. Les types de décisions à prendre sont inscrits sur des post-it. Une couleur est affectée à chacun des post- it. Elle définit par qui doit être prise la décision. Bleu : décision prise en autonomie. Jaune : décision subordonnée à une autorisation hiérarchique. Gris : décision prise par le manager. Les personnes placent ensuite ces post-it sur un éventail qui reprend les types de décisions. On peut ainsi observer aisément non seulement le décalage entre l’intention de départ et la prise de décision effective, mais aussi le décalage entre les croyances des uns et des autres sur qui prend effectivement tel ou tel type de décision. Dans la figure ci-dessus, un certain nombre de post-it jaunes qui devraient être dans le deuxième cadran « Décision de B avec information en amont de A » se retrouvent en fait dans l’éventail de gauche « Décision de A ». Dans les faits, la décision est donc prise par A, malgré l’intention initiale qui était que B prenne la décision en informant A en amont. Un débat est alors lancé pour résoudre le problème. La dynamique consiste ensuite à refaire l’exercice régulièrement pour voir si les zones d’autonomie théoriques se sont effectivement concrétisées.
Troisième axe : créer les conditions de pérennisation du modèle responsabilisant
La pérennisation de ce type de transformation est sans doute l’une des plus grandes difficultés que rencontrent les organisations. Parce que le modèle responsabilisant s’inscrit dans un temps long, il va se heurter à de multiples facteurs perturbateurs. Parce que le modèle responsabilisant repose sur des hommes et des femmes réels (et non sur une modélisation théorique), il est très dépendant des personnes qui le font vivre et se révèle souvent peu résilient quand ces hommes et ces femmes viennent à manquer.
Parmi les effets perturbateurs fréquents, on relève les changements de gouvernance. À l’occasion d’une acquisition, d’une fusion, de l’entrée d’un nouvel actionnaire (fonds d’investissement par exemple) ou de changements dans la structure du marché, les priorités de l’entreprise se modifient, pouvant influer sur les choix de la direction générale. Plus couramment encore, une nouvelle direction générale pourra vouloir marquer son « ère » en décrétant un nouveau type de transformation qui sera moins orienté vers la responsabilisation et davantage tourné vers l’obtention de résultats rapides, visibles, voire spectaculaires, ou obéissant à un nouvel effet de mode. Cette nouvelle orientation pourra peut-être se superposer aux acquis de la responsabilisation, mais le plus probable est qu’elle la mette en péril en modifiant la hiérarchie des priorités du management et des équipes. Frédéric d’Arrentières souligne cependant que chez Renault Group, même si les changements de gouvernance et la nécessaire adaptation à de nouveaux contextes ont modifié les priorités de transformation du groupe, la poursuite d’une démarche responsabilisante est restée un levier actif et mobilisateur dans le cadre des développements véhicules.
Les organisations dans lesquelles l’actionnariat est stable, les successions sont préparées très à l’avance, et où le nouveau dirigeant est choisi au sein du sérail de l’entreprise, présentent une meilleure continuité et sont moins exposées à ce type de risque, sans pouvoir totalement s’en prémunir.
L’instabilité du personnel est également un facteur de discontinuité. Dans certains cas, la stabilité peut être contrée par des facteurs générationnels, comme des départs à la retraite massifs. Dans d’autres, c’est la mobilité des cadres (système de gestion des carrières) qui représente un facteur structurel d’instabilité. Ainsi, un bon directeur de site industriel sera inévitablement aspiré par le siège, et les bons managers seront mutés tous les trois ou quatre ans environ. Les « nouveaux » n’auront peut-être ni la même sensibilité, ni le même goût pour la complexité, et tout sera à recommencer.
Il est cependant possible de contrer ces effets perturbateurs, en réunissant certaines conditions de pérennisation. D’abord, parce que la transformation vers une OR est une transformation complexe qui nécessite beaucoup de leadership, de connaissances et de réflexion, il sera bon que la cellule support, que nous avons évoquée au lancement de la transformation, soit pérennisée dans son rôle de réflexion et de stimulation sur une longue durée. Ce ne sera pas obligatoirement une équipe dédiée, mais plutôt une coalition de personnes sources qui assureront la continuité des intentions et des réalisations. Cette cellule pourra également créer des passerelles avec d’autres entreprises ou avec des centres de recherche sur l’innovation managériale, de manière à essaimer autant que possible le modèle responsabilisant.
Mais la pérennisation sera avant tout stimulée par un Comex exemplaire sur ce sujet. Si le Comex n’est pas lui-même en mouvement, il devra au moins assurer un sponsoring à haut niveau, et en continu, de la responsabilisation. Sans ce soutien, les avancées obtenues à partir d’initiatives locales risquent fort de ne jamais passer à l’échelle. Sans soutien et en considérant le taux de rotation des managers et des équipes, la tendance globale dans la durée risque d’être plutôt une régression vers un modèle plus classique. Cela peut s’expliquer par la contradiction inhérente existant entre standardisation et subsidiarité (voir encadré ci-contre).
Subsidiarité versus standardisation : une contradiction difficile à gérer
Beaucoup d’entreprises manufacturières construisent leur avantage compétitif sur l’excellence opérationnelle de leurs processus et la supériorité de leurs produits. Cet avantage s’entretient grâce aux capacités des services de R&D et du bureau d’étude d’une part, de leur bureau des méthodes industrielles d’autre part, ce qui explique en partie les avantages liés à la taille et le mouvement de consolidation (mutualisation de coûts de développement et d’industrialisation croissants). Les entreprises qui pratiquent le lean améliorent encore leurs standards, grâce à l’implication des opérateurs. Lorsque ceux-ci surmontent une difficulté et inventent une manière plus efficace de produire, cette amélioration est intégrée aux standards de l’entreprise et chaque unité en bénéficie. L’efficacité globale provient donc essentiellement de la standardisation de leur Manufacturing Way.
La subsidiarité, en revanche, consiste à laisser les opérateurs adapter le système à leur contexte. Ils peuvent alors s’éloigner du standard pour mettre en œuvre une méthode qui leur convient mieux, compte tenu des caractéristiques locales, mais qui n’est pas forcément adaptée à d’autres contextes. La subsidiarité valorise les personnes qui font, mais oblige à renoncer à certains avantages de la standardisation. Un ingénieur muté d’un site à un autre ne pourra pas appliquer à l’aveugle les méthodes et les procédures qui ont fonctionné dans son poste précédent.
Il y a donc une tension au sein des directions industrielles entre les objectifs de subsidiarité et les objectifs de standardisation. Cette tension rend difficile la diffusion et la généralisation d’initiatives qui se sont avérées très satisfaisantes dans un contexte donné. Par exemple, telle unité de fabrication est fière de gérer elle-même la répartition des primes accordées par la direction, mais une autre unité du même site qui n’a pas construit le même niveau de confiance entre ses membres préférera laisser à la hiérarchie ou aux RH cette décision. Telle direction de site souhaitant motiver sa main-d’œuvre ne fera pas les mêmes choix qu’une autre plus soucieuse d’atteindre rapidement une meilleure performance en intégrant les meilleurs standards du groupe.
Si la direction accorde une attention intermittente aux objectifs de subsidiarité et aux bénéfices de la standardisation, ou ne pondère pas ces objectifs de la même façon selon les usines et les pays, la diffusion des démarches de responsabilisation et d’autonomie sera compliquée. Le management intermédiaire subira des injonctions contradictoires (laissez-leur la main, mais veillez à ce qu’ils appliquent les processus optimaux).
Par ailleurs, le risque pour un Comex est de retomber dans la facilité des injonctions managériales, c’est-à-dire des prescriptions de comportement faites aux managers sans aucune dimension de redevabilité. La responsabilisation sera progressivement noyée dans le millefeuille des compétences dont le manager est supposé témoigner à titre personnel, à rebours complet de son caractère structurant et systémique. L’entreprise « choisit la voie individuelle et occulte la part collective du travail » (Leonard, 2023), part qui était tout l’enjeu de la démarche de responsabilisation.
La pérennisation de l’OR demande aussi de récompenser la responsabilisation et de sanctionner la passivité. Or, les directions gèrent souvent la responsabilisation comme un plus, un nice to have, qui n’entre pas explicitement en ligne de compte dans les systèmes de reconnaissance des acteurs. La passivité de certains sur le sujet ne porte pas à conséquence sur leur carrière et leur rémunération. Le système de reconnaissance reste alors uniquement basé sur les résultats de performance à court terme (le must have). La nature à moyen-long terme du projet de responsabilisation nécessite de construire des indicateurs qui valorisent cette dimension.
Il est enfin primordial de s’assurer que les managers de proximité ont compris leur nouveau rôle, qu’ils sont réellement accompagnés dans la durée, qu’ils sont disponibles pour accompagner leurs équipes et qu’ils ne sont pas en souffrance. Les managers de proximité se trouvent souvent face à un problème de carrière insidieux : ils doivent tenir suffisamment longtemps pour valider cette étape de leur carrière, puis partir ailleurs pour progresser. Ce système de carrière est en contradiction évidente avec l’objectif de maintenir une certaine stabilité du corps managérial pour pérenniser la responsabilisation. Il y a donc un contrat à passer avec les managers sur la durée de leur engagement au service de la responsabilisation. Gérer les plans de succession avec le plus d’anticipation possible permettrait en outre d’assurer un passage de témoin en binôme et un recouvrement des savoirs et des savoir-faire nécessaires à la responsabilisation. Les effets des méthodes d’accompagnement sur les comportements des managers peuvent être mesurés par des KBI (Key Behavior Indicators). Ces indicateurs très simples sont basés sur des données observables (des faits). Ils jouent un rôle de miroir pour les bénéficiaires du coaching, leur permettant de mesurer leur propre évolution : au fait, pendant ma tournée de terrain, combien de signes de reconnaissance positifs ou négatifs ai-je donnés ? Combien d’engagements ai-je obtenus sans substitution ? Intégrer ces KBI dans l’évaluation qualitative des managers devient un facteur de leur engagement dans le processus de responsabilisation.
En résumé
- 30. Il s’agit des avis des membres du groupe de travail présentés en introduction.
- 31. Mot japonais signifiant « grande salle ».
Conclusion
Au terme de ce voyage en responsabilisation, qu’avons-nous appris ?
D’abord, pour conduire une exploration de ce type, une boussole est bien utile. Celle-ci peut être construite sur cinq principes qui font système : responsabilité, subsidiarité, solidarité, collégialité et activité. En s’appropriant chacun de ces principes, l’entreprise peut construire une vision et suivre la maturation de sa transformation. En effet, une transformation équilibrée doit assurer une évolution de chacun de ces cinq piliers.
Les exemples de Lippi, de Martin Technologies et de Michelin nous ont ensuite enseigné plusieurs fondamentaux sur le « comment » conduire le changement. Les transformations de ces entreprises se caractérisent par leur longue durée (entre dix et vingt ans). Il faut donc considérer le temps long comme un allié indispensable de ce type de démarche. Nous avons tenté, à partir de ces exemples, de dégager un vade-mecum sous la forme d’un itinéraire conseillé qui suit une séquence de transformation en trois phases : impulsion du dirigeant et de son équipe de tête, embarquement du corps social, puis refonte participative et progressive de l’organisation. En réalité, les exemples montrent qu’une transformation globale est constituée de plusieurs cycles répétés de ces trois phases. Le retour d’expérience d’un cycle préparera l’impulsion du cycle suivant. La phase d’embarquement doit être répétée lors de chaque élargissement de la transformation à un nouveau périmètre de l’organisation et, bien entendu, à chaque nouveau cycle de transformation. Et cet embarquement ne doit pas se résumer à une communication descendante, mais doit déjà intégrer la construction collective de la phase de refonte qui le suivra. C’est à cette condition que l’on pourra concrètement embarquer les équipes.
La transformation globale vers une organisation responsabilisante n’est jamais un projet balisé, elle est une émergence progressive dont le résultat « final » reste en partie indéterminé. Chaque exploration est propre à l’entreprise qui l’a initiée. Elle va dépendre de sa culture, de son histoire, de son secteur d’activité, de sa population, de ses actionnaires, du tempérament de son dirigeant. Si le résultat du voyage et les étapes restent en partie indéterminés, il ne faut cependant pas renoncer à le préparer. Vous avez la voiture et la carte du territoire ; vous n’avez pas entièrement fixé les étapes du voyage et, comme la carte n’est pas le territoire, la configuration du terrain va vous surprendre, vous allez parfois vous perdre, parfois décider de vous attarder un peu plus dans ce joli village ou encore fuir rapidement un lieu que vous aviez pourtant imaginé comme idyllique. C’est pourquoi, nous avons parlé à propos de cette transformation d’exploration dirigée. Elle naît de la volonté d’une ou de plusieurs personnes « source », elle obéit à des principes qu’il faut connaître et elle suit un chemin, même si celui-ci est rarement une ligne droite. C’est certes un saut dans l’inconnu mais nous espérons vous avoir fourni un bon parachute.
Aujourd’hui, l’entreprise responsable est au cœur de l’actualité. Il s’agit d’une entreprise consciente de l’impact environnemental et social de son activité, qui décide de se mettre en mouvement pour maîtriser ses impacts et contribuer positivement aux objectifs du développement durable. Cette orientation est de moins en moins optionnelle, car la pression réglementaire qui s’exerce sur les entreprises augmente fortement dans ce domaine32. Comment devenir une entreprise responsable ? Nous sommes convaincus – et ne sommes pas seuls à l’être – qu’elle s’appuiera de plus en plus sur la responsabilisation des salariés. Le temps où la RSE était l’apanage de la seule direction du développement durable est révolu. C’est toute l’organisation qui doit être mobilisée (Bobin et al., 2023), et la meilleure manière d’y parvenir est de responsabiliser les salariés à ce sujet (Cournarie et Guenyveau, 2020). Une démarche de responsabilisation n’est donc pas seulement porteuse d’engagement des salariés et d’efficacité de leur mission principale, elle est aussi un support important pour mobiliser progressivement tout le corps social autour de l’impact social et environnemental de l’entreprise.
- 32. Voir par exemple la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) qui fixe de nouvelles normes et obligations de reporting extrafinancier fondé sur les données ESG. Elle concerne les grandes entreprises et les PME cotées en bourse. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 pour une application entre 2025 et 2027 selon le type d’entreprise considéré.
Bibliographie
Ballarin, B. (2017). À la recherche d’un nouveau modèle d’organisation et de management chez Michelin. Le journal de l’École de Paris du management, n° 126, pp. 38-44. https:// doi.org/10.3917/jepam.126.0038
Ballarin, B. (2019). La responsabilisation appliquée à Michelin. In Bourdu, É., Lallement, M., Veltz, P., & Weil, T. (dir.) (2019). Le travail en mouvement (Colloque de Cerisy). Presses des Mines, pp. 127-135.
Baudoin, R. (éd.) (2012). L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales. Collège des Bernardins. Réédité en 2019.
Béziat, F., & Nancy, H. (2023). Nous les ouvriers [Documentaire]. https://www.france.tv/france-2/nous-les-ouvriers/
Bobin, É., Lambert, S., & Petitbon, F. (2023). Il n’y a pas d’entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Au-delà de la RSE. Vuibert.
Bourguinat, É. (2019). De la clôture à l’esprit libre. La transformation de l’entreprise Lippi. Presses des Mines.
Burns, T., & Stalker, G. M. (1961). The Management of Innovation. Tavistock Publications.
Canguilhem, G. (2002). Écrits sur la médecine. Seuil.
Canivenc, S. (2022). Les nouveaux modes de management et d’organisation. Innovation ou effet de mode ? Les Notes de La Fabrique, Chaire FIT2, Presses des Mines.
Canivenc, S. (2024). Les jeunes, des travailleurs comme les autres. Comment les entreprises peuvent-elles mieux répondre aux attentes des salariés ? Chaire FIT2, Presses des Mines.
Chaire FIT2 (2022a). Renforcer l’autonomie du terrain dans les PME : le programme Tech’Care du Cetim. Repère Futurs du travail, n° 7, mai 2022.
Chaire FIT2 (2022b). Le radar de l’autonomie. Working Paper n° 1, 20 février 2022.
Chaire FIT2 (2021). Entretien avec F. Menegaux : « Être un leader, c’est donner le pouvoir à ses équipes ». Repère Futurs du travail, n° 3, Chaire FIT2, décembre 2021.
Clot, Y. (2019). Les conflits de la responsabilité. In Bourdu, É., Lallement, M., Veltz, P., & Weil, T. (dir.) (2019). Le travail en mouvement (Colloque de Cerisy). Presses des Mines, pp. 112-121.
Clot, Y. avec Bonnefond J.-Y., Bonnemain A., & Zittoun M. (2021). Le prix du travail bien fait. La Découverte.
Cournarie, T., & Guenyveau, F.-R. (2020). La responsabilisation des salariés est la pierre angulaire de la responsabilité de leur entreprise. In Weil, T., & Dubey, AS (2020), Au-delà de l’entreprise libérée. Enquête sur l’autonomie et ses contraintes. Presses des Mines, pp. 143-146.
Coutrot, T., & Perez, C. (2022). Redonner du sens au travail. Une aspiration révolutionnaire. coll. La République des idées, Seuil.
Deci, E. L., Ryan, R. M. (1996), Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, coll. « Perspectives in social psychology », Plenum Press.
Detchessahar, M. (coord.) (2019). L’entreprise délibérée. Refonder le management par le dialogue. Coll. Racines, Nouvelle Cité.
Edmondson, A. C. (2018). The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth. Wiley. Traduit en langue française : L’entreprise sereine. La sécurité psychologique, levier d’une organisation performante, apprenante et innovante. Pearson, 2022.
Ellul, J. (2012). Le système technicien. Coll. Documents, Le cherche midi.
Forment, V., & Vidalenc, J. (2020). Les ouvriers : des professions toujours largement masculines. Insee Focus, n° 199, 24 juillet 2020. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4634325
Forsyth, D. R. (2006). Group Dynamics (4e ed.). Belmont CA: Thomson Wadsworth Publishing.
Freeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.
Frixon, J.-M. (2021). Michelin, matricule F276710. Nombre 7 éditions.
Frixon, J.-M. (2023). L’ouvrier qui murmurait à l’oreille des cadres. Nombre 7 éditions.
Gomez, P.-Y. (2023). La subsidiarité, retour vers le futur (La sociétalisation, épisode 6) [Blog], 28 avril 2023. https://pierre-yves-gomez.fr/la-subsidiarite-retour-vers-le-futur-la-societalisation-episode-6/
Insee (2023). Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie – avril 2023. Informations rapides, n° 99. https://www.insee.fr/fr/statistiques/7456565
Institut de l’Entreprise (2023). Baromètre de la relation des Français à l’entreprise (3e vague), réalisé avec le cabinet d’études et de conseil ELABE en partenariat avec Malakoff Humanis et Veolia.
Jochem, J., Lefèvre, H., & Kéa & Partners (2014). Le mix organisation. Et si l’entreprise mobilisait enfin l’énergie naturelle de l’autonomie ? Eyrolles.
Katzenbach, J. R., & Smith, D. K. (1993). The wisdom of teams : Creating the high-performance organization. Harvard Business School Press. Traduction : Les équipes haute performance. Imagination et discipline. Dunod, 1994.Laborde, O. (2023). Quand sécurité psychologique rime avec performance. Harvard Business Review France, 27 novembre 2023.
Lebrun, P.-B. (2015). La responsabilité. Empan, 2015/3, n° 99, pp. 105-109. https://www.cairn.info/revue-empan-2015-3-page-105.htm?contenu=article
Leonard, D. (2023). Accompagner la responsabilisation : l’intervention ergonomique comme mise en dialogue des aspirations et prescriptions d’autonomie. Activités [En ligne], vol. 20, n° 1. https://journals.openedition.org/activites/8250
Lusteau, J. (2021). Donnez du sens à vos décisions. La clé de d’agilité stratégique des entreprises. Mardaga.
Merckelbach, S. (2020). Un petit livre rouge sur la source. Un regard inspirant et libérateur sur le management et la vie grâce aux « principes source ». Éditions Aquilae.
Meyronin, B., & Ditandy, C. (2007). Du management au marketing des services. Redonner du sens aux métiers de services. Dunod.
Morin, E. (1980). La Méthode 2. La vie de la vie. Seuil.
Nivet, B. (2019). Malaise dans le management. In Bourdu, É., Lallement, M., Veltz, P., & Weil, T. (dir.). (2019). Le travail en mouvement (Colloque de Cerisy). Presses des Mines, pp. 160-167.
OpinionWay pour Kéa (2023). Les jeunes Français, la valeur du travail et l’entreprise. Décembre 2023.
Pellerin, F., & Cahier, M.-L. (2019). Organisation et compétences dans l’usine du futur. Vers un design du travail ? Les Notes de La Fabrique, Chaire FIT2, Presses des Mines.
Pellerin, F., & Cahier, M.-L. (2021). Le design du travail en action. Transformation des usines et implication des travailleurs. Les Notes de La Fabrique, Chaire FIT2, Presses des Mines.
Picard, H. (2015). « Entreprises libérées », parole libérée ? Lectures critiques de la participation comme projet managérial émancipateur [Thèse]. Université Paris-Dauphine.
Ringelmann, M. (1913). Recherches sur les moteurs animés. Travail de l’homme. Annales de l’Institut national agronomique, vol. 12, pp. 1-40. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54409695.image.f14.langEN
Segrestin, B., & Hatchuel, A. (2012). Refonder l’entreprise. Coll. La République des idées, Seuil.
Serre, B. (2021). Après la raison d’être, la raison de venir ? [Séminaire]. École de Paris du management, 10 décembre 2021. https://www.ecole.org/fr/seance/1485-apres-la-raison-detre-la-raison-de-venir
Tesi, F. (2008). Michelin et le taylorisme. Histoire, économie & société 2008/3, pp. 111-126 https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2008-3-page-111.htm
Tonnelé, A. (2023). Rendre les collaborateurs plus autonomes : pourquoi les entreprises tournent en rond. LinkedIn, 12 septembre 2023.
Weil, T., & Dubey, A-S. (2020). Au-delà de l’entreprise libérée. Enquête sur l’autonomie et ses contraintes. Les Notes de La Fabrique, Chaire FIT2, Presses des Mines.
Weil, T. (2008). Stratégie d’entreprise. Presses des Mines.
Zielinski, A. (2010). L’éthique du care. Une nouvelle façon de prendre soin. Études, 2010/12, tome 413, pp. 631-641.
Zobrist, J.-F. (2020). L’entreprise libérée par le petit patron naïf et paresseux. Le cherche midi.
Annexe – La recette de la transformation responsabilisante
Testez la recette de la « mayonnaise de la transformation responsabilisante », créée en exclusivité par Frédéric d’Arrentières (Renault Group), et faites-nous part de vos impressions.
Les ingrédients
- Des compétences collectives
- Une vision partagée/alignée (le client pouvant jouer ce rôle…)
- Une volonté de changement/de l’exemplarité
- De la co-construction
- Du sponsorship et de l’accompagnement
- De la méthode et du temps
- Un socle de valeurs communes
- Un terrain de jeu
La recette
« Installez-vous sur le socle des valeurs communes de votre organisation, et dans un saladier organisationnel, constituez des équipes suffisamment compétentes et d’origine contrôlée, ajoutez une bonne dose de sponsorship, intégrez le sel de la vision partagée, embarquez les équipiers et les parties prenantes et dotez-vous d’une équipe d’accompagnement.
Mélangez l’ensemble en continu jusqu’à établir une émulsion coconstruite avec les équipes. Montrez l’exemple et testez régulièrement le résultat en modifiant si besoin les dosages, entretenez régulièrement la mayonnaise une fois montée en l’adaptant le cas échéant aux goûts des équipes, aux difficultés du terrain et aux retours des clients et en mobilisant le management intermédiaire, sachez passer le relais en cuisine auprès des équipes de progrès permanent sur le long terme. »
Organisation responsabilisante : de l’idée à la réalisation
Pierre Bocquet et François Pellerin, Organisation responsabilisante : de l’idée à la réalisation, Paris, Presses des Mines, 2024.
ISBN : 978-2-38542-587-6
ISSN : 2495-1706
© La Fabrique de l’industrie
81, boulevard Saint-Michel – 75005 Paris – France
info@la-fabrique.fr
www.la-fabrique.fr